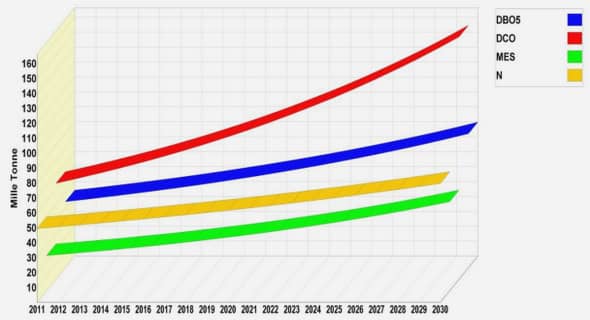Handicap
La principale conséquence des symptômes évoqués ci-dessus est l’apparition progressive d’un handicap. En effet, dans la majorité des cas, la SEP aboutit à plus ou moins long terme à un handicap principalement moteur, le délai médian avant une aide à la marche étant de 20 à 25 ans (24,25). Huit systèmes fonctionnels permettent de caractériser ce handicap : quatre majeurs (fonction pyramidale, fonction cérébelleuse, fonctions du tronc cérébral et fonction sensitive) et quatre mineurs (fonctions sphinctérienne et intestinale, fonction visuelle, fonction cérébrale ou mentale et autres fonctions) (Annexe A). Les quatre systèmes majeurs font référence principalement à l’appareil locomoteur, à la coordination des mouvements et aux troubles sensitifs. En complément les systèmes mineurs concernent les troubles liés aux appareils urinaire et intestinal, à la vision, à la capacité de réflexion et aux autres perturbations neurologiques pouvant être attribuées à la SEP. Afin de quantifier le handicap lié à la SEP, l’échelle EDSS (Expanded Disability Status Scale) a été développée par Kurtzke à partir de 1983 (26). Cette dernière est basée sur l’évaluation de chacun des huit systèmes fonctionnels précédents et conduit selon le niveau d’atteinte des systèmes à un score allant de 0 à 10 (Figure 4). Les points de repère sur cette échelle sont le score 0 correspondant à un examen neurologique normal, 6 signifiant le besoin d’une aide unilatérale à la marche (canne, béquille, canne anglaise), et 10 le décès du patient à cause de la SEP (27). Les systèmes fonctionnels étant majoritairement liés aux troubles locomoteurs, le score EDSS reflète principalement le handicap moteur dont la limitation du périmètre de marche des personnes atteintes de la SEP.
Traitements
Traitements de fond
Actuellement la SEP est une maladie pour laquelle aucun traitement curatif n’est disponible. Pendant longtemps, seuls des traitements des symptômes de la maladie et non de la maladie elle-même ont été délivrés aux patients. Grâce aux progrès de la médecine, des traitements spécifiques à la SEP ont été disponibles à partir du milieu des années 1990. Ainsi, les interférons ont été les premiers traitements approuvés en France à partir de 1995. Ces traitements de fond visent à diminuer la fréquence des poussées et à limiter le handicap. Agissant sur l’inflammation, ils sont prescrits majoritairement pour les SEP rémittentes, alors qu’il n’existe à l’heure actuelle qu’un seul traitement pour la SEP progressive primaire uniquement ayant reçu une autorisation de mise sur le marché (AMM) en France permettant sa commercialisation.
Durant les dernières décennies, l’arsenal thérapeutique, à prescription réservée uniquement aux neurologues, s’est considérablement élargi. Au total, 13 médicaments spécifiques à la maladie sont disponibles en 2018, certains étant délivrés à l’hôpital uniquement, d’autres en ville dans les pharmacies (Figure 5 et Annexe B). Ces traitements peuvent être classés selon leur voie d’administration (injectable, orale ou en perfusion), leur mécanisme d’action (immuno-modulateur ou immuno-suppresseur) et leur ordre dans la séquence thérapeutique, formée de l’ensemble des traitements pris successivement par un patient (première ligne, deuxième ligne et troisième ligne).
Ainsi, en première ligne, des immuno-modulateurs, ayant pour but de réguler le système immunitaire, délivrance en officine, peuvent être prescrits. Ces derniers se présentent sous forme injectable et sont présents sur le marché pour certains depuis plus de vingt ans. Ils ont pour substance active les interférons bêta-1a (Avonex® et Rebif®) ou bêta-1b (Betaferon® et Extavia®), ou encore l’acétate de glatiramère (Copaxone®). Afin d’améliorer la qualité de vie des patients et limiter les effets secondaires liés aux injections, de nouveaux traitements sont arrivés sur le marché depuis 2013. Ainsi, les derniers traitements ayant obtenu une AMM en 2013 et 2014 sont sous forme de gélule, donc orale, comme le diméthyl fumarate (Tecfidera®) et le teriflunomide (Aubagio®) ou sous forme injectable seulement deux fois par mois (peginterféron bêta-1a (Plegridy®)), contre des injections quotidiennes ou pluri-hebdomadaires pour les interférons.
Des traitements immuno-suppresseurs administrés oralement utilisés dans d’autres maladies chroniques telles que la polyarthrite rhumatoïde ou le cancer, et donc non spécifiques à la SEP,
peuvent également être prescrits en première ligne, et ont alors comme substance active l’azathioprine (Imurel®), le méthotrexate (Methotrexate®) ou le mycophénolate mofétil (Cellcept® et génériques). Ces trois médicaments sont prescrits hors AMM dans le cadre de la SEP. Ces médicaments ont été fortement prescrits en France des années 70 aux années 90 mais le sont beaucoup moins à l’heure actuelle (en termes d’initiation tout du moins).
Pour des SEP actives avec un nombre important de lésions, ou lorsqu’un traitement de première ligne ne fait pas effet, un traitement de seconde ligne peut-être proposé. D’un côté, le Gilenya®, se présentant sous forme orale et ayant pour substance active le fingolimod, est le seul délivré en pharmacie. De l’autre, le natalizumab (Tysabri®), l’alemtuzumab (Campath®) et le rituximab (Mabthera®), ce dernier étant non spécifique à la SEP, sont prescrits en perfusion à l’hôpital par voie intraveineuse. Enfin, en cas de SEP agressive, le traitement par mitoxantrone (Novantrone® puis Elsep®) peut être proposé en milieu hospitalier. Par ailleurs, plusieurs autres traitements sont en attente d’AMM en France et/ou en autorisation temporaire d’utilisation (ATU), comme le Lemtrada® ayant pour substance active l’alemtuzumab ou encore la biotine (Quizenday®), l’ocrelizumab (Ocrevus®) et la cladribine (Mavenclad®).
Le conditionnement de l’ensemble des traitements de fond de la SEP est tel qu’une boîte correspond à un mois de traitement avec un prix variant de 700 € à près de 2000 € la boîte.
Séquences thérapeutiques
La grande variété de traitements de fond disponibles entraîne de plus nombreux changements de traitements, appelés également switches, qu’au début des années 90 où un patient pouvait rapidement se trouver en échec thérapeutique, c’est-à-dire ne répondant à aucun traitement disponible. Les raisons principales de ces switches sont 1) la tolérabilité du traitement avec l’apparition ou non d’effets secondaires et 2) l’inefficacité du traitement, correspondant à la progression de la maladie avec l’apparition ou la résurgence de nouvelles plaques sur l’imagerie (28). L’arrêt peut aussi correspondre un choix du patient, pour lui permettre une amélioration de sa qualité de vie ou à la survenue d’une grossesse (29). La majorité des traitements de fond disposant de l’AMM ne nécessitent pas une période de wash-out, c’est-à-dire une période sans aucun traitement, permettant un switch immédiat entre traitements, excepté le teriflunomide (29). En effet, pour ce dernier, une procédure d’élimination base de charbon actif existe, la demi-vie du principe actif étant très longue.
Dépendant de la sévérité et de l’avancée de la maladie, deux stratégies thérapeutiques principales
peuvent être envisagées dans le traitement de la SEP : l’escalade thérapeutique et l’induction (28–31) (Figure 6). La première consiste en un début de traitement avec un immuno-modulateur de première ligne, suivi d’un traitement de seconde ligne, puis de troisième ligne dans une dernière mesure, dans le cas d’une faible efficacité sur la progression de la maladie. La stratégie d’induction emprunte le chemin inverse, c’est-à-dire un premier traitement immunosuppresseur (de troisième ligne) suivi d’un traitement de seconde et/ou de première ligne (31). Contrairement à l’escalade thérapeutique, l’induction est beaucoup moins fréquente et reste réservée à des situations bien particulières.
Effets secondaires des traitements de fond
Les traitements de fond disponibles à l’heure actuelle présentent comme tout traitement des effets indésirables pouvant être plus ou moins graves selon les principes actifs (29). Ainsi, les interférons ont pour effet secondaire principal un syndrome grippal suivant l’injection, les traitements oraux pouvant causer des nausées et douleurs abdominales, notamment pour le diméthyl fumarate, et la perte de cheveux concernant le teriflunomide. Les traitements de seconde et de troisième ligne entraînent quant à eux des effets indésirables semblables à ceux provoqués par les chimiothérapies.
Concernant les effets indésirables graves, pour les plus anciens traitements comme les interférons ou l’acétate de glatiramère, le recul et le nombre de patients traités en vie réelle sont suffisamment importants pour quantifier le risque et ainsi adapter les modalités de prescription, de suivi et de prise en charge. Ceci n’est pas le cas pour les traitements plus récents, pour lesquels quelques événements graves et rares ont été documentés (par exemple, 15 cas de LEMP (leucoencéphalopathie multifocale progressive) ont été observés suite à un traitement par fingolimod, alors que cet évènement indésirable grave n’a jamais été observé dans les essais thérapeutiques (15 cas sur 217 000 patients traités au 31 août 2017)) (32). Le fingolimod peut également entraîner des troubles du rythme cardiaque pouvant conduire au décès du patient. Le teriflunomide, quant à lui, peut conduire à des lésions hépatiques et est à fort risque tératogène, c’est-à-dire dangereux pour le fœtus dans une grossesse, nécessitant l’utilisation de la procédure d’élimination accélérée. A ce jour, ces deux molécules orales ainsi que la troisième (le diméthyl fumarate) font l’objet d’un plan de gestion de risques (PGR) à la demande des autorités de santé.
Traitements des poussées
Lors d’une poussée, un traitement peut être administré après confirmation diagnostic par un neurologue (33). Actuellement, le seul traitement est la délivrance de corticoïdes à forte dose. Ces derniers étant des anti-inflammatoires, ils permettent une diminution de l’intensité, de la gravité et de la durée de la poussée et peuvent accélérer la récupération suite à celle-ci. La posologie fréquemment utilisée est de 1g/jour de méthylprednisolone sur 3 à 5 jours consécutifs. Plusieurs modes d’administration du traitement sont désormais possibles : en bolus en intraveineuse à l’hôpital, avec le Solumedrol® 1000 mg, ou alors per os, avec du Medrol® 100 mg (34). Il est également possible d’effectuer des échanges plasmatiques, au nombre de 5 à 6 et s’étalant sur 2 à 3 semaines. Mais ce traitement est beaucoup moins fréquent avec seulement 5 à 10 patients par an par CHU (Centre Hospitalier Universitaire).
Traitements symptomatiques
En parallèle des traitements de fond de la SEP, des traitements symptomatiques peuvent être prescrits. Ils peuvent être délivrés tout au long de la maladie qu’importe la phase de cette dernière et traitent principalement les séquelles des poussées.
Traitements pharmacologiques
Un seul traitement pharmacologique est disponible sur le marché pour lutter contre les troubles de la marche, la fampridine (Fampyra®) (35). Son principe actif permet à l’influx nerveux de se propager pour stimuler les muscles et ainsi améliorer la marche. Le baclofène (Lioresal®) et le dantrolène (Dantrium®) sont deux molécules per os utilisées contre la spasticité (15,35,36). En cas d’échec de ces traitements, la tizanidine (Sirdalud®), en ATU uniquement, peut être délivrée (36). Lorsque la spasticité est localisée, des injections de toxine botulique peuvent être prescrites, alors que lorsqu’elle est diffuse et à partir d’un EDSS important (EDSS>7) le baclofène peut être administré par voie intrathécale au moyen d’une pompe implantée chez le patient avec rechargement de la substance active à l’hôpital (15,36). Les troubles sensitifs, notamment les douleurs neurologiques, peuvent être traités avec des spécialités anti-épileptiques (gabapentine, prégabaline, carbamazépine) ou anti-dépressives (duloxétine, amitriptyline) (35,36). Les anticholinergiques sous forme orale sont utilisés pour lutter contre les symptômes urinaires, comme l’oxybutynine ou la solifénacine dans le cadre de l’hyperactivité vésicale (incontinence), et les alpha-bloquants comme la tamsulosine dans le cadre de rétention urinaire due à des problèmes sphinctériens (15,35,36). Si les symptômes persistent, des injections intra-vésicales de toxine botulique peuvent être envisagées. Concernant les troubles intestinaux et sexuels, les traitements principalement proposés sont des laxatifs et des traitements du trouble de l’érection, respectivement (36).
Traitements non-pharmacologiques
En complément de médicaments, des traitements non-pharmacologiques peuvent être proposés aux patients (15,35,36). Ces derniers sont majoritairement proposés par les spécialistes de médecine physique et de réadaptation (MPR) au vu des symptômes présentés. Ainsi, des séances de kinésithérapie peuvent être prescrites pour lutter contre la spasticité ou les troubles de la marche. Des bains froids, ou des vestes réfrigérantes peuvent permettre de lutter contre les troubles sensitifs et la spasticité. Lorsque les troubles urinaires deviennent trop importants et que l’évacuation naturelle de l’urine n’est plus possible, le passage à l’auto-sondage peut être envisagé. De même, lorsque les troubles moteurs deviennent handicapants, des aides techniques à la marche (canne, déambulateur, véhicules pour handicapé physique (VHP) manuel ou électrique, ….) peuvent être prescrites. Des recours à des ergothérapeutes peuvent également être envisagés afin d’orienter le patient dans sa vie quotidienne et d’aménager son domicile. Enfin, des stages dédiés à la gestion de la fatigue sont proposés par certains réseaux de soins spécialisés dans la SEP afin de permettre aux patients touchés de partager leur expérience.
Epidémiologie
Environ 2,3 millions de personnes ont une SEP dans le monde (37). Cette maladie affecte plus de femmes que d’hommes avec un sex-ratio de 2 à 2,5 femmes pour 1 homme (38–40). La SEP se déclare principalement chez le jeune adulte, âgé de 20 à 40 ans, il s’agit de la première cause de handicap non liée à un accident traumatique dans cette classe de la population (14). La maladie ne diminue en moyenne que de sept ans l’espérance de vie par rapport à la population générale (41), ce qui en fait une maladie au long cours.
La SEP est présente sur l’ensemble du globe, mais sa prévalence varie fortement selon la région (42). En France, deux études récentes ont estimé la prévalence de la SEP selon différents algorithmes de sélection des cas. Ainsi, en 2010, Fromont et al. ont estimé une prévalence française de 94.7 malades pour 100 000, soit 49 417 personnes atteintes, au 31 octobre 2004, en identifiant les cas au moyen du statut d’affection de longue durée (ALD) uniquement (43). Plus récemment, Foulon et al. ont évalué, quant à eux, la prévalence à 151.2 cas pour 100 000, soit 99 123 personnes touchées, au 31 décembre 2012 (40). Dans cette dernière étude, les cas ont été identifiés à partir de l’ALD, mais aussi des traitements de fond spécifiques à la SEP et des diagnostics relatifs aux séjours hospitaliers, permettant une identification plus importante des cas comparativement à la première étude. Ces deux études, ainsi qu’une étude plus ancienne de Kurtzke et al., montrent un gradient décroissant Nord-Est/Sud-Ouest en France (40,43,44). Quelques études ont été réalisées sur l’incidence de la SEP en France aux niveaux national et régional. La dernière au niveau national, effectuée sur les données d’ALD de l’Assurance Maladie, fait état d’une incidence de 7,5 pour 100 000 sur l’année 2004 (45). Deux études ont été réalisées au niveau régional, une en Bretagne et une en région Lorraine toutes deux basées sur des données issues de registres régionaux (46,47). L’étude lorraine estimait en 2008 une incidence brute de 4,4 pour 100 000 réévaluée à 8,5 pour 100 000 grâce à une méthode de capture-recapture appliquée sur les données du registre Lorrain (LORSEP – Réseau Lorrain pour la prise en charge de la Sclérose en Plaques) (47). L’étude bretonne avait quant à elle trouvé une incidence brute similaire de 4,3 pour 100 000 en 2000-2001 (46).
Etiologie
L’étiologie de la SEP reste pour une grande part inexpliquée, mais il est admis qu’il s’agit d’une maladie multifactorielle (48), dont on peut regrouper les causes en deux catégories majeures. D’un côté, la SEP peut toucher plusieurs membres d’une même famille, suggérant une origine génétique. En effet, des études menées sur des jumeaux et des fratries ont montré une augmentation du risque de développer la maladie si un des membres l’avait (49,50). De plus, de nombreux gènes semblent être liés à la maladie, les majeurs étant dans la région HLA du chromosome 6 jouant un rôle dans la gestion de l’immunité, mais d’autres d’ordre mineur ont été identifiés ailleurs dans le génome (51,52).
De l’autre, la variation importante de la prévalence de la SEP dans le monde suppose un rôle de l’environnement dans son étiologie (42). Une des causes environnementales probables, proposée dès 1974, est un déficit en vitamine D, dont la production est liée à l’exposition au soleil (53,54). En outre, d’autres facteurs environnementaux semblent augmenter le risque de déclencher la maladie, comme une infection au virus Epstein-Barr, appartenant à la famille des herpès, ou encore la consommation de tabac (55–58).