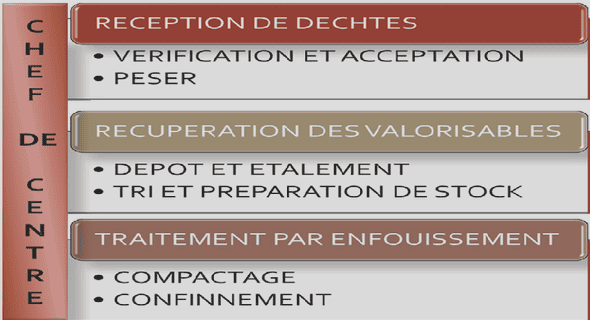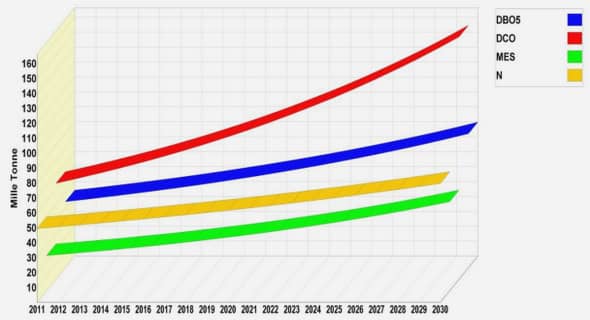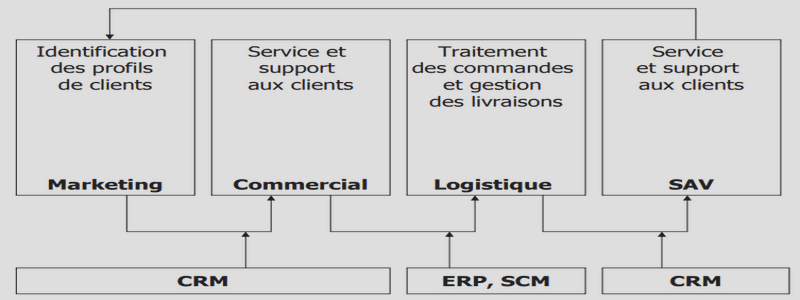Un Chhattisgarh : un Etat englobé mais distinct (carte 1)
Avant de devenir un Etat à part entière, le premier novembre 2000, le Chhattisgarh a fait partie dʼune région beaucoup plus vaste en superficie, tout dʼabord les Provinces Centrales, puis le Madhya Pradesh.
Le Chhattisgarh existait donc, mais il était inséré dans les « Provinces Centrales », «Central Provinces » en anglais, créées en 1861 par les Britanniques. Puis, juste après lʼIndépendance, à la suite dʼun redécoupage administratif, en 1956, le Chhattisgarh est intégré au Madhya Pradesh. Dʼune superficie de 443 446 km2, dʼune population de 73 millions et dʼune densité de 165 km2 (Census of India 1981), cʼétait lʼEtat le plus vaste de lʼInde. En étant rattaché ainsi aux Provinces Centrales puis au Madhya Pradesh, le Chhattisgarh, dʼun côté, a su profiter de lʼurbanisation et de la politique de développement. De lʼautre côté, comme il est resté entier, un sentiment de distinction du reste de la région a germé, ainsi que la volonté dʼaffirmer une identité régionale particulière. Actuellement, le Chhattisgarh, dʼune superficie de 135 133 kilomètres carrés – classé dixième – comprend 20 millions 833 mille habitants (Census of India 2001).
La situation géographique du Chhattisgarh dans lʼInde – bordé au nord-ouest par le Madhya Pradesh, à lʼouest par le Maharashtra, au sud par lʼAndhra Pradesh, à lʼest par lʼOrissa et au nord-est par le Jharkhand – en fait une région aux frontières et aux influences diverses, néanmoins bien délimitée par le relief composé de montagnes infranchissables. En effet, les montagnes Maikal, la chaîne Sihawa et la forêt Sonakan entourent lʼEtat et ont contribué à lʼisolement politique et social du Chhattisgarh.
Le Chhattisgarh : un Etat contrasté et pauvre (cartes 2, 3, 4)
Le Chhattisgarh est composé de seize districts, mais la répartition de la population est plutôt inégale. La population est concentrée dans les districts de Raipur et Durg principalement (au centre), puis de Bilaspur et ensuite de Surguja (au nord). Le total de ces quatre districts abrite presque la moitié de la population. 70% des « tribus répertoriées » est concentré dans le district de Bastar, situé au sud de lʼEtat. Raipur est le chef-lieu de ce district ainsi que la capitale de lʼEtat. Quant aux castes répertoriées », elles sont principalement recensées dans les districts de Bilaspur et Surguja.
Le Chhattisgarh – qui a produit, quand il faisait partie du Madhya Pradesh 70% de la production du riz de cet Etat – est encore appelé « bol de riz », « dhan ka katora ». En fait, cʼest surtout de la plaine, alimentée par des rivières comme le Mahanadi et ses affluents, que provient une grande partie de la production agricole. En contrepartie, les collines, montagnes et forêts offrent peu de ressources économiques qui attirent les habitants.
Cʼest donc un Etat à fort contraste, divisé en une partie relativement riche et une autre pauvre. La première est la plaine irriguée et cultivée. La seconde est composée de collines forestières isolées, peu irriguées, cultivées difficilement, qui forment pourtant 44% de la superficie. Malgré quelques ressources qui sont issues de la forêt comme le teck servant à lʼameublement, celles provenant de lʼagriculture et des industries (minérales – fer, bauxite, ciment à Bilaspur, charbon à Korba – ou autres – soie à Bilaspur) proviennent de la plaine.
Les revenus de la population dépendent de ce contraste géographique et économique. La population qui réside dans la plaine, dans un milieu agricole ou semi-urbain (comme à Ratanpur) vit assez aisément. Des villes comme Bilaspur voient dʼun côté lʼémergence dʼune classe moyenne urbaine qui vit confortablement, mais de lʼautre côté une classe ouvrière pauvre qui vit plus difficilement de petits travaux. Enfin, une population pauvre réside dans les forêts dʼoù elle doit tirer ses moyens de subsistance. La répartition de la population reste alors contrastée : les habitants des plaines proviennent du système de castes (et des « castes répertoriées »), ceux des forêts sont essentiellement des « tribus répertoriées ».
Il existe bien des âdivâsî, comme les Oraon, qui vivent dans les forêts. Cependant, dans la plaine du Chhattisgarh, beaucoup dʼautres se sont hindouisés, ont acquis des attributs de caste et ont été intégrés dans la hiérarchie de la caste locale (Burchalker 1996). Dans la commune de Ratanpur, les Gond résident encore dans lʼex-royaume, dans la plaine, au pied des collines et de la forêt (à six kilomètres du centre), mais dʼautres se sont disséminés dans les villes. A lʼinverse, il existe quelques hautes castes, vivant dans les villages pour des raisons essentiellement professionnelles. La scolarité étant devenue obligatoire dans les villages, des personnes de hautes castes sʼinstallent en tant quʼinstituteurs.
Sʼil est certain que les « tribus répertoriées » résident, en majorité, dans ou aux confins des forêts, les castes, quant à elles, résident, en majorité également, dans les plaines et près des villes. Lʼévolution sociale et professionnelle provoque cependant des mélanges et des décloisonnements. Parallèlement, lʼurbanisation et lʼessor des réseaux routiers et ferroviaires contribuent au développement de la circulation des biens et des personnes.
Au niveau linguistique, bien quʼil subisse des influences au contact des langues de lʼUttar Pradesh, de lʼOrissa ou du Maharashtra, bien que la langue officielle soit le hindi, comme dans le reste de lʼInde, le chhattisgarhi reste communément parlé. On trouve cependant, dans la communauté marathe (restée après lʼinvasion des Marathes) le marathe (dû aux séjours des Marathes) et les langues dʼorigine dravidienne comme le Gond ou lʼOraon.
Quant au taux dʼalphabétisation, il nʼatteint même pas la moitié de la population totale. Il est seulement de 42,9% – contre 44,7 % au Madhya Pradesh – , montrant une inégalité entre les hommes et les femmes (58,1 % chez les premiers et 27,5 % chez les secondes) et il nʼest classé que 23è sur 35 Etats (Census of India 1991). Le taux dʼalphabétisation est lié au phénomène dʼurbanisation assez bas et au taux élevé du travail des femmes (les femmes âdivâsî sont une main-dʼœuvre agricole importante). Quant aux femmes du système de castes, vivant selon le système du pardâ (traduit selon les sources comme « réclusion » de la femme indienne, « séparation » ou « ségrégation »17), elles sont scolarisées certes, mais sur une courte période (jusquʼà la fin du collège).
Malgré le développement du réseau routier et ferroviaire, en dépit dʼun développement urbain certain (taux dʼurbanisation de 17,4 % contre 25,3% au Madhya Pradesh), le Chhattisgarh reste un Etat agricole, dont les ressources sont importantes certes, mais concentrées dans une plaine, au réseau dʼirrigation encore insuffisant et peuplé essentiellement de villages. Le contraste géographique, la répartition conséquente de la population, les ressources essentiellement agricoles font du Chhattisgarh un Etat qui est considéré encore comme pauvre.
Situation historique et politique
Le nom du « Chhattisgarh »
Il existe plusieurs interprétations quant à lʼorigine du terme « Chhattisgarh ». Cette région a été désignée sous ce nom seulement depuis lʼinvasion des Marathes au XVIIIè siècle.
Une des versions les plus courantes est que Chhattisgarh signifierait « la terre des trente-six forts », région donc qui aurait connu ce nombre de villages fortifiés (littéralement chhattîs : trente-six et garh : fort). Une seconde version indique que Chhattisgarh pourrait provenir de Chedisgarh, siège des Chedi, nom dʼune dynastie Rajput (également appelée Kalchuri). La dernière version proposée est que le terme Chhattisgarh pourrait provenir de Chhattisghar. En effet, littéralement, « chhattîs » signifie « trente-six », « ghar » signifie « maison ». Il est donc conté quʼil y a quelques siècles, trente-six familles de travailleurs de cuir (Chamar) auraient émigré et se seraient installées dans la région. Cependant, les Chamar étant une caste dʼintouchables, cette dernière version nʼest pas la préférée des habitants du Chhattisgarh.
Le Chhattisgarh, le royaume et la ville de Ratanpur
Du Royaume Gond à la formation de lʼEtat du Chhattisgarh
Lʼhistoire du Chhattisgarh est jalonnée de guerres de pouvoir entre les dynasties qui détiennent des royaumes, les scindent et les fondent. Lʼhistoire de lʼEtat est également liée à celle de Ratanpur, qui fut le siège dʼun royaume du même nom. Le Gondwana, royaume Gond avait en effet trois capitales : Mandla, Ratanpur et Chandrapur. Les Gond cédèrent le royaume de Ratanpur au début du second siècle après J. C à une dynastie de Rajput.
Durant le règne de ces derniers, le royaume de Ratanpur était connu sous le nom de Kosal (littéralement « royaume »), Mahâ Kosal (Grand royaume) ou Dakshin Kosal (Royaume du sud). Le petit-fils dʼun descendant de la famille royale des Chedi (branche des Haihaya), Ratanraja fonda la ville de Ratanpur.
Au XIVè siècle, la branche Haihaya se scinda en deux, la plus âgée continuant le règne à Ratanpur et la plus jeune à Raipur (Mishra 1979 : 46-47). Chaque royaume fut divisé alors en dix-huit forts (garh ou chaurâsî) dont chacun était dirigé par un chef royal (divân)18 la fin du XVIè siècle, les royaumes connurent la souveraineté des Moghols. Au XVIIIè siècle, en 1751, les Marathes attaquèrent le Chhattisgarh et renversèrent les Haihaya. En 1758, le Chhattisgarh fut annexé au Maharashtra19. Il est conté dʼailleurs que ce règne marathe fut le départ dʼune longue période de désordres. Les Gond, cependant, continuèrent à résister et cette résistance donna lieu à de nombreux conflits. Au XIXè siècle, en 1818, le Chhattisgarh passa sous le contrôle des Britanniques.
Histoire politique de la construction de lʼEtat du Chhattisgarh
Ce sont les mouvements de réformes socio-religieuses et les rébellions tribales qui ont contribué à faire émerger le sentiment dʼappartenance à une région. En affectant le discours politique, social et économique du Chhattisgarh, ils ont permis de soulever la question fondamentale de lʼidentité, de la préservation de la culture et des modes de vie appelés « traditionnels », sʼopposant à un modèle unique de type urbain.
Avant lʼIndépendance, le combat pour la création de lʼEtat du Chhattisgarh est essentiellement dʼordre social (réformes des conditions sociales, reconnaissance de lʼexistence de groupes), sporadique (provenant de rébellions propres à un groupe – les Halba, les Gond) et défensif (défense de propriétés). Après lʼIndépendance, le discours sur lʼidentité régionale change, il cherche à unir ces groupes pour construire une identité régionale.
Il y eut de fortes rébellions dʼâdivâsî qui débutèrent dès le XVIIIè siècle (révolte des Halba de 1774 à 1779…), liées à des revendications de droits sur les ressources locales de terres ancestrales, de forêts et sʼopposant à un ordre politique, économique et social imposé par les Britanniques. Christopher Von Fürer-Haimendorf considère ces rébellions comme des mouvements défensifs (Von Fürer-Haimendorf 1976). En 1958, les Gond défièrent les Britanniques par plusieurs batailles. En 1859, il y eut une révolte très importante dans le sud de Bastar contre la décision des Britanniques de couper des arbres. Quant aux castes répertoriées, elles ont donné naissance dès le XVIIè siècle, à des sectes prônant lʼégalité et la non-violence, comme le Satnam Panth avec Guru Ghasidas, de manière à améliorer les conditions de vie des Chamar, travailleurs du cuir.
Les revendications quant à la formation dʼun Etat séparé du Chhattisgarh remontent aux années vingt du XXè siècle. Cʼest le « Raipur Congress Unit » qui en fait la demande en 1924. La discussion est poursuivie durant la session annuelle du Congrès Indien à Tripuri et un « Congrès Régional dʼOrganisation du Chhattisgarh » est créé, avec, comme leaders, Pandit Sunderlal Sharma, Thakur Pyarelal Singh et Khub Chand Baghel. Des tentatives sporadiques ont ensuite continué. Quand la Commission de Réorganisation de lʼEtat est établie en 1954, la demande en faveur dʼun Etat séparé est refusée, lʼune des raisons avancées étant la pauvreté du Chhattisgarh. Après lʼIndépendance de lʼInde, en 1955, cette demande est relancée à lʼassemblée de Nagpur, mais en vain.
La presse a largement contribué à la propagande. Des journaux, comme Chhattisgarh Chhattisgarhion ka (le Chhattisgarh appartient aux chhattisgarhi) -lancé par Khub Chand Baghel – ou encore Chhattisgarh âtmâ ki pukar (la voix de lʼâme du Chhattisgarh) militent en faveur de la préservation de la culture fondée sur le concept de fierté dʼappartenance régionale. En 1956, Chedi Lal Barrister avec le soutien de Khub Chand Baghel organise le Chhattisgarh Mahâsabha à Rajnandgaon, qui met en place la résolution de la nécessité de développer sur « lʼart et la culture du Chhattisgarh ».
Dans les années 90, le débat reprend de plus belle, mais cette fois, de concert avec les mouvements dʼindépendance de lʼUttarakhand et le Jharkhand. En 1994, le gouvernement du Congrès du Madhya Pradesh prend la première initiative législative et institutionnelle quant à la création du Chhattisgarh. Après donc une longue série de propositions et de remaniements, lʼavant-projet de la formation de lʼEtat du Chhattisgarh est approuvé en 1998. Le 25 août 2000, le Président de lʼInde donne son consentement au Madhya Pradesh Reorganisation Act 2000. Le Chhattisgarh devient un Etat le premier novembre de la même année.
La ville de Ratanpur et le village de Puru (cartes 5 et 6)
La ville de Ratanpur
Contrairement à Bilaspur, placée sur la ligne ferroviaire de Delhi à Raipur, en plein essor urbain et comprenant environ 500 000 habitants, Ratanpur est restée une petite ville avoisinant dix mille habitants (Census of India 2001). Malgré le fait quʼelle soit placée à lʼécart du réseau ferroviaire, elle est située sur un bon réseau routier (route de Bilaspur à Korba, cf carte 5).
Ce qui fait la spécificité de la ville de Ratanpur, cʼest que justement, elle a su de son passé, autant par les communautés qui y résident (Gond, Rajput, musulmans, Marathes), les constructions qui y existent (fort des royaumes Gond et Rajput, temples et étangs Rajput, divinités Gond et hindoues…), que par lʼorganisation spatiale et villageoise (Mishra 1979 : 56).
Le fait que Ratanpur ait été un royaume « sombré dans lʼoubli » comme lʼécrit Makhan Jha (1977 : 89) ne chagrine que quelques nostalgiques. Ratanpur est en effet appelée la « ville qui sʼétend sur les quatre âges » (chaturyugi nagri). Au premier âge, ce fut Manipur (mani : objet précieux), au second Hirapur (hira: diamant), le troisième, Manikpur (manik: perle) et le quatrième, Ratnapur (ratna: bijou).
Ratanpur est formée dʼune ville centrale et de nombreux villages aux alentours (carte 6, plan 1). La ville de Ratanpur (carte 6, plan 2) est séparée en deux par une route principale qui va de Bilaspur à Korba dans un axe nord-est – ouest (en rouge sur la carte). Le long de cette route, très fréquentée par la circulation, sont situés les arrêts de bus, les restaurants, les cafés, le cinéma, le terrain de sport et de nombreux commerces. A la sortie de Ratanpur vers Korba, cette route est bordée de maisons habitées par les basses castes pauvres de pêcheurs et des musulmans tout aussi pauvres.
Au nord de cette route principale, il y a le centre-ville divisé par une rue où se trouve le marché de produits frais (en jaune sur la carte). Cette rue est habitée par des hautes castes, des « castes répertoriées » reconverties socialement et des moyennes castes comme les commerçants. Cet axe du marché sʼétend vers lʼest, dans une rue dʼex-travailleurs de cuivre (Shûdra), caste reconvertie comme petits commerçants (en vert). Le bout de cette rue donne sur tout un ensemble de ruelles habitées par les Gupta (Vaisha), commerçants (en bleu). A lʼest toujours, hors du quartier Gupta se trouve le temple de Shiva (1), avec lʼarbre banyan, lieu de culte des femmes de Ratanpur, et encore plus à lʼest, sur une colline, le temple de Râm (Râm Tekri (2). A quelques kilomètres à lʼest est situé un village dʼintouchables, Nawa Ganj (en violet). Au nord-ouest du centre ville, le temple de Mahâmaya Devi, lieu de pèlerinage très connu dans le Chhattisgarh, endroit où sont fêtés les rituels du cycle de vie ou de saisons, abrite les déesses Pârvatî et Durgâ (3).
Au sud de lʼaxe principal de circulation, il y a le « vieux Ratanpur » (purânâ Ratanpur – en rose), formé de quelques ruines du « vieux fort » (purânâ qila) et, à quelques pas de ces ruines, au sud, le temple de Râm. Au sud-est se trouve le quartier, brahmane, entouré de maisons appartenant à des castes diverses. Il jouxte lʼétang de Dulhara (4), considéré aussi religieux que le Gange. Cʼest là où sʼeffectuent les rites funéraires (le terrain de crémation (5).
Sur la route de Ratanpur qui va à Bilaspur, faisant partie de la commune, se trouve Djuna Shahar, ancien lieu de royaume Gond, où se dressent les ruines de château. Les Gond y habitent encore. Il existe quantité de temples et dʼétangs quʼil nʼest pas possible de citer et qui sont présentés dans un article écrit par Makhan Jha, qui les regroupe en cinq segments (Jha 1977 : 91). Chaque étang rappelle ou est une forme de la divinité (Dulhara est considéré comme le Gange, Bêrag-ban est une forme du dieu Vishnou).
Mentionnons quʼen outre, il existe une mosquée à Ratanpur ainsi que de nombreux lieux de culte âdivâsî (Thakur Dev). A signaler également, les temples de crémation des veuves, au sud-est (6), sur le terrain vague où se déroule la grande foire annuelle de Ratanpur ou encore au nord-est (7).
Le village de Puru
A Puru, village de 1000 habitants, réside une majorité de Kanvar, population âdivâsî. Ils sont nommés également Kavar ou Kaur. Dès le début du XXè siècle, Russell les recense dans les plaines de la région du Chhattisgarh, au nord de la rivière Mahanadi, correspondant aux districts de Surguja, Raigarh et Bilaspur (Russell 1916 : 389).
Le mythe dʼorigine des Kanvar est fondé sur une « chute statutaire de castes20 » ou déclassement dans la hiérarchie, ce qui leur donne une image plus valorisante. Ils seraient en effet, selon ce mythe, les descendants dʼune caste royale, plus particulièrement les descendants des Kaurava du Mahâbhârata, vaincus par les Pândava lors de la bataille de Hastinâpur. Après la bataille, deux femmes enceintes se seraient enfuies vers les montagnes de lʼInde centrale ; elles se seraient réfugiées chez un cultivateur (Râvat) et un laveur de vêtement (Dhobî), avec qui elles auraient ensuite des descendants.
Si Puru compte, en majorité, une population de Kanvar (cultivateurs), il existe également des Dash, qui font partie de la secte Kabir Panth, créée au XVè siècle par Kabir, poète mystique. Les Dash ont été recensés comme des « backward castes » jusquʼau dernier recensement. Il existe en outre, une famille de commerçants (Vaisha) et une de haute caste (Kshatriya) dont le maître de maison est à la fois propriétaire de terrains, prêteur, médecin, commerçant de vêtements et instituteur, bref qui détient le pouvoir et lʼautorité au village.
Bien quʼintégré dans un Etat plus vaste, le Chhattisgarh, dont lʼorigine du terme ferait référence soit aux dynasties ou aux castes lʼayant fondé, soit à une organisation spatiale royale, est resté distinct et a gardé ses spécificités. La configuration géographique y a contribué fortement. Le Chhattisgarh est encore pauvre malgré une production de riz importante, mais provenant seulement des plaines. Lʼaire montagneuse et boisée, assure peu de ressources. Les revendications de la population âdivâsî, dont le pourcentage est fort par rapport à dʼautres Etats, ont contribué à la reconnaissance de leur identité et à la formation dʼun Etat à part entière. Quant à Ratanpur, lieu de terrain principal de lʼétude, elle fait partie dʼun district en essor, Bilaspur. Malgré la place importante quʼelle a eu en tant que capitale du royaume, au même titre que Raipur, elle a perdu son titre de capitale. Restant une petite ville de 20 000 habitants appartenant au système des castes, elle abrite, de manière un peu excentrée, des Gond.