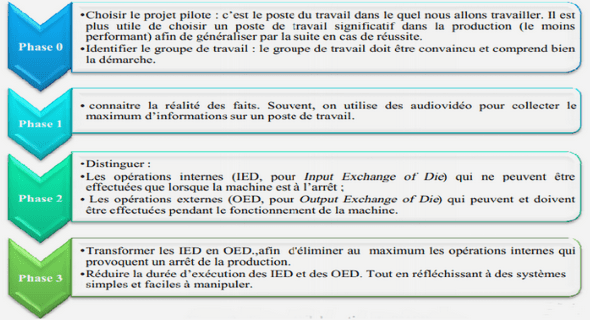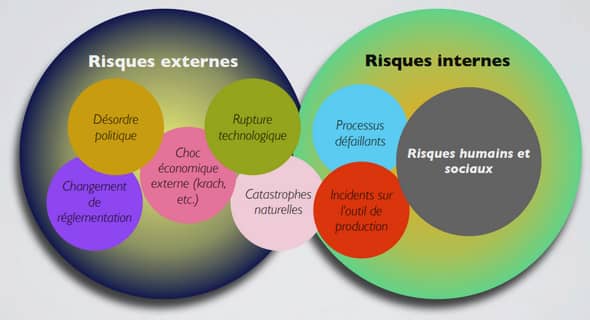Le sucre, adoré ou abhorré
Le sucre : une histoire de goût
En 1775, le raffineur Ravot désigne la mode des boissons coloniales comme facteur principal de diffusion du sucré. Pourtant, le goût du sucre est largement indépendant des nouveaux produits exotiques. En effet, à la différence du café ou du thé, il est consommé pour lui seul sous des formes variées : confitures, bonbons ou gâteaux. Il correspond à une mode nouvelle : celle des desserts en vogue chez les élites. Mets doux au palais et aliments de bon ton en société, le sucre concentre à lui seul toute la richesse et la polysémie du terme »goût ». Si les scientifiques ont prouvé que certains goûts et dégoûts étaient innés, les nourrissons de toutes les civilisations se délectent du sucre mais grimacent le goût amer. L’alimentation reste de ce fait une construction sociale sujette aux modes . L’étude de la culture matérielle est donc centrale dans les travaux des chercheurs en sciences sociales. Sociologues et anthropologues ont insisté sur la formation du goût, qui diffère néanmoins selon les sociétés et les cultures.
Le sacre du sucré : la diffusion d’un aliment de bon goût
Grâce à la baisse des prix, les usages du sucre se modifient ; le sucre quitte progressivement la boutique des apothicaires pour celle des épiciers et gagne peu à peu sa place d’aliment au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Ce dernier est ainsi présenté comme un condiment et un médicament : il assaisonne les fruits, soigne les rhumes et il est « recommandé d’en manger au moins une livre par jour » . L’essor du goût pour le sucre a entraîné de vives controverses médicales et morales. 22 Tout d’abord aliment plaisir, sa consommation devient un péché, à tel point que certains médecins de l’époque le rendent même responsable de tous les maux. L’analyse des discours permet une plongée au cœur de la question du risque alimentaire, et les analogies sont fortes avec les débats qui portent sur les autres produits exotiques (ananas, café, thé, chocolat) dès lors que leur consommation devient courante. La diffusion de nouvelles modes peut être longue et nécessiter quelques adaptations. Loin de faire l’unanimité, le sucre a fini par s’imposer dans les habitudes alimentaires des européens. Détaillants, nobles, bourgeois et médecins ont participé à la composition d’une image positive du sucre. Malgré une face sombre, on retrouve une face lumineuse et festive, celle des banquets ornés de pièces en sucre, des boutiques de confiseurs, des salons et des cafés, où le sucre accompagne les boissons exotiques, symbole de civilisation des mœurs et de bon goût, bref d’une certaine distinction sociale. Il devient de bon ton de manger du sucre sous toutes ses formes. Les discours qui ont entouré sa réception permettent de comprendre comment la mode du sucre s’est répandue, malgré les controverses.
Un produit controversé : de la crainte à l’engouement pour le sucré
Les « Lettres de Madame de Sévigné. » illustrent les préventions à l’égard de deux produits souvent associés, le sucre et le café. En 1679, sur les recommandations du docteur Duchesne, la marquise persuade sa fille, Madame de Grignan, de ne plus consommer de café, ou du moins de ne le sucrer qu’avec du miel, à cause des vertus échauffantes du sucre . Dix ans plus tard, elle lui confie qu’elle boit chaque jour du café au lait sucré, y compris pendant le Carême. Pour se justifier, elle cite les médecins du Bois et d’Aliot, qui en encouragent l’usage pour les malades de la poitrine. Comme pour les fruits, l’engouement des élites a influencé le discours médical et a fait taire les anciennes prescriptions diététiques qui leur étaient hostiles . L’image positive du sucre a fini par conquérir l’opinion malgré les craintes qui provenaient à la fois des procédés de fabrication et des caractéristiques naturelles attribuées au sucre. Sa diffusion a même été appuyée par le discours médical dominant qui insistait sur ses bienfaits pour la santé des consommateurs.
Les dangers du sucre liés à certains procédés de fabrication jugés dangereux
Le raffinage et la confiserie inquiètent toutefois les médecins et les acheteurs, en raison des nombreux produits chimiques utilisés. La principale crainte porte sur l’utilisation de métaux dangereux, comme le cuivre, très présent dans les divers ustensiles de raffinage. D’ailleurs, à cette même époque, la peur des métaux a également touché d’autres secteurs alimentaires comme le vin. Effectivement, dès 1750, l’utilisation du cuivre a soulevé les interrogations des médecins de l’Académie royale des sciences qui recommandent l’interdiction des récipients fabriqués dans ce métal. Le cuivre est majoritairement utilisé car il est réputé plus résistant que le fer, facilite la cuisson des aliments et conserve la couleur naturelle des fruits confits. Mais le vert-de-gris, produit par la combustion des aliments, est cependant toxique. Il provoque des empoisonnements que les contemporains nomment les »coliques métalliques », incidents largement relayés par la presse et à l’origine d’innovations comme le plaquage en or et en argent de la vaisselle. Le goût pour les confitures et les friandises sucrées s’est tant développé qu’il l’emporte sur le principe de précaution, et malgré les risques encourus, le cuivre fait toujours partie des batteries de cuisine à la fin du XVIIIe siècle. 4) Les méfaits d’une consommation excessive de sucre : le jugement médical et moral. Alors que le sucre est connu depuis la période médiévale, les médecins restent circonspects sur sa nature car les Anciens n’ont pas précisément défini ses vices et ses vertus. Dans les grands textes diététiques arabes, inspirés des encyclopédies médicales du monde classique méditerranéen, seul Ibn Khalsûn évoque la canne à sucre dans son « Kitâb al-Agdiya. » . En 1713, Andry, docteur et régent de la faculté de médecine de Paris, rappelle dans son « Traité des aliments de caresme. » que le sucre était connu des Anciens mais qu’il n’était pas raffiné, d’où la difficulté à définir précisément ses qualités. Pour combler le silence des traités médicaux précédents, les auteurs de la période moderne comparent le sucre avec le miel, bien mieux connu à cette époque [26]. Par la suite, plusieurs médecins proscrivent son usage et s’inspirent de la médecine chimique développée par Paracelse (1493-1541), un des précurseurs de la toxicologie grâce à ses 24 travaux sur les poisons. Effectivement, ce dernier est un farouche opposant de la théorie des humeurs, et selon lui, le corps peut être soigné grâce aux propriétés chimiques des aliments, bien que certains soient mauvais par nature et doivent être proscrits, comme le sucre ! Joseph Duchesne, faisant partie des héritiers modernes de Paracelse et accessoirement médecin du roi Henri IV, emprunte alors les éléments de la médecine paracelsienne et compare le sucre à de l’acide nitrique . En France, les galénistes, défenseurs de la théorie humorale soutenue par Hippocrate, sont les plus nombreux et admettent les vertus du sucre malgré les désordres métaboliques qu’il peut entraîner. Ils le classent parmi les aliments chauds et humides, mais recommandent tout de même une consommation mesurée. En 1786, un article publié dans « La gazette de santé. » accuserait même le sucre de faire maigrir car il serait un aliment « propice à diminuer la graisse » [28]. Pour le médecin Lemery, « il provoque un peu les vapeurs, il se tourne facilement en bile, il cause des maux de dents, il les noircit et les échauffe beaucoup quand on s’en sert avec excès ». Alors que de son côté, Andry observe par ailleurs que « le sucre nuit aux viscères » [29,30]. En somme, tous deux recommandent l’usage du sucre dans certains cas, mais en condamnent fermement sa consommation excessive. Les médecins sont les premiers à relayer le jugement moral, en condamnant le glissement des usages qui s’est opéré au profit du plaisir. L’aliment est néanmoins autorisé pendant les périodes de jeûne car il est considéré comme une drogue, mais sa consommation n’est plus acceptable quand l’unique but est le seul plaisir de la gourmandise. Par exemple, Andry réprouve avec virulence sa consommation pendant le Carême. La gourmandise est assimilée à la sexualité pour ses liens avec le plaisir. Selon C.-L. Strauss, partout dans le monde, les hommes associent l’acte sexuel et le repas, à tel point que de nombreuses sociétés ont un seul mot pour désigner ces deux fonctions biologiques vitales [31]. Les romans et les ouvrages de cuisine présentent les femmes comme des gourmandes invétérées. Leur goût exagéré pour le sucre devient alors une preuve de leur frénésie sexuelle, d’où l’association classique du sucre, des femmes et du libertinage
Remerciements |