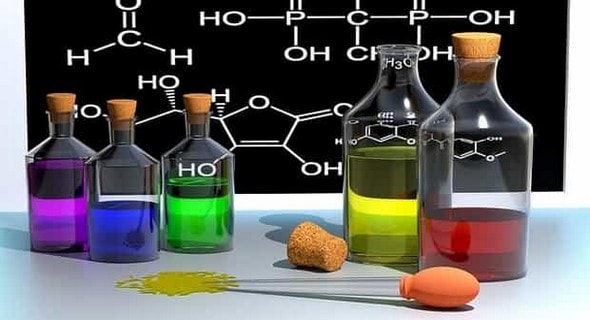Philosophie analytique et sciences cognitives, pensée et monde physique
La philosophie analytique est la discipline qui s’intéresse aux concepts. Plus précisément, elle se sert des outils de la logique pour analyser les structures conceptuelles que nous employons pour penser aux choses, en parler et interagir avec elles. Toute pensée qui utilise des concepts complexes peut donc potentiellement être un objet d’étude pour la philosophie analytique.
Ainsi, il existe une philosophie analytique de la morale, de la sociologie, de la biologie, du droit, de l’art, de l’esprit, etc. La philosophie analytique se caractérise donc simplement par le fait qu’elle analyse des concepts en utilisant les outils de la logique (Carroll, 1999).
En cela, la philosophie analytique est à distinguer clairement de la science. Si la première s’intéresse à la façon dont nous parlons des choses et dont nous nous les représentons en pensée, la seconde se préoccupe des choses elles-mêmes. Toutefois, pour étudier les choses, nous avons nécessairement besoin de nous les représenter en pensée et on considère généralement qu’il existe une certaine correspondance entre les choses et la façon dont on y pense. On peut donc s’attendre à rencontrer des interactions entre science et philosophie analytique autour des concepts qui désignent des entités étudiées par une discipline scientifique et qui sont également analysés par une branche de la philosophie analytique. La possibilité de telles interactions semble confirmée par le fait qu’il arrive de voir une même personne partager son temps entre une discipline scientifique et l’analyse philosophique des concepts que celle-ci emploie. Lorsqu’un biologiste ressent le besoin de suspendre temporairement l’étude expérimentale d’un gène pour se demander ce qu’il entend exactement par le concept de « gène », s’il a raison de l’employer comme il l’emploie et si ses collègues l’emploient de la même façon que lui, il passe de la biologie à la philosophie analytique de la biologie. De la même manière, il n’est pas rare qu’un philosophe de l’esprit se mette à faire des expériences de sciences cognitives, ou qu’un expérimentateur écrive des articles purement dédiés à la clarification conceptuelle. C’est que certains objets des sciences cognitives sont désignés par des concepts qui intéressent traditionnellement les philosophes de l’esprit, tels que ceux de représentation, de vision, d’expérience ou encore d’intention.
Bien sûr, les interactions entre philosophie analytique et science n’ont rien de nécessaire, et ce même pour des concepts communs aux deux disciplines. Un scientifique peut tout à fait utiliser les concepts sans jamais s’interroger sur la structure de l’édifice conceptuel de sa discipline. Inversement, un philosophe peut s’occuper d’un édifice conceptuel sans s’intéresser aux résultats empiriques qui touchent les entités désignées par les concepts qu’il analyse. Plus spécifiquement, une discipline scientifique peut faire des prédictions empiriques sans que celles-ci ne découlent d’une analyse logique de ses concepts et sans que les résultats obtenus participent à la cohérence de son édifice conceptuel ; dans ce cas, les résultats sont pertinents pour la discipline scientifique, mais pas directement pour sa philosophie. Inversement, un philosophe peut proposer de redéfinir des concepts, d’en réduire certains à d’autres ou au contraire d’en créer, sans que ce travail de redéfinition n’ait une quelconque implication sur la façon dont les scientifiques conçoivent la structure naturelle de leur objet d’étude. Dans ce cas, l’opération est pertinente pour la philosophie de la discipline mais pas directement pour la discipline elle-même. Il y a généralement interaction entre une discipline scientifique et sa philosophie quand le scientifique désire avoir une connaissance réflexive de la structure de l’édifice conceptuel auquel il emprunte des concepts, ainsi que de la façon dont cet édifice se connecte à ceux employés par d’autres disciplines (ou à celui employé par la pensée de tous les jours). Inversement, l’interaction peut se produire si le philosophe souhaite apporter une caution scientifique à son travail en mesurant la proportion dans laquelle l’édifice conceptuel qu’il analyse peut-être compatible avec des données empiriques. Plus trivialement, faire des découvertes empiriques informe sur la manière dont on pense aux choses (ou dont on devrait y penser). Inversement, clarifier la façon dont on pense aux choses peut aider à les étudier plus efficacement.
Les interactions dont nous venons de parler sont celles qui touchent une discipline scientifique et sa propre philosophie (ou une branche de la philosophie qui s’intéresse à des concepts employés par la discipline scientifique, comme dans le cas de la philosophie de l’esprit et des sciences cognitives). La question que nous nous posons ici est sensiblement différente puisque nous ne nous intéressons pas aux possibles interactions entre la philosophie de l’esprit et les sciences cognitives, ni à celles qui peuvent exister entre la philosophie analytique de l’art et la pratique artistique, mais bien aux relations entre la philosophie analytique de l’art et les sciences cognitives. Or, contrairement à l’édifice conceptuel auquel s’intéresse la philosophie de l’esprit, celui de la philosophie analytique de l’art ne possède a priori pas de point de superposition avec celui construit par les sciences cognitives. La philosophie analytique de l’art s’intéresse à la façon dont nous employons différents concepts liés à celui d’œuvre d’art, tandis que les sciences cognitives utilisent leurs concepts pour étudier le fonctionnement naturel du cerveau. Les deux tâches étant très différentes, on peut douter de la possibilité de collaboration entre ces disciplines.
L’argument le plus fort qui peut être dressé contre le rapprochement entre philosophie analytique de l’art et sciences cognitives consiste à dire qu’il y a incompatibilité de principe entre les deux disciplines. D’après cet argument, la philosophie analytique de l’art serait une entreprise purement normative (Seamon, 2004), dont l’unique rôle serait de nous dire comment employer correctement les concepts qui structurent notre rapport à l’art. Une de ses tâches les plus fondamentales serait de nous dire comment il faut employer le concept d’œuvre d’art. Pour leur part, les sciences cognitives, en tant que sciences naturelles, s’intéressent aux faits tels qu’ils sont (et non pas tels qu’ils devraient être) et ne peuvent donc pas être normatives. Les langages normatif et factuel étant par nature différents, le dialogue entre philosophie de l’art et sciences cognitives serait irrémédiablement compromis.
La thèse selon laquelle les sciences cognitives ne peuvent pas être normatives est probablement juste. En revanche, la thèse qui fait de la philosophie analytique de l’art une entreprise purement normative est suspect. Pour répondre à cet argument, rappelons les objectifs généraux de la philosophie analytique.
Objectifs et méthodes de la philosophie analytique
La philosophie analytique peut avoir des visées descriptives et prescriptives. Elle affiche des objectifs descriptifs lorsqu’elle cherche à caractériser la structure d’un concept telle qu’elle se dissimule dans les usages qu’on en fait. Les objectifs sont prescriptifs lorsque le philosophe cherche à nous dire comment doit être utilisé un concept, indépendamment de la manière dont il est effectivement utilisé.
Lorsque ses objectifs sont descriptifs, le philosophe envisage les intuitions, les façons de parler et les comportements comme des faits. Son but est d’élucider les structures conceptuelles sous-jacentes qui déterminent ces faits tels qu’on les observe. L’une des méthodes les plus représentatives de la tâche descriptive consiste à choisir un concept et à essayer de le décrire. Le philosophe prend généralement comme point de départ une description existante du concept, ou une qui lui semble intuitive, puis il la met à l’épreuve de nos intuitions, de notre langage et de nos comportements, afin de l’affiner. Mettre la description d’un concept à l’épreuve de nos intuitions ne signifie pas que le philosophe cherche une description du concept qui soit elle-même intuitive (nos intuitions relatives à la structure de nos concepts peuvent très bien être fausses). Cela signifie qu’il cherche une façon, intuitive ou non, de caractériser les situations où on applique intuitivement le concept. La tâche descriptive est résolue lorsque le philosophe dispose d’une caractérisation du concept qui lui permet d’isoler les situations où, intuitivement, on applique le concept, et de les distinguer des situations où, intuitivement, on ne l’applique pas.
Une façon classique de caractériser un concept consiste à lui trouver une « définition », ce terme étant pris ici dans le sens particulier que lui attribue la philosophie analytique, c’est-à-dire un ensemble de conditions indépendamment nécessaires et conjointement suffisantes à l’emploi correct du concept. Ainsi, la tâche descriptive est-elle résolue par une définition lorsque le philosophe réussit à énoncer une liste de conditions telles que (1) les conditions sont toutes vérifiées toutes les fois où le concept s’applique, et (2) au moins une condition ne se vérifie pas toutes les fois où le concept ne s’applique pas (peut-être faut-il ajouter : (3) la vérification des conditions reste indéterminée lorsque nos intuitions quant à l’application du concept sont floues). Le recours à la définition pour résoudre la tâche descriptive a été critiqué par certains philosophes car il n’est pas certain que l’emploi de nos concepts soit régi par l’application tacite d’une définition que le philosophe analytique pourrait révéler. Par exemple, certains auteurs pensent que l’emploi d’un concept dans une certaine situation est régi par la ressemblance entre cette situation particulière et la situation prototypique d’emploi de ce concept. Ce genre de critique n’oblige toutefois pas à abandonner la méthode qui consiste à essayer de définir les concepts. En effet, même s’il s’avérait que les définitions ne reflètent pas la structure naturelle de nos concepts, la méthode qui consiste à rechercher une définition pourrait néanmoins être conservée pour ses vertus méthodologiques. La recherche de conditions nécessaires et suffisantes s’est maintes fois révélée être un outil puissant pour structurer la progression de la pensée logique. Ainsi, même lorsqu’un concept ne peut finalement pas être efficacement décrit par une définition, c’est souvent la recherche d’une définition qui permet de s’en rendre compte, de trouver une alternative efficace ou, plus généralement, d’apprendre ce qu’on voulait savoir à propos de ce concept (Carroll, 1999; Kaufman, 2004). La recherche d’une définition apparaît donc toujours comme une bonne manière de se lancer dans la tâche descriptive, c’est-à-dire dans la tâche qui consiste à caractériser la structure d’un concept dissimulée derrière les intuitions, les façons de parler et les comportements. Parlons maintenant du cas où le philosophe affiche des ambitions prescriptives.
Les ambitions du philosophe sont prescriptives lorsqu’il considère les intuitions, les façons de parler et les comportements, non pas comme des faits à décrire, mais comme des choses pouvant être correctes ou incorrectes. Lorsque sa tâche est prescriptive, il s’autorise par exemple à réviser certaines de nos intuitions. La tâche prescriptive peut également aboutir une définition ; dans ce cas, la validité de la définition ne vient pas de son adéquation aux faits mais de considérations extérieures expliquant pourquoi il est souhaitable de museler la façon intuitive dont on se sert du concept et pourquoi il convient d’adopter, à la place, la définition proposée par le philosophe. Idéalement, la tâche prescriptive devrait suivre la tâche descriptive. En d’autres termes, le philosophe devrait commencer par décrire un concept tel qu’il est avant de dire, si besoin est, ce qu’il devrait être. Idéalement encore, la tâche descriptive et la tâche prescriptive devraient être articulées par ce qu’on appelle une « théorie de l’erreur ». Une théorie de l’erreur explique pourquoi certaines de nos intuitions (de nos façons de parler, de nos comportements) font fausse route et pourquoi il convient de les réviser. Ainsi, le philosophe commence-t-il par décrire un concept tel qu’il est ; si besoin est, il avance ensuite une théorie de l’erreur pour expliquer pourquoi la structure de ce concept doit être révisée. Enfin, il prescrit les révisions permettant d’améliorer la structure de ce concept.
Imaginons de nouveau une situation fictive autour du concept de « gène ». Le philosophe pourrait accomplir la tâche descriptive, par exemple, en proposant la définition suivante : Dans l’usage actuel, X est un gène si et seulement si (1) X est un fragment d’ADN, et (2) X commence par un codon début et finit par un codon stop. Le philosophe nous dit ensuite que cette définition doit être révisée, car elle ne provient pas d’un choix délibéré mais de notre tendance naturelle à définir les objets à partir de leurs propriétés matérielles. Puis, il nous donne des raisons de penser que l’édifice conceptuel de la génétique serait plus cohérent et plus opérationnel si on abandonnait cette définition en terme de propriétés matérielles, au profit d’une définition parlant de propriétés fonctionnelles ou informationnelles. Enfin, il termine en proposant une nouvelle définition, selon laquelle X est un gène si et seulement si (1) X est un fragment d’ADN et (2) X contient l’information suffisante pour produire une protéine.
La distinction entre les objectifs descriptifs et prescriptifs de la philosophie analytique nous permet d’apporter une première réponse à l’argument de la normativité. En tant que philosophie analytique, celle de l’art a probablement elle aussi des visées descriptives et prescriptives. Or, s’il y a de la normativité dans la philosophie analytique, celle-ci ne peut se trouver que dans la tâche prescriptive, car un discours descriptif n’a par définition pas d’ambition normative. Donc, tout au moins lorsque le philosophe de l’art est impliqué dans une tâche descriptive, son langage n’est pas incompatible avec celui des sciences cognitives.
Le sceptique répondra que cette progression de la description vers la prescription en passant par une théorie de l’erreur est une utopie. Si elle n’est jamais réalisée, c’est tout simplement parce qu’elle repose sur une conception naïve selon laquelle les concepts ont une structure universelle. Comme nous l’avons vu, lorsque la tâche est descriptive, les intuitions, les façons de parler et les comportements sont considérés comme des faits. Or, bien souvent, ces derniers ne sont pas universaux ; ils dépendent d’une culture, d’une époque, voire d’un groupe d’individus, voire même parfois d’un individu unique. Pourtant, le travail du philosophe ne consiste généralement pas en une enquête de terrain visant à recenser les différentes intuitions relatives à l’application d’un concept ; ce type de travail est plutôt celui du sociologue, de l’anthropologue ou de l’ethnologue. Le philosophe, au contraire, propose des définitions de concepts supposées transcender les particularités individuelles. Or, selon le sceptique, transcender les particularités individuelles pour des concepts ayant une histoire culturelle aussi complexe que ceux auxquels s’intéresse la philosophie de l’art (comme le concept d’œuvre d’art, par exemple) se fait nécessairement à l’aide d’une dose non négligeable de prescription. Tout au moins pour les concepts complexes du point de vue culturel, la description pure n’existe donc pas. Pour étayer son propos, le sceptique rappellera que les philosophes parlent souvent d’ « équilibre réflexif » pour décrire la façon dont se déroule leur analyse, ce qui signifie qu’ils progressent dans un compromis raisonnable entre description et prescription. Dans cette façon de procéder, la normativité peut venir se greffer, d’une part, dans la composante prescriptive de l’équilibre et, d’autre part, dans la détermination de ce qu’est un compromis « raisonnable » entre description et prescription.
Une réponse possible à cette contre-attaque du sceptique consiste à faire valoir que ce qui motive les choix du philosophe, dans sa détermination des points où il faut être prescriptif ainsi que dans le contenu précis des prescriptions, c’est la norme selon laquelle il faut accroître la cohérence logique globale d’un édifice conceptuel. Lorsque le philosophe décèle une incohérence logique qui l’amène à prescrire une révision ponctuelle de certains concepts, la seule norme qui oriente ses décisions est celle qui veut qu’on essaie autant que possible de passer d’un état de moindre cohérence à un état de plus grande cohérence logique. Or, cette norme est également essentielle dans la démarche scientifique. Donc, si c’est là la seule norme que le sceptique parvient à pointer, cela ne démontre en aucune façon une incompatibilité entre la philosophie analytique et les sciences naturelles.
Le sceptique peut recibler son attaque en rappelant que son objectif n’est pas de dire que la philosophie analytique dans son ensemble est incompatible avec les sciences naturelles. Sa critique ne vise que la compatibilité de ces dernières avec la philosophie analytique de l’art. Après ce recalibrage, le sceptique réitérera son argument en disant que l’idée selon laquelle la seule norme qui guide la démarche du philosophe de l’art est la recherche de la cohérence logique n’est pas raisonnable. Dans un domaine aussi complexe et aussi pénétré par l’histoire culturelle d’une société que l’art, les choix prescriptifs du philosophe sont nécessairement contrôlés par des normes qui peuvent toujours au final être réduites à des convictions personnelles. Aussi, pour contrer le sceptique, nous allons devoir nous aussi recentrer nos objectifs sur la philosophie analytique de l’art et plus précisément sur certaines de ses branches. Notre ligne de défense consiste à rappeler que la philosophie analytique de l’art a pris conscience dans les cinquante dernières années du fait qu’elle était pénétrée de toutes parts par des considérations normatives et qu’au moins certaines de ses branches ont fait un effort particulier pour y remédier.
Objectifs et méthodes de la philosophie analytique de l’art
Comme nous le verrons en détail dans le premier chapitre de cette thèse, la philosophie analytique de l’art a opéré une sorte d’auto-analyse, à partir des années 60, sous l’impulsion des héritiers spirituels du philosophe Wittgenstein. D’une part, les philosophes de l’art se sont rendu compte que les visées de leur discipline étaient tacitement prescriptives. D’autre part, ils se sont aperçus qu’il serait souhaitable de se recentrer sur la description. Cette réévaluation des objectifs fut particulièrement tangible dans la branche de la philosophie de l’art qui s’occupe du concept d’œuvre d’art lui-même. Sous l’influence des wittgensteiniens, les philosophes qui cherchaient à caractériser le concept d’œuvre d’art se sont aperçus qu’ils n’essayaient pas de le décrire, bien que ce soit ce qu’ils pensaient faire, mais de dire ce qui, selon eux, doit être le concept d’œuvre d’art. La nature prescriptive des ambitions d’un philosophe apparaît évidente quand il n’hésite pas à dire que beaucoup de gens, y compris ceux du monde de l’art, se trompent en utilisant le concept d’œuvre d’art. Nous verrons dans le chapitre I, que Monroe Beardsley a par exemple affirmé que les ready-made de Duchamp n’étaient pas des œuvres d’art du fait qu’ils ne correspondaient pas à sa définition esthétique du concept d’œuvre d’art, affichant ainsi clairement les visées prescriptives de cette dernière.
Pour proscrire la normativité de leurs analyses et se recentrer sur la description, les philosophes de l’art ont alors adopté une nouvelle stratégie. Ils ont décidé de considérer les intuitions, les façons de parler et les comportements des personnes un minimum impliquées dans le monde de l’art (c’est-à-dire principalement les artistes, les critiques et le public averti) comme des faits, et de les décrire aussi fidèlement que possible. En particulier, ils ont essayé de produire une caractérisation du concept d’œuvre d’art qui soit fidèle à la façon dont il est utilisé par le monde de l’art. Il se trouve qu’il existe une catégorie d’artefact que les sujets familiers avec le monde de l’art isolent des autres artefacts en les désignant par le concept œuvre d’art. Or, ce fait doit être décrit. Autrement dit, le philosophe doit trouver les mots justes pour dessiner les frontières de la catégorie des œuvres d’art et pour la distinguer des autres catégories existantes. Dès lors, le nouvel objectif des philosophes n’est plus de dire aux acteurs du monde de l’art comment ils doivent se servir du concept d’œuvre d’art mais de le décrire tel qu’il est utilisé.