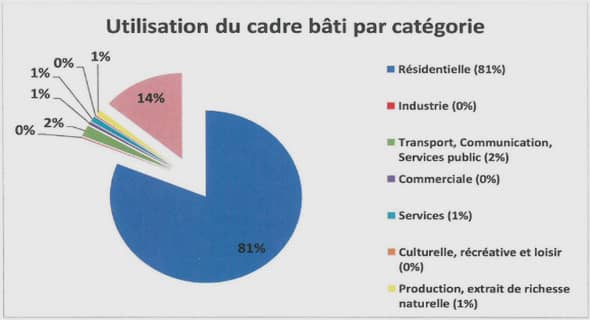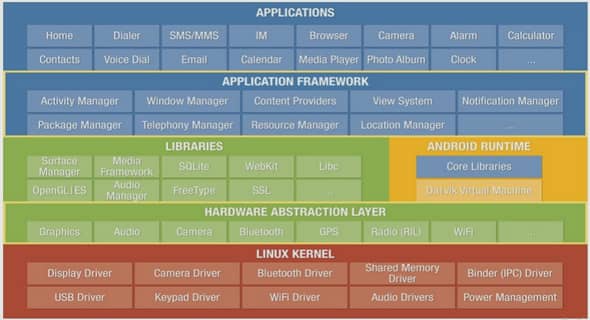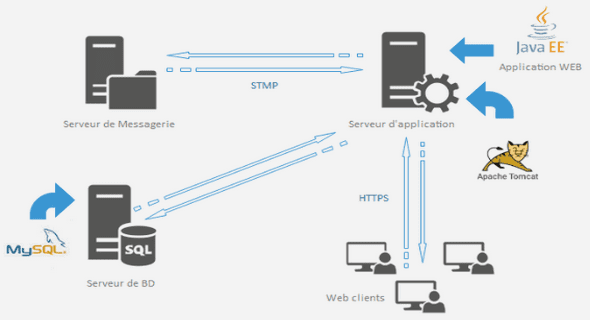Des politiques institutionnelles open source encore bien discrètes
La majorité des répondants (61 %) n’a pas connaissance de politiques de publication des codes sources au sein de leur établissement. Concernant les établissements, on note la plupart du temps des positionnements informels ancrés dans une culture d’un laboratoire (principes éthiques et philosophiques) sans pour autant de politique institutionnelle validée.
Recommandation 12 : Formaliser des politiques de valorisation au sein des établissements de l’ESR en s’appuyant sur la politique de contribution aux logiciels libres de l’État et en étendant le plan national pour la science ouverte aux enjeux de l’open source.
Recommandation 13 : Informer les personnes travaillant ou étudiant au sein de l’ESR des politiques de diffusion de codes sources au sein de leur établissement ainsi que des recommandations nationales
Quelques instituts néanmoins, ont mis en œuvre une politique de développement informatique et un positionnement concernant l’open source. Sans vocation à être exhaustif, voici quelques politiques remontées par le biais du questionnaire et des entretiens en lien avec différents établissements français78.
Mais de telles politiques nécessitent d’être construites et coordonnées avec l’ensemble des acteurs politiques impliqués au sein de l’ESR, en concertation avec les autres administrations. Cela implique et permet également de penser la valorisation de manière plus large : à l’échelle de la société, de l’administration, de l’ESR ou encore de certaines recherches disciplines scientifiques. Une telle vision élargie permet d’intégrer les dynamiques propres de l’ESR en tant que service public, de mesurer son impact pour la société et l’environnement, d’identifier les spécificités et la diversité d’instituts et de pratiques qui composent la recherche.
Conjuguer open source et valorisation : éléments communs et spécifiques au sein de l’ESR
Penser la valorisation dans une définition plus large et plurielle
Aujourd’hui, l’évaluation de l’ESR et sa « valorisation » (entendu par valorisation financière se basant sur un ensemble d’indicateurs majoritairement liés à la propriété intellectuelle et industrielle (brevet, etc.) et au « transfert » possible avec les milieux industriels). Outre un modèle de valorisation orienté essentiellement sur les Sciences Techniques et Médicales (STM), sans prendre en considération les spécificités des Sciences Humaines et Sociales (SHS), plusieurs personnes interrogées soulignent que ces indicateurs n’apporteraient pas une véritable plus-value financière (redevance). Les brevets ou licences serviraient plutôt des critères d’évaluation d’une recherche performante.
Ainsi, avant même de réfléchir à la valorisation possible par l’open source, l’ensemble des réponses montrent la nécessité de repenser la notion même de valorisation. Une des personnes interrogées chargées de l’innovation au sein d’une université notait ainsi80 :
Pour les instituts, plus que de parler de valorisation la notion d’impact semble plus adaptée sachant que la valeur créée ne se résume pas seulement à une valeur financière, mais également d’action sur des enjeux telle que la transition écologique, la durabilité, le dynamisme des universités, etc.
Au cours des entretiens et par l’apport de missions précédemment menées auprès d’instituts de recherche et université, plusieurs éléments de valorisation clefs ressortent afin de pouvoir conjuguer la dynamique des communautés de l’ESR produisant et ouvrant leur code source et une valorisation respectueuse de ses principes. Pour cela, il s’agit de bien comprendre les éléments de valeurs possibles et leurs synergies.
Des éléments de valeurs communs aux acteurs de l’ESR adaptés à des modèles ouverts
Plusieurs éléments de valorisation ressortent des échanges menés avec les instituts de recherche81 :
• l’usage : il est généralement considéré par les instituts de l’ESR que l’usage fait d’un logiciel a plus d’importance que les redevances qui en sont tirées. Un logiciel est valorisé dès lors qu’il est utilisé, quel que soit le domaine ou le type de personne (startup, acteurs locaux ou nationaux). Le nombre de personnes et le type d’utilisation sont autant d’indices à prendre en compte. La réutilisation des recherches par un autre laboratoire est une valorisation évidente) ;
• la mutualisation et les économies d’échelle : la mutualisation avec d’autres acteurs peut-être génératrice d’économies parfois plus intéressantes que de potentielles licences ;
• l’indépendance technologique : le développement de technologies open source par les centres de recherche contribue aussi à une volonté commune au monde de la recherche d’éviter toute appropriation par un seul acteur dans les domaines clefs de la société (retours perçus dans des domaines comme l’optique, le traitement d’image, la mécanique spatiale, la télécommunication, etc.) ;
• le rayonnement : valorisation, reconnaissance à l’extérieur du savoir-faire, bénéfice en termes d’image. Plusieurs projets bénéficient ainsi d’une retombée médiatique (notamment en lorsqu’ils participent à l’information des citoyens) par les analyses et visualisations qu’ils produisent sur des sujets d’actualités et de société.82
Au-delà des bénéfices directs parfois inexistants pour l’institut de recherche ou projet diffuseur, la publication et l’ouverture d’un projet peuvent reposer sur le bénéfice que cette ouverture est susceptible de générer pour d’autres acteurs (motivation extrinsèque). En plus des valeurs habituellement évaluées (diffusion et usage, développement de l’activité économique, soutien à la recherche et rayonnement scientifique, mutualisation externe, facilitation de partenariats et collaborations, services associés, rayonnement et marque), plusieurs valeurs non évaluables sont à considérer (innovation et agilité, transparence, qualité et mutualisation interne) tout autant que de des problématiques prenant un poids majeur aujourd’hui associées aux objectifs de développement durable, de constitution de territoire résilient83.
Tous ces critères sont complexes à mesurer pour l’open source. Ils permettent in fine d’identifier les situations où les ordres de grandeur de revenus de redevances seraient moindres que les externalités impliquées par une diffusion sous licence libre. Plus encore, ils amènent à prolonger la politique publique au-delà de la seule recherche, de sorte à s’assurer que le rôle économique du secteur public tient compte aussi de cette valorisation par l’open source.
Recommandation 14 : Évaluer les bénéfices pour l’ESR d’une politique d’acquisition ou de subvention publiques favorisant l’open source, à l’échelle de l’ESR et au-delà.