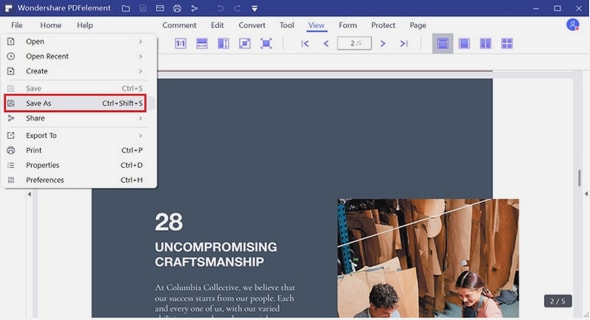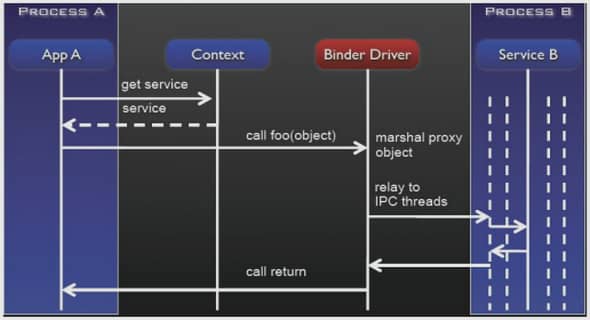Les femmes de l’immigration, des victimes méritantes
L’épidémiologie : preuve de vulnérabilité, facteur de visibilité
Les enquêtes statistiques du début des années 2000 pointent la part largement majoritaire des femmes nées à l’étranger, notamment dans les pays d’Afrique Subsaharienne, parmi les transmissions hétérosexuelles. En ce sens, les premiers résultats de la notification obligatoire de l’infection à VIH soulignent que parmi l’ensemble des nouvelles découvertes chez les femmes, 68% sont nées en Afrique Subsaharienne contre 28% de femmes nées en plus, les enquêtes ANRS-VESPA (2003) et ANRS-VESPA2 (2011) signalent une multiplication par deux (de 7,2% en 2003 à 15,6% en 2011) de la part des femmes d’Afrique Subsaharienne au sein de la population vivant avec le VIH/sida en France métropolitaine (Dray-Spira et al., 2013).
Particulièrement exposées au VIH, elles sont dès le début des années 2000 désignées comme « une population vulnérable », devant faire l’objet d’une attention particulière. Devenues des variables épidémiologiques visibles, ces femmes « émergent » et deviennent (…) des objets de politiques publiques, des sujets de mobilisations associatives et des acteurs de l’action collective en tant que femmes originaires d’Afrique ». (Musso, 2011b, p. 223)
Les femmes de l’immigration, des victimes méritantes
L’épidémiologie a donc largement justifié l’intérêt manifesté à l’égard des « femmes africaines » par les autorités sanitaires françaises à partir des années 2000 (Musso, 2011b), renforçant les représentations stéréotypées de la femme vulnérable, passive (Musso, 2005a) et sans ressource, victime des hommes dans l’épidémie. En ce sens, les femmes d’Afrique Subsaharienne incarnent la « bonne » figure de l’étrangère « méritante », par opposition aux hommes perçus comme les « mauvais immigrants » : parce qu’ils ont migré « volontairement » (Yarris & Castañeda, 2015) et qu’ils occupent dans le système de genre une position dominante.
M.Ticktin (2006, 2011), s’inspirant des travaux et réflexions de D.Fassin (2010), s’intéresse à la « politique humanitaire » contemporaine développée en France à l’égard de certaines catégories d’étrangèr-e-s, les malades et les femmes victimes de violence de genre, dans un climat national plutôt hostile à l’immigration, comme en attestent les multiples débats politiques sur la question9 et l’actualité récente. Présentées par leurs promoteurs comme apolitiques », ces mesures humanitaires exceptionnelles jouent en réalité un rôle critique dans la gouvernance des immigrant-e-s en France.
L’anthropologue souligne en effet combien la raison humanitaire » est instrumentalisée par le gouvernement français10 pour façonner les figures de « bon-ne-s » et de « mauvais-e-s » étrangèr-e-s et justifier une politique de l’exclusion des second-e-s. Cette « violence de l’humanitarisme » (Ticktin, 2006) a pour conséquence de légitimer moralement une nouvelle humanité fondée sur le « corps souffrant » à laquelle le corps valide, « corps exploité » au fondement de la mondialisation néolibérale – celui des travailleur-se-s sans papiers –, n’a pas accès.
Ces régularisations exceptionnelles ne sont pour autant pas assorties de contreparties civiques pour leurs bénéficiaires (Fassin 2001a; Ticktin 2011), maintenu-e-s dans une position de « citoyen-ne-s de seconde zone ». Les travaux de M.Ticktin (2006, 2011) viennent révéler les dommages collatéraux de cette politique humanitaire (Casualties of care) et par là, réaffirmer l’ambivalence du traitement politique de la santé des immigrant-e-s en France. Dans cette continuité, la question du « mérite » (deservingness) (Castañeda, 2012; Willen, 2012; Yarris & Castañeda, 2015) fait l’objet de réflexions spécifiques parmi les anthropologues anglo-saxons. Néanmoins, l’anthropologie politique, en pointant les enjeux de telles régularisations, nous permet à la fois de décrypter les structures gouvernementales d’exclusion et d’appréhender les espaces possibles de mobilisation des personnes destinataires de ces mesures d’exception.
En effet, si l’ambivalence historique de la nation française face à ses minorités est indéniable, la lutte contre le VIH/sida est une « épidémie politique » (Pinell, 2002) qui semble ouvrir un univers de mobilisation associative inédit aux populations immigrantes. « Épidémie politique » car, d’une part, pour la première fois dans le domaine de la santé, des associations avant-gardistes mobilisent le registre de la contestation sociale pour faire valoir les besoins et les droits des patient-e-s. D’autre part, aux risques de transmission du VIH/sida en Afrique comme en France. Les facteurs de vulnérabilité, biologiques et sociaux, de ces femmes sont multiples et sont largement documentés par la communauté scientifique internationale (Cleland, Ferry, & World Health Organization, 1995; Desclaux & Desgrées du Loû, 2006; Le Palec, 1997; Lydié, 2008; Musso, 2005a; Pourette, 2008a; Rwenge, 1998; Vidal, 2000).
Un numéro spécial de la revue Médecine & Sciences paru en 2008 sur « Les femmes et le sida en France » (Bajos & Paicheler, 2008) revient notamment sur la manière dont l’épidémie s’inscrit dans des rapports sociaux inégalitaires. Suite à l’immigration, il est démontré que des inégalités de genre persistent et impactent les possibilités des femmes d’Afrique Subsaharienne de négocier l’usage du préservatif bien qu’elles se sentent exposées à des risques d’infection par le VIH (Lydié, 2008). Cependant, la mobilisation des inégalités de genre pour justifier la féminisation de l’épidémie demande à être nuancée ; l’analyse des vulnérabilités liées au genre nécessite d’être replacée dans le contexte sociopolitique dans lequel elles s’inscrivent (Desclaux, Msellati, & Walentowitz, 2009; Dowsett, 2003).
La consubstantialité des rapports sociaux de genre, de classe et de race11 (Kergoat, 2009) doit en effet être prise en considération afin de bien saisir la complexité de la dynamique du VIH/sida. L’exemple de la France est, en ce sens, éclairant dans la mesure où la féminisation de l’épidémie au début des années 2000 s’est accompagnée de sa précarisation ; la majorité des femmes touchées se trouvant en situation d’immigration (Lydié, 2008). La précarité sociale et administrative touchant les immigrantes en France a en particulier été analysée comme un facteur de recours tardif au dépistage (Calvez, Semaille, Fierro, & Laporte, 2008). « Être une femme immigrée ou étrangère face au sida en France » serait devenu selon S.Musso (2005a) un « nouveau facteur de risque ».
Les conséquences du traitement sociopolitique de l’altérité sur les pratiques préventives et la prise en charge des femmes immigrantes vivant avec le VIH ont par ailleurs fait l’objet de réflexions particulières de la part des anthropologues (Musso, 2005a; Pourette, 2010; Ticktin, 2011) qui rappellent la nécessité d’intégrer les femmes à une réflexion sur l’immigration afin de dépasser les stéréotypes qui leur sont assignés, l’impact de l’un et l’autre sur la santé en général et le sida en particulier a mis bien du temps à être pris en compte. » (Musso, 2005b : 14)
Cette représentation dominante de la « femme mineure » fait directement écho à celle de « la femme moyenne du tiers monde » (Mohanty, 2009; Spivak, 2009) présentée comme dépourvue de ressources face aux inégalités de genre qui l’oppressent.
DÉCONSTRUIRE LA VULNÉRABILITÉ DES FEMMES D’AFRIQUE SUBSAHARIENNE
Au-delà de justifications épidémiologiques, des considérations d’ordre sociologique permettent d’expliquer la féminisation particulière des associations de personnes d’Afrique Subsaharienne engagées dans la lutte contre le VIH.
Une abondante littérature africaniste et des pays des Suds pointe la dimension sexuée des dispositifs de lutte contre le VIH/sida et les ressources qui s’offrent paradoxalement aux femmes pour gérer leur vulnérabilité à l’épidémie et celle de leur famille (Bila, 2011 ; Sow, 2013). B.Bila (2011), dans une recherche réalisée au Burkina Faso au sein de lieux de prise en charge des personnes vivant avec le VIH, justifie l’importance de la présence et de la participation féminines ainsi que la moindre fréquentation des hommes de ces espaces par le rôle de « soignante familiale » (Cresson, 1991; Saillant, 1999) traditionnellement assigné aux femmes, dans les pays européens comme dans les pays d’Afrique.
Le rapport à la santé apparaît comme un produit des représentations, des normes et des valeurs liées au genre. Les femmes ont, en tous lieux et de tout temps, été les principales productrices de soins dans les sphères professionnelles comme domestiques. Ces dernières apparaissent dans l’ensemble de ces travaux africanistes comme majoritaires sur les différents lieux de prise en charge hospitalière (Desclaux & Desgrées du Loû, 2006; Desgrées du Loû et al., 2009; Hejoaka, 2009; Le Cœur, Collins, Pannetier, & Lelièvre, 2009) et associative (Bell, 2005; Bila, 2011; Bila & Egrot, 2009; de Souza, 2010; Liamputtong, Haritavorn, & Kiatying-Angsulee, 2009; Lyttleton, 2004). Ce phénomène s’explique par un ensemble de déterminants socioculturels qui rendent ces lieux favorables aux femmes.
Selon B.Bila (2011), les rôles traditionnels de soignantes familiales dévolues aux femmes dans l’ensemble des pays du monde (Cresson, 1991; Saillant, 1999) leur permettent de développer une expertise face à la maladie sur laquelle les soignant-e-s vont pouvoir s’appuyer.
On note en effet la manière dont les femmes vont globalement se poser comme le relai des institutions de santé (et gouvernementales), gérant la prévention dans le couple et auprès des enfants tout comme la prise en charge socio-thérapeutique de l’ensemble des membres de la famille. Des travaux sur le milieu associatif en Afrique montrent par ailleurs comment ces espaces fortement féminisés sont devenus des espaces mandatés par les firmes pharmaceutiques et par les gouvernements pour distribuer et choisir les bénéficiaires des traitements antirétroviraux dans un contexte de ressources limitées (Bila, 2011; Nguyen, 2010).Intéressons-nous à présent aux femmes d’Afrique Subsaharienne résidant en France.
Malgré une différence de contexte, l’histoire des rapports sociaux de genre permet en partie d’expliquer la sur-visibilité des femmes d’Afrique Subsaharienne au sein des associations d’immigrant-e-s16 de lutte contre le VIH/sida en France. Si l’on se détache momentanément du VIH/sida et que l’on observe l’histoire de la mobilisation associative de ces femmes, un constat similaire peut être établi. Quelle que soit la période considérée, les femmes de l’immigration apparaissent en France comme des actrices dynamiques des différents domaines de la vie sociale, économique et politique (Catarino & Morokvasic, 2005; Miranda, Ouali, & Kergoat, 2011; Morokvasic, 2011; Veith, 2005).
Un numéro spécial de la revue Migrance (Oubechou & Clément, 2014) dédié aux femmes de l’immigration, des XIXème et XXème siècle en France, propose en ce sens une série d’articles « déconstruisant le mythe de la passivité des femmes en migration », contribuant à « sortir les femmes immigrées de la double invisibilité (femmes et immigrées) dans laquelle la recherche historique les confinait jusqu’alors, et à leur rendre leur pleine place dans l’histoire commune ». L’activité associative des immigrantes est à ce titre particulièrement mise en évidence.
Une série de recherches sociologiques réalisées au début des années 1990 vient également pointer la richesse de la vie associative des femmes de l’immigration et le rôle d’interface qu’elles ont historiquement joué entre les populations immigrantes et les institutions françaises (Quiminal, Diouf, Fall, & Timera, 1995) dans certains quartiers. La mobilisation associative de ces femmes est alors décrite comme un « creuset d’intégration » (Timera, 1997) et les femmes de l’immigration comme des « citoyennes innovantes » (Delcroix, 1997).
L’impact de la vie associative sur l’individuation17 de ces femmes a fait l’objet d’une attention particulière (Quiminal, 1998; Veith, 1999, 2005). Rappelons que le métier de médiateur social est en France issu, en grande partie, de l’expérience des « femmes relai » (Barthélémy, 2007, 2009; Delcroix, 1997). Les femmes de l’immigration, si elles peuvent apparaître comme spécifiquement vulnérables face à certaines épreuves de la vie, ne sont donc nullement passives ou sans ressources pour y faire face.