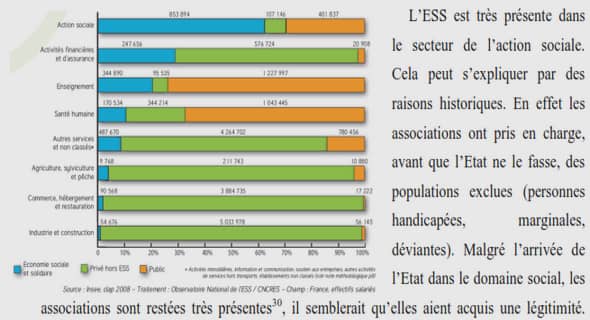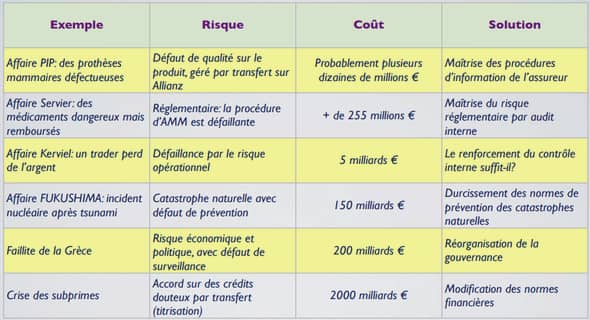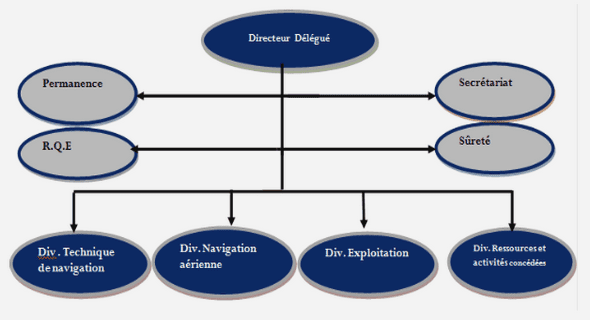Écrivains tunisiens de langue française
Les romans tunisiens sont moins connus que les romans marocains ou algériens. Le romancier tunisien le plus connu est probablement Albert Memmi qui a fini par s’identifier plutôt comme Français que comme Tunisien. Ahmed Mahfoud, professeur de littérature francophone à la faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis, a fait valoir que les écrivains tunisiens de langue française n’ont pas la même pression que les Algériens qui eux, ont fait la guerre avec la métropole avant leur indépendance. Les Tunisiens ne sont donc pas entièrement tournés vers la France : « La colonisation n’a pas été aussi tragique qu’en Algérie ni aussi enracinée qu’au Maroc, cela épargne au Tunisien d’avoir une conscience très conflictuelle de ses rapports à l’ancienne métropole » (Mahfoudh 2002 :89).
L’autonomie littéraire et la censure en Tunisie
La Tunisie n’est pas un pays homogène, il a été de temps en temps conquis : il y a des chrétiens, des berbères, des traces de culture punique, arabo-islamique et méditerranéenne et le multiculturalisme est une composante essentielle de la thématique du roman tunisien. Mahfoudh constate que les écrivains tunisiens de langue française sont soit installés à l’étranger dans des postes universitaires, soit dans des fonctions diplomatiques. Les écrivains tunisiens de langue française qui sont au pays sont aussi bien des avocats, des universitaires ou des anciens hauts fonctionnaires (Mahfoudh 2002 :90).
Catherine Gravet, qui a fait beaucoup de recherches littéraires sur des écrivaines francophones, arrive à la conclusion que les écrivaines et surtout les femmes du Maghreb, qui sont invisibles depuis longtemps, trouvent un refuge dans la langue française. Cette langue de l’ancien colonisateur se développe alors en une langue de liberté qui permet aux Maghrébines de s’exprimer plus librement qu’en arabe. Les femmes maghrébines ont par tradition opté de s’exprimer dans la langue française pour pouvoir librement exprimer les thèmes du corps, de la sexualité, de l’éducation et de l’émancipation de la femme ou bien ceux touchant à l’aspect social et politique (Gravet 2017 :133).
Abir Kréfa, sociologue tunisienne, a écrit un article sur l’autonomie des écrivains tunisiens. Elle compare les caractéristiques de la littérature tunisienne à celle des écrivains belges, suisses ou bien québécois pour qui le français est utilisé comme langue quotidienne par rapport aux pays comme le Maghreb où seulement « les élites intellectuelles et les classes moyennes » l’utilisent (Kréfa 2013:397). Pour ce qui est de l’arabe littéraire, il est enseigné dans les études supérieures et est utilisé dans la presse et la littérature où l’accès est réservé à ceux qui ont été scolarisés. Kréfa décrit les années juste après l’indépendance comme un univers littéraire sous contrôle total de l’Etat. Cela a pris jusqu’aux années 1980 pour que la Tunisie voie des maisons d’édition privées s’établir et que ce contrôle s’affaiblisse.
La liaison entre l’État et le monde littéraire entre 1956 et les années 1980 était très étroite : les quatre principales revues culturelles et/ou littéraires sont soit éditées par l’État, soit dirigées par des hommes politiques qui sont aussi des hommes de lettres » (Kréfa 2013:398). Officiellement la censure n’existait pas en Tunisie car la Constitution de 1959 déclarait la liberté de la presse et d’opinion. Cependant, un certain nombre d’œuvres ont tout de même été interdites de temps à autres. Kréfa dit que la censure peut être associée à la prise en compte des thèmes qui sont socialement et politiquement tabous. Elle justifie ce fait par le cas de Frej Lahour qui a eu des problèmes car elle mettait en scène des rapports sexuels entre les personnages de ses romans et a vu ses romans interdits moins d’un an après leur publication. Il était également courant de censurer quelqu’un si ses relations familiales et leurs liaisons passées, voire leur soutien à l’opposition en faveur d’Ennahda dérangeaient. « Certains auteurs, alors même que ni leur positionnement politique, ni le contenu de leurs ouvrages ne sont tenus pour un problème, ont vu leurs écrits interdits au motif qu’ils ont, dans leur entourage familial, ‘un frère, ou ‘un cousin ; lié à l’organisation clandestine Ennahda » (Kréfa 2013 :400).
À partir de l’année 1985, les maisons d’édition privées se sont installées à Tunis, mais même ces maisons d’édition étaient fortement liées à l’État et recevaient parfois son soutien financier. Les subventions étaient attribuées de façon perverse. En effet, recevaient le plus souvent des subventions les maisons d’édition qui publiaient surtout des livres qui allaient dans le sens des intérêts de l’État. Cette méthode était un autre mode de contrôle de la production littéraire. Kréfa dit que même si c’est possible de comparer le système tunisien à celui des anciens régimes communistes, les écrivains tunisiens étaient moins contrôlés, « on ne trouve, en Tunisie, nulle tentative d’imposition par les élites politiques d’un modèle artistique et les gratifications matérielles possibles sont également bien plus faibles que celles qui s’offraient aux écrivains vivant en régime communiste » (Kréfa 2013: 401).
Le résultat fut que des écrivains prennent une position plutôt favorable envers le régime totalitaire et contrôlant. Il y avait pourtant une opposition et en 2001 six écrivains ont fondé la L.E.L. (la Ligue des Écrivains Libres) pour protester contre la censure. Pendant une courte période de trois mois, ils sont parvenus à publier des listes établies par l’État où figuraient les noms des artistes qui avaient subi la censure, avant qu’ils ne se retrouvent eux-mêmes dans le viseur des organes de censure ; les six écrivains ont tous été au moins une fois incarcérés pour avoir critiqué le régime absolu de Ben Ali et par ailleurs ils ont tous écrit des œuvres qui ont été interdites. Après cette brève période, la L.E.L. a organisé des rencontres publiques où des auteurs pouvaient présenter et discuter de leurs œuvres et de la censure. Ces réunions ont eu lieu dans les grandes villes comme Tunis, Monastir, Sfax et Kairoun. En 2004, les forces policières étaient souvent présentes, voire même menaçantes, pour empêcher que des rassemblements publics aient lieu. (Kréfa 2013:403).
Abir Kréfa expose trois tabous qui réapparaissent dans la société tunisienne : la sexualité, la politique et la religion (Kréfa 2013 :404). D’après Kréfa, une œuvre moderne tunisienne est constituée d’un contexte social où le mariage hétérosexuel demeure la norme sociale mais qui donne voie aux personnages à la sexualité libérée. La Tunisie est un pays avec une identité basée sur l’islam, donc les œuvres qui décrivent des personnages athées, ou qui critiquent l’islam sont très difficilement acceptées dans la plupart des milieux tunisiens, et ce même parmi les couches sociales les plus ouvertes.
Dans Les Intranquilles il y a tous les éléments qui constituent un roman tunisien moderne : le mariage hétérosexuel et malheureux, des personnages homosexuels, des prostituées. La politique est omniprésente car l’histoire a lieu en pleine Révolution du printemps arabe ; l’aspect religieux est aussi bien là. Le roman d’Emna Belhaj Yahia, Jeux de rubans est aussi un roman moderne selon les critères d’Abir Kréfa : il est vrai que Frida, le personnage principal, ne vit pas une vie dans un mariage hétérosexuel, mais elle a été une fois mariée. Étant une femme moderne, elle est divorcée et, qui plus est, elle a un nouveau partenaire depuis plusieurs années. Les aspects religieux et politiques sont aussi bien présents dans le roman entier, surtout la question du voile et le futur rôle de la femme tunisienne.
Aujourd’hui la situation des maisons de publication est différente d’avant la révolution. Dans un article dans Words without Borders, le fondateur d’Elyzad, Elisabeth Daldou, une maison d’édition à Tunis fondée en 2005, explique que les maisons d’édition ne sont plus obligées d’envoyer leurs publications pour recevoir l’approbation du Ministère de la Culture. Azza Filali et Emna Belhaj Yahia ont toutes les deux publiées leurs romans aux éditions d’Elyzad et c’est grâce à cela que leurs romans, qui sont d’ailleurs écrits en français, ont pu être accessibles hors du pays. Aucune des deux œuvres n’a été traduite en arabe et elles ne sont donc pas lues par la majorité des Tunisiens arabophones et qui ne maîtrisent pas forcément la langue française.
Azza Filali
Azza Filali exerce en tant que gastro-entérologue à Tunis, et elle possède aussi un Master en philosophie qu’elle a passé dans une université parisienne. Filali est aussi connue comme journaliste et écrivaine s’étant essayé à différents genres : essais, nouvelles et romans. Son roman L’Heure du cru a reçu le Prix spécial du jury Comar. Elle a par la suite reçu en 2010, pour son roman Ouatann, le fameux prix Comar. Azza Filali vient d’un milieu privilégié, où son père faisait partie du mouvement de résistance pendant la guerre de libération tunisienne. Après l’indépendance, il a occupé le poste de ministre de l’agriculture, entre autres. C’est une des femmes de lettres tunisiennes qui s’exprime littérairement dans la langue de Molière, alors qu’elle habite de façon permanente à Tunis et par conséquence subit et vit sans doute des influences linguistiques et culturelles du milieu dans lequel elle vit. Depuis l’indépendance, Azza Filali écrit pour le journal tunisien La Presse.
Les Intranquilles
Les Intranquilles se déroule pendant la période qui suivit la chute du régime absolutiste de Ben Ali, une période pleine de turbulences et d’incertitudes. Cette incertitude postrévolutionnaire où les Tunisiens sont pacifiques ou « tranquilles » est un des thèmes du roman. Celui-ci est présenté par les différents personnages à mesure de leur ordre d’apparition successif. Il s’agit des voix d’hommes et de femmes, de classes sociales diverses dont les destins se croisent assez fréquemment. Les thématiques tournent autour de la façon dont les bouleversements extérieurs affectent non seulement les institutions étatiques mais aussi les vies des personnes. La langue utilisée dans le roman est le français, mais y figurent des noms d’une grande symbolique tunisienne : la région de Gafsa, qui a connu de multiples révoltes dans l’Histoire tunisienne et jouit d’une réputation de bonnes et hautes valeurs morales ; l’avenue Bourguiba, qui se trouve dans le centre de la capitale et où se tenaient la plupart des manifestations, sont autant de milieux qui reviennent à plusieurs reprises.
Puisque Bourguiba est le père de l’État moderne et le principal acteur dans ce qui sera le mouvement d’émancipation des femmes tunisiennes, il est bien évidemment normal qu’il détienne une place prépondérante dans tous les récits. D’autres noms de grandes personnalités tunisiennes tel que Taher Haddad sont également souvent mentionnés dans les divers récits. Le mérite de Haddad est qu’il était un syndicaliste de grande réputation qui luttait pour l’émancipation de la femme tunisienne.
Le roman est de toute évidence une histoire sur le genre, mais aussi bien une critique sociale contre les inégalités dans la société tunisienne. Azza Filali décrit certains des différents mouvements qui étaient présents pendant la période de la Révolution de jasmin. Il y avait ainsi le mouvement des étudiants dont fait partie Sonia, un des personnages principaux ; ceux-là sont mal organisés mais pas moins passionnés pour autant. Il ne faut pas non plus oublier les mouvements clandestins qui voulaient plus que tout ségréguer les genres (clandestins car chassés par le régime de Bourguiba). Leur idéologie était stricte et même totalitaire, imposant des règles de conduite spécifiques et rigoureuses, et où les femmes n’ont pas leur mot à dire. Azza Filali parle d’un certain Mouvement qui a été formé par certains anciens représentants de l’ancien régime et qui avaient déjà montré leur mécontentement envers le régime de Ben Ali. Ils se dissocièrent donc de lui. Ils appartiennent à des classes sociales différentes.