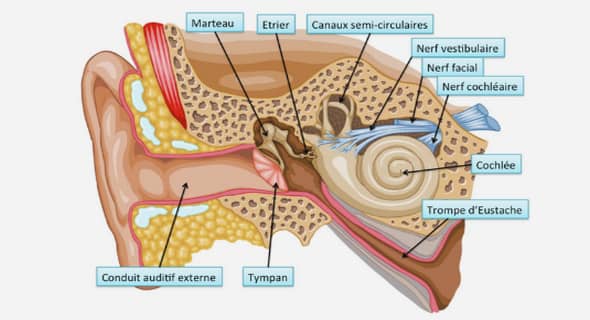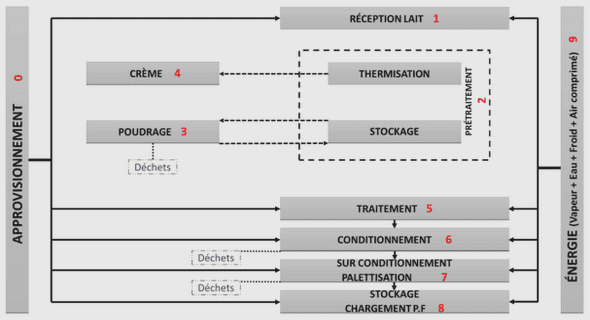Des DPs aux portes de la France : se protéger du surplus démographique de l’Allemagne
Que les DPs soient en Sarre ou dans les autres Länder de la ZFO, leur présence prolongée aux portes de la France inquiète certains politiques français. Ils sont considérés comme un poids dangereux pour une Allemagne surpeuplée, se relevant à peine des ruines de la guerre et n’étant pas en mesure de les absorber. En août 1947, un rapport de la Commission des Affaires étrangères présente la coopération avec l’IRO comme un moyen d’assurer la sécurité française : « la situation géographique de la France lui commande aussi de rechercher une solution internationale du problème1344 ». L’IRO permettra d’éviter que le mouvement de réfugiés ne devienne anarchique et que les frontières françaises ne soient assaillies. Ces préoccupations ne sont pas propres aux Français et à la période IRO. Par exemple, en 1946, l’ECOSOC estime que « les camps s’étendent comme un cancer sur toute l’Europe centrale » et qu’ « ils retardent l’avènement d’une paix durable, augmentent la surpopulation de l’Allemagne et de l’Autriche et pompent la sève vitale de ces pays1345. » Au printemps 1947, on peut lire sous la plume de la délégation française envoyée à la conférence de Moscou : […] La question démographique allemande est capitale sur le plan de la sécurité comme elle l’est sur le plan de l’économie […]. Ces mesures – qui préviendraient des « tendances d’expansion qui s’ensuivraient infailliblement » – sont les transferts de population allemande (notamment les expulsés des pays de l’Est), l’émigration des Allemands et celle des DPs, ou le rapatriement de ces-derniers1347. Dans le contexte de déclin démographique de la France, à Paris, on est surtout inquiet de l’arrivée en masse des expulsés allemands des pays de l’Est1348. De manière à prémunir la France « de l’esprit d’aventure qui naîtrait, sans aucun doute, chez des Allemands qui seraient trop à l’étroit sur leur territoire1349 », le ministre français des Affaires étrangères, Georges Bidault, propose en mars 1948 d’envisager l’émigration d’un large groupe de Volksdeutsche pour la France1350.
Baden-Baden, on est également préoccupé par le surplus de population que représentent les DPs, sans parler de celui incarné par les expulsés allemands, et ce d’autant plus qu’on craint une catastrophe alimentaire dans la zone et qu’au printemps 1948 le remboursement des frais par l’IRO ne couvre pas toutes les dépenses1351. On se dit même opposé à ce que « les Personnes Déplacées actuellement en Allemagne s’y établissent à demeure et viennent renforcer la population allemande […] 1352 . » Pour sortir de cette situation, Bidault suggère d’organiser une conférence réunissant les puissances alliées et les États susceptibles d’accueillir des immigrants (« personnes déplacées se trouvant en Allemagne, juifs et populations de langue allemande venues de Pologne, de Tchécoslovaquie et de Hongrie ») et précise que : « Cela ne ferait nullement double emploi avec l’organisation internationale des réfugiés qui n’est pas susceptible de promouvoir une action sur le plan gouvernemental1353 ». Washington montre quelques hésitations à « réunir dans une même étude la question des personnes déplacées déjà traitée par des organismes internationaux, et celle de l’émigration de l’excédent de la population allemande 1354 . » Par ailleurs, les Américains prônent une résolution du problème des réfugiés avant tout sur le plan européen – colonies et protectorats inclus – ; ce ne sera « qu’après épuisement des possibilités de cet espace que la question devra être abordée du ré-ajustement intercontinental1355. » En réponse, les Français ne manquent pas de rappeler que le réarmement intensif de l’Allemagne sous Hitler a été possible de par le fort taux de chômage1356. Cette réponse n’est pas seulement stratégique mais révèle une vraie angoisse. Elle est à intégrer à l’inquiétude plus générale des Français vis-à-vis d’une Allemagne qui, soutenue par les Américains, est en train de renaître de ses cendres, de reconstituer une économie qui pourrait devenir supérieure à celle de la France, ou encore de reprendre une vie politique suite à la création d’une Assemblée constituante. Le Quai d’Orsay et les autorités françaises d’occupation craignent un renouveau du nationalisme allemand. Pour inciter Washington à adhérer à la cause française, Jean Monnet rappelle le lien intrinsèque entre économie française forte (et donc contrôle de la Ruhr) et sécurité européenne1357.
En 1951, le discours reste inchangé. Les Français campent sur leur position : le surplus » de population en RFA est un danger pour la France et la population excédentaire entrave la construction de la communauté européenne et la libéralisation des échanges. L’IRO, par la voix de son directeur général, Kingsley, manifeste la même préoccupation : « la présence de millions de personnes insatisfaites et non établies crée des dangers menaçant la stabilité de l’Europe et constitue une menace pour la sécurité de tout le monde occidental1358. » En octobre 1951, à Naples, est organisée une conférence internationale sur les migrations pour orchestrer la redistribution de cet excès de population ; l’idée étant de transférer en 5 ans 1,7 millions d’Européens outre-mer. Cette fois-ci la France peut donc espérer être soutenue par les États-Unis. D’ailleurs, en 1952, la politique de Truman va dans ce sens1359.
Cette question de la présence de DPs aux portes de la France ainsi que celle du devenir des DPs dans une Sarre qui change de situation administrative illustrent que, si les autorités françaises d’occupation sont moins obsédées par la perte de leur souveraineté dans les zones au profit d’un organisme international qu’à l’époque de l’UNRRA, la question DP continue néanmoins à gêner le traitement de la question allemande par la France. Les personnes déplacées participent au poids démographique de l’Allemagne ou peuvent servir d’instruments à l’IRO pour contrer les ambitions françaises dans ce pays.
PROVOQUER UN « RELÈVEMENT SOCIAL ET MORAL » DES DPS POUR AMÉLIORER LEURS CONDITIONS DE VIE ET EN VUE DE LEUR EMBAUCHE : UNE MISSION COMMUNE AUX PDR ET À L’IRO
Pour mieux cerner la coopération franco-IRO, il faut s’intéresser à leur travail auprès des DPs mêmes. Comme stipulé dans les accords de 1947, l’IRO a pour responsabilité de contrôler si les conditions de vie des personnes déplacées administrées par les autorités françaises correspondent bien à ses principes. Les administrations PDR appliquent-elles correctement la résolution n° 19 de la PCIRO émise en mai 1947 et réglementant les conditions de logement et de niveau de vie des DPs ? Respectent-elles les clauses des accords de septembre ?
L’accord concernant la ZOF stipule que « les autorités françaises s’assureront que les autorités autrichiennes font bénéficier les réfugiés de l’hébergement, du ravitaillement et des prestations nécessaires à un niveau égal à celui de la population autrichienne1360. » Dans celui pour la ZFO : « Les autorités françaises seront chargées de fournir l’hébergement, le ravitaillement et les prestations nécessaires en les prélevant dans la plus large mesure possible sur les ressources allemandes […] de façon que les rations des réfugiés soient d’une composition et d’un niveau égaux à ceux des rations des populations locales ». Si l’idée de conformer le rationnement des DPs à celui des populations locales est commune aux deux zones, le mode d’intervention est différent. En ZOF, ce sont les autorités autrichiennes qui en ont la charge tout en étant supervisées par les Français, alors qu’en ZFO ce sont directement les autorités françaises qui opèrent. Pour s’assurer que ces clauses sont (soient ?) bien respectées, des agents de l’IRO entreprennent des inspections périodiques en zones françaises. Par exemple, des nutritionnistes de l’IRO, telle Mlle Abrahams1361 pour la ZFO, sont en charge de vérifier si les menus sont adéquats aux besoins des DPs et si la ration moyenne pour un DP – hors groupes spéciaux – est au moins de 1 900 calories, soit 100 de moins que sous l’UNRRA1362. Puis, régulièrement, l’IRO met en place de nouveaux taux selon les catégories de DPs (enfants, adultes selon la difficulté de leur travail, femmes enceintes, etc.), auxquels les autorités françaises doivent s’adapter1363. Pour avoir un aperçu de l’intervention des Français et de l’IRO auprès des DPs, je vais m’intéresser aux conditions de logement de ces derniers ainsi qu’à leur mise au travail1364.
Les conditions de logement
Avec la coopération franco-IRO, les camps placés sous la tutelle de l’UNRRA sont transférés au Gouvernement militaire français. L’exemple des camps UNRRA du Tyrol illustre bien cette passation de pouvoir. Les camps de Kufstein et de Landeck sont repris par le Service PDR à la date du 1er septembre 19471365. La prise en charge de ce dernier fait l’objet le 6 janvier 1948 d’une cérémonie officielle en présence du général Béthouart et du chef de la mission de contrôle M. Voizard1366. Les délégués nationaux du Service social et le personnel DP du camp leur sont présentés. On leur fait faire le tour du centre : les bureaux, le local des scouts, les lieux de culte, les services médicaux, quelques logements d’habitants du camp. Ceux-ci, entourés d’enfants vêtus comme il se doit de costumes nationaux, sont groupés pour saluer les représentants du GM. Une « séance artistique » a été préparée par les personnes déplacées en l’honneur des invités. Le rapport établi par les administrations françaises à la suite de cette visite met en exergue la réception faite par les DPs de l’événement : ils l’ont « interprété comme la preuve de toute l’attention et de tout l’intérêt que le Gouvernement français apporte aux questions touchant les personnes déplacées1367. » Une fois que les autorités françaises ont investi les lieux, il s’agit pour elles d’adapter le fonctionnement des camps à leur propre système : Les équipes françaises d’administration des camps de Landeck et Kufstein continuent avec succès leur travail de réorganisation. Après avoir rétabli dans ces camps une vie plus disciplinée, elles apportent un soin tout particulier à essayer de résoudre au mieux les différents problèmes sociaux qui se posent : instruction, mise au travail, aide matérielle et spirituelle, lutte contre le marché noir, etc. Des résultats appréciables ont été déjà enregistrés et la grosse majorité des habitants de ces camps approuve et soutient l’action de leur chef de camp1368. »
Les autorités françaises veulent donc se démarquer de l’UNRRA et sont soucieuses de l’image que les personnes déplacées vont retenir de la France et qu’elles vont véhiculer plus tard à l’étranger. Par la mention « après avoir rétabli […] une vie plus disciplinée », les PDR montrent que leurs méthodes – que j’ai décrites comme militarisées dans les précédents chapitres – se différencient de celles de l’UNRRA.
En ZFO, Poignant informe périodiquement la Direction PDR des remarques faites par les officiers IRO suite à leurs visites des camps. D’ailleurs, en février 1948, il écrit à la Direction PDR qu’il est « obligé de […] signaler l’état déplorable de certains camps en […] priant de vouloir bien donner des instructions énergiques afin qu’il soit rapidement porté remède à une situation qui ne saurait se prolonger 1369». La zone souffre du surpeuplement des grands camps, véritable obstacle à l’amélioration de la condition sociale et morale des DPs.
Certaines personnes déplacées se plaignent des conditions de vie qui leur sont faites dans les Centres de la Zone, faisant des rapprochements avec les camps de concentration et d’extermination allemands du IIIe Reich1370.
S’il y a lieu de faire la part d’exagération dans ces plaintes, il n’en reste pas moins que certains Centres ne sont pas tenus avec tout le soin désirable. Il est extrêmement important que des aménagements soient apportés d’urgence aux locaux déficients.
Par ailleurs, certains Centres ont encore des oisifs momentanés. S’il n’est pas possible de les mettre au travail pour diverses raisons valables, certaines agences volontaires (YMCA, Croix-Rouge) peuvent contribuer à réaliser des salles agréables qui transformeront l’ambiance des camps qui rappellent encore trop souvent les Stalags1371 », rapporte la Direction PDR en février 1948.
Si cette description date de 1948, elle rappelle – par sa comparaison des camps DP à des camps nazis – celles de l’avocat Earl Harrison en août 1945. Ce dernier comparait alors les conditions de vie des DPs à leur traitement sous domination allemande1372. En trois ans, les conditions de vie des DPs ne se sont donc que peu améliorées, même si le concept de camp DP a évolué. Alors qu’au sortir de la guerre, les camps font partie d’un vaste programme ayant pour but d’assurer une transition rapide de la guerre à la paix, ils apparaissent en 1947, après la fin des rapatriements massifs, comme des habitations pour des personnes en attente d’émigration. De sorte qu’ils sont devenus des « sites normatifs de sortie de guerre1373 ». L’IRO règle la hauteur des cubicles dans les camps, la largeur des espaces entre les lits, la proportion des ouvertures. Sont prévus environ 3 mètres carrés (35 pieds carrés) pour chaque personne déplacée. Ce n’est qu’en 1948 que l’IRO juge cette norme insuffisante et souhaite que 45 pieds carrés soient alloués par personne1374. Mais l’écart persiste entre ces normes et la réalité. Au camp d’Ebingen (ZFO), certaines des pièces accueillent encore en 1948 jusqu’à 22 personnes et servent tour à tour de dortoir, de réfectoire et de buanderie. Femmes enceintes, vieillards, nourrissons, enfants, jeunes adultes peuvent se trouver dans une même pièce. Il est pratiquement impossible de se laver. Les toilettes sont mixtes et certaines sont dépourvues de portes. Outre le surpeuplement, la plupart des camps des zones françaises sont organisés dans d’anciennes casernes de la Wehrmacht « souvent même remis[es] en état avec les moyens du bord, par les personnes déplacées1375 ». Les conditions de vie restent difficiles, comme à l’été 1948, au camp de Münsingen (ZFO) où les baraques en bois du camp sont infestées de punaises. On est loin de la suggestion de Koenig de loger les DPs dans « les propriétés et les châteaux, actuellement encore sous séquestre, des criminels de guerre nazis1376. »
Le SEAAA invite à prendre rapidement des mesures de manière à ce que la mission IRO n’ait plus de raison d’être en zones françaises d’occupation et que les DPs soient mieux installés. Ceci est d’autant plus urgent que l’IRO demande à cette même période à reprendre le contrôle des camps. Les autorités françaises recherchent alors activement des locaux susceptibles d’être transformés en petits centres et accordent des avantages aux DPs s’installant en privé. Selon la Direction PDR, le décongestionnement des camps permettrait par ailleurs le « redressement moral de la population des centres et agglomérations de Personnes Déplacées1377 ». Elle prône la vie « en privé1378 » :
Il est indéniable que le système qui consisterait à maintenir les Personnes Déplacées dans les camps est un système indigne, qui diminue l’homme. Ce n’est pas dire par là qu’il ne devrait plus y avoir de camps, mais il ne devrait plus y avoir de camps que pour réunir les familles ou les isolés qui n’ont pas trouvé la possibilité de vivre en privé.
Le Chef du Service des Personnes Déplacées souhaite que tous ses collaborateurs et leurs agents œuvrent de façon à disperser les camps, c’est-à-dire à placer temporairement le plus possible au dehors toutes les personnes qui peuvent être utilisées dans l’économie allemande ou dans les services français d’occupation.
Aucun élément valide ne doit rester oisif dans un camp.
Cette dispersion aura le double avantage d’éviter une constante promiscuité qui est toujours extrêmement dangereuse et de donner l’impression d’une vie familiale […]1379 ».
Permettre aux DPs de vivre en privé aurait aussi des avantages financiers pour les autorités françaises qui ont besoin de faire des économies. L’IRO, qui doit rembourser une partie des dépenses, a également tout intérêt à cette réduction ; elle pourrait de la sorte réaliser des économies sur le chapitre Care and maintenance au profit du chapitre Emigration1380. Cette politique consistant à faire passer les DPs du système de camp à celui de la vie en privé revient finalement à opter pour les principes de l’UNRRA qui voyait dans ce dernier mode de logement un meilleur moyen pour les DPs de se reconstruire1381. Du fait notamment de l’impossibilité à pouvoir réquisitionner davantage de logements sur la population allemande, Poignant craint que la Direction PDR ne se heurte à de graves difficultés et rende impossible aux DPs de se loger. En outre, la dispersion des DPs porterait préjudice à leur recrutement et elle les obligerait à des déplacements parfois inutiles, et qui ne sont pas faits pour relever le moral1382. » Français de Paris et des zones, comme IRO, ont donc des soucis communs : faire des économies et éviter l’ « oisiveté » des DPs. Toutefois, les autorités françaises d’occupation déclarent que le système de distribution de fournitures mis en place par l’IRO fait « grossir les rangs des oisifs », poussant les DPs à l’inaction et avantageant « une seule catégorie qui ne semble pas être […] la plus digne d’intérêt1383 » : certains DPs profitent indûment » de l’aide de l’IRO1384 et, d’autres, ou les mêmes, au lieu de travailler, usent de leur temps pour faire « des réclamations futiles et inopportunes1385 ».
Sortir les DPs de l’«oisiveté» par le travail
Le SEAAA à Paris est lui aussi sévère quant aux conséquences de l’amélioration des conditions de vie des DPs : les rations alimentaires actuelles « encouragent les personnes déplacées à se complaire dans leur situation », voire à participer au marché noir1386. Les DPs sont-ils à considérer comme des travailleurs sans particularité psychique et socio-économique ? Quelle est la politique de mise au travail des autorités françaises ? La coopération franco-IRO va-t-elle pouvoir sortir les DPs de leur état « oisif » ?
Les DPs, des êtres considérés comme apathiques
Très tôt, sociologues, médecins, agents de l’IRO ou membres des agences volontaires essayent de définir l’état moral et psychologique des DPs. Si une majorité des analyses abonde dans le même sens, présentant les DPs comme des êtres apathiques, on constate cependant une certaine ambivalence dans l’image d’ensemble qui se dégage des conclusions : d’un côté, le DP est un être « complètement asocial », « abattu », « désaxé », « déprimé » qui vit dans un « monde irréel », et de l’autre il est confiné « dans un périmètre restreint » du camp, il doit se « réintégrer dans un nouveau cadre ».
Certains observateurs manifestent en effet une prise de conscience du cadre exceptionnel dans lequel évoluent les DPs et les obstacles à une vie « normale » que représente ce cadre. Le psychiatre britannique Henry Murphy constate « une véritable mentalité de camp de réfugiés (“DP-camp mentality”), stimulée par le confinement dans un périmètre restreint et par la routine quasi-militaire des camps de l’OIR1387 ». Un autre psychiatre, le français Henri Stern, insiste sur l’importance des structures économiques et sociales dans le développement des maladies psychiques chez les personnes déplacées1388. L’abbé polonais Walczewski évoque quant à lui les effets néfastes, sur un psychisme déjà fragile, de la promiscuité dans les camps et d’absence de vie privée1389. L’historienne de l’IRO, Louise Holborn, écrit de son côté: Affaiblis par la misère et les privations, désaxés par une vie anormale, ils devaient supporter de longues périodes d’inaction dans l’instabilité des camps. La monotonie d’une existence sans but dans des centres surpeuplés et l’impossibilité de prétendre à un minimum de vie privée avaient brisé tout esprit d’initiative. Beaucoup se résignèrent. Déprimés par une longue attente et par une oisiveté dont ils n’étaient pas toujours responsables, ils devenaient apathiques1390. »
Suite à son passage dans des camps de DPs baltes, le psychologue estonien Edward Bakis publie une étude sur l’ampleur des traumatismes liés à la guerre et à l’exil et décrit ce que les DPs eux-mêmes appellent la « DP-apathy »1391. Il rapporte que le temps passant et les perspectives d’avenir demeurant maigres, les crimes commis deviennent plus graves, l’absentéisme au travail plus récurrent, la participation à la vie interne du camp moins fréquente…
La promesse d’une émigration peut agir comme un remède à cette vie sans projection dans l’avenir. Un membre du Joint, Koppel Pinson, abonde dans le même sens à propos des DPs juifs. Par ailleurs, les employés du Joint remarquent que dans les kibboutzim, les DPs récupèrent mieux psychiquement que dans les camps DP car ils y ont un projet collectif et commun, y travaillent, ont accès à une nourriture plus variée, ont une volonté de transmettre et sont mobilisés par la perspective d’une émigration en Palestine1392. La position d’attente devient une normalité pour les DPs, elle est au cœur de leur vie quotidienne. Le terme de « salle d’attente » est même utilisé par l’administration et les DPs eux-mêmes pour qualifier les camps DP1393. L’attente pour une émigration, l’attente pour une réponse à leur sort. D’elle naît l’apathie.
D’autres observateurs contemporains dressent, eux, des tableaux sans nuance des DPs. Par exemple, pour l’ancien case worker de l’IRO John Stoessinger, le réfugié-type est un être rude, irresponsable et finalement, complètement asocial1394 ». Le Service social d’aide aux émigrants (SSAE) constate que « quiconque a approché les réfugiés a pu remarquer leur esprit tendu, préoccupé […]. Tout à leurs tristes pensées, ils ne parviennent pas à se concentrer sur les tâches nouvelles qui leur sont confiées1395 ». Cette incapacité des DPs à se concentrer est aussi déplorée par une mission française de recrutement de travailleurs en Allemagne, confrontée « à la masse amorphe que constitue un camp de DPs » et à « l’esprit moutonnier » des réfugiés « qui tous se précipitent vers le même groupe, l’agriculture par exemple1396 ».
D’autres doutent de la capacité des DPs à pouvoir dépasser cette apathie. Suite à une visite des camps DPs à la toute fin des années 1940, Dominique Pire – religieux belge et futur prix Nobel de la paix – dépeint l’état d’esprit des DPs et utilise un certain nombre d’images et de termes (désaxé, asocial) déjà employés par les observateurs cités1397 : Mais je dois pourtant essayer de leur1398 faire comprendre ce que c’est qu’un D.P., ce que le Hard Core était en 1949. Pourquoi ces déracinés étaient devenus lentement des désaxés, des déshumanisés. Pourquoi ces gens, qui n’étaient pas nés asociaux, l’étaient devenus…
[…] Le réfugié est d’abord un déraciné. Il flotte entre l’Europe de l’Est qu’il a fui, et un Ouest qui ne s’ouvre bien souvent à lui que s’il a gardé de la force musculaire utile. Il vit pendant de longues années dans un camp ou dans une vieille caserne. Il s’aigrit. Je l’ai souvent défini : “ Un apatride vidé et désespéré ” […].
Vidé et désespéré : le déracinement entraîne la pire des misères qui puisse toucher un être humain : ne plus croire à la possibilité de l’amour fraternel. C’est pourquoi tant de réfugiés sont amers, boivent pour noyer leur chagrin, manquent parfois de propreté, d’esprit d’économie, d’esprit de travail. Ce n’est pas une paresse, c’est une rouille de l’âme. Ils manquent de réalisme, rêvent à la patrie perdue ou à un avenir impossible à atteindre1399. »
Dans son rapport de 1953, pour le compte de l’ONU, le politologue français Jacques Vernant décrit ainsi les réfugiés : « le réfugié présente souvent un manque total de motivation. Il ne dispose plus de l’élasticité nécessaire à un homme abattu quand il doit se réintégrer dans un nouveau cadre. Cette incapacité, tant physique que psychologique, est due à l’oisiveté forcée à laquelle le réfugié est contraint1400. » Comme l’analyse Daniel Cohen, « cette observation [de Jacques Vernant] n’est pas seulement remarquable par sa définition du réfugié comme entité à la fois individuelle et masculine. Le réfugié aurait aussi son caractère propre, apathique, détaché et mélancolique. Surtout, en droite ligne avec les théories de la psychologie des peuples et du “caractère national”, le peuple réfugié aurait son âme, forgée par cinq années de vie dans l’univers terne des camps de l’OIR » ; et de conclure que « la pathologisation des personnes déplacées constitue ainsi le versant médical et psychologique de la constitution des réfugiés en peuple homogène réalisée entre 1945 et 19511401. »
L’apathie est un phénomène courant chez les réfugiés, DP ou non, de l’immédiat après-guerre ou non, d’Europe ou d’ailleurs. La particularité des DPs est de vivre en temps de paix, entourés d’une population encore ennemie quelques mois, quelques années auparavant et ce dans un pays administré par des puissances occupantes, le plus souvent alliées de leur patrie d’origine. Trouver des repères pour le DP en pleine reconstruction est d’autant plus difficile qu’il évolue dans un pays – l’Allemagne ou l’Autriche – lui-même en plein relèvement et divisé en deux par la Guerre froide. L’autre particularité est d’être la cible d’une propagande au rapatriement très intensive ; ce qui pour certains a peut-être alimenté une tergiversation entre rentrer ou non. Par ailleurs, dans les zones françaises, pour la majorité des personnes déplacées, l’« oisiveté » évoquée dans les documents présentés plus haut s’explique entre autres par le contexte socio-économique local : La main d’œuvre PDR disponible dans les camps est de moins en moins sollicitée par les offices de travail, de telle sorte que des artisans et ouvriers spécialistes en nombre important mènent dans les camps une oisiveté imposée par les circonstances1402 », écrit le Service PDR du Tyrol en mai 1948. Seulement moins d’un tiers des DPs aptes au travail trouvent un emploi. En Autriche, les travailleurs DP sont souvent écartés des postes au profit des autochtones. En ZFO, les personnes déplacées rencontrent des difficultés au sein de l’économie locale et auprès des entreprises françaises (notamment forestières) sur place. D’autres obstacles encore se présentent à elles : leurs relations avec les Allemands et les Autrichiens, la distance qui sépare leur logement du lieu de travail, le manque de vêtements adéquats, etc.1403. Travailler pour les services de l’occupation s’avère également de plus en plus difficile. En novembre 1947, en ZOF, le Service PDR affirme qu’il n’y a plus aucune raison que les camps, qui étaient auparavant sous la tutelle de l’UNRRA, continuent à employer 7,5% de l’effectif total des résidents d’un camp ; et qu’ils doivent se soumettre au même système que ceux gérés directement par le Service PDR, lequel consiste à n’embaucher que 5% des résidents. La situation des travailleurs DP s’aggrave encore suite à la réforme monétaire de juin 1948 en Allemagne1404.
L’ensemble des analyses des observateurs a en commun de présenter l’oisiveté comme un danger pour la reconstruction psychologique, économique et sociale des DPs. Selon les autorités d’occupation occidentale, elle pousse aussi à la délinquance ou encore au désir de revanche1405. L’oisiveté étant reconnue comme étant à l’origine de l’apathie, les solutions prônées par les Français sont la mise au travail des DPs et leur émigration.
La critique française de l’oisiveté et la valorisation du travail
Les autorités françaises expliquent donc régulièrement l’apathie par l’inactivité professionnelle des DPs qu’elles évoquent également sous le terme de « oisiveté ». L’utilisation de ce terme n’est pas propre au monde des DPs. À la fin du 19e siècle, lors de la création et de la définition de la catégorie « population active », celle-ci est opposée à celle des « oisifs ». L’oisiveté est alors synonyme d’inactivité professionnelle. À partir du début du 20e siècle, des connotations morales sont appliquées aux différentes catégories de chômeurs 1406 . Dans la France d’après-guerre, le terme « oisif » fait toujours partie du vocabulaire administratif du monde du travail : en juin 1948, dans le cadre de la politique de hausse des impôts conduite par René Mayer1407, est créée la « taxe sur les oisifs ». Le projet de loi prévoit l’institution d’un impôt de capitation de 50 000 Francs pour « toute personne de sexe masculin, majeure et âgée de moins de 60 ans qui ne pourra justifier avoir exercé en 1947 une activité professionnelle susceptible de subvenir à son existence1408. » L’apport attendu de cette taxe est du point de vue budgétaire presque négligeable et elle répond à une préoccupation de justice fiscale qui peut se teinter de moralisme. Frédéric Tristram note que sur un plan plus strictement juridique, la taxe sur les oisifs devient une illustration du “devoir de travailler”, rigoureux principe inscrit dans le préambule de la Constitution de la Quatrième République en octobre 19461409 ». Finalement cette loi n’est pas adoptée : la notion d’activité professionnelle apparaît très difficile à traduire juridiquement, tout comme le classement des oisifs en catégories. Et Frédéric Tristram de conclure : « La taxe sur les oisifs témoigne en outre d’une certaine conception de la fraude fiscale à la fin des années quarante, encore très liée au contexte d’une économie de restriction et au marché noir. Dans l’esprit des fonctionnaires fiscaux, le fraudeur c’est principalement le trafiquant, le délinquant, l’homme sans situation ni domicile assurés1410. » On peut remarquer que ces points, à savoir la crainte que les sans-emploi sombrent dans le marché noir, voire dans la délinquance, et injonction à travailler, sont également lisibles dans les documents relatifs aux DPs, ce qui est peu surprenant puisqu’il s’agit d’une population sans situation ni domicile fixes.