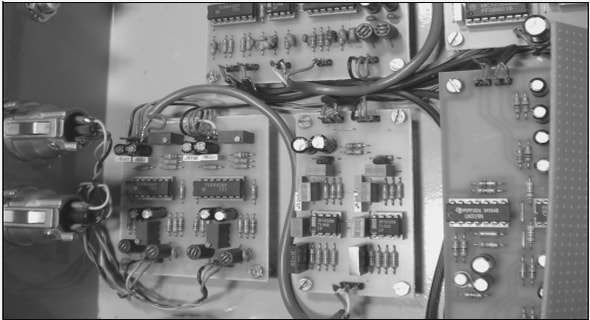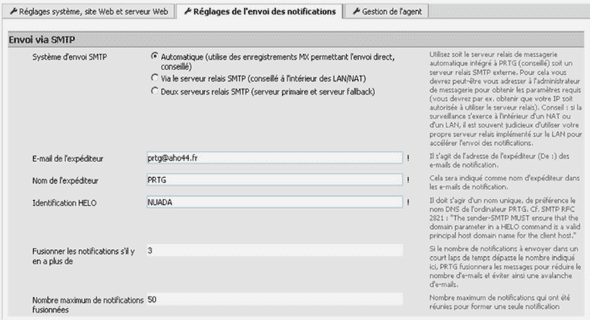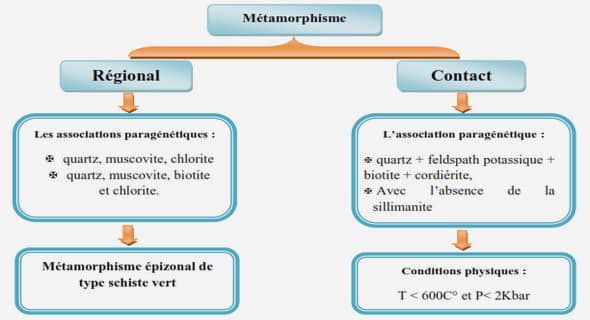Le tracé régulateur : un préalable historique et technique à l’inscription du texte
Des études en histoire, en littérature et en esthétique, notamment, s’intéressent à la matérialité du livre et autres médias ; une dimension que d’aucuns jugeai(ent) comme trop peu examinée car considérée par beaucoup comme trop triviale pour être prise en considération pour elle-même et inintéressante pour l’analyse de ces objets (Laufer, 1984 : 63). Certaines de ces études se concentrent spécifiquement sur les tracés régulateurs – également dénommés réglures ou grilles.
Cette sous-partie (A) relève les caractéristiques intrinsèques des tracés régulateurs et la diversité de leurs usages dans plusieurs contextes de pratiques et domaines d’activité en développant les points suivants :
L’élaboration, le développement et la diffusion, par les premiers artisans du livre, des principes graphiques de mise en protection, en forme et en lisibilité du texte caractérisant les réglures.
La permanence de ces principes lors de la transformation et de la multiplication des schémas de grilles – héritières des réglures – engagées par le collectif éditorial qui s’occupe de la mise en page de contenus17 divers et variés.
Les spécificités de la réglure normalisée Séyès et les usages de cette dernière dans le cadre spécifique de l’apprentissage de l’écriture et dans le cadre général de la communication pédagogique.
L’importation de la réglure Séyès et la création de tracés originaux dans le domaine littéraire, leur emploi par les écrivains dans l’activité d’élaboration des textes et la standardisation des grilles automatiquement générées par les logiciels de traitement et de présentation des textes, de gestion et de publication des contenus.
Les réglures du livre courant…
Vers 3300 av. J.-C., l’argile est le matériau utilisé par le scribe mésopotamien pour la fabrication de tablettes – dont les dimensions correspondent souvent à celles de sa main.
l’aide d’un calame, il grave – verticalement de droite à gauche puis par la suite horizontalement de gauche à droite – des signes qui constituent son texte – économique, littéraire ou divinatoire par exemple18. Les lignes de texte ainsi composées couvrent toute la surface du support et forment in fine un pavé – ou plusieurs lorsque la largeur du support le permet (Arnaud, 2014). Dans l’Égypte antique, le scribe inscrit d’abord des cadres sur la surface du volumen – soit un ensemble d’une vingtaine de feuilles de papyrus dont la largeur correspond au champ visuel et à l’ouverture des bras du scribe et la hauteur correspond à la longueur de sa cuisse utilisée comme appui lors de la rédaction (Zali, 1999 : 13-14). Il remplit ensuite ceux-ci de signes tracés à l’encre de droite à gauche, de haut en bas, en colonnes puis en lignes19. Ainsi placé à distance des limites du support et à la différence du texte mésopotamien qui court d’une extrémité à l’autre de la surface, le texte égyptien – administratif, juridique, littéraire, religieux, scientifique – est entouré de marges (Thibault, 2002 ; Vercoutter, 2014). Ensuite, à partir du IIe siècle de notre ère, lorsque le texte passe lentement du papyrus au parchemin et du volumen au codex – soit un ensemble de cahiers constitués de feuilles découpées et pliées –, les deux principes de mise en forme que sont la justification et le margeage demeurent appliqués (Thibault, 2002). Les textes grecs et latins se développent donc également sous forme de pavés rectangulaires ceints d’un périmètre marginal et seront ainsi dupliqués par les copistes médiévaux.
Au Moyen Âge, préalablement au travail de copie et après constitution des cahiers du codex, le copiste inscrit sur chaque feuillet des lignes formant un quadrilatère. Ces cadres – souvent rectangulaires et parfois carrés – sont dits d’empagement car ils délimitent les pages soit les surfaces spécifiquement dédiées à l’inscription du texte20 (Zali, 1999 : 24). Ils sont également appelés cadres de justification car simultanément ils déterminent la longueur des futures lignes d’écriture, l’emplacement précis de leur départ et de leur fin (Muzerelle, [1985] 2002-2003 ; Parisse, 2001 : 294). Ensuite, le copiste trace à l’intérieur des pages des traits horizontaux composant la linéation21 – qu’il suivra scrupuleusement au moment de la copie car elle assure le respect du ductus des lettres et la rectitude des lignes d’écriture tout comme le confort de lecture. Enfin, il ménage à l’intérieur de la page de petits cartouches vierges qui, une fois le travail de copie terminé, seront remplis par les rubriques – soit les titres, sous-titres et résumés –, les pieds-de-mouche, les initiales22, les bordures, les miniatures, etc., réalisés parfois par le copiste lui-même et plus communément, à partir de la période gothique, par le rubricateur, l’enlumineur, le miniaturiste (Salles, 1986 : 63 et 70 ; Parisse, 2001 : 294). Ainsi, la réglure médiévale – dont les prémices remontent aux écrits de la plus haute antiquité – dote le support de pages souvent rectangulaires et simultanément de marges encadrantes, impose la rectitude et une longueur aux lignes de texte, uniformise l’écriture par le calibrage des lettres, organise le contenu en signalant et en hiérarchisant ses parties constitutives. En somme, elle est une application ancienne du « principe du casier » : Ce principe, que nous pouvons appeler le “principe du casier”, sous-tend toute la syntagmatique du texte écrit. Le texte présuppose une surface, et cette surface se divise, en fonction du texte, en un certain nombre de cases. Le principe du casier est celui des “boîtes chinoises” ; c’est-à-dire que les cases les plus petites se trouvent à l’intérieur des cases plus grandes. Il s’agit d’une hiérarchie fondée sur des inclusions successives. » (Harris, 1993 : 229.)
Dans certains cas, la réglure détermine également la composition des enluminures – et les proportions des figurines humaines peintes – tout comme leur rapport avec la surface écrite en vue d’établir un dialogue subtil entre texte et image et une architecture d’ensemble équilibrée – comme le révèle notamment l’étude de manuscrits iraniens du XIVe siècle (Porter, 2003 : 67).
Au milieu du XVe siècle, les premiers imprimeurs adoptent les habitudes médiévales et notamment le principe d’une infrastructure graphique sous-jacente et préalable à la mise en pages des incunables dont les textes denses sont encore fragmentés en colonnes compactes et dont la réalisation des pieds-de-mouche, initiales, etc. est encore laissée à la charge du rubricateur et de l’enlumineur une fois l’impression du texte réalisée (Salles, 1986 : 101 ; Blaselle, 1997 : 66 ; Jean, 1998 : 158). De fait, les incunables ressemblent formellement aux manuscrits médiévaux (Souchier, 1999 : 41). À partir du XVIe siècle, de nombreuses innovations graphiques sont introduites par les imprimeurs dans le but de gagner en visibilité et en lisibilité – abandon de la glose au profit de la note, invention des alinéas et des arguments23, élaboration de l’écriture humanistique plus épurée que la gothique, perfectionnement de la ponctuation, déploiement du texte sur une colonne unique qui couvre tout l’espace de la page, etc. (Laufer, 1984 : 135-137; Salles, 1986 : 104-105; Blaselle, 1997: 85; Berthier & Zali, 2002). Si elle conduit d’abord à l’aération de la surface imprimée, la recherche graphique engagée dans cette voie est poussée à l’extrême jusqu’au XVIIIe siècle. Par excès de perfectionnisme, elle provoque alors une perte d’information et un certain inconfort à la lecture – remplacement des titres détaillés par des formules courtes et génériques, suppression des arguments, utilisation du Didot notamment dont les caractères filiformes fatiguent plus rapidement l’œil du lecteur par rapport au Garamond précédemment utilisé (Laufer, 1984 : 137).
La mise en pages des livres du XIXe siècle est quant à elle très dense en raison d’une ornementation excessive et ostentatoire. Néanmoins, comme aux siècles précédents, son organisation générale ressemble encore à celle des manuscrits médiévaux et des premiers imprimés du fait de l’utilisation continue de tracés régulateurs et ce jusqu’au XIXe siècle : si les diverses innovations des cinq premiers siècles de l’imprimerie conduisent à l’élaboration du livre tel que nous le connaissons encore aujourd’hui, il apparaît également que les principes d’empagement, de justification, de margeage, de linéation et de rubricage demeurent. La réglure sert encore à l’arrangement du texte et à l’aménagement symétrique de la double-page.
En toute fin du XIXe siècle, en France, Stéphane Mallarmé avec Un coup de dés jamais n’abolira le hasard (1897) bouscule la réglure séculaire et propose un modèle de typographie expressive faisant fi des normes de lisibilité traditionnellement établies. Cette conception plus picturale qu’architecturale du texte est en début de XXe siècle reprise et diversement déclinée notamment par Apollinaire avec ses Calligrammes (1918) et d’autres poètes et peintres dadaïstes et futuristes – comme Filippo Tommaso Marinetti, Cendrars et Sonia Delaunay (Renoult, 1986 : 381). Dans les années vingt, en Europe et précisément en Allemagne, sous l’influence des idées et des réalisations du Bauhaus, du suprématisme, du constructivisme, du De Stijl, une « nouvelle typographie » ou « typographie élémentaire » se fait jour – définie et portée en premier lieu par le praticien et théoricien de la typographie Jan Tschichold. En décalage avec la typographie classique respectueuse des canons ancestraux et plus précisément avec celle du siècle précédent caractérisée par son ornementation ostentatoire, celle-ci se veut fonctionnelle, économique, efficace, intelligible, épurée. De cette visée découlent : la déclinaison de la forme en fonction des différents types de textes ou messages, la maîtrise et l’amélioration des techniques manuelles et mécaniques de composition et d’impression, la plus grande hiérarchisation des informations, la conception et l’utilisation de typographies bien lisibles, mais également l’élaboration et l’application de tracés régulateurs dissymétriques d’une page à l’autre en vue d’apporter un certain dynamisme à la composition. Cette « nouvelle typographie » suscite autant l’adhésion que le rejet24 – les adversaires l’accusant de verser dans la doctrine – mais servira, plus tard, de base à un courant majeur du design graphique (Baudin, 1975 : 44-48). Dans les années trente, l’édition spécifiquement destinée aux enfants est clairement influencée par les propositions offertes par la typographie expressive et la nouvelle typographie. Reflétant graphiquement les idées de l’époque en matière d’éducation et de lecture, les albums25 font la part belle à l’image, aux marges généreuses, à l’écriture cursive, aux caractères de tailles variables, aux couleurs vives inondant la double page de grand format26. Les manuels scolaires vont également évoluer dans le sens de ces innovations en présentant notamment une hiérarchisation du contenu des leçons par l’emploi de couleurs différenciées – pour les différents titres et sous-titres, le questionnaire sur la leçon, les légendes des illustrations – et par une diversification des éléments graphiques – filets, bordures –; en employant le document imagé – cartes, photographies, dessins – à titre de complément à l’enseignement par le texte seul (Renoult, 1986).
Tschichold lui-même revient sur ses positions plus tard, lorsqu’en 1938, exclusivement tourné vers la mise en pages du livre, il abandonne la composition asymétrique au profit d’un tracé traditionnel symétrique et critique violemment la nouvelle typographie autrefois prônée qu’il qualifie désormais d’uniformisante et d’autoritaire en référence directe au contexte politique de l’Allemagne d’alors, à l’accession au pouvoir d’Hitler (Baudin, 1975 : 51).
Ceux du Père Castor (Flammarion, 1931) et de Babar (Hachette, 1939) par exemple.
L’institut allemand de normalisation (DIN) fixe avant 1930 les dimensions des imprimés. Elles sont reprises par l’organisation internationale de normalisation (ISO) et son comité français (l’AFNOR). Les formats définis par la norme ISO 216 se répartissent selon 3 séries : la série principale A, la série additionnelle B et la série additionnelle C. La série principale débute et se termine avec les formats A 10 (26 × 37 cm) et 1A 0 (1682 × 2378 cm) et compte les formats courants A5 (148 × 210 cm), A4 (210 × 297 cm), A3 (297 × 420 cm).
Néanmoins, ces changements graphiques concernent surtout les productions de secteurs bien circonscrits de l’édition – l’édition jeunesse, l’édition scolaire, l’édition publicitaire – et ne révolutionnent pas pour autant l’organisation classique des feuillets du livre courant. La persistance de l’usage de la réglure canonique pour la mise en pages des livres imprimés à l’époque s’explique par les procédés techniques employés, par l’observance des préceptes traditionnels de la part de la profession et par leur enseignement : La mécanisation croissante du travail dans les imprimeries au début du XXe siècle ne s’accompagne pas de bouleversements fondamentaux des traditions de mise en pages. Bien au contraire, la généralisation des composeuses mécaniques apparaît comme un facteur de consolidation des usages. De par leur conception même la Linotype et la Monotype ont été construites pour produire des lignes justifiées. Quant au reste du travail de composition, il demeure dans ses principes et dans sa pratique inchangé. “Selon notre enseignement, les pages d’un livre bien conçu sont en formes de rectangles verticaux, divisés en paragraphes dont les lignes comptent environ dix à douze mots, régulièrement espacés et composés dans un caractère dont les dimensions et le dessin sont à la fois commodes et familiers27…”. Ces principes de la typographie que rappelle en 1929 Stanley Morison se sont transmis dans les ateliers mais aussi par le biais des écoles qui se sont multipliées vers 1880, ou encore par l’intermédiaire des manuels de typographie. Ils sont fondés sur l’homogénéité de la composition, le juste équilibre des marges, la discrétion des caractères, l’harmonie de la page et du texte. » (Renoult, 1986 : 377.)
Après la Seconde Guerre mondiale, le mot et la forme sont discutés : au plan lexical, le terme grille28 est préféré à celui de réglure. Inspirée par la programmation télévisuelle et radiophonique qui se présente sous forme de « grille de programmes », la formule grille éditoriale » émerge alors dans le champ du graphisme au milieu du XXe siècle (Pignier & Drouillat, 2008 : 95) et supplante le terme originel au cours des décennies suivantes29.
En somme, le tracé régulateur apparaît aux premières heures de l’écriture et ordonne également le champ graphique du codex en y instaurant des marges, des pages, des cartouches et des lignes qui participent à la mise en forme et en lisibilité du contenu. Le schéma monobloc de la réglure disposée symétriquement sur les feuillets s’impose aux incunables puis aux livres jusqu’à sa remise en question qui s’engage à l’orée du XXe siècle. Dès lors, apparaissent les grilles modulaires organisant un peu différemment les surfaces d’inscription.
Influencés par les idées et réalisations urbanistiques et architecturales de Le Corbusier, artistiques de Kasimir Malevitch et Piet Mondrian, typographiques de Jan Tschichold – qui ont tous considéré, en théorie comme en pratique, les tracés régulateurs –, les graphistes, maquettistes, typographes se réclamant du style typographique international ou style suisse30 – comme Emil Ruder, Armin Hofmann et Joseph Müller-Brockmann – conçoivent et utilisent la « grille modulaire » comme base nécessaire à toutes compositions dynamiques, emploient des caractères sans empattements, prônent l’alignement du texte à gauche seulement, les colonnes étroites, les photographies plutôt que les illustrations faites à la main, etc. (Livingston, 1998 : 179). Cette grille modulaire doit son qualificatif aux modules, unités spatiales discrètes qui la composent. Les dimensions de ces modules sont homothétiques avec celles du gabarit d’empagement et se déterminent en subdivision de sa hauteur et de sa largeur. Ces modules servent à contenir ou à regrouper au sein de colonnes ou de zones spatiales horizontales et verticales tel ou tel texte, telle ou telle image, telle ou telle information (Ambrose & Harris, 2008 : 60-63 ; Pignier & Drouillat, 2008 : 95 ; Tondreau, [2010] 2013 : 11). En outre, cette grille modulaire est aussi qualifiée d’asymétrique dans le sens où le positionnement des différents blocs de texte et d’image diffère d’un feuillet à l’autre et les tailles de ces derniers sont hétérogènes (Demarcq, 1999 : 86 ; Ambrose & Harris, 2008 : 166). En France, le typographe français Pierre Faucheux devient également un fervent partisan et créateur prolifique de tracés régulateurs : Un tracé régulateur commande généralement l’équilibre des ouvrages que je crée : qu’il s’agisse d’une série de romans, d’une encyclopédie, d’un livre de club ou d’un livre d’art illustré, d’un hebdomadaire ou d’une affiche. Ce tracé est lié au format et à la matière rédactionnelle à mettre en place. J’en ai appris la méthode en 1944, quand un ami m’apporta pour le lire, le livre de Le Corbusier : Vers une architecture. Ce fut le détonateur et dans les jours qui suivirent j’appliquais au livre, des ouvrages existants ou à mes travaux en cours, la méthode qu’employaient les architectes… depuis des siècles… comme aussi Serlio, Léonard de Vinci ou Dürer, pour ne citer qu’eux, avaient créé de superbes alphabets. » (Faucheux, 1986 : 392.)
Néanmoins, à partir de la fin des années soixante, les conventions typographiques sont mises de côté par certains graphistes postmodernistes31. Ces derniers défient les principes fondamentaux d’ordre et de discipline propres au Bauhaus et à ses partisans (Livingston, 1998 : 155) et avancent notamment que l’emploi systématique des grilles provoque l’ennui et relève du diktat. Poussant à l’extrême l’initiative de Mallarmé, ils rejettent l’organisation rationnelle en faveur de la composition intuitive et s’emploient à sacrifier la lisibilité au profit de l’expression, à perturber de manière plus ou moins appuyée les automatismes de lecture afin de provoquer un effet émotionnel. Les réalisations des graphistes Neville Brody et David Carson dans les années quatre-vingt-dix sont exemplaires de cette « typographie spectacle » qui ne répond à aucune règle – no more rules » – et qui rompt radicalement avec la traditionnelle typographie rendue transparente au plan perceptif car mise au service du texte (Vandendorpe, 2003 : 16 ; Poynor, 2003). Le découpage excessif des mots, l’envahissement voire la disparition des marges, l’absence de repères stables, etc., sont caractéristiques de cette esthétique visuellement anarchique qui s’épanouit dans les domaines de la publicité, de la presse magazine et affleure le domaine du livre.