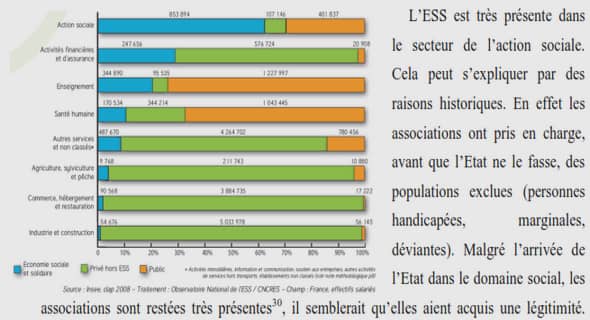Des amis aux premiers admis
Crescimbeni dans les milieux intellectuels romains
De par son rôle dans la pérennisation de l’Arcadie et dans la création d’une institution multi-située, Crescimbeni est pris dans de multiples réseaux, notamment familiaux, amicaux, académiques etc. C. Lemercier propose une définition de réseau, qui peut servir de point de départ :
Le terme technique « réseau » se réfère à un ensemble de données relationnelles, c’est-à-dire des données sur les liens qui unissent ou non un ensemble d’individus statistiques (personnes, communes, organisation…). Un réseau inclut souvent des individus isolés ; un ensemble de points isolés peut même être considéré comme un réseau (même si structure pas intéressante). L’analyse de réseaux ne vise pas à savoir si un individu est dans le réseau, mais à spécifier la place occupée dans le réseau.44
Elle poursuit ensuite par la présentation des différents types de réseaux, et sur les analyses et les questions de recherche qu’ils peuvent susciter. L’analyse structurale de réseaux traite des réseaux complets en étudiant les liens internes d’un ensemble existant (une institution), entre la totalité des membres. L’étude des réseaux personnels se caractérise par l’analyse des relations entre des individus liés à un même individu45. Ici, il est question d’une analyse égocentrée : il ne s’agit pas d’établir les liens d’un ensemble relationnel et de situer un individu dans un réseau, mais bien de comprendre les relations entretenues par Crescimbeni, à la fois personnellement et par le biais de l’Arcadie, et d’établir des degrés de relation en fonction de la régularité et de la densité des correspondants. Au sujet des réseaux de correspondances, D. Roche propose trois problématiques sur l’utilisation du réseau pour des sujets référant à l’organisation sociale : l’insertion des individus dans des réseaux diversifiés, le rapport au réseau et l’existence de réseaux multiples dès l’époque moderne au prisme de leur maîtrise et de leur efficacité46. Sa première hypothèse considère le réseau comme une trame constituée d’une architecture et d’une imbrication hiérarchique des flux, selon un classement de ces derniers inscrits dans l’espace physique à ceux plus virtuels, comme la réflexion et les idées. Ensuite, une autre piste est celle de l’ « économie » interne au réseau et sur la construction d’un système de dons, impliquant des coûts et des avantages. Par exemple, pour amorcer un commerce épistolaire avec un individu réputé, il est nécessaire de « payer un droit de passage » et d’obtenir une forme de reconnaissance par différents statuts (noblesse, admissions dans des académies etc.)47. Dans le cas de Crescimbeni, il s’agit d’établir à la fois son espace relationnel romain, déjà esquissé précédemment, et surtout son réseau de correspondants. Cette démarche fait ainsi écho aux problématiques de D. Roche en tant qu’elle vise à analyser l’existence de réseaux multiples dans lesquels s’insère Crescimbeni.
L’étude de l’insertion de Crescimbeni dans les milieux intellectuels romains ne peut se faire sans une introduction sur l’environnement et les institutions culturels de Rome. La spécificité romaine réside en l’importance de l’Etat pontifical, qui induit des relations complexes entre les lettrés et le pouvoir, et en son « polycentrisme culturel », par la multiplication des cours (cardinalices, d’ambassades, de princes étrangers) et par la profusion de cercles plus informels (salons, cabinets, bibliothèques). Parmi les principales institutions romaines, autres que les académies, se trouvent l’université et les bibliothèques de la Sapienza, consacrées aux champs théologiques et juridiques, et des collèges Romain jésuite et Clémentin, ainsi que les nombreuses autres bibliothèques privées et publiques comme la Vaticane, l’Angelica, et la Vallicelliana48. Les individus font preuve d’affiliations multiples dans les institutions romaines, car un certain nombre d’arcades est aussi pensionnaire au sein des Collèges. Pour reprendre les travaux d’A. Romano, Rome est une « ville ouverte », incarnée par un cosmopolitisme fort créé la fois par la curie internationale de l’Etat pontifical, par les nombreux voyageurs se déplaçant la fois pour la diplomatie et pour le Grand Tour et par des « occupations différenciées de l’espace urbain », qui se dessinent au regard des « groupes « nationaux » » (quartiers des Espagnols, des Français, des Florentins). Rome est aussi un « nœud de communication et une ville ressource », insérée dans différents réseaux (diplomatiques, religieux, artistiques, scientifiques)49. Comme nous le verrons par la suite50, ce cosmopolitisme international a un impact sur les admissions des membres, car 14% sont originaires d’autres états européens. Bien qu’apparaissant pour certains aspects comme une cité réfractaire aux idées scientifiques modernes, notamment cartésiennes51, Rome « serait moins cet anti-lieu de la science moderne qu’un autre des lieux d’observation de la culture hybride qui caractérise l’entier processus de constitution de la science moderne, avec la mise en place du paradigme expérimental comme synonyme de la commensurabilité »52. Dans ce cadre-ci, la complexité liée au polycentrisme culturel et au contrôle pontifical s’exprime dans la forme des académies romaines, qui peut se lire de façon duplice :
D’une part, en tant que structure organisée, codifiée par des règles, l’académie procure aux individus qui la composent les moyens d’intégrer une identité collective, susceptible d’ouvrir un conflit entre la représentation que les intellectuels se font de cette identité collective et les contraintes émanant des normes imposées par la structure. D’autre part, chaque individu mobilise les ressources de l’institution, voire celles du polycentrisme institutionnel, selon des stratégies individuelles, au risque d’un affaiblissement, voire au détriment, de l’identité collective.53
Au XVIIIe siècle, un changement de la forme « académie » s’opère : selon M.P. Donato, ce serait « un lent passage d’un type d’académie “baroque” (surtout littéraire, à fins récréatives, de mécénat privé) à l’académie comme institution publique, avec des buts principalement scientifiques, […] en correspondance avec la modernisation des équipements de reproduction des savoirs (écoles, universités, ordres professionnels) »54. Dans cet ouvrage de référence, M.P. Donato analyse les différentes institutions académiques qui organisent les groupes intellectuels romains, et l’évolution de la forme institutionnelle entre la fin du XVIIe et le début du XIXe siècle. A la fin du XVIIe siècle, les académies scientifiques ont comme fonction d’améliorer le profil culturel et moral de la prélature, et de la confronter aux idées modernes afin d’élaborer une réponse efficace. Se trouvent également à Rome des conversations érudites, où se fréquentent lettrés, cardinaux et prélats : il s’agit d’une pratique ancienne de la cour romaine, afin de discuter plus librement des nouveautés scientifiques et littéraires et d’entretenir sa réputation d’hommes de lettres savants auprès d’étrangers célèbres55. Les salons romains sont une voie de diffusion de la culture littéraire prônée par l’Arcadie et contribuent à la cohésion des milieux intellectuels dans un espace social en cours d’agrandissement par l’implication de figures féminines aux sociabilités littéraires, ce qui conduit à la multiplication des temps de rencontres et de discussion56. S’intéressant ensuite aux premiers admis à l’Arcadie, M.P. Donato conclut que les membres et aspirants de la Curie romaine ainsi que les jeunes nobles, en vue de leur carrière professionnelle ou religieuse, s’agrègent à l’Arcadie. Cela est également le cas pour les grandes familles romaines, florentines, et napolitaines, intéressées par les rapports avec les personnes importantes de la cour romaine57. Le mouvement académique littéraire romain connaît une forte attractivité au début du XVIIIe siècle, notamment grâce à l’Arcadie. Comme dit précédemment, Crescimbeni est devenu la « figure publique » de l’Arcadie. L’incarnation forte par un seul individu a permis son développement réticulaire rapide. A l’inverse, cette personnalisation du pouvoir arcadique a conduit à une difficile transition à la mort de Crescimbeni. Cela provoque un essoufflement du phénomène académique à Rome peu avant 1730, partiellement en raison de son décès, ce qui conduit à l’émergence de nouvelles formes de sociabilité, notamment maçonniques jusqu’à leur condamnation en 1734 et 173858.
Premiers admis
L’importance de l’Etat pontifical dans les réseaux intellectuels romains se perçoit en étudiant les membres de l’Arcadie. La recherche menée par A. Quondam sur l’Arcadie comme institution a proposé une analyse sociologique des membres de l’Arcadie où il définit que 21% font partie de la noblesse, 33% du clergé et 46% du tiers-Etat. Cependant, les catégories utilisées, empruntées à l’analyse sociale des académies de province françaises59 conduite à la même époque par D. Roche, reprennent la division tripartite de la société française, ne sont pas véritablement adaptées aux structures sociales italiennes, ce qui nous a conduit à mobiliser d’autres classes pour cette étude60.
Sur les 259 premiers admis en 1690 et 1691, 8% n’ont pas été identifiés. La forte présence de membres de la curie romaine se voit tout d’abord par les fonctions occupées par un nombre important d’Arcades au sein de la famille pontificale, telle que la définit M.A. Visceglia : La famille pontificale se présente comme la matrice originelle sur laquelle se greffe une articulation entre un champ bureaucratique, autonome de plus en plus complexe, mais de plus en plus strictement réservé au clergé, et une sphère du palais, qui reste liée au service personnel au pontife, dans laquelle les laïcs du XVIIème siècle sont encore présents, mais à condition qu’ils appartiennent à un réseau de familles de fidélité certaine à la curie. 61
M.A. Visceglia établit un tableau avec trente-six catégories d’offices de la famille Pontificale, entre 1591 et 1685 : fonctions religieuses (prélats, cardinaux, maîtres de cérémonie), fonctions bureaucratiques relevant à la fois du domaine judiciaire (auditeurs de la Rote, avocats consistoriaux, votants à la Signature de Justice), de l’organisation quotidienne curiale (secrétaires, camériers, palefreniers, médecins, porteurs) et de la diplomatie (ambassadeurs). Parmi les premiers membres de l’Arcadie, 19,7 % font partie de la famille Pontificale, avec notamment des cardinaux (16), des référendaires des deux signatures de Justice62 (11), et, en nombre plus réduit, deux avocats consistoriaux, deux protonotaires apostoliques et deux présidents de la Bibliothèque Vaticane.
Les pourcentages ci-après représentent une tendance, et non des données fixes, car certains individus peuvent appartenir à plusieurs catégories. Par exemple, Francesco Marucelli (1625-1703) est un abbé, et compté comme tel, mais aussi un grand bibliophile florentin. Les choix faits pour analyser les premiers admis ont été de privilégier le métier (par exemple, un chanoine lecteur a été considéré comme universitaire) et l’appartenance à des familles patriciennes ou nobles, plutôt que des compétences (bibliophile, et non bibliothécaire par exemple). Comme indiqué par M.P. Donato, les grandes familles romaines, napolitaines et florentines63 sont attirées par l’Arcadie et en deviennent membres rapidement. On constate la présence de Grands d’Espagne et de la noblesse principalement napolitaine (ducs et princes), soit 4% du total, de patriciens florentins avec la présence de deux sénateurs (Alessandro Segni (1633-1697), sénateur en 1686 et Pandolfo Pandolfini (sec. XVII-XVIII)), et deux en devenir, Filippo Buonarroti (1661-1733 ; sénateur en 1700) et Vincenzo da Filicaia (1642-1707 ; sénateur en 1695). A cela s’ajoute un certain nombre de marquis, comtes et chevaliers de différents ordres (Saint-Jacques, de Malte64, de la Toison d’Or, de Saint-Stéphane), soit 2,8% du total.