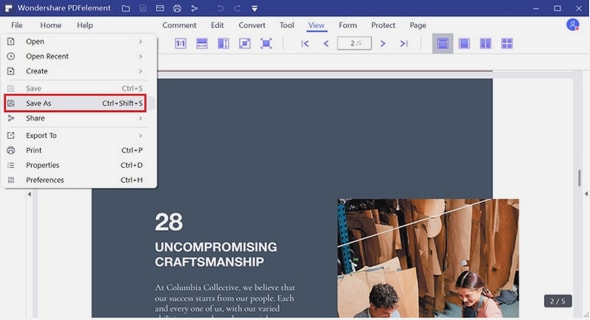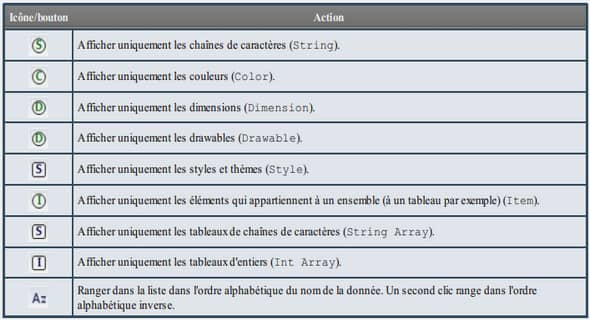Les écrivains et leurs œuvres
Les auteurs réalistes pendant le XIXième siècle voulaient montrer la société de manière aussi réaliste que possible en utilisant ce qu’ils voulaient appeler une technique, plutôt qu’un style, de décrire les gens et leurs vies habituelles comme les auteurs les trouvaient sans les romancer, simplifier ou augmenter. Les auteurs de cette époque voulaient être regardés comme des artisans plutôt que des artistes. Ils n’avaient aucune confiance en l’inspiration des auteurs romantiques, tandis qu’ils travaillaient durement avec leurs romans. Un des ces auteurs réalistes et industrieux était Gustave Flaubert.
Flaubert trouva l’histoire de Madame Bovary dans une ville où un homme malheureux s’était marié avec une fille infidèle. En outre la fille était tout absorbée des romans mauvais avec lesquels elle avait fuit sa vie monotone à la ville triste. Elle avait aussi vécu une vie splendide bien au–delà du budget de son ménage. Elle aimait surtout les vêtements coûtants et flamboyants. La famille avait eu une fin désastreuse. 1
Lorsque Flaubert trouva cette histoire, il commença à l’écrire comme le roman de Madame Bovary pour découvrir la société et les sentiments, pensées et désirs des hommes dans une petite ville au milieu de la France, sur les confins de la Normandie, la Picardie et de l’Île de France2. Au milieu de la France comme Middlemarch de George Eliot, se trouvait au milieu de la Grande Bretagne à travers la Manche, Flaubert voulait dévoiler le centre de la France. À la fois découvrant le centre de la société, et l’intériorité des hommes qui vivaient dans cette société.
Flaubert et Maupassant ont décrit une société très stratifiée avec un style précis et étroit. Les lecteurs de Madame Bovary se trouvent au milieu d’une ville rurale vers 1830. On voyage par les champs de blé et les bois profonds autour de la ville écartée de Yonville, où Emma trouvera son destin effroyable. Dans Yonville on peut sentir les odeurs, on voit les rues avec leurs magasins, les chevaux tirants des chariots et les hommes bavardant les avec les autres de la belle femme de monsieur le docteur Bovary quand ils font leurs achats.
De la même façon, les personnages dans Boule de Suif bavardent de la jeune femme prostituée, Mademoiselle Elisabeth Rousset, qu’on appelle Boule de Suif, parce qu’elle représente la fraîcheur et la pureté dans une société hypocrite et sale. Comme Jésus Christ, elle est condamnée par des gens qui se trouvent eux-mêmes convenables, mais elle est en vérité le personnage le plus juste de toute la nouvelle. Maupassant utilisait sa plus bonne plume quand il décrivait le calvaire de Boule de Suif, avec les plus fins moyens, il montrait une société sans grâce ni décence qui se cache dans un habit d’honnêteté et de respectabilité.
Dans La parure Maupassant dépeint une femme respectable, Madame Loisel, qui voudrait être plus respectée et elle finit par emprunter une parure à son amie plus riche. Mais les plumes de paon, la parure, lui devinrent fatals. Comme Madame Bovary, qui voulait aussi monter l’échelle de la société sans avoir la ruse qui est vitale pour survivre dans cette société cruelle, masquée dans un déguisement de l’amabilité la bourgeoisie. Cependant, au contraire de Madame Bovary, Madame Loisel trouvera confiance en soi pour travailler et elle ne doit plus se déguise.
Dans les textes de ce mémoire sur la stratification dans la société montrée dans l’habit, Flaubert et Maupassant avaient fait des portraits des gens qui étaient devenus des victimes d’une société inégale. C’était une société inégale aussi bien quant aux rapports entre les femmes et les hommes qu’entre les classes sociales. Cette inégalité est rendue visible dans les vêtements que les personnages des textes portent. Au même temps l’habit reflète les âmes et la fatalité du personnage du roman et des nouvelles.
Méthode et analyse de matériaux
Les textes utilisés dans ce mémoire sont Madame Bovary, le plus connu des romans de Flaubert et deux nouvelles de son ami Guy de Maupassant : Boule de suif et La parure.
Le roman et les nouvelles sont examinés par lecture proche selon la théorie littéraire sociocritique de trois parties qui racontent trois thèmes principaux : comment les habits démasquent la position des personnages dans la société, comment les habits racontent l’histoire et la psychologie des personnages et comment les habits symbolisent les caractères dans un plus grand contexte littéraire.
• Comment les habits démasquent la position des personnages dans la société
• Comment les habits racontent l’histoire et la psychologie des personnages
• Comment les habits symbolisent les caractères dans un plus grand contexte littéraire
La première source des faites sur les auteurs, leur époque et le réalisme Précis de littérature française par Christiane Lauvergnat – Gagnière et alia est utilisé. La Poétique du Roman par Vincent Jouve donne les termes littéraires employés dans ce mémoire.
Pour l’analyse des textes M. Keith Booker A Practical Introduction to Literary Theory and Criticism , Barsky & Fortier, Introduction à la théorie littéraire, sont utilisés. En approfondissent l’analyse sociale Pierre Bourdieu «La domination masculine. (Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 84), est consultée avec Richard Wilkinsson The Impact of Inequality.
Partie principale
La famille déchirée (Madame Bovary)
Pour décrire la société entière beaucoup des auteurs du XXième siècle dépeignaient la famille. Dans ce mémoire, se trouvent trois familles différentes avec certains traits en commun, et les autres traits totalement contradictoires. La première famille est celle des Bovary, une famille de la basse bourgeoisie d’une petite ville à la campagne. C’est la seule famille nucléaire des textes du mémoire; elle se compose d’une mère, d’un père et une fille, la mère Emma, le père Charles et de sa fille, la petite Berthe,.
Charles Bovary et lʼimportance des casquettes
La casquette démasque la position de Charles Bovary dans la société
L’incipit du roman Madame Bovary, on trouve un exemple de focalisation interne 3 quand un élève de la classe de l’adolescent Charles Bovary raconte, lorsqu’il fit son entrée à l’école où il était le « nouveau habillé en bourgeois »4. Normalement, Flaubert utilise la focalisation externe dans ce roman pour réaliser son idéal de l’impersonnel5. Il voulait montrer toute sa maladresse en le décrivant avec ses vêtements déviants. En plus des vêtements bourgeois, il portait : […] les cheveux coupés droit sur le front, comme un chantre de village, l’air raisonnable et fort embarrassé. Quoi–qu’il ne fût pas large des épaules, son habit – veste de drap vert à boutons noirs devait le gêner aux entournures et laissait voir, par la fente des parements, des poignets rouges habitués à être nus. Ses jambes, en bas bleus, sortaient d’un pantalon jaunâtre très tiré par les bretelles. Il était chaussé de souliers forts, mal cirés, garnis de clous.6 p. 61
La casquette raconte lʼhistoire et la psychologie de Charles Bovary
Charles Bovary était ainsi un garçon déplacé et son habit le montre parfaitement. On aperçoit qu’il avait une mère que voulait le tenir en garçon le plus longtemps possible puisqu’il était la seule raison de vivre pour elle. Pour cette raison elle l’habille avec une veste et un pantalon qui sont trop justes pour lui. Avec les vêtements d’un enfant elle essaie de garder son enfance et à la fois son pouvoir sur son fils. Avec la description des habits de Charles Bovary, Flaubert avait aussi créé une image d’une personne vulnérable et exclue de la société malgré son « air raisonnable ».
Tout le monde s’était déjà fait une opinion de lui : « habillé en bourgeois » malgré qu’il était un garçon rural et les autres garçons étaient plus habitués à la vie en ville et l’école. Charles Bovary était déplacé à l’école et en lisant le roman on s’aperçoit qu’il n’était pas non plus comme les autres personnages du roman. Il est un homme marginalisé par sa naïveté dans la société et il gardera cette vulnérabilité sociale jusqu’à la fin du roman.
La casquette symbolise Charles Bovary dans un plus grand contexte littéraire
Quand le garçon timide s’assit il montrait une autre preuve de sa gaucherie sociale en ne savant pas comment faire avec sa casquette :
Nous avions l’habitude, en entrant en classe, de jeter nos casquettes par terre, afin d’avoir ensuite nos mains plus libres ; il fallait, dès le seuil de la porte, les lancer sous le banc, de façon à frapper contre la muraille, en faisant beaucoup de poussière ; c’était là genre.
Mais, soit qu’il n’eût pas remarqué cette manœuvre ou qu’il n’ eût osé s’y soumettre, la prière était finie que le nouveau tenait encore sa casquette sur ses deux genoux. C’était une de ces coiffures d’ordre composite, où l’on retrouve les éléments du bonnet à poil, du chapska, du chapeau rond, de la casquette de loutre et du bonnet de coton, une de ces pauvres choses, enfin, dont la laideur muette a des profondeurs d’expression comme le visage d’un imbécile. Ovoïde et renflée de baleines, elle commençait par trois boudins circulaires ; puis, s’alternaient, séparés par une bande rouge, des losanges de velours et de poil de lapin ; venait ensuite une façon de sac qui se terminait par une polygone cartonné, couvert d’une broderie en soutache compliquée, et d’où pendait, au bout d’un long cordon trop mince, un petit croisillon de fils d’or, en manière de gland. Elle était neuve ; la visière brillait. 7 p.62
La casquette raconte l’histoire d’un garçon avec des parents sans argent ni culture, en montrant son manque de savoir-faire en ville. La casquette était laide mais si elle avait été vieille, une casquette héritée, le garçon aurait été plus respectable en étant pauvre. Mais « Elle était neuve ; la visière brillait. » et elle était « couverte d’une broderie en soutache compliquée » p.66. Ceci montre que la casquette était fabriquée soigneusement, ou a été achetée exprès par une mère ridicule à un garçon prédestiné au ridicule.
Flaubert décrit tout : les habits, les airs, les apparences, les paysages et les intérieurs, avec exactitude mais cette casquette est l’objet qui porte le plus de signification de tous les vêtements de ce jeune homme malheureux, Charles Bovary. Quand Flaubert développe le portrait de Charles Bovary on sait déjà tout parce qu’il avait déjà raconté sa vie à l’aide de cette casquette mélangée et laide.
Le père, un homme qui était beau auparavant, 8 p.64 avec rien d’autre que du mépris pour la mère qui était : «Enjouée jadis, expansive et tout aimante, elle était, en vieillissant, devenue ( à la façon de vin évanté qui se tourne en vinaigre) d’humeur difficile, paillarde, nerveuse. » p.65 9 Le père, trop paresseux pour travailler, vivait «en paix» dans un village où les Bovary pouvaient louer une maison « une sorte de logis moitié ferme, moitié maison de maître ». p.65 10 Comme la casquette était faite de matières provenant de la campagne de la vie d’un agriculteur (le poil de lapin), aussi bien que de la vie de la noblesse (les losanges de velours et le fils d’or). La mère compétente et le père paresseux, la vie entre la pauvreté et l’abondance, la classe entre l’agriculture et la bourgeoisie et l’aristocratie, se montrent sur la casquette. En outre, les espoirs de sa mère et l’indifférence de son père, se trouvent dans l’apparence de cette casquette aussi soigneusement décrite par Flaubert.
La réification d’un garçon montrée dans une casquette
La casquette démasque la société en entier
Le critique littéraire, George Lukacs prétendait que les œuvres littéraires réalistes montraient la société dans sa totalité avec ses structures sociales, ses inégalités et ses conflits.11 Selon Lukacs, le roman réaliste était une forme d’art progressive en décrivant comment la révolution des classes moyennes avait réussi à remplacer l’aristocratie comme la force première dans la société européenne.12 La théorie marxiste s’intéresse aux mêmes sujets comme le roman réaliste et Flaubert. Surtout Lukacs utilisait les romans réalistes pour identifier les forces hégémoniques d’une société, par exemple le capitalisme, le pouvoir de l’église ou la situation de la femme. 13 Madame Bovary donne des exemples de l’hégémonie à tous ces égards comme Lukacs appréciait avec le roman de la XIXième siècle.
Dans cet épisode de la casquette du jeune Charles Bovary, Flaubert utilisait une notion fondamentale du marxisme : la réification. La réification est le procès qui transforme les gens dans une société capitaliste en des objets à acheter ou vendre. En utilisant un artefact symbolique comme la casquette pour raconter l’histoire du jeune homme, Flaubert montre comment la société bourgeoise réifie l’homme.14 La casquette aux plusieurs matériaux devient une métaphore et à la fois une métonymie d’un jeune homme de la classe moyenne qui est en train de transformer un être humain en un objet économique.