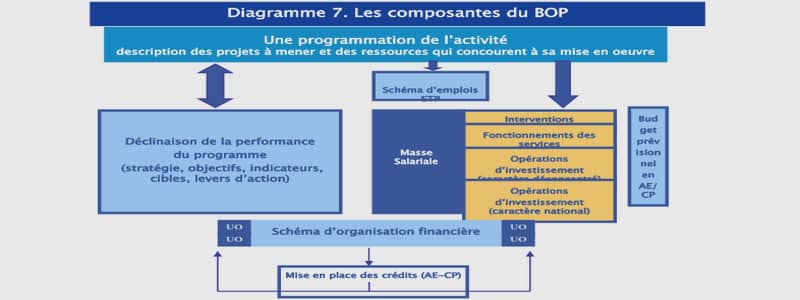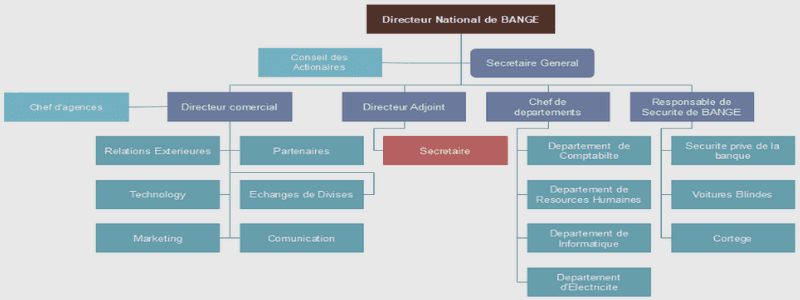Faire l’histoire de ce qui n’est pas pensé comme un problème
Notre travail est un travail d’interprétation, mené à partir des présupposés théoriques de l’histoire conceptuelle appliquée à une histoire des implicites, et des outils de la sociologie et de l’anthropologie, tels qu’ils ont été définis par Louis Dumont dans son approche conjointe des sociétés holistes et individualistes : système hiérarchique, englobement du contraire, approche unitaire du social…, font partie des notions qui nous ont permis d’appréhender les caractéristiques de la citoyenneté des femmes, et de faire émerger ce qui n’apparaît jamais explicitement dans les textes de lois : la famille comme catégorie de la pensée politique. Issu de la confrontation entre les valeurs individualistes de la société civile et politique, et les effets supposés contradictoires des lois qui en définissaient la citoyenneté, c’est un travail d’interprétation qui a dû porter essentiellement sur les catégories juridiques en tant que lieu d’expression privilégié de ce qui, à une époque donnée, relève du consensus implicite, i.e. de cette fameuse évidence qui pèse si fort sur la situation politique des femmes de 1789 à 1848, et qu’on a appelée le “niveau non-idéologique” de la pensée politique72.
La famille, catégorie de la pensée politique du premier XIXème siècle
Si au lieu de considérer uniquement la question des femmes, comme on le fait habituellement, on prend en compte la situation politique similaire qui est faite aux enfants et aux domestiques, également exclus sans mot dire, on s’aperçoit alors que l’évidence de l’exclusion du droit de suffrage ne joue pas qu’en leur direction. L’opposition au suffrage restreint, au sein de la Constituante, est significative à cet égard : les constituants qui interviennent en faveur d’une extension du droit de suffrage à tous les individus, n’entendent par individu, ni les femmes, ni les enfants, ni les domestiques73. En sortant d’une analyse occupée de la seule exclusion des femmes74 et en considérant globalement tous les exclus, on est amené immédiatement à remarquer qu’ils s’inscrivent tous trois dans une même structure : femmes, enfants et domestiques appartiennent tous à la famille. Le changement de perspective oblige ainsi à abandonner momentanément une analyse en termes de rapports sexués, pour lui préférer une approche tenant compte de cette particularité commune à tous les exclus “naturels”, et qui est leur appartenance à la même “société familiale”.
Cette particularité, cette communauté de destin n’est pas passée inaperçue des historiens de la Révolution ; mais on n’en a pas tiré toutes les conséquences. Certains se sont scandalisés de ce qu’ils considéraient comme une inexplicable (ou trop bien explicable) assimilation des femmes aux domestiques et aux enfants, c’est-à-dire à des “catégories inférieures” de la population ; mais on s’est peu interrogé sur la sphère d’appartenance qui permettait ainsi de rassembler en une même communauté des êtres aussi différents. François Hincker fait ainsi le rapprochement entre les critères qui président à l’exclusion des domestiques et des femmes : c’est, dit-il, en raison de leur dépendance et de leur appartenance à l’espace domestique, que les uns et les autres se voient privés de droits politiques75. Mais aussitôt, sont ajoutées à ces deux catégories, celles des débiteurs et des esclaves ; ce qui fait que leur exclusion à tous se trouve plus rapportée au premier critère (la dépendance), qu’aux deux ensembles, considérés dans leur relation. Pierre Rosanvallon a bien expliqué l’exclusion des domestiques par leur assimilation à l’espace de la domus76, et celle des femmes par le caractère naturel de leurs fonctions familiales. Chacune des catégories du paragraphe consacré aux “figures de la dépendance” (femmes, enfants, domestiques, membres du clergé…) est étudiée séparément, sous l’angle des raisons spécifiques qui justifient qu’on les exclue du politique77. Et sans doute l’âge, le sexe, la condition servile ou religieuse sont-ils quatre appartenances différentes, auxquelles on est capable d’associer spontanément, encore aujourd’hui, autant de spécificités politiques et sociales78. Mais c’est justement à l’encontre de cette spontanéité qu’il convient “Ce consensus à l’égard de ce double caractère de la citoyenneté — indépendance, distanciation d’avec l’espace domestique — pèsera lourdement, on le verra, en défaveur des droits politiques des femmes. Il explique aussi l’exclusion des débiteurs, soupçonnés d’être dépendants des volontés de leurs créanciers. Il explique enfin pourquoi les abolitionnistes (de l’esclavage) n’ont jamais envisagé que soit immédiatement accordée, avec la liberté dont la citoyenneté civile, la citoyenneté politique des ci-devants esclaves.” François Hincker, “La citoyenneté révolutionnaire saisie à travers ses exclus”, in Nathalie Robatel (dir.), Le citoyen fou, Paris, PUF, Nouvelle Encyclopédie Diderot, 1991, p. 21.
Pierre Rosanvallon, Le sacre du citoyen, op. cit., p. 121. Il faut remarquer le désintérêt général de l’histoire politique pour le statut civique des domestiques de la Révolution de 1789 à celle de 1848, souvent évoqué, mais rarement problématisé ; même les études consacrées aux domestiques se montrent peu prolixes sur la question de leur spécificité politique. Comme si cette exclusion était beaucoup plus facile à comprendre, à justifier, que celle des femmes pendant la même période, et ne nécessitait par conséquent pas d’étude particulière. Voir Claude Petitfrère, L’Oeil du maître, Maîtres et serviteurs de l’époque classique au romantisme, Bruxelles, Editions Complexe, 1986, dont l’ouvrage dit peu de choses sur le statut politique des domestiques, mais qui a cependant consacré un article à ce sujet dans “Liberté, égalité, domesticité”, Les droits de l’homme et la conquête des libertés, des Lumières aux révolutions de 1848, Grenoble-Vizille, PUG, 1988.
Ainsi, n’a-t-on pas besoin, aujourd’hui, d’expliquer l’exclusion des enfants, qui paraît naturelle parce qu’elle est encore considérée comme “normale”, inscrite dans la nature des choses. Ce faisant, on ne voit pas que la normalité invoquée est un autre nom de la capacité qui fonde implicitement une telle conception de la citoyenneté — capacité de l’adulte qui, par conséquent, appartenait objectivement aux femmes hier comme aujourd’hui et qui rend l’exclusion de celles-ci d’autant plus injuste, incompréhensible. Or, on sait que ça n’est pas la capacité qui fonde le droit électoral depuis 1944 (date de la reconnaissance du droit de suffrage aux femmes), mais l’individualité autonome ; c’est ainsi que l’analphabète ou l’imbécile n’ont pas moins de droits politiques que l’homme instruit, et que l’enfant est encore considéré comme un d’aller, pour considérer ce que l’appartenance à la domus peut avoir de politiquement significatif quant à la situation de trois de ces catégories ; encore doit-on éviter la tentation de les dénombrer, si l’on choisit de les regarder du point de vue qui les rassemble et fait d’elles une unité79.
Si les domestiques sont exclus, c’est donc que tous les hommes ne sont pas naturellement des “hommes”, du moins au sens politique qu’on a bien voulu donner à cette catégorie ; et si toutes les femmes sont exclues, c’est au contraire parce qu’elles sont toutes assimilées à des épouses, quel que soit leur statut matrimonial réel. Il y a là une distinction qui reprend l’opposition qu’ont bien su mettre en valeur les études sur la citoyenneté des femmes, entre politique et naturel : la citoyenneté des hommes est bien une notion socio-politique, et celle des femmes, une notion socio-naturelle. Au regard de cette constatation, il faut cependant apporter une nuance dont les enjeux théoriques vont se révéler d’importance : c’est que la masculinité n’est pas une notion naturelle, qui ferait que tout “mâle blanc” aurait d’emblée droit à la citoyenneté en tant qu’homme ; aussi la partition entre les citoyennes et les citoyens ne se donne-t-elle à comprendre que dans le cadre implicite de la famille, qui fait des seuls pater familias des hommes au sens politique (des individus, des citoyens), et qui fait politiquement de toutes les femmes, des épouses. La question ne consiste plus seulement à comprendre en quoi le maintien de la différence de sexe dans la citoyenneté peut être pensé comme non problématique, naturel, mais à quel titre le sexe, l’âge et le statut domestique peuvent être regroupés sous une seule et même catégorie. Autrement dit, qu’est-ce qui incite les révolutionnaires à amalgamer politiquement des personnes que tout semble séparer, du moins selon notre point de vue moderne, en nature comme en société ? C’est pour répondre à ces questions qu’a été adoptée une démarche “holistique” de la citoyenneté des femmes, tandis que d’autres observations, issues d’un examen des rares discours politiques sur les droits politiques des femmes, confirmaient la validité d’une telle voie de recherche.
Le 30 octobre 1793, le député Amar présente au nom du Comité de sûreté générale son tristement célèbre rapport, qui conduit à l’exclusion des femmes des droits civiques, du gouvernement, et leur interdit de créer des associations politiques. Il y oppose clairement la raison politique masculine et le désordre tout féminin qui le pousse à rejeter les femmes : « Gouverner, c’est régir la chose publique par des lois dont la confection exige des connaissances étendues, une demi-individu, inachevé donc exclu. Par conséquent, il n’est pas plus naturel (ie objectif ou normal) d’exclure les enfants que les femmes ou les domestiques, ni absurde (d’un strict point de vue logique, qui est celui dans lequel on se place généralement pour aborder la situation politique des femmes, avant 1944) d’envisager qu’un jour ils puissent, comme les femmes et les domestiques, se voir reconnaître un droit de suffrage dérivé de leur existence individuelle, de leur appartenance à la communauté nationale par exemple.
1984 ; 1ère édition, 1976) qui montre que régnait encore, à la fin du XVIIIème siècle, une ambivalence sur le terme “famille”, lequel pouvait désigner soit un ensemble de parents qui ne résidaient pas ensemble (lignée), soit un ensemble de corésidents qui n’étaient pas nécessairement liés par le sang ou le mariage, et qui pouvait comprendre en une seule unité aussi bien les domestiques que l’épouse et les enfants (maisonnée).
application et un dévouement sans bornes, une impassibilité sévère et l’abnégation de soi-même ; gouverner, c’est encore diriger et rectifier sans cesse l’action des autorités constituées. Les femmes sont-elles susceptibles de ces soins et des qualités qu’ils exigent ? On peut répondre en général que non. (…) Les femmes ont-elles la force morale et physique qu’exige l’exercice de l’un et de l’autre de ces droits ? (…) Quel est le caractère propre à la femme ? Les moeurs et la nature même lui ont assigné ces fonctions : commencer l’éducation des hommes, préparer l’esprit et le coeur des enfants aux vertus publiques, les diriger de bonne heure vers le bien, élever leur âme et les instruire dans le culte politique de la liberté ; telles sont leurs fonctions, après les soins du ménage ; la femme est naturellement destinée à faire aimer la vertu. »80
C’est en référence à leurs devoirs d’épouses et leur destination de mères, bien plus qu’à leur moindre raison, que les femmes dont l’action politique a outrepassé les limites admises, se voient rappelées à l’ordre, en cet automne de l’année 1793. Les jugements ainsi portés sur ce que doit être une femme dans la Révolution, rattachent leurs fonctions à quelque chose de positif, de radicalement différent, plutôt qu’à une position subalterne dans un rapport de comparaison81. Ça n’est pas parce que les femmes sont de quelque manière inférieures aux hommes qu’elles sont privées des droits électoraux, c’est parce qu’en tant que femmes, il leur revient d’autres droits et fonctions, et partant, un autre type de citoyenneté82 catégories. Si au contraire on considère non seulement les femmes, mais également ceux avec qui elles semblent partager un même destin politique, il faut alors abandonner le critère de la différence sexuelle, pour lui préférer celui qui s’avère commun à ces trois catégories, et qui est celui de leur commune et naturelle appartenance à la famille.
Il convient, ici, de s’expliquer sur ce qui constitue le noeud de notre approche, sur l’hypothèse méthodologique qui a guidé cette recherche : le constat que la citoyenneté des femmes ne se comprendrait qu’en la resituant dans son propre cadre conceptuel, en appréhendant la différence de sexe dans un ensemble qui investit chacun de ses représentants de fonctions dissymétriques et incommensurables ; où ça n’est pas un critère commun qui décide de la hiérarchie entre les êtres, mais une unité dans laquelle tous les deux ont une situation particulière indépendante de leurs qualités individuelles. Ce cadre conceptuel, c’est celui du système de pensée holiste, caractéristique, selon l’analyse qu’en a faite l’anthropologue Louis Dumont, des sociétés traditionnelles par opposition aux sociétés dites modernes84. L’opposition entre un supérieur et un inférieur n’a en effet pas le même sens selon que l’on se place dans le contexte d’une société holiste ou dans celui d’une société individualiste : dans la première, les fonctions spécifiques à chacun des “niveaux” résultent d’une différence de valeur qui s’inscrit dans la nature, la matérialité des faits :
“En tant que modernes, nous tendons à mettre tout au même plan. Si c’était possible, nous n’aurions que faire de la hiérarchie. Quand nous l’introduisons, il faut prendre garde qu’elle est intrinsèquement bidimensionnelle. Dès que nous posons une relation de supérieur à inférieur, il faut nous habituer à spécifier à quel niveau cette relation hiérarchique elle-même se situe. Elle ne peut être vraie d’un bout à l’autre de l’expérience (seules les hiérarchies artificielles ont cette prétention) car ce serait nier la dimension hiérarchique elle-même, qui veut que les situations soient distinguées en valeur.”85
Leur appartenance commune à une entité qui les englobe ne peut pas induire une égalité de valeur, de situation, de comportement, alors que tout (c’est-à-dire la nature) les sépare, et qu’à ce titre toute égalité de valeur ne serait que factice, sur-imposée malgré les faits. La seule égalité possible, c’est d’appartenir à une communauté : “chaque homme particulier, explique Louis Dumont, doit contribuer à sa place à l’ordre global et la justice consiste à proportionner les fonctions sociales par rapport à l’ensemble”86. Aussi la hiérarchie est-elle une opposition qui doit s’analyser à deux niveaux ; d’une part “l’élément est identique à l’ensemble en tant qu’il en fait partie”87 (exemple : une femme est un être humain), d’autre part, “il y a différence ou plus strictement nécessairement une femme) : “essentiellement, résume Louis Dumont, la hiérarchie est englobement du contraire.”89
On voit peut-être encore mal, à ce stade, en quoi le recours à un tel cadre de pensée permettrait de mieux comprendre les structures politique d’une société dont on sait bien qu’à partir de 1789, elle s’est justement pensée et construite contre la société traditionnelle d’ancien régime90. La société politique révolutionnaire se construit en effet sur des valeurs résolument opposées à l’idéologie holiste : l’individualisme qui la caractérise est cette idée que l’homme doit être considéré indépendamment de ses différences naturelles. L’individualisme, c’est le fait de poser l’homme comme premier, et de penser la société à partir de lui ; homme abstrait, au sens où l’on ne considère que ce qui est commun à tous pour édicter des lois valables pour tous en tous lieux, indépendamment des différences naturelles. C’est bien, en dépit des changements de régimes politiques qui parcourent le XIXème siècle, une société individualiste qui naît en 1789. Reste que cet individu de 1789 n’est pas nécessairement celui que l’on croit y voir aujourd’hui ; c’est même en raison d’une erreur de jugement sur la définition de l’individu politique révolutionnaire, que l’on a pu dénoncer l’exclusion politique des femmes en tant que telles, i.e. comme catégorie sexuée politiquement discriminée.
Hors du politique, effet de la tradition et de réflexes archaïques, la citoyenneté des femme n’est pas intégrée à la pensée du politique puisqu’elle relève d’une “autre histoire”. Pourtant, il faut pousser plus loin cette analyse de la pensée politique comme pensée artificialiste et individualiste par opposition à la famille comme société naturelle, à la femme comme demi-individu, voire non individu. Car l’on reste sans réponse si l’on s’interroge sur le maintien des rapports familiaux dans les rets de la tradition, surtout quand on sait à quel point la Révolution s’inquiète de réorganiser ces rapports familiaux dès le commencement, montrant ainsi que la famille comme société dite naturelle par opposition au politique comme “sociétal” est bien plus le fruit d’une évolution du droit révolutionnaire, qu’une donnée maintenue intacte en dépit du passage d’un régime politique à l’autre91. Qu’est-ce qui permet aux révolutionnaires de créer cette opposition qui n’est pas caractéristique de l’ancien Régime, mais au contraire, tout à fait spécifique à la société démocratique ? Qu’est-ce qui pousse ces hommes à respecter la différence de sexe, lorsque toute la pensée politique se construit au contraire sur une indifférence affichée à l’égard des différences naturelles ? Si on voit bien qu’il y a une spécificité de la différence sexuelle, et son effet sur l’organisation politique en déterminant l’attribution de fonctions spécifiques chacun des deux sexes, on ne voit pas en revanche ce qui justifie le maintien de cette différence-là dans l’organisation politique de la société.
La séparation domestique/politique, quoique valide dans le champ de la philosophie politique (dans la mesure où celle-ci étudie la pensée politique telle qu’elle est exprimée, telle qu’elle s’analyse elle-même), oblitère notre approche de la citoyenneté des femmes et par conséquent, celle de la citoyenneté en général. On a eu tendance à la poser comme constitutive de la démocratie, et de ce fait, comme l’explication de la séparation entre les sexes, les femmes étant assignées à l’ordre du privé et les hommes à celui du public, sans que l’on sache trop comment expliquer, autrement que par un éternel retour à la différence de sexe, ce recours des révolutionnaires à ce type d’opposition — ce qui n’était pas seulement inverser l’ordre des causalités, mais confondre l’effet et la cause puisqu’on bout du raisonnement, on l’a dit, c’est toujours la différence de sexe qui expliquait la différence de sexe (la séparation domestique-politique se contentant de reproduire cette différence, mais n’en étant pas fondamentalement différente, ni par sa structure, ni par ses intentions, toujours séparatistes). Or, c’est moins la séparation domestique-politique qui fonde la différence de droits entre les citoyens et les citoyennes, qu’une référence implicite à la famille comme modèle politique. A partir de cet angle de vue, dont il faut bien saisir les enjeux théoriques, tout change et prend un sens différent.
C’est parce qu’elle pense implicitement les hommes et les femmes comme des époux et des épouses, immédiatement rapportés à l’entité familiale qui les unit, mais aussi les hiérarchise et les distingue, que la Révolution maintient, en dépit de toute cohérence philosophique apparente, l’inégalité entre les hommes et les femmes dans la nation. Il n’y a pas de pensée de la femme “en soi”, supposée inférieure aux hommes comme pure catégorie naturelle (définie strictement par son appartenance sexuelle), et pour cela, exclue de l’humanité : il y a une pensée qui englobe hommes et femmes dans une relation socio-naturelle dont le sens est dépendant d’une entité supérieure, qui les dépasse : non pas l’humanité, mais la famille. Non pas un ensemble d’individualités interchangeables, mais au contraire, une unité hiérarchisée composée d’êtres différents par nature et par destination. Il n’y a pas addition de deux individus, mais relation hiérarchique entre deux êtres dont les fonctions respectives sont dictées par des principes qui ne dépendent pas de la volonté des hommes, mais de la “nature des choses”.
Parce qu’aucune femme n’est pensable indépendamment de sa nature sociale d’épouse, donc d’être subordonné à l’homme en tant que chef de famille, aucune (même célibataire, même propriétaire), ne saurait advenir à la même citoyenneté que celle de cet être dont, toujours en référence implicite à l’organisation familialiste des personnes, tout la sépare ; tout, c’est-à-dire en fait une simple différence de nature dont on respecte politiquement les effets différentialistes parce qu’elle est rapportée à la famille qui lui donne un sens, et lui confère sa nécessité. Alors que la société politique au sens étroit, se construit a contrario contre les différences de nature entre les individus, elle respecte en dernière instance le déterminisme sexuel : c’est que les premières ne sont plus rapportées à une entité supérieure qui leur donne un sens (la société comme nature), mais sont au contraire détachées du finalisme qui caractérisait la pensée de la société sous l’ancien régime — c’est bien là toute la révolution de 178992 ; alors que les secondes, parce qu’elles sont inscrites dans l’unité naturelle de la famille, et parce qu’un modèle politique de la famille continue de régir l’organisation de la citoyenneté, continuent d’être pensées comme fixistes.
La famille comme société politique est un schéma mental caractéristique d’un ancien régime honni, dans lequel n’étaient pas distingués les niveaux social et naturel, ce qui était et ce qui devait être. Aussi les révolutionnaires, pour penser le social comme artificiel, se voient-ils dans l’obligation “intellectuelle” de reléguer la famille dans la nature, et d’opérer ainsi la distinction constitutive de la démocratie, et plus largement, de toute la pensée politique moderne : la distinction entre le naturel et le social, entre ce qui s’impose aux hommes et ce qui relève de leur volonté et donc de leur liberté. La famille est reléguée dans la nature des choses, par opposition à la société civile et politique : telle est la pensée politique qui se met en place, se donne à voir à travers les textes, la théorie, la parole des législateurs. Telle est l’Idéologie individualiste, telle que l’a définie Louis Dumont. Mais cette relégation n’est pas, contrairement à ce que l’on a cru, constitutive de la Révolution, c’est-à-dire déjà là au moment où sont remises en cause les structures de l’ancien régime, elle en est au contraire un de ses effets les plus visibles. Les législateurs révolutionnaires, lorsqu’ils agissent sur la famille pour la mettre en stricte conformité avec les principes de la société politique (contractualisation du mariage, égalité entre les époux, abolition de la puissance paternelle sur les majeurs…), montrent bien que les deux sociétés continuent d’être pensées sur le même mode, parce que l’une et l’autre ne se distinguent pas nettement. Il faut attendre la fin de la période révolutionnaire, et surtout, l’avènement du Code civil de 1804, pour qu’elles soient explicitement mises en opposition, l’une civile donc égalitaire, et l’autre naturelle et hiérarchisée. En revanche, s’ils respectent en définitive l’organisation hiérarchique de la famille, et renoncent à la modeler selon les principes de l’égalité et de la liberté, c’est parce qu’elle continue, à leur insu, de véhiculer un modèle politique d’organisation de la citoyenneté des hommes et des femmes. La disjonction entre le domestique et le politique joue au niveau idéologique, comme un des effets nécessaires de la mise à distance toute moderne entre ce qui est pensé comme naturel et ce qui est pensé comme social ; mais à un niveau implicite, on voit bien que la disjonction n’est pas opérée, et que c’est un modèle de la famille, unité à la fois politique et naturelle, qui structure l’organisation de la citoyenneté différenciée des hommes et des femmes. La séparation philosophique entre les deux sphères devient ainsi l’effet inattendu de leur osmose, à un niveau non idéologique, laquelle est bien ce qui contraint les hommes de la Révolution à penser les deux citoyennetés comme distinctes et indissociables. Distinctes en droits, indissociables politiquement : c’est ainsi que l’on retrouve, par la prise en compte de ce niveau supérieur qui ne se dit pas, l’unité politique de la nation, l’incorporation des citoyennes à la souveraineté, et leur présence implicite dans la représentation, par les citoyens, de l’intérêt général.
Saisir le niveau non-idéologique de la construction politique
Ce niveau supérieur qui ne se dit pas, n’est pas vu, c’est ce que Louis Dumont a appelé le niveau “non idéologique” par opposition à l’Idéologie93. La prise en compte de ce niveau est nécessaire pour comprendre comment cohabitent des schémas intellectuels apparemment aussi contradictoires que ceux que nous venons d’esquisser. Au premier niveau, au niveau idéologique, le citoyen est bien cet homme doué de droits par cela seul qu’on l’a pensé indépendamment de “tout le reste”, qu’on est parti de l’homme naturel pour penser la société politique et civile des individus. Mais, — et c’est là qu’on saisit l’intérêt de cette remontée en amont de la pensée politique exprimée, vers le niveau non-idéologique —, est à l’oeuvre une catégorie qui structure la pensée politique et donc, l’organisation de la cité : la famille ; c’est-à-dire, un modèle politique de la famille, un idéal-type de la relation entre les époux dont sont déduits les droits et devoirs des citoyens et citoyennes.
Les révolutionnaires s’aperçoivent d’autant moins qu’ils continuent implicitement de se référer à la famille pour organiser la société politique, qu’ils ne pensent pas conjointement la citoyenneté des hommes et celle des femmes. C’est à leur insu que ça se passe : en ne prenant en compte que la citoyenneté des hommes, ils mettent en place, en effet, une société individualiste, contractualiste, purement égalitaire, etc. : la société politique au sens strict, celle destinée à représenter la volonté générale, à exprimer la souveraineté nationale. La société des citoyens électeurs. Mais si l’on veut bien s’attarder sur cette question de la citoyenneté des femmes, on voit bien que cette indifférence à leur égard est en fait le résultat d’une pensée politique déjà constituée, efficace, et qui se tait parce qu’elle n’est pas au centre du débat, de la construction politique telle qu’elle se pense artificialiste, individualiste. La citoyenneté des femmes est destinée à épouser systématiquement les évolutions de la citoyenneté telle qu’elle est mise en place, discutée, enjeu de pouvoir ; mais c’est bien par référence non dite à l’unité du couple, représentée par ce modèle idéal de la famille, que peut être aussi peu pensée leur citoyenneté : parce qu’elle est une fonction, un attribut des épouses et des mères, c’est-à-dire des femmes en tant que membres de la famille et non en tant qu’individus. C’est par cette jonction socio-naturelle entre l’homme et la femme comme membres de la famille, que se fait la jonction politique entre le citoyen et la citoyenne, et que se tait l’apparent scandale de la citoyenneté sans suffrage de cette dernière, de cette appartenance au souverain sans participation électorale.
Faut-il le préciser ? Il ne s’agit pas de se placer dans une optique sociologique au sens où l’on décrirait la famille telle qu’elle est, de l’ancien régime à la révolution. Ainsi, un éventuel “désordre des familles”, caractéristique du mouvement en faveur de l’abolition des lettres de cachet, et plus généralement de la puissance paternelle avant la Révolution, nous intéresse-t-il pour ce qu’il dit de la figure de l’autorité, mais non pour ce qu’il peut donner à voir, éventuellement, de l’état supposé déliquescent de la société familiale à cette époque94. C’est un modèle idéal que nous étudions, en tant qu’il traverse la pensée politique, de surcroît. Autant dire que toute velléité de confrontation de ce modèle à la réalité sociologique ne mènerait à rien, ni dans un sens ni dans l’autre. C’est pourquoi on ne trouvera, dans notre travail, aucun développement sur les différentes formes de familles, sur les comportements des époux, des parents et des enfants, des maîtres et des domestiques, etc95. Ça n’est pas la famille telle qu’elle est, mais la famille telle qu’elle est imaginée et à partir de laquelle on pense implicitement la citoyenneté des hommes et des femmes, qui nous intéresse. Mais ne nous y trompons pas : tout en s’en tenant à la famille comme modèle politique, on n’en examinera pas moins son empreinte sur les “pratiques” (quoique seulement dans la mesure où celles-ci relèvent de l’organisation de la citoyenneté). Il n’y a pas lieu, ici, de distinguer une histoire des idées d’une histoire sociale, au sens où l’une n’aborderait que les “concepts”, et l’autre les pratiques sociales qui viendraient en contredire la portée ; il s’agit au contraire d’observer quelles catégories structurent — très concrètement, puisqu’à travers ses lois — l’organisation politique de la société. Il faut bien garder à l’esprit cette distinction primordiale entre l’étude politique et l’étude sociologique, tout à fait différente de l’opposition entre le conceptuel et le réel, du moins telle qu’on l’entend généralement. En écartant d’emblée les pratiques familiales, nous n’écartons pas toute la “réalité”, mais simplement ce qui relève des comportements, avec toute la marge de liberté et de contournements individuels que cela implique, et que la sociologie politique essaie justement de mesurer96. Ce faisant, nous nous situons à un niveau différent, attentif à faire émerger ce qui, à l’insu des législateurs, “travaille” l’organisation politique de la société. La famille qui nous intéresse reste à un niveau très “théorique”, mais qui n’en a pas moins des effets directs sur les droits et devoirs des uns et des autres. C’est en cela que nous nous démarquons de la tendance, toujours forte dans nos disciplines, à ramener l’histoire des idées politiques à une histoire abstraite des principes, par opposition à une histoire concrète des gens. Car il va sans dire que les principes, surtout lorsqu’ils s’inscrivent dans des lois, ne sont pas sans effets sur la vie des gens. Pour ce qui concerne cette étude, c’est aux principes politiques que nous nous intéressons ; et donc, aux effets politiques de ces principes incarnés par les lois. C’est pourquoi c’est la citoyenneté spécifique des femmes, en tant que conséquence de la famille comme catégorie de la pensée politique, qui nous intéresse — et non les comportements des individus par rapport à cette norme.
Dans le même ordre d’idée, on constatera, au fil du développement, qu’à quelques exceptions près, nous n’avons pas utilisé d’archives ou d’imprimés qui ne soient déjà connus, ou qui n’aient fait l’objet de travaux de recherche spécialisés97. En outre, la focalisation a porté essentiellement sur les textes de lois, civiles et électorales : d’abord par l’heureux hasard qui nous fit découvrir de rares articles qui, contre toute attente, mentionnaient de manière explicite les droits et devoirs des femmes en la matière ; ensuite par la transformation progressive de ce premier hasard en principe de recherche : à savoir, que les lois s’offraient comme un des supports les plus riches et les plus solides pour une histoire des représentations politiques dominantes.
Récemment, dans un article bilan sur l’histoire du suffrage en France, Michel Offerlé attirait l’attention sur le désintérêt manifesté par l’histoire politique à l’encontre des catégories juridiques, dont l’étude est en effet généralement laissée aux juristes98. On a en effet une histoire juridique du droit de la citoyenneté, une histoire sociologique et politique du suffrage et de la citoyenneté, voire une histoire féministe de l’exclusion des femmes, mais sans que les problématiques des uns et des autres se rencontrent réellement pour confronter leurs résultats99
En général, c’est même grâce à ces travaux que nous avons eu accès aux sources qu’ils citaient, ce qui nous a parfois amenée à découvrir des aspects, voire de nouveaux textes, jusque-là peu ou pas exploités. Cf. notamment les textes de P.-L. Roederer (cité par Patrice Gueniffey, dans Le nombre et la raison, La révolution française et les élections, Paris, éd. de l’EHESS, 1993, avec une préface de François Furet), dont les pages sur le citoyen père de famille n’ont pas à ma connaissance fait l’objet d’une étude systématique, et m’ont en outre guidée vers des cours donnés en 1793 que je n’ai jamais vus cités ; les textes d’Ernest Legouvé (dont l’un, important, souvent attribué à tort à Pierre Leroux) qui, en dépit de sa position institutionnelle en 1848, a jusqu’à maintenant peu intéressé la recherche ; ceux de George Sand, dont le texte sur les femmes dans la société politique est peu connu, alors qu’il développe avec force la position de celle qui en 1848 s’oppose avec le plus de fermeté aux revendications des femmes en faveur d’un droit de suffrage — méconnaissance sûrement dûe à la situation éditoriale de ce texte, discrètement publié parmi des Souvenirs et idées en 1904, et des textes consacrés à La femme au 19ème siècle, textes réunis par Nicole Priollaud, Paris, Liana Levi, 1983 ; mais dont on peut espérer qu’elle sera réparée par la publication, en 1997, des écrits politiques de George Sand, par Michelle Perrot ( Politique et polémiques, éd. Imprimerie nationale, 1997) ; enfin, un texte de Luc Desages, représentatif du courant de pensée précédent, quoique plus favorable à un suffrage féminin, et dont l’article, probablement en raison de son peu de résonance, n’est pas cité dans les histoires du féminisme de cette période. On trouvera, en annexe, l’essentiel de ces textes, dont quelques uns sont peu faciles d’accès, et qui tous méritaient d’être mis à la disposition du chercheur en général, et du lecteur de cette thèse en particulier.
Outre les ouvrages déjà cités, sur l’histoire politique et l’histoire féministe de la citoyenneté, voir les thèses récentes de Bertrand Hérisson, L’évolution de la citoyenneté en droit public français, thèse de droit public sous la dir. de E. Picard, Paris 1, 1995 ; Sophie Duchesne, Citoyenneté à la française : tension entre particularisme et universalisme. Analyse d’entretiens “non directifs”, thèse de science politique sous la dir. de Jean Leca, IEP de Paris, 1994 ; Olivier Ihl, La citoyenneté en fête : célébrations nationales et intégration politique dans la France républicaine de 1870 à 1914, thèse d’histoire, EHESS, 1991 (publiée aux éditions Gallimard, en 1996) ; Yves Déloye, La citoyenneté au miroir de l’école républicaine et de ses contestations : Politique et religion en France XIXe- XXe siècles, thèse de science politique, Paris la conséquence la plus visible est que l’on obtient soit un citoyen qui n’est visible qu’à travers les droits dont il peut se prévaloir, soit un citoyen défini dans le cadre des enjeux politiques qui font de lui une “question” à un moment donné, soit enfin un citoyen ayant plus ou moins usurpé un droit qui n’a plus d’universel que le nom. De ces trois figures du citoyen, celles du détenteur de droits, de l’individu et de l’homme illégitime, émergent trois histoires parallèles, sinon contradictoires.