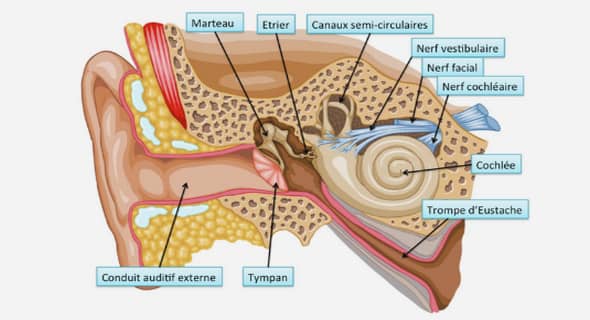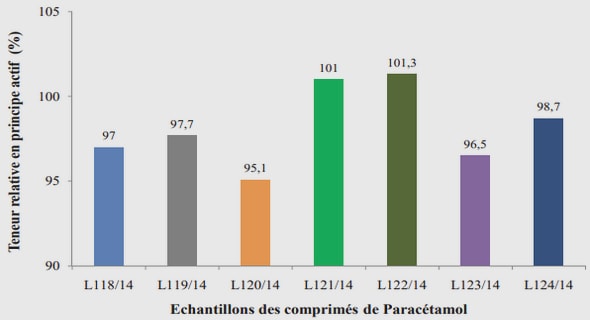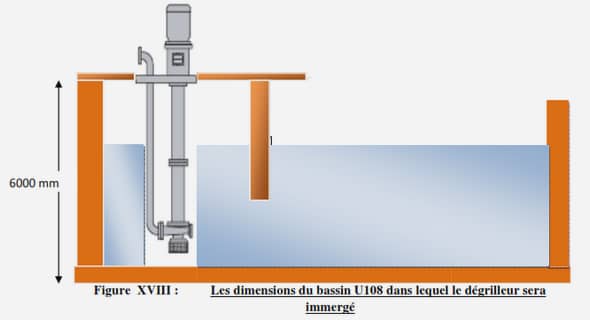Obtenir les récits biographiques de trajectoires gustatives
Le choix des enquêtés
Étudier les processus à l’œuvre dans la constitution, la transformation, l’actualisation ou la mise en veille des goûts musicaux d’individus au cours de leur trajectoire nécessite d’abord de se poser la question du choix de la population. Que souhaite-on faire varier dans les caractéristiques sociales de nos enquêtés afin de faire émerger de nos entretiens, sans aucune prétention à une quelconque représentativité statistique, des processus identifiables comme étant typiques de certaines trajectoires ? Il nous a semblé pouvoir identifier deux séries de variations sociales.
La première est bien sûr celle relative à l’ensemble des caractéristiques sociodémographiques. Sur les 33 trajectoires reconstruites, 19 sont celles d’hommes et 14 sont celles de femmes. 16 enquêtés avaient entre 25 et 34 ans ; 11 avaient entre 35 et 44 ans ; 4 avaient entre 45 et 54 ans ; et 2 avaient 55 ans ou plus. Le choix d’attribuer à la tranche d’âge des 25-34 ans un intérêt central fut motivé par le fait que, ayant une trajectoire plus importante que les tranches d’âges de 15-24 ans, les 25-34 ans sont ce qui, après les 15-24 ans, écoutent le plus de musique au quotidien60. De plus, étant nés entre 1979 et 1988, ce sont les enquêtés qui ont connu le plus de transformations des supports musicaux depuis leur adolescence jusqu’à leur entrée dans le marché du travail, période au cours de laquelle une partie importante du répertoire musical ce constitue et qui, pour la suite de leur trajectoire, posera de manière plus aigue la question des modalités d’actualisation et de mise en veille de leurs goûts musicaux. Du point de vue des catégories socioprofessionnelles, nous avons interviewé 8 étudiants, 2 personnes sans emploi, 2 ouvriers, 2 personnes occupant des professions intermédiaires, 9 employés de la fonction publique ou du secteur privé, 5 membres des professions libérales, 4 cadres et membres des professions intellectuelles supérieures et 1 retraité. Du point de vue des niveaux annuels de revenus, nous avons interviewé 6 personnes qui touchent moins de 15 000e/an, 13 personnes qui touchent entre 15 000 et 19 000e/an, 5 personnes qui touchent entre 20 000 et 29 000e/an et 7 personnes qui touchent plus de 30 000e/an. En ce qui concerne les niveaux de diplômes des enquêtés, 6 ont le Bac ou un diplôme inférieur au Bac, 7 ont entre le Bac et Bac+2, 10 ont entre Bac+3 et Bac+5, et 10 ont un niveau Bac+5 ou plus. Par ailleurs, bien que pour des raisons pratiques tous avaient en commun d’habiter dans la région Midi-Pyrénées au moment de l’enquête, la plupart n’y sont pas nés, ce qui, du point de vue scientifique, ne limite pas les résultats à une circonscription régionale. La seconde série de variation qui a guidé le choix de nos enquêtés est celle du rapport à la musique : partant de l’hypothèse que la variation de ce critère allait nous permettre d’observer des processus distincts, mais aussi afin de voir ce que des trajectoires d’enquêtés ayant des rapports à la musique sensiblement différents pouvaient avoir de commun, il nous a semblé pertinent d’un point de vue scientifique de sélectionner d’une part des personnes qui n’estimaient pas que la musique avait une importance forte dans leur vie, d’autres personnes pour qui elle occupait une place relativement plus importante. D’autre part, nous avons sélectionné des personnes auditrices et d’autres qui, en plus d’écouter de la musique, y dansent dessus, jouent d’un instrument, chantent ou encore sont dj’s.
Afin de les sélectionner, nous avons procéder en plusieurs étapes : notre accès à une large palette de catégories sociales nous a permis d’entamer la sélectionner en fonction de ce critère. Puis, nous avons procédé selon la méthode des générateurs de noms : en fonction des critères pertinents dont il nous restait traiter, les enquêtés nous ont indiqué des personnes de leur entourage qui pouvaient correspondre. Ainsi, le contact était facilité, bien qu’il pouvait entraîner certains biais quant à ce que l’on allait pouvoir obtenir comme données de la personne indiquée, sachant ce que « l’indicateur » avait pu nous dire de leur relation. Mais nous avons pu constater que, lorsqu’il existait des différences du point de vue des goûts ou du point de vue de la manière d’aimer, les enquêtés ne se gênaient pas pour affirmer leur propre position : cela notamment du fait que nous sollicitions chez eux un discours qui permette de rattacher le sens positif que prenait leur goût à la grammaire dans laquelle, au moment de la situation décrite, il était grammaticalisé.
Faire émerger le sens positif d’interactions passées et leurs enchaînements
L’approche grammaticale telle que développée par Cyril Lemieux a ceci de spécifique qu’elle privilégie la description d’actions les plus circonstanciées possibles (l’idéal étant la description d’actions en train de se faire), dans la mesure où elle suppose de pouvoir identifier des procès de grammaticalisation à l’issue d’actions et d’actions-en retours. D’un autre côté, travailler sur les trajectoires biographiques de goûts musicaux suppose, il nous semble, d’accéder à cinq séries de faits sociaux : 1/ accéder aux différentes configurations sociales (collectifs, relations, dispositifs, pratique en solitaire) dans lesquelles le répertoire musical de l’enquêté et ses manières d’aimer se sont constitués ; 2/ disposer de descriptions à propos des degrés de tensions gustatives que l’enquêté a pu traverser (et traverse peut-être encore au moment de l’enquête) de par sa multi-appartenance à ces configurations sociales; 3/ disposer de descriptions des situations de petits ou de grands basculements qui lui font prendre des directions gustatives plus ou moins radicalement différentes, via également son inscription contingente dans une configuration sociale ou au contraire via son départ, contraint ou fortuit, d’une autre ; 4/ disposer de descriptions sur les situations qui l’ont conduit à établir des « ponts gustatifs » entre des genres, des artistes ou des groupes et ont abouti à l’élargissement de son portefeuille musical ; 5/ disposer de descriptions, enfin, sur les situations dans lesquelles il trouve la possibilité d’actualiser une plus ou moins grande partie de son répertoire ou, au contraire, se voit contraint d’en mettre une partie en « sourdine ». De ces situations, il fallait également être renseigné sur leur durée, afin de rendre compte des conditions qui permettent à l’enquêté une plus ou moins grande intensité d’actualisation ou qui le contraignent à une mise en veille plus ou moins durable d’une partie de son répertoire.
Ces cinq séries de faits ont été reconstruites par la passation d’entretiens biographiques auprès des enquêtés, dont la narration, comme le souligne Aurélien Djakouane en critiquant l’illusion biographique à laquelle fait référence Pierre Bourdieu (Bourdieu, 1986), « n’est plus nécessairement une inclination à se faire l’idéologue de sa propre vie, mais plutôt une occasion de raconter les événements et leurs circonstances. Selon nous, c’est en cherchant à reconstituer les environnements, les contextes et les situations que l’on parvient à accéder à la genèse des dispositions et des comportements » (Djakouane, 2006, p. 114). Ainsi, afin d’éviter de commettre, au moment de l’interprétation, des erreurs de Frazer l’égard du discours de nos enquêtés, il a été crucial d’orienter leur narration au plus près des processus concrets qui ont eu lieu, en leur permettant autant que possible de les situer dans la grammaire dans laquelle les interactions décrites prenaient un sens positif61. Cette nécessité méthodologique nous paraît en outre plus apte que l’investissement d’une « réflexivité réflexe » défendue par Pierre
C’est également ce à quoi ont procédé Gérard Mauger, Bernard Pudal et Claude Poliak à propos des « histoires de lecteurs ». Entendant lutter contre « l’ethnocentrisme lettré » qui caractérise selon eux les modes d’appréhension de l’herméneutique et de la sociologie de la réception en matière d’analyse des pratiques de lectures, qui se manifeste par une projection sur les pratiques de lecture des enquêtés du rapport lettré à la lecture du chercheur, les trois chercheurs axent leur étude sur les usages sociaux de celle-ci, afin de faire apparaître d’une part la Variétés des intentions des différentes lectures pour un même lecteur et, d’autre part, la pluralité des manières d’appréhender un même ouvrage (Mauger, Poliak et Pudal, 2010, p. 21 .- 23)
Bourdieu pour rendre intelligible à l’enquêté des éléments qu’ils n’avaient pas nécessairement mis en relation, entre autre parce que l’incapacité matérielle à rompre avec certains de ses élans ou de ses attentes passés pouvait l’empêcher de saisir complètement le sens de certaines notifications de fautes qu’avaient pu lui adresser l’une ou l’autre de ces connaissances. Ainsi, si la possession d’ « une connaissance approfondie des conditions d’existence [dont les enquêtés] sont le produit » peut permettre au sociologue de mieux « comprendre » l’enquêté, il n’en reste pas moins que l’exigence méthodologique de se référer au sens positif que prend pour les acteurs leur action est selon nous le meilleur moyen de mettre en œuvre cette « démocratisation de la posture herméneutique » à laquelle Pierre Bourdieu aspirait :
Le regard prolongé et accueillant qui est nécessaire pour s’imprégner de la nécessité singulière de chaque témoignage, et que l’on réserve d’ordinaire aux grands textes littéraires ou philosophiques, on peut aussi l’accorder, par une sorte de démocratisation de la posture herméneutique, aux récits ordinaires d’aventures ordinaires. Il faut, comme l’enseignait Flaubert, apprendre à porter sur Yvetot le regard que l’on accorde si volontiers à Constantinople : apprendre par exemple à accorder au mariage d’une femme professeur avec un employé des postes l’attention et l’intérêt que l’on prêterait au récit littéraire d’une mésalliance et à offrir aux propos d’un ouvrier métallurgiste l’accueil recueilli que certaine tradition de la lecture réserve aux formes les plus hautes de la poésie ou de la philosophie (Bourdieu, 1993, p. 1421).
Pour saisir les phénomènes relatifs à la première série de faits sociaux, nous demandions à l’enquêté, de manière chronologique, de nous décrire l’ambiance musicale du foyer familial lorsqu’il était enfant, les disques présents au foyer et les goûts musicaux des parents, le matériel audio permettant d’écouter la musique à ce moment-là, la place que prenait l’écoute de la musique au sein du foyer, la gestion de l’écoute fraternelle si le matériel audio était partagé avec la fratrie, etc. Nous procédions ensuite à une énumération des relations (d’ordre amicales, associatives, politiques, professionnelles, amoureuses, etc.), des groupes ou des dispositifs qui ont été importants pour la constitution de ses goûts musicaux au moment de la scolarité (primaire, collège, lycée et, parfois, études supérieures), puis nous procédions de même pour la suite de la trajectoire, en circonscrivant à chaque fois des collectifs, des relations, des dispositifs ou, parfois, des pratiques en solitaire, qui ont eu un impact quelconque sur sa trajectoire de goût.
En parallèle, nous lui demandions comment il gérait les liens qu’il entretenait avec les différents groupes ou relations et la place que le partage musical occupait dans ces liens : est-ce qu’il partageait la totalité du répertoire musical avec l’ensemble des relations ou des groupes ? Fragmentait-il plutôt ce même répertoire ? Si oui de quelle manière et pour quelles raisons ? Est-ce que les groupes ou les relations dans lesquels il était inscrit se côtoyaient ou bien est-ce qu’il y avait maintien d’une homogénéité de chacun d’eux ?
Lors de la narration des trajectoires, nous abordions ensuite la question des bifurcations à propos du répertoire musical et/ou des manières d’aimer la musique : l’enquêté peut-il identifier des moments de rupture biographique du point de vue de son itinéraire de goût musical ? A quoi les rattache-t-il ? A l’insertion dans un nouveau groupe ou d’une nouvelle relation ? De quel ordre est ce rattachement : amical, professionnel, associatif, géographique, conjugal, institutionnel, etc. ? Nous lui demandions également de nous décrire l’impact qu’a pu avoir ces ruptures sur la suite de son parcours : à quel degré ces ruptures ont-elles transformé son répertoire musical ou son appréhension de la musique ? Cela a-t-il eu un effet quelconque sur son répertoire accumulé jusqu’alors ou sur sa manière de l’aimer ? Qu’en est-il du maintien des anciens liens sociaux ? Comment l’ensemble des liens se reconfigurent-ils à la suite de ces ruptures de plus ou moins grande ampleur ?
Nous abordions par ailleurs les logiques de l’éclectisme musical des enquêtés : des questions du type : « comment avez-vous découvert tel disque ou tel artiste ? » permettent de faire émerger un discours relativement bien contextualisé des conditions de découverte et des raisons de changer ou de s’ouvrir qui soutiennent cette découverte. La question suivante était très généralement : « qu’est-ce qui vous a plu dans ce disque, chez cet artiste, etc. ? ». Elle permet d’accéder d’une part aux raisons d’agir sur lesquelles l’enquêté appuie son goût, mais également aux liens que celui-ci a pu faire par rapport à d’autres morceaux, artistes, genres, sous-genres, qu’il apprécie alors, ou d’autres liens qu’il effectue par rapport aux personnes qui lui ont fait découvrir telle unité musicale. Du point de vue de l’ensemble des groupes ou relations auxquels appartient l’enquêté, l’éclectisme musical est alors le produit de son encastrement dans différentes configurations sociales.