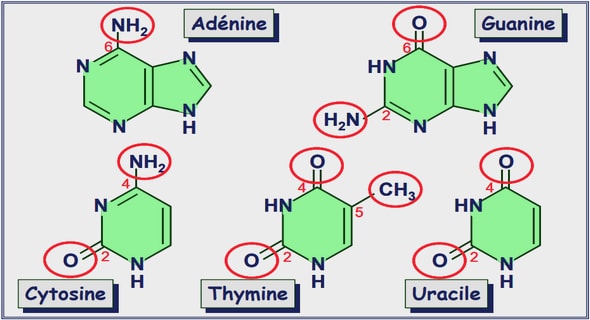Construire l’asymétrie dans les interstices des règles formelles
Si les communications en coursives prennent essentiellement la forme de requêtes, celles-ci s‘adressent à des professionnel·le·s qui disposent de peu de ressources institutionnelles pour y répondre. Situation commune à la plupart des agents de première ligne, dont l‘autorité sur le public n‘a d‘égal que leur position subalterne au sein de leur administration, les réformes pénitentiaires contemporaines ont contribué à raréfier les ressources institutionnelles de l‘autorité des surveillant·e·s. Selon quelles modalités s‘opèrent alors les négociations asymétriques de ressources rares dans un espace de proximité conflictuelle ? Le renforcement de l‘informalité des relations de coursives reconfigure le « système des privilèges »1 et avec lui les fondements normatifs de l‘asymétrie entre prisonnier·e·s et surveillant·e·s. D‘une part, les surveillant·e·s disposent de marges d‘action essentiellement indirectes – conseiller, informer, relayer des demandes avec plus ou moins de diligence et de conviction. D‘autre part, une grande partie des négociations entre prisonnier·e·s et surveillant·e·s s‘inscrit dans les marges ou à rebours des règles formelles de l‘organisation.
Distance au rôle de l’intermédiaire et hybridation normative
Erving Goffman écrivait que, dans les institutions totales, « le personnel a pour mission d‘être les cibles de l‘hostilité et des demandes des reclus, et qu‘il y fait en général face en mobilisant la perspective rationnelle adoptée par l‘institution »2. Cependant, l‘observation des échanges entre prisonnier·e·s et surveillant·e·s montre que la distance des seconds aux décisions de l‘administration autorise une hybridation des registres normatifs et relationnels. En effet, l‘absence relative de prises directes sur les situations des prisonnier·e·s n‘assigne pas aux surveillant·e·s un rôle univoque d‘exécution du « sale boulot ». Elle autorise au contraire des engagements plus indirects, et parfois plus distanciés, dans le processus de traitement des doléances. Détenteurs d‘un pouvoir discrétionnaire sur les situations des prisonnier·e·s, les membres de l‘encadrement incarnent plus directement la dimension répressive de l‘institution. Au contraire, les surveillant·e·s peuvent mettre à distance les rationalités institutionnelles pour mobiliser des ressources morales partagées avec les prisonnier·e·s en vertu de socialisations communes. Monsieur Mihoubi, déjà évoqué plus haut, m‘indique qu‘il a eu quelques interactions avec la hiérarchie pénitentiaire ou l‘autorité judiciaire. Dans notre discussion, il revient cependant sans cesse aux contacts avec les surveillants : « Nous c‘est qu‘avec les surveillants qu‘on parle. Les chefs, c‘est que pour te casser les couilles ! ».
Dans l‘espace de coursives, les surveillant·e·s endossent le rôle les gatekeepers, plus ou moins bien disposés, d‘informations et ressources institutionnelles. À la maison de Tormeilles, ce travail concerne principalement les réclamations sur les cantines et l‘argent disponible pour les futures commandes. Plutôt que leur pouvoir décisionnel propre, c‘est alors les moyens d‘information et de communication – le téléphone et l‘ordinateur – dont disposent les surveillant·e·s qui sont au cœur des négociations. Le téléphone permet de joindre des services auxquels les prisonnier·e·s ne peuvent pas accéder directement, et notamment – en maison d‘arrêt – à la hiérarchie pénitentiaire. L‘ordinateur donne accès à des informations cruciales pour la vie quotidienne : la réservation de parloirs, le montant du pécule disponible*, l‘inscription à une activité, etc. Plus largement, les surveillant·e·s peuvent dispenser des conseils, faire preuve d‘écoute, de compassion, voire de connivence, et ce d‘autant plus facilement qu‘ils ne n‘ont pas à assumer le poids d‘une éventuelle décision négative. Ainsi, au centre de détention de Marignu, j‘observe par exemple une courte discussion entre un surveillant d‘étage et un prisonnier qui lui demande s‘il peut demander à son fils de lui apporter des jeux vidéo lors de leur prochain parloir. Le surveillant n‘en sait rien, mais précise que si cela ne tenait qu‘à lui, ce serait bien sûr possible. Hésitant, il indique à son interlocuteur qu‘il lui faut certainement faire un mot à la directrice ou au chef de détention, puis se reprend et ajoute que la direction lui paraît « le plus probable ». Il suggère néanmoins d‘aller voir le « bricard » (premier surveillant) pour être sûr de la procédure. Le prisonnier se range à cet avis et s‘engage dans l‘escalier1. Si les surveillant·e·s sont les intermédiaires des requêtes des prisonnier·e·s vers les services compétents, ils interviennent bien dans l‘aiguillage, la formulation et parfois l‘appui aux demandes. Sans être décisionnaires, les surveillant·e·s peuvent s‘appuyer sur leur connaissance des procédures et des jurisprudences de leurs supérieurs hiérarchiques pour anticiper, conseiller et décourager les demandes. Par ailleurs, en mentionnant qu‘il accepterait, lui, sans difficulté la demande, le surveillant se positionne du côté du prisonnier face à une administration dont la réponse est encore en suspens.
L‘absence relative de pouvoir décisionnaire permet que surveillant·e·s et prisonnier·e·s se rejoignent dans la critique de décisions d‘autorités pénitentiaires, et plus souvent encore d‘autorités judiciaires, médicales et de prestataires privés. La présence de prisonnier·e·s souffrant de troubles psychiatriques, dont les comportements bruyants ou étranges peuvent perturber la détention, est souvent commentée pour critiquer leur absence de prise en charge médicale. Visant principalement des acteurs non pénitentiaires, de telles connivences normatives entre prisonnier·e·s et surveillant·e·s sont démultipliées, à la maison d‘arrêt de Tormeilles, par la présence d‘une entreprise privée en charge de nombreux aspects de la détention. Les réclamations liées aux cantines ou les demandes de réparations sont adressées par les surveillant·e·s, via le cahier électronique de liaison, à l‘entreprise privée sur sollicitation des prisonnier·e·s concernés1. Ces interactions donnent souvent lieu à des récriminations sur les façons d‘agir du prestataire privé. À travers les commandes en cantine ou les rémunérations du travail, elles visent en priorité la rapacité supposée d‘acteurs auxquels n‘est reconnue que cette seule motivation. C‘est ainsi que trois surveillant·e·s en charge des ateliers de la maison d‘arrêt de Tormeilles s‘accordent à dire que les doléances des prisonnier·e·s quant à leur rémunération sont presque toujours justifiées. En effet, la détermination du montant touché est « opaque ». Le document justificatif en est la preuve : « Ils l‘ont donné au chef [l‘officier responsable des ateliers] même lui il n‘a rien compris ». Cette facilité à critiquer les professionnel·le·s du privé, mais aussi parfois le personnel médical ou même les conseillers pénitentiaires d‘insertion et de probation se retrouve dans l‘accueil, voire l‘encouragement, à l‘expression de doléances à leur encontre de la part de prisonnier·e·s.
Pour cela, les communications entre prisonnier·e·s et surveillant·e·s activent parfois des justifications conformes aux objectifs affichés par l‘institution – comme lorsqu‘ils critiquent la sélection productiviste des travailleurs par les entreprises privées au nom de la bonne gestion de la détention et de la prévention de l‘indigence2 – mais aussi sur des registres normatifs concurrents. Je me trouve cette après-midi au niveau du rond-point du rez-de-chaussée du bâtiment principal du centre détention de Marignu en compagnie d‘un surveillant. Monsieur Laudonio, dont plusieurs prisonniers et membres du personnel m‘ont déjà signalé les débordements violents, vient à plusieurs reprises dans la guérite du rez-de-chaussée. Il s‘adresse avec une grande virulence au surveillant. Je peine à comprendre l‘objet du litige, d‘une part parce que M. Laudonio parle vite, de manière heurtée et avec un fort accent, d‘autre part parce que les deux interlocuteurs s‘expriment fréquemment en créole. Le glissement ne paraît d‘ailleurs pas anodin : il intervient notamment lorsque M. Laudonio commence à menacer explicitement de « planter » quelqu‘un dont je ne parviens pas à savoir s‘il en précise l‘identité ou la fonction. Avec des gestes et des paroles agitées, il exhibe des ciseaux qu‘il dit avoir en permanence dans sa poche. Après quelques minutes, le surveillant se tourne même vers moi et plaisante sur le fait que je ne dois rien comprendre, avant de reprendre la conversation en créole. De ce que je peux saisir, et des explications sibyllines que me donne le surveillant entre deux passages de Monsieur Laudonio, la cuisine est depuis quelques jours en incapacité de donner à M. Laudonio le régime alimentaire dont il a besoin. De fait, pendant leurs discussions, le prisonnier brandit à plusieurs reprises un certificat de l‘unité sanitaire, qui atteste selon lui d‘un régime alimentaire strict sous peine de complications médicales immédiates. Face à la colère verbale et aux gestes emportés de Monsieur Laudonio, le surveillant reste d‘ailleurs calme, souriant, détaché même, renversé sur son fauteuil de bureau. Il écoute sans particulière manifestation d‘émotion les explications et les menaces qui ne le concernent visiblement pas directement. Il n‘en fera d‘ailleurs pas état lorsqu‘il me résume sommairement leurs échanges. Plusieurs fois, il conseille simplement à son interlocuteur de « faire attention », de ne pas aller trop loin, mais le ton semble plus celui du conseil que de l‘avertissement. Plus tard, il lui propose même d‘intervenir le lendemain pour prendre des nouvelles de sa situation. L‘absence de réaction plus directe face à un prisonnier exhibant une arme blanche et menaçant de s‘en servir ne manque pas d‘interroger de la part d‘un agent pénitentiaire. Face à un prisonnier redouté par ses codétenus comme par une partie du personnel pour ses gestes violents, elle marque une distance étonnante vis-à-vis de l‘impératif institutionnel de maintien de l‘ordre dans l‘établissement.
La posture de conseiller, détaché, mais sympathisant, est ici renforcée par l‘emploi du créole, qui active une communauté à la fois intérieure et extérieure à l‘incarcération. Erving Goffman, contre les lectures restrictives de la notion d‘institution totalisante, notait déjà que la plupart de ces établissements possédaient une certaine perméabilité avec le monde extérieur, notamment parce que reclus et gardiens étaient susceptibles de partager des origines sociales ou géographiques communes : « parce qu‘ils partagent la culture du monde social d‘origine des reclus, ces membres du personnel peuvent être un canal de communication naturel »1. Bien que plus rares, on retrouve de telles affinités sociales et géographiques à la maison d‘arrêt de Tormeilles. L‘établissement est lié à une ville de taille moyenne. Cela permet le partage de repères culturels communs et territorialisés, notamment visibles dans le soutien apporté à l‘équipe footballistique locale1. Même si nombre de prisonniers et de surveillants lui préfèrent les ors du Paris-Saint-Germain ou les gloires passées de l‘Olympique de Marseille, les matchs de l‘équipe de Tormeilles, notamment ceux disputés à domicile dans le stade proche, donnent lieu à des discussions passionnées auxquelles se mêlent parfois surveillants et prisonniers. Entre les surveillant·e·s et les prisonnier·e·s les plus âgés, il arrive également que la proximité des origines sociales et géographiques crée les conditions d‘une interconnaissance extérieure au monde carcéral. Ainsi, un premier surveillant proche de la retraite, en poste pendant presque toute sa carrière dans la région, m‘indique connaître une partie des prisonniers depuis des années. Pour la plupart, cette interconnaissance s‘est établie au fil des incarcérations successives. Cependant, pour certains, elle s‘inscrit dans des sociabilités de quartier, par la pratique du football amateur notamment2. Mon interlocuteur précise alors que c‘était surtout le cas dans le passé, avec des personnes proches du « milieu » criminel local. Il n‘a pas de liens directs avec les « jeunes »3 ces repères culturels importés de socialisations antérieures ou extérieures au monde carcéral s‘ajoutent des normes informelles du monde pénitentiaire4. Le même surveillant décrit plus haut dans sa discussion avec Monsieur Laudonio est interpelé par un prisonnier qui affirme que sa chaîne hi-fi a été volée dans sa cellule. Il précise que la chaîne se trouve d‘ailleurs en ce moment dans la cellule du voleur, qu‘il identifie par son nom. Son interlocuteur hausse les épaules et l‘interroge sans ménagement : « Tu peux aller voir le chef de dét‘ [détention], mais bon si t‘as des couilles, tu peux régler ça tout seul, non ? ». Âgé d‘une quarantaine d‘années, le regard un peu dans le vague, son interlocuteur s‘interrompt. Il me semble le voir se redresser légèrement lorsqu‘il répond d‘une voix plus forte : « Ouais, okay, je sais ce que j‘ai à faire ». Il sort rapidement. Plutôt qu‘un aiguillage vers les circuits légitimes d‘expression de la plainte, cet échange donne à voir un court-circuit : alors que le prisonnier fait appel à l‘autorité pénitentiaire pour résoudre une difficulté, il se trouve renvoyé par un soupçon sur sa virilité vers un mode de résolution endogène, inscrit dans une valorisation de l‘honneur et son affirmation par la force physique. J‘ai eu à plusieurs reprises l‘occasion d‘assister à l‘explicitation de cette règle carcérale1 : en cas d‘infractions aux normes des échanges clandestins – non-remboursement d‘une dette, vol, racket –, il est attendu que la victime réclame son droit par la force. L‘affirmation de l‘honneur par la mise en scène de la force physique fait écho à des descriptions de la « grammaire de l‘honneur » des bandes de jeunes des classes populaires2, mais aussi à des modes de régulations endogènes du monde carcéral3. Ici, l‘hybridation des registres normatifs ne marque pas une connivence : il permet à un surveillant de refuser son rôle d‘intermédiaire institutionnel en ne remontant pas à la hiérarchie l‘accusation de vol faite à l‘encontre d‘un codétenu.
Ainsi, l‘hybridation normative des relations de coursives prolonge l‘asymétrie du conflit statutaire en prisonnier·e·s et surveillant·e·s. Elle sert à la fois de ressource pour marquer une proximité, voire une alliance contre d‘autres acteurs de la détention, et pour souligner la distance des surveillant·e·s aux obligations que leur confère leur position d‘agent·e·s subalternes.
Sanctions informelles des écarts relationnels
Si les surveillant·e·s insistent sur l‘importance de répondre à, voire de devancer, certaines doléances des prisonnier·e·s, cette attention n‘est ni systématique ni inconditionnelle. Les ressources interstitielles ou interdites qui se négocient dans l‘espace des coursives servent de support à des négociations sur la nature des relations de pouvoir entre prisonnier·e·s et surveillant·e·s, lesquelles passent notamment par des retraits de « faveurs » pour sanctionner des comportements qui ne satisfont pas les attentes de déférence des surveillant·e·s4. L‘analyse des synthèses comportementales rédigées à l‘issue du séjour des nouveaux prisonnier·e·s au quartier « arrivants » permet alors de décrire un jugement professionnel sur les formes adéquates que doivent prendre, dans un fragile équilibre entre l‘engagement et le retrait, les communications en coursives.
L‘importance accordée aux sollicitations des prisonnier·e·s dans le quotidien des surveillant·e·s pénitentiaires s‘accompagne d‘une dévalorisation de leur contenu et de leurs motivations qui participe à définir la nature de leur relation. Il s‘agit alors de montrer que rendre service à des prisonnier·e·s n‘est aucunement synonyme d‘être à leur service. De tels propos sont souvent infantilisants. « Ici c‘est pas une prison, c‘est une crèche »,1 commente une surveillante du centre de détention de Marignu. L‘un de ses collègues décrit les prisonniers comme « gamins mal élevés ». Il m‘explique que les détenus n‘ont aucun respect pour les choses, n‘ont que de petits problèmes et ne savent pas prendre sur eux. En particulier, ils prennent la nourriture de l‘établissement, mais ne la mangent pas, jettent systématiquement la baguette de pain qui leur est distribuée le matin, mais réclament à grands cris le jour où celle-ci ne leur est pas distribuée2. Il est fréquent de prêter aux femmes une propension particulière à formuler des requêtes. « Elles adorent ça. Dès qu‘il y a un truc », m‘explique une surveillante de la maison d‘arrêt des femmes de Tormeilles3. Pléthoriques, les requêtes des prisonnier·e·s sont présentées le plus souvent comme insignifiantes. La dévalorisation du contenu et des motivations des demandes des prisonnier·e·s participe à inscrire la relation sur le mode d‘une bienveillance personnelle, détachée de la moindre obligation professionnelle ou de toute nécessité relationnelle. « Je suis trop bonne avec lui », me dit en riant une surveillante alors que s‘éloigne un prisonnier qui lui parlait de ses déboires lors de sa dernière audience d‘application des peines.
De telles mises en cause interviennent également en présence des demandeurs : parfois acceptées, elles déclenchent alors souvent des joutes verbales où s‘engage une négociation sur la nature de la relation. Dans sa guérite du rez-de-chaussée au centre de détention de Marignu où je me trouve une après-midi, une surveillante accueille chaque nouvelle demande par des démonstrations théâtrales : elle lève les bras au ciel, s‘exclame qu‘elle n‘a pas un moment à elle, fait mine de ne plus s‘y retrouver entre les boutons qui commandent l‘ouverture des portes, etc. Alors qu‘elle me prend à témoin de ce que les prisonniers « aiment bien [la] déranger », celui qui vient d‘entrer dans la guérite lui rétorque avec un sourire sans joie qu‘elle est paresseuse et qu‘elle ne veut même pas faire son travail alors qu‘il consiste à rester assise à appuyer sur des boutons. Le ton est celui de la plaisanterie, il s‘accompagne d‘un large sourire. Néanmoins, il ne manque pas d‘une certaine vivacité, voire d‘une certaine tension1. L‘humour euphémise à peine une dévalorisation réciproque des surveillant·e·s. La faveur personnelle, accordée sans nécessité ni obligation, devient une tâche subalterne et mécanique. À la maison d‘arrêt de Tormeilles, les comptes rendus d‘incident rapportent de nombreux débordements verbaux sur le thème de l‘insignifiance du travail des surveillant·e·s
« Tu es un bon à rien, un fainéant, tu es un gorille ! tu es un voleur, va faire ton travail va me chercher mes cantines » ou encore « Vous les surveillants avec votre niveau vous n‘êtes bon qu‘à ouvrir les portes ». Ces affronts marquent le pendant de la dévalorisation du contenu et des motivations des requêtes des prisonnier·e·s : ils soulignent au contraire l‘obligation des surveillant·e·s de se mettre au service des prisonnier·e·s dans leurs actions quotidiennes.
Cette tension entre bienveillance personnelle et obligation professionnelle se décline en de multiples relations interpersonnelles. Celles-ci peuvent être approchées par une étude des « synthèses arrivants », courts textes rédigés sur le cahier électronique de liaison pour rendre compte du comportement de chaque nouvel arrivant lors de son passage dans un quartier dédié2. Ces synthèses renseignent des items prédéterminés qui aident alors à comprendre les points d‘attention essentiels de l‘évaluation professionnelle des prisonnier·e·s : Sociabilité, Promenade, Hygiène, Comportement vis-à-vis du personnel3. Cette dernière catégorie donne lieu à des évaluations succinctes de la qualité des communications avec les surveillant·e·s pendant les quelques jours passés au quartier « arrivants », et en particulier des modalités d‘expression de requêtes. L‘analyse de ces textes entre le 1er octobre 2014 et le 31 septembre 2015 (n=486)4 permet d‘identifier trois manières de caractériser ces relations, entre la demande légitime, voire trop rare, et la revendication insistante et disqualifiante5.
Un premier ensemble lexical, positif, rassemble des qualificatifs marquant l‘absence d‘incidents ou de difficultés (« calme », « tranquille »), mais aussi un engagement dans la communication respectant les formes attendues (« correct », « poli », « courtois », « respectueux »). Cela peut concerner des prisonnier·e·s dont on peut lire par ailleurs qu‘ils sont ouvert[s] », qu‘ils « discut[ent] sans problème avec tout le monde », mais aussi des individus présentés comme « timide[s] » et « non demandeur[s] ». Si ces notations sont positives, la méfiance est parfois de mise. L‘appréciation d‘un « détenu calme et correct et très courtois envers le personnel pour le moment » est immédiatement suivie d‘un commentaire suspicieux : « trop ??? ». En effet, chacune de ces formes d‘engagement ou de retrait préfigure cependant deux autres champs lexicaux pour caractériser les communications avec les surveillant·e·s, associées cette fois à des appréciations plus circonspectes – voire franchement hostiles – sur le profil du prisonnier.
Si la description d‘un prisonnier « timide, peu demandeur » peut être contrebalancée par une envie supposée d‘entrer en communication avec le personnel (« mais interrogatif »), la mention « peu expressif » ou « peu demandeur » est le plus souvent associée à des qualificatifs dépréciatifs comme « blasé, soumis ». Le fait d‘être « peu communicatif » est interprété comme une volonté de se tenir à l‘écart des autres prisonniers d‘une part (« Assez effacé, ne semble pas vouloir se mélanger aux autres pour le moment »), mais aussi des personnels de surveillance (« Semble vouloir se faire oublier »). Les deux peuvent être dissociés, comme dans cette observation qui décrit un « détenu tranquille et communicatif en entretien, [qui] évite de parler lors des mouvements collectifs de peur d‘être en contact avec la population carcérale ». C‘est en effet avant tout l‘absence de communication avec les surveillant·e·s qui semble retenir l‘attention et la réprobation. On lit ainsi qu‘un prisonnier « ne parle pas, même pour dire « merci » et « Bonjour » », il « ne formule aucune demande, et n’exprime rien ». Être « très peu dans la communication » apparaît comme une entorse aux attentes relationnelles des surveillant·e·s. Les requêtes constituent un support relationnel nécessaire à la réduction de l‘incertitude du travail en détention. Comme le notent Antoinette Chauvenet, Françoise Orlic et Georges Benguigui, « l‘évitement, le mutisme de détenus, auparavant communicatifs sont interprétés comme des signes de danger individuel et collectif »1.