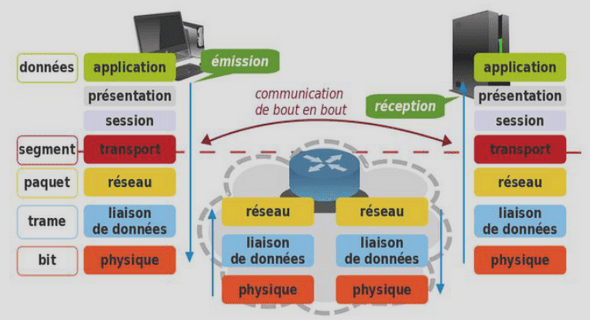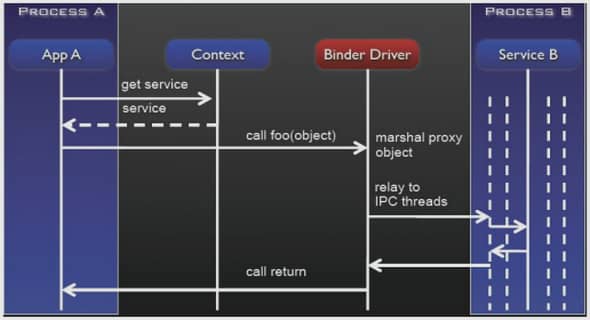Diffusion du Christianisme depuis les cités
Il existait déjà au milieu du VIe siècle quelques assemblées de chrétiens hors du centre urbain d’Autun, réparties au nord du territoire de la cité.
Un proche de l’évêque Germain d’Auxerre nommé Sénator occupait la fonction presbyter à Alésia42. Dans l’un des quartiers de la ville haute, en bordure de la voirie existait un monument similaire à une memoria ou un martyrium43. Non loin de là on découvrit un service culinaire portant des graffites Regina qui font supposer que le corps reposant dans la memoria était celui de sainte Reine. Une construction de plan basilical attenant à cet édifice fut réalisée au VIe siècle, on la suppose desservie par quelques clercs.
Dans l’agglomération de Saulieu, la présence de prêtres est encore à démontrer bien qu’il soit assez plausible qu’un culte liturgique fut rendu non loin du tabernaculum du martyr Andoche que saint Amateur évêque d’Auxerre avait visité44. Le sarcophage ayant contenu les restes des martyrs locaux présente un décor paléochrétien comparable à quelques autres découverts à Autun et à Lyon datés du début du VIe siècle45.
Le siège de Lyon est représenté par quinze saints, celui d’Auxerre par dix-sept. Bien que celui de Nevers fut érigé depuis moins d’un siècle, sa proximité avec la cité épiscopale d’Auxerre et la participation de plusieurs prélats aux conciles du VIe siècle aurait pu guider l’inspirateur de la recension gallicane. Pourtant aucun évêque de Nevers n’y est reporté.
Voir notamment SAULNIER C., 1686, Autun chrétien, naissance de l’Église, les évêques, Autun, Guillemin, p. 4, repris par la Gallia Christiana, tome IV, col. 327. Dans ces listes, figurent en tête d’autres évêques, dont saint Amateur et saint Martin au IIIe siècle. Le premier figurait dans la recension gallicane du martyrologe hiéronymien au VIe siècle, pas le second. Leur épiscopat n’est assuré par aucune source antique, Duchesne dans ses Fastes épiscopaux ne les a pas inscrits. Le fait qu’on conservait au XVIIe siècle les ossements d’un évêque nommé Aman dans un mausolée ne donne pas un crédit suffisant pour le placer en tête de la liste épiscopale d’Autun.
Un autre foyer de christianisme existait aussi dans le vicus de Cervon situé à la marge occidentale du Morvan. Saint Eptade y était qualifié de presbyter dans le courant du VIe siècle, dans sa vita comme dans la recension gallicane du martyrologe hiéronymien46.
On peut signaler dans le calendrier gallican le dies natalis d’un chrétien nommé Florentin, son statut n’est pas précisé, localisé dans le castrum de Duême au nord du diocèse. Il ne reçut le qualificatif de martyr qu’au VIIIe siècle seulement. À Semur-en-Auxois, une cella bâtie dans le castrum fut offerte par le roi Sigismond aux moines de Saint-Maurice en Valais dans les années 500.
On voit ainsi la religion chrétienne tisser son réseau, plus particulièrement entre Autun et Auxerre.
La création du siège épiscopal de Nevers
L’origine du diocèse de Nevers est plus tardive que celle d’Autun, elle date du début du VIe siècle, avant 517 puisque l’évêque Tauriciacus était présent au concile d’Épaone. Sa naissance découlait d’une nouvelle organisation politique réalisée vers 500, correspondant à la séparation des zones de domination franque d’une part, dans l’Auxerrois de Clovis et burgonde d’autre part, dans l’Autunois de Gondebraud. Le choix de Nevers comme siège épiscopal est lié à l’importance de l’agglomération secondaire qui était alors ceinte d’un castrum, au centre duquel on choisit d’ériger l’ensemble architectural paléochrétien composé d’une cathédrale, d’une église annexe et d’un baptistère monumental47. La naissance assez tardive du diocèse correspond au détachement de son territoire d’un autre diocèse, soit celui d’Autun, soit celui d’Auxerre. La seconde hypothèse est aujourd’hui admise, elle donne à Gondebraud l’initiative de la fondation de cet évêché afin que son peuple n’ait pas à dépendre d’un évêque auxerrois lié à Clovis48. Les successeurs de Tauriciacus sont connus par leur présence à différents conciles mérovingiens, on retient notamment Rusticus et Aré.
Premiers développement connus dans le Nivernais
L’organisation de cette récente ville épiscopale a pris corps assez rapidement. À la fin du siècle, dans les années 590, l’évêque Agricole fonda un monastère sous le vocable de Saint-Vincent au nord-est du castrum sur la voie conduisant à Lutèce, dans la zone des nécropoles chrétiennes. C’est d’ailleurs dans ce lieu qu’il fit porter sa sépulture49. Hors de la cité, quelle organisation peut-on apercevoir ? Il semblerait qu’à Decize, installée en bord de Loire sur la route d’Autun à Paris, un petit foyer chrétien existait dans la seconde moitié du VIe siècle. En effet, l’évêque Aré aurait souhaité être enterré auprès d’ermites installés dans une cellule50. L’archéologie livrera sans doute d’autres indices de la christianisation du Nivernais.
Il est difficile d’entrevoir l’organisation de communautés rurales pour cette époque. Un essai a été tenté dans les environs d’Auxerre à partir du croisement de sources écrites et de vestiges archéologiques. La documentation d’époque mérovingienne est le règlement d’Aunaire fixant le parcours des églises stationnales du clergé d’Auxerre à la fin du VIe siècle. La vingtaine d’églises citées est inférieure d’un tiers au nombre de vestiges liés à une occupation humaine découverte dans cette zone51. D’une part, ce règlement n’avait pas pour objet d’inventorier les églises comme dans le cas d’un pouillé et il se peut que tous les oratoires ou cella n’aient pas été cités. D’autre part, la présence d’une nécropole mérovingienne n’atteste pas l’existence d’une église à proximité et il peut y avoir une marge importante entre le nombre de sites archéologiques mérovingiens et le nombre de lieux de culte existant.
Pour ces époques hautes, une autre tentative portant sur l’Autunois dans la vallée de l’Arroux visait à dégager l’évolution paroissiale durant le haut Moyen Âge se heurte aux limites des données52. Le tableau dressé siècle par siècle à partir d’outils géomatiques est séduisant, mais deux obstacles majeurs sont apparus qui conduisent à invalider une partie des résultats. Le premier est, là encore, d’ordre sémantique : tous les lieux de culte sans distinction de statut ont été traités de façon similaire comme des parochiae, alors qu’il s’agit d’ecclesia, de cella, d’oratoires privés dont on ne peut affirmer qu’ils entraient dans un système de culte partagé pour une communauté villageoise précise. Pour le second, faute d’indices chronologiques absolus, ce sont les vocables qui ont parfois permis de tenter une datation. Or, le fonds majoritairement constitué de saints bibliques ne peut pas être attribuable à une période plutôt qu’à une autre53.
la lecture des dernières synthèses sur cette question, il apparaît que la paroisse comprise au sens d’un territoire établi pour une communauté vivant dans le ressort d’une église ne soit applicable qu’à partir des Xe-XIIe siècles54.
Le développement des réseaux communautaires (VIIe-XIIe siècles)
Les premiers établissements monastiques, suburbains, étaient favorisés à la fois par les souverains Burgondes et mérovingiens et par l’épiscopat dont on sait pour l’époque qu’il était très lié à l’aristocratie, voire issu de ses rangs et que les évêques avaient souvent été fonctionnaires à la cour royale. Depuis les centres intellectuels importants qu’étaient les monastères de Marmoutiers, de Fleury-sur-Loire, de Luxeuil, des moines partirent créer d’autres établissements. C’est le cas de la ville de Nevers qui profita de l’oeuvre d’un disciple de Colomban.
L’œuvre des abbés aux VIIe et VIIIe siècles
Théodulfe Baboleine, moine formé à l’abbaye de Luxeuil, avait fondé dans les années 620-640 pas moins de quatre monastères entre le Berry et le Nivernais55. La proximité de ces établissements indiquerait qu’ils reposaient sur les terres mêmes du moine, bien que la provenance du personnage soit mal connue. Sa fondation à Nevers vers 635-40 est identifiée avec l’église Notre-Dame-Saint-Genest au sud-ouest du castrum56. En 643, l’évêque Rauracus de Nevers se joignit à onze autres prélats siégeant en Neustrie et en Burgondie pour accorder à Baboleine et à ses moines l’exemption épiscopale57. Peu après, à la suite de nombreuses promotions des colombaniens, il accédait à la fonction d’abbé de l’établissement royal de Saint-Maur-des-Fossés. On attribue encore au mouvement colombanien l’installation à Nevers au VIIe siècle d’une autre communauté religieuse, féminine, localisée au nord-ouest du castrum et placée sous le vocable de Saint-Etienne. Cette fondation féminine s’inscrivait dans un vaste mouvement de création de ce type dans la province de Sens où l’on comptait déjà une vingtaine d’établissements58.
Un siècle après sa promotion, le siège épiscopal de Nevers s’est enrichi d’une ceinture de monastères bordant le castrum.
Extension des réseaux monastiques en contexte rural
Vers 700, l’abbé de Saint-Martin d’Autun devait commander une communauté devenue prospère puisqu’il implanta un prieuré sous son autorité dans le Nivernais au lieu qui prit dès lors le nom de Saint-Pierre-le-Moûtier. Quelques années plus tard, le testament dressé en 719 par Varé, abbé et riche propriétaire foncier59, nous éclaire sur la pérennité de quelques communautés nées au Ve siècle. Dans la basilique d’Alise comme dans celle de Saulieu, Varé a eu des droits, peut-être a-t-il été à leur tête. Il leur légua de nombreux biens fonciers situés dans l’Auxois, l’Avalonnais, le Nivernais et le Morvan ainsi que les hommes attachés à ces domaines.
En outre, Varé fonda au cœur de ce domaine une nouvelle communauté monastique sous le vocable de Saint-Prix située dans le castrum de Flavigny placée sous l’autorité de Magnoaldus. Il lui fit d’importantes donations foncières et l’exempta de l’autorité épiscopale60. Il projetait aussi de placer un prieuré dans la dépendance de Flavigny, à Corbigny sur les terres de son père Corbon, mais son projet fut différé jusque dans les années 860. À cette époque le monastère était riche d’un patrimoine de quatre-vingt unités d’exploitations qui en faisait l’un des plus importants du diocèse.
Moins bien documentées sont les fondations de l’abbaye Saint-Georges de Couches61 attribuables et Saint-Merry de La Celle au VIIIe siècle situées au sud de la cité d’Autun.
L’implication de l’aristocratie carolingienne dans les missions monastiques
En quelques décennies, les potentats de Bourgogne eurent à cœur de développer un tissu de monastères sur leurs terres ; ceux-ci ont pour effet non seulement de favoriser les progrès de la religion mais aussi de créer des nœuds relationnels. Le partage des territoires au moment du Traité de Verdun et les luttes entre partisans des fils de Louis le Pieux furent déterminants pour l’implantation de puissants établissements religieux. Le septième comte d’Autun Eccart ou Audri (Aldricus), partisan de Lothaire62 et grand propriétaire foncier fonda en 840, dans sa seigneurie de Perrecy63, un prieuré qu’il porta à l’abbaye de Fleury-sur-Loire.
Manassès de Vergy qui possédait divers comtés dont ceux d’Auxois et de Beaune implanta un monastère à Amaous au sud-est d’Auxonne vers 860-70 et encore un autre au début du Xe siècle sur le territoire de sa seigneurie de Vergy dont le château était bâti sur un éperon. Ses deux prieurés prirent le vocable de Saint-Vivant du nom du saint mis sous la protection du comte par les moines de Saintonge fuyant les Normands.
L’initiative de l’implantation de religieuses à Saint-Père-sous-Vézelay en 858 venait du comte Girart de Vienne, régent du comte de Provence et de son épouse Berthe fille du comte de Paris. Issus de la haute aristocratie franque proche du pouvoir royal, ces deux personnages possédaient d’immenses domaines notamment en Bourgogne.
La communauté fut placée dès 863 sous la protection pontificale afin de la protéger de toute tentative d’usurpation par des laïcs. Par ce biais, Girart, alors en délicatesse avec Charles le Chauve dont il s’était éloigné pour rallier le parti de Lothaire lors du traité de Verdun, offrit à ce monastère un solide gage de sécurité64. La présence des corps des saints Andéol et Pontien obtenus dans les années 86065 complétait la protection du lieu et de la communauté par leur virtus. Son implantation primitive fut toutefois de courte
Varé appartenait par son père à la haute noblesse du royaume, il était grand vassal de Charles Martel. Le testament de Varé en 719 intervient peu de temps après que Charles Martel a pris le pouvoir en Neustrie et s’apprêtait à conquérir le royaume franc durée, on la remplaça en 878 par une communauté masculine établie désormais au sommet de la colline de Vézelay66. C’est vraisemblablement la fondation carolingienne la plus riche du diocèse67.
En 880, Letbalde et Aspasie seigneurs d’Anzy-le-Duc fondèrent un prieuré dépendant de Saint-Martin d’Autun. Ici point n’a été besoin d’acquérir ou d’inventer des reliques, le premier prieur Hugues de Poitiers fut vénéré dès son décès survenu vers 930.
Au Xe siècle, l’ascension des comtes de Chalon, qui sont aussi vicomtes d’Autun, dans la politique bourguignonne constitua un rempart face aux prérogatives des comtes d’Auvergne68. Le comte Lambert fonda en 973 un monastère Notre-Dame-Saint-Jean-Baptiste à Orval sur le territoire de Paray69, sa sépulture s’y trouve depuis 983, comme celle de son petit-fils Thibaut en 1065 peut-être de son arrière petit-fils Hugues II mort en 1078. Le comte Lambert avait formulé le vœu de doter son sanctuaire de reliques prestigieuses, il conçut avec l’évêque de Chalon d’ôter celles du monastère Saint-Laurent. Le projet fut, semble-t-il, différé et intervint dans la première moitié du XIe siècle. L’évêque saint Grat fut substitué à saint Jean-Baptiste dans le vocable70. Pour donner plus de “ corps ” à ces reliques, on rédigea une Vita légendaire du saint évêque dans le courant du XIe siècle71.
Un peu plus tard, la fondation de Marcigny-sur-Loire en 1055 est due à Hugues de Semur abbé de Cluny et de son frère Geoffroi II sur leurs terres familiales. Les nœuds de relation, entre les familles du Brionnais et du Charolais, renforcèrent la position de Cluny.
Aux IXe et Xe siècles, d’autres établissements ont été favorisés par la noblesse locale. Dans le diocèse d’Autun, un monastère dédié à Saint-Martin est signalé, au sud de la cité épiscopale à Mesvres, en 84372 de même que l’abbaye de Saint-Pierre d’Yzeure près de Moulins Autour du castrum de Nevers, d’autres fondations monastiques ont complété la première strate mérovingienne, les abbayes de Saint-Trohé, Saint-Martin, Saint-Loup et le prieuré Saint-Sauveur trouvent leur origine dans le courant du IXe siècle.
Le maillage monastique de plus en plus dense qui supposait aussi une gestion partagée des biens et des richesses entre de nombreux établissements obligea les évêques à intervenir pour se départir des prérogatives des abbés comme des feudataires.
La place de l’évêque
Vers une remise en ordre diocésaine
Deux tendances dirigent nettement les actions menées par les prélats dans la seconde moitié du IXe siècle. Il s’agit d’une part, après le partage de l’Empire de Charlemagne de se positionner par rapport aux puissants, comtes de Chalon, comtes d’Autun, comtes du Beaunois, etc., et par rapport au roi de Francie Occidentale, Charles le Chauve afin de faire revenir dans le giron de l’Église les biens dispersés. D’autre part, le corollaire spirituel concerna la restauration de plusieurs établissements monastiques tombés dans le désordre par délabrement moral et matériel.
Le poids de l’opposition aux feudataires
La seconde moitié du IXe siècle fut fructueuse pour l’église d’Autun qui s’est vue protégée par Charles le Chauve et par Richard le Justicier.
L’épiscopat de Jonas le montre particulièrement. À sa demande, Charles le Chauve prit l’église d’Autun sous sa protection en 85073. Il accomplit en 853 la plus importante démarche dans la reconnaissance des droits de l’Église d’Autun par l’autorité comtale, en obtenant d’Isembard la reconnaissance du droit supérieur de son église74.Il recouvrit enfin de nombreux domaines dont la terre de Tillenay en 86075 rendue par Charles le Chauve, lequel remis l’année suivante sur requête du comte Onfroi d’autres domaines de la Voivre, de la Porcheresses, de Couhard et de Pierre-Cerveau usurpés par les anciens comtes d’Autun76.
Charles le Simple restitua en 900 à l’église d’Autun gouvernée par Wallon de Vergy le droit de frapper monnaie, que son père avait accordé le premier ainsi que la possession du castrum que les comtes d’Autun avaient aliénée77.
L’évêque d’Autun Gauthier I assista à deux conciles de la Paix de Dieu, à Anse en 994 et à Verdun-sur-le-Doubs en 1019-21, son successeur Helmuin se rendit au second concile d’Anse en 102578 accompagné des reliques du prieur d’Anzy-le-Duc, Hugues de Poitiers. Dans un contexte de heurts entre les princes et leurs vassaux pour le contrôle du pouvoir sur les fiefs, les statuts des conciles de la Paix de Dieu visaient à protéger les églises, les clercs auxquels on ôtait le droit de porter les armes, ainsi que les religieux et les pauvres. En effet, les églises entraient encore dans le patrimoine privé des nobles et passaient d’une main à l’autre par le jeu des donations, échanges et héritages, ce qui risquait d’entraîner une instabilité pour le desservant chargé de la cura animorum.
Dans le diocèse de Nevers, il semble que la volonté ou la possibilité d’intervention épiscopale soit moins développée. Aucun évêque n’assista aux conciles décisifs pour le mouvement de la Paix de Dieu entre les années 994 et 1037. Le cartulaire de l’église de Nevers comporte d’ailleurs tout au long du XIe siècle de nombreuses usurpations de biens d’église par des particuliers, voire par le prévôt du chapitre de la cathédrale lui-même79.
Ce n’est qu’en 1110 que le comte Guillaume de Nevers s’engagea à ne pas saisir les biens de l’église à la mort d’un évêque. Sur le plan de la gestion du temporel, les évêques de Nevers ne se heurtaient pas seulement au pouvoir comtal, mais également aux prérogatives du puissant prieur de Saint-Etienne qui, en tant que seigneur d’une partie de la ville octroyait libertés et franchises aux habitants de son bourg80.
Le cap des réformes et des restaurations
Quelle a pu être l’incidence des préoccupations des évêques d’Autun liées à ce mouvement de pacification comme d’ailleurs au contexte global de réforme dans lequel ce mouvement s’inscrit, sur leur terrain d’action ? En l’absence de statuts établis pour cette époque, une partie de la réponse peut être recherchée dans les chartes émanant de ces évêques, celles qui concernaient l’abbaye de Flavigny sont particulièrement éclairantes.
L’abbaye de Flavigny connut au Xe siècle une profonde crise et fut, pendant un temps, dépossédée de ses droits par les évêques d’Autun. Gauthier y restaura la règle en 992 et restitua à son abbé les droits sur quatorze églises paroissiales81. En 977, il porta sous son patronage l’église Saint-Genest de Flavigny. Son successeur Helmuin, poursuivit l’action en confirmant en 1034 à l’abbé de Flavigny son autorité sur l’abbaye de Corbigny, en dépit des protestations de l’abbé de Corbigny, dissident et aspirant à l’autonomie82. Toutefois, l’abbé de Flavigny perdit rapidement son pouvoir sur l’abbaye de Corbigny dont la procédure d’indépendance se poursuivit entre 1076 et 1107.
Les bonnes dispositions des évêques en faveur de l’abbaye ont permis de tempérer les désordres et de rendre au monastère son succès attesté par les nombreuses donations de particuliers qui occupent les dernières chartes du cartulaire.
Nevers, l’évêque Hériman bénéficiait comme ses prédécesseurs depuis l’évêque Jérôme, de la protection de rois, que Charles le Chauve confirma en 84183. Or, la ville avait traversé difficilement la succession de Charlemagne et les guerres féodales sous les comtes amovibles de Nevers84. Il restaura l’ancienne abbaye mérovingienne Notre-Dame-Saint-Genest. Il fonda aussi une communauté religieuse à Saint-Aignan. Par le même acte, Hériman s’imposa comme un évêque très concerné par les affaires de sa cité pour laquelle il institue deux hôpitaux, l’un destiné aux personnes aisées, l’autre aux nécessiteux. Les prieurés de Saint-Sauveur et Saint-Etienne entrèrent dans le giron de Cluny, par l’appui des évêques Hugues le Grand en 1045 et de Guido en 1097.