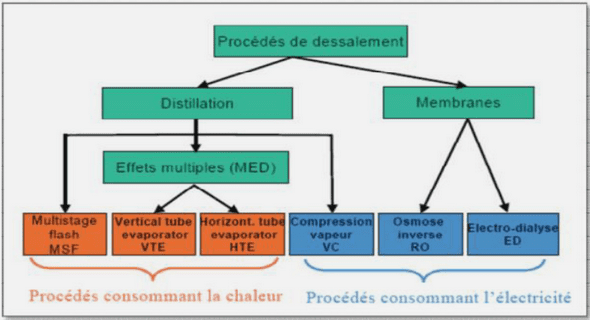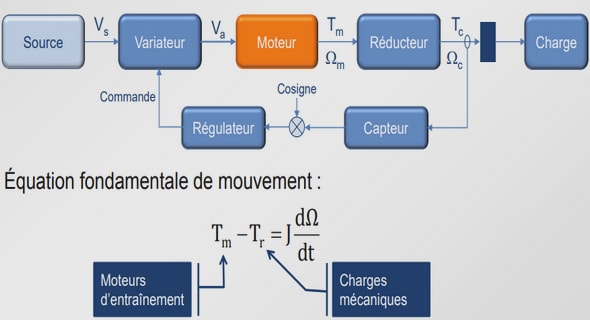La disposition du travail
Pour essayer de répondre à la question de recherche, le travail est divisé en plusieurs parties. Premièrement, nous faisons une étude historique pour mettre en lumière l’évolution du français en Suisse. Cette partie sert à donner un contexte historique au sujet du mémoire, nécessaire pour pouvoir mieux comprendre l’origine des expressions dites suisses comprises dans cette étude. Deuxièmement, dans une présentation des matériaux et de la méthode, cinquante expressions dites spécifiquement suisses selon quelques dictionnaires français de Suisse français de France, ont été choisies. La sélection des expressions est faite selon quelques critères présentés dans la partie 3.2.1.
Troisièmement, dans un chapitre consacré à l’analyse, les expressions choisies et leurs « traductions » en français de France ont été cherchées et comptées dans le Corpus Oral de Français de Suisse Romande, la base de données comprenant des enregistrements. Cette partie est divisée en deux sous-parties. Dans la première, les expressions cherchées sont analysées en fonction de leur origine et leur catégorie de variation (dialectisme, archaïsme, germanisme, statalisme) en utilisant quelques dictionnaires. Dans la deuxième partie de l’analyse, les résultats sont présentés dans un tableau montrant la présence des différentes versions d’expressions cherchées dans le corpus.
La quatrième partie est consacrée à la synthèse, où les résultats de l’analyse sont présentés sous forme d’un texte. Le résultat de l’étude de l’origine des expressions est résumé et les résultats du tableau sont divisés en différentes groupes et résumés.
L’histoire du français helvétique
Cette partie a pour objet la présentation brève de l’histoire de la langue française et, plus spécifiquement, le français en Suisse – le français helvétique.
L’Université de Neuchâtel présente sur son site internet la Suisse romande, et déclare que l’espace géographique qui constitue la Suisse romande d’aujourd’hui « a été romanisé la suite de la conquête romaine, entre le IIe s. av. J.-C. et le début de l’ère chrétienne ». Ainsi, la Suisse est un pays latin, depuis 2000 ans (Université de Neuchâtel, 2000). Dans les parties suivantes, le rôle joué par cette latinisation dans l’histoire de la langue française est exploré.
Origine du français
Selon Charoenwutipong (2016 : 10), dans Le français de Suisse romande la zone géographie qui constitue aujourd’hui la Suisse est occupée par les Celtes vers le Ve siècle avant J.-C., jusqu’à la conquête de la Gaule par les Romains. Les peuplades celtes parlent les langues celtiques – des langues indo-européennes – mais dans l’écriture, le grec est utilisé. Pour l’ensemble des peuples habitant la Gaule à cette époque-ci, on utilise le terme : les Gaulois.
Les Romains arrivent en Gaule en 58 avant J.-C.. Pour les Helvètes, vivant sur le plateau Suisse, leur arrivée mène à une soumission définitive en 69-71 après J.-C. (Larousse, a). Avec les Romains arrivent aussi les langues latines, et Charoenwutipong déclare que : « on distingue généralement deux variétés de latin : le « latin classique » et le « latin vulgaire » » dont le premier est surtout utilisé à l’écrit et le deuxième à l’oral (Charoenwutipong 2016 : 11). Le territoire est maintenant appelé la Gaule romaine et à cet endroit, les Celtes parlent toujours leur langue celtique, mais ils apprennent aussi le latin pour pouvoir communiquer avec les Romains. Cependant, les Celtes parlent le latin avec un accent étranger, et le latin parlé par la population celtique est modifié par les langues celtiques (Charoenwutipong 2016 : 12). La latinisation de la Gaule n’est pas un processus homogène. La partie du sud de la Gaule (au bord de la mer Méditerranée) est la partie la plus accessible aux Romains, et par conséquent, la latinisation commence à cet endroit. En revanche, le terrain montagneux de la partie du nord de la Gaule la rend plus inaccessible que celle du sud, et il y a ainsi un retard dans la latinisation dans cette région (Charoenwutipong 2016 : 12).
Les Francs arrivent en Gaule, avec leurs langues germaniques vers les années 250-275 (Leclerc 2019) et cet évènement cause une situation de plurilinguisme à l’est de la Gaule, à cause des interactions entre les Francs, les Gaulois et les Romains. Comme l’écrit Charoenwutipong, les Francs utilisent le latin pour l’administration et leur propre langue germanique – le francique – pour communiquer entre eux (Charoenwutipong 2016 : 13). Cependant, le francique disparaît ultimement alors que le latin reste, et au IXe siècle le résultat de ce processus est une variété de latin modifié d’abord par la langue celtique et puis par le francique. Cette variété-là est le français.
Le français helvétique
Le territoire qui devient ultimement la Suisse est au Ve siècle envahi par les Burgondes et les Alamans (Larousse, a). Les Burgondes sont déjà chrétiens, et ils s’installent dans la région où habitent la population latinisée, incluant la Suisse romande d’aujourd’hui. Par contre, les Alamans païens germanisent une partie de l’Helvétie, un territoire qui va plus tard constituer une autre partie de la Suisse (Larousse, a). Selon Charoenwutipong, les Burgondes parlent un dialecte germanique, mais ils l’abandonnent peu à peu au profit du latin et il ne reste plus de traces linguistiques de leur dialecte en Suisse romande aujourd’hui (2016 : 14).
La Confédération Suisse naît en 1291 – et elle est composée de trois cantons germanophones : Uri, Schwyz et Unterwald (Manno 2007 : 2). Aujourd’hui, la Suisse est composée de 26 cantons, dont sept sont entièrement ou partiellement francophones (Manno 2007 : 5). Les cantons de Genève, du Jura, de Neuchâtel et de Vaud sont francophones unilingues, alors que les cantons bilingues – où le français et l’allemand sont les langues officielles – incluent les cantons de Fribourg et du Valais, ainsi que les districts francophones du canton de Berne (Manno 2007 : 6). Le domaine linguistique du francoprovençal est le domaine auquel appartient la plupart des cantons composant la Suisse romande (Université de Neuchâtel, 2000). Le francoprovençal est une langue gallo-romaine indépendante », développée au sud-est de la France dont les particularités linguistiques […] sont documentées depuis la fin du VIe siècle » (Université de Neuchâtel, 2000).
Aujourd’hui, la partie francoprovençale constitue la partie principale de l’espace de la Suisse romande. Cependant, le canton du Jura appartient au domaine linguistique d’oïl (Université de Neuchâtel, 2000). Dans ce domaine, on trouve des dialectes francs-comtois, parlés par les jurassiens. Par contre, le Jura bernois constitue « une zone de transition » où on trouve trois types de dialectes : franc-comtois, francoprovençal et intermédiaire. Ces trois types sont trouvés dans le nord-est, le sud-est et le centre du Jura bernois, respectivement (Université de Neuchâtel, 2000). Le francoprovençal et le franc-comtois sont des dialectes romands appelés aussi patois (Charoenwutipong 2016 : 21).
Charoenwutipong déclare aussi qu’il y a quatre types de variations distinguant le français de Suisse romande du français standard : les dialectismes, les archaïsmes, les germanismes et les innovations/les statalismes (Charoenwutipong 2016 : 21). Les dialectismes constituent des formes linguistiques empruntées aux dialectes romands (patois), alors que les archaïsmes « représentent d’anciennes normes du français » utilisées dans certaines « régions francophones périphériques » (Charoenwutipong 2016 : 21). Les mots septante et nonante sont des exemples d’archaïsmes. Les germanismes dans le français de Suisse romande constituent des traces du contact entre le français et l’allemand, tandis que les innovations et les statalismes sont, selon Charoenwutipong, des formes linguistiques régionalement limitées, crées ou résultant d’une évolution interne dans la langue française en Suisse romande (Charoenwutipong 2016 : 21).
Matériaux et méthode
Cette partie sert à présenter les sources principales et la méthode utilisée.
Matériaux
Les matériaux présentés dans cette partie incluent le Corpus Oral de Français de Suisse Romande ainsi que les dictionnaires français de Suisse – français de France.
Le corpus
Le Corpus Oral de Français de Suisse Romande – OFROM, est un corpus développé à l’Université de Neuchâtel, sous la direction d’Avanzi, Béguelin et Diémoz (2016, a). Il est composé de 64 heures d’enregistrements de 341 locuteurs francophones de Suisse romande. Dans ce corpus, il est possible de faire des recherches de mots ou d’expressions, pour vérifier leur présence dans les enregistrements. Les résultats sont présentés sous forme de fragments de textes, représentant des fragments d’enregistrements et contenant le mot cherché ou l’expression cherchée. Ces fragments sont plus ou moins longs et offrent plus ou moins de contexte.
En faisant des recherches, il est possible de faire une seule recherche principale, mais aussi d’ajouter des critères pour filtrer le contexte. Ainsi, il est possible de combiner différents critères dans la recherche. Les fonctions disponibles incluent des fonctions pour chercher un mot entier, une chaîne de caractères et une partie du discours (nommé Part of speech) etc. (Avanzi, et al. 2016, b : 13). La fonction part of speech permet par exemple une recherche de toutes les conjugaisons d’un verbe, tout comme un seul mot ou un mot dans une expression.
Si un critère est ajouté à la recherche principale, il faut spécifier si ce critère constitue un contexte antérieur ou postérieur par rapport à la recherche principale, mais aussi l’intervalle. L’intervalle détermine « l’empan temporel du contexte de recherche (en termes de nombre de mots ou de secondes) » (Avanzi, et al. 2016, b : 14).
De plus, l’utilisateur a la possibilité de filtrer les résultats par rapport au locuteur, selon différents critères incluant : le canton de résidence actuel, le lieu de résidence actuel, les enregistrements d’un locuteur spécifique (à l’aide d’un code anonyme), la langue, le niveau socio-éducatif, le sexe, l’âge au moment de l’enregistrement (Avanzi, et al. 2016, b : 15).
La possibilité de filtrer les enregistrements quant au genre de parole (incluant la conférence, la discussion et la narration) et à la qualité sonore existe aussi (Avanzi, et al. 2016, b : 16).
Les dictionnaires
Pour trouver des expressions à étudier, deux dictionnaires (ou plutôt listes), déclarant des différences entre le français de France et le français de Suisse, sont utilisés. La première liste, appelée « Petit guide d’expressions idiomatiques pour la Suisse francophone », se trouve sur Le blog du frontalier. Ce blog est lié à l’entreprise MonCoachFinance, notamment spécialisée dans la fiscalité franco-suisse, et contenant des informations pour les frontaliers – à savoir les personnes qui selon le dictionnaire Larousse habitent près d’une frontière, et, en particulier, qui travaillent au-delà de cette frontière (Larousse, b). La liste a été publiée en 2017, et est écrite par Emilie Steinert, étudiante en sciences politiques et histoire militaire (Steinert 2017).
La deuxième liste, avec le titre « Lexique français – Suisse romand », est publiée sur les Pages persos de Robert FERRÉOL, mathématicien et ex-professeur au lycée de Fénelon à Paris (Ferréol n.d.).