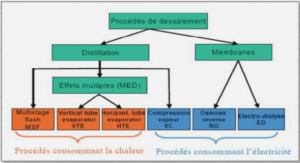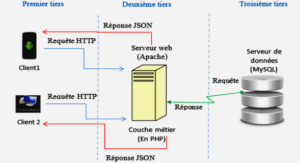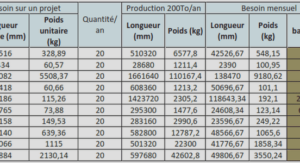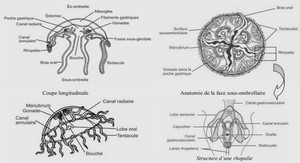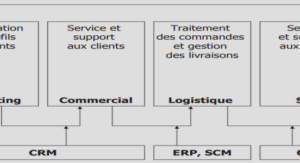La relativité
Le but de cet exposé est de présenter de façon simple la Relativité qui trop souvent est synonyme de complexité ou d’incompréhension. Même dans les ouvrages ayant pour vocation de la mettre à portée de tous on a beaucoup de peine à comprendre les fondements et les concepts de cette théorie qui allait révolutionner le XXème siècle. Cet exposé n’a pas la vocation d’un cours magistral, bien au contraire. Il a pour objectif de vous présenter la théorie de la relativité sans faire appel à un formalisme mathématique lourd et indigeste pour le profane. Seuls, les résultats fondamentaux seront exprimés afin de permettre de comprendre les conséquences de cette théorie et ses applications. « Si la relativité se révèle juste, les Allemands diront que je suis Allemand, les Suisses que je suis citoyen suisse, et les français que je suis un grand homme de science. Si la relativité se révèle fausse, les français diront que je suis Suisses, les Suisses que je suis Allemand, et les allemand que je suis juif. » Pour comprendre, il faut faire un retour en arrière d’environ cent cinquante ans et établir un état de la connaissance des scientifiques d’alors et envisager les problèmes qui leur étaient posés. Le premier d’entre eux a trait à la lumière. Plan B. La Lumière : Que ce soit la foudre, les éclairs, les tornades ou les tremblements de Terre, lorsqu’un physicien s’interroge sur un phénomène, il cherche tout d’abord à en déterminer sa nature, puis la vitesse à laquelle ce phénomène se propage. La lumière n’allait pas échapper à cette règle. Ainsi, de nombreux physiciens essayèrent de calculer sa vitesse ou plutôt sa célérité. 1°) Célérité de la lumière Dès l’Antiquité on connaissait qualitativement les propriétés fondamentales des rayons lumineux : propagation rectiligne, réflexibilité, réfrangibilité … On a utilisé très tôt les propriétés des lentilles et des miroirs sphériques, les phénomènes de dispersion par le prisme ; des expériences sur ce sujet dans la Catoptrique d’Euclide et dans l’Optique de Ptolémée et de Damianus. Malheureusement, les notions malhabiles qui interviennent ne permettent d’obtenir aucune simplification des données expérimentales et, bien entendu, aucun résultat quantitatif. En effet, depuis que Parménide (515-440 av. J.C.) a proclamé que la lumière se déplaçait – que celle que reçoit la Lune vient du Soleil – aucune tentative n’a été faite pour mesurer sa vitesse, ou même pour déterminer si celle-ci était finie ou infinie, c’est-à-dire comme on disait au XVIIème siècle, si son déplacement était « progressif » ou « instantané ». Cet insuccès se prolonge encore quand Alhazen (Ibn-Al-Haytham) propose, au début du XIème siècle, une explication mécaniste de la réflexion de la lumière sur les miroirs. Il amorce même une intéressante interprétation de la réfraction mais cependant, n’aboutit à aucune conclusion précise. Néanmoins, il était convaincu que la vitesse de la lumière était grande mais finie. Ensuite, il faudra attendre la fin du XVIème siècle pour que Galilée imagine une expérience analogue à celle qui permettra plus tard à Mersenne de mesurer la vitesse du son grâce à l’écho : tenter d’évaluer le temps mis pour faire un aller-retour entre les sommets de deux collines voisines. Galilée se place, une nuit, sur l’un de ces sommets, muni d’une lanterne à volet, dont la lumière peut-être découverte brusquement. Sur l’autre colline, un assistant dispose d’une lanterne identique, qu’il doit découvrir dès qu’il apercevra la lumière de Galilée. En évaluant le temps mis par la lumière pour faire l’aller-retour – plus le temps de réaction de l’assistant … Envisagée à l’origine entre deux endroits distants de 15 km, l’expérience fut finalement réalisée sur 200 m. En vain évidemment. Des membres de l’Académia del Cimento essayèrent sur 2 km sans davantage de résultat. Galilée put seulement conclure, et cette conclusion modeste est un modèle de sérieux scientifique : « … je n’ai pas pu décider si l’apparition de la lumière opposée est instantanée ; si elle ne l’est pas, elle est du moins extrêmement rapide, quasi-immédiate ». Par conséquent, on ne pourra espérer mesurer le vitesse de la lumière que de deux façons : en mesurant des temps extrêmement brefs, ou en utilisant des distances très grandes – c’est-à-dire astronomiques. Le principe reste le même que celui exposé par Galilée. On cherche toujours a évaluer le temps mis par la lumière pour parcourir une certaine distance, mais cette fois non plus entre les sommets de deux collines voisines mais entre deux planètes distantes de plusieurs millions de kilomètres. En mesurant le temps mis pour parcourir cette distance, on peut calculer la vitesse ou plutôt la célérité de la lumière dans l’espace qui n’est alors pas encore vide mais empli d’éther. Le seul problème est que pour y parvenir il faut connaître la distance entre deux planètes – Terre-Soleil – par exemple. Malheureusement, à cette époque, si le système de Copernic commence peu à peu à s’imposer, il ne fournit que des distances relatives entre les planètes et le Soleil. En effet, depuis Aristarque de Samos, on savait qu’il était très difficile de mesurer avec précision la distance Terre-Soleil. Alors plutôt que de produire une estimation imprécise, Copernic avait choisi de se servir de la distance Terre-Soleil comme d’un étalon, que l’on nomma unité astronomique (UA). Dans le système de Copernic, la distance Mars-Soleil est 1.5 UA. C’est-à-dire que Mars se trouve à une distance égale à 1.5 fois la distance Terre-Soleil du Soleil. La première estimation raisonnablement précise de l’unité astronomique fut obtenue par Jean Richer et Jean-Dominique Cassini en 1671. Richer partit en expédition à Cayenne, en Guyane française (Amérique du Sud), et Cassini demeura à Paris. À un moment convenu à l’avance, ils notèrent la position de Mars en prenant pour point de repère l’arrière-plan des constellations. Au retour de Richer, ils comparèrent leurs observations et notèrent que la position de Mars différait légèrement vue de Paris et vue de Cayenne. La différence de l’angle formé par chacune des deux lignes de visée n’était que de quelques millièmes de degrés, mais la précision des mesures de Richer et de Cassini était suffisante pour que le résultat soit considéré comme significatif. Connaissant la distance de Paris à Cayenne, Richer et Cassini purent déterminer la distance de la Terre à Mars (voir figure). Une fois cette distance établie, il ne restait plus qu’un simple calcul à faire pour calibrer l’échelle du système de Copernic.
Restait alors à trouver un moyen de calculer le temps mis par la lumière pour nous parvenir d’une planète. Or depuis la nuit de janvier 1610 où Galilée avait découvert les satellites de Jupiter, ces « planètes médicéennes » n’avaient cessé d’être étudié avec la plus grande précision, en particulier par Cassini qui avait établi des tables précises de ces satellites. Cassini avait demander à un jeune astronome danois Olaüs Romer de vérifier ces tables. Celui-ci eut la surprise de trouver un retard ou une avance systématique entre des éclipses de ces satellites selon que Jupiter est en conjonction ou en opposition (voir figure). A Romer revient seul le mérite de l’interprétation correcte de cet écart avec les prévisions : l’écart total (22 minutes) représente le double du temps que met la lumière pour parcourir la distance du Soleil à la Terre. Ainsi, le 22 novembre 1675, une première estimation de la vitesse de la lumière était réalisée. Soit environ 226 869 km/s. La valeur elle même ne présente pas un grand intérêt. Le résultat de la mesure en revanche, démontre que cette vitesse est bien finie ! Cette estimation ne cessera d’être affinée au cours des siècles par les plus illustres scientifiques. Ainsi, en 1727, James Bradley (1693-1762) calcule le temps mis par la lumière solaire pour parvenir sur la Terre : 493″ (soit environ 8 minutes). Les estimations de l’unité astronomique ayant été améliorées, il lui est possible d’en déduire la vitesse de la lumière avec une meilleure précision : 303 000 km/s. Environ un siècle plus tard, ce sont les physiciens « amateurs » comme ils aimaient à se qualifier eux-mêmes puisqu’ils n’avaient été ni à l’Ecole Polytechnique, ni à l’Ecole Normale : Hippolyte Fizeau (1819-1896) en 1849 avec le dispositif de la roue dentée, puis Léon Foucault (1818-1868) en 1850 grâce à la méthode des miroirs tournant qui précisent encore davantage la mesure avec une valeur égale à 312 146 km/s. Si le débat sur la finitude de la célérité de la lumière semble clos, un autre qui s’est ouvert concomitamment va perdurer jusqu’au début du XXème siècle. Il porte sur la nature de la lumière. 2°) Nature de la lumière » Nous saurions beaucoup de choses, affirmait Louis de Broglie, si nous savions ce qu’est un rayon lumineux. » De quoi la lumière est-elle faite ? Isaac Newton, observant que les ombres des objets étaient nettes et non pas floues, avançait prudemment l’idée que la lumière est constituée de toutes petites billes, autrement dit de corpuscules. Il expliquait par exemple le phénomène de réflexion sur un miroir par le fait que les corpuscules rebondissent sur la surface du miroir, un peu comme une balle rebondit sur un mur. Il énonça l’ensemble de ses vues dans l’Optique, qu’il publia en 1703. Son contemporain, le physicien hollandais Christian Huyghens, tenait au contraire que la lumière est une sorte d’onde. Il s’en expliqua dans son Traité de la lumière, publié en 1691. Si nous tendons une corde puis agitons l’une de ses extrémités, nous envoyons une onde qui se propage le long de la corde, sans que cette dernière quitte notre main pour courir après l’onde. De même, quand une rafale de vent s’abat sur un champ de blé, chaque épi se balance et oscille au grès du vent, mais aucun d’eux n’est arraché ni transporté d’un bout à l’autre du champ. À la différence des corpuscules, les ondes ne transportent rien, elles ne font que transmettre de l’énergie et de l’information. Parce qu’il y a une différence entre le jet d’une pierre et le mouvement d’une vague, les théories ondulatoire et corpusculaire semblent absolument irréconciliables. Entre les deux, la nature a dû choisir. La lumière est-elle un corps ou bien le mouvement d’un corps ? La théorie corpusculaire de Newton a d’abord supplanté la théorie ondulatoire, en particulier (mais pas seulement) grâce au prestige immense de l’homme qui avait percé les secrets de la gravitation. L’idée simple selon laquelle la lumière consiste en corpuscules qui, dans un milieu homogène, se propagent en ligne droite, connut un certain succès. À partir du concept de rayon lumineux, elle permettait d’expliquer de façon élégante la plupart des phénomènes qui relèvent de ce qu’on appelle aujourd’hui l’optique géométrique. Mais la victoire de Newton ne fut pas définitive. Dès 1800, le physicien anglais Thomas Young (qui fut aussi médecin et égyptologue) s’y opposa. Il avait observé que la lumière interprète d’une bien curieuse manière le signe plus de l’arithmétique. De la lumière superposée à de la lumière peut donner de l’obscurité! Ce n’était là qu’un exemple d’un groupe de phénomènes qu’il baptisa interférences lumineuses. Young publia ses résultats en 1804. La théorie corpusculaire ne semblait pas pouvoir les expliquer. En effet, comment une particule pourrait-elle en annuler une autre ? La théorie ondulatoire, elle, permet de les comprendre : lorsque deux ondes se rencontrent dans l’eau, il existe certains points où les ondes sont toujours en opposition de phase (l’une est à sa crête au moment où l’autre est à son creux, et vice versa). Les deux ondes s’annulent donc toujours en ces points. Si l’on considère non plus des vagues mais des ondes lumineuses, le même effet entraîne que ces points seront obscurs. La théorie ondulatoire contient donc la clé du mécanisme par lequel de la lumière ajoutée a de la lumière peut donner de l’obscurité. Dans un premier temps, l’idée de Young fut tournée en ridicule. Le monde scientifique se déchaîna contre sa thèse. En Angleterre, on ne comprit pas qu’un Anglais put contredire le grand Newton. Un article dans l’Edinburgh Review couvrit Young d’insultes. Mais après maintes résistances, la théorie ondulatoire finit par l’emporter triomphalement. Ce spectaculaire renversement d’opinion eut pour une large part la conséquence des études plus complètes qu’Augustin Fresnel entreprit a partir de 1815. Pour départager la théorie corpusculaire de la théorie ondulatoire, il eut l’idée d’une expérience cruciale. En effet, Newton tout comme Descartes affirmait en accord avec la théorie corpusculaire parfois appelée balistique corpusculaire que la vitesse de la lumière est d’autant plus grande dans un corps transparent que sa densité est plus élevée. Par exemple, selon cette théorie, la vitesse de la lumière doit être plus grande dans l’eau que dans l’air. En revanche, la théorie ondulatoire aboutit à la conclusion inverse, c’est-à-dire d’une vitesse de la lumière plus grande dans l’air que dans l’eau. L’expérience réalisée par Fizeau qui mesura la vitesse de la lumière dans un tube parcouru par un courant d’eau montra que celle-ci était plus faible dans l’eau que dans l’air. Ce résultat conforta les physiciens sur l’aspect ondulatoire de la lumière. Cependant, au XVIIème siècle, des expériences sur le vide avaient conduit le bourgmestre de la ville de Magdeburg a découvrir un phénomène inattendu. Otto von Guericke (1602-1686) avait remarqué que lorsqu’on place une sonnette dans un récipient sous vide, on n’en perçoit plus le son. En remplaçant la sonnette par une lampe électrique des physiciens eurent la mauvaise surprise de constater que la lumière quant à elle se propageait bien dans le vide ! La lumière est une vibration et toute vibration qui se propage suppose un milieu qui vibre. A lors, le vide était-il absolument vide ? Ne contenait-il pas une substance susceptible de permettre la propagation de la lumière ? Les physiciens eurent alors l’idée de réintroduire une substance imaginée dans l’Antiquité : l’Ether.
La notion d’éther est aussi vieille que la physique, mais sa signification a considérablement varié, suivant en cela l’évolution des théories et les progrès de l’expérience. Oscillant entre l’idée de feu, de lumière et celle de représentation subtile de la matière, elle est rarement associée, dans l’Antiquité, à celle de support d’action cinématique et, par conséquent, à celle de milieu. « Éther », qui vient du grec et signifie (brûler par le feu), laisse supposer que l’éther était considéré comme parent d’une substance unique, susceptible d’engendrer toutes les autres ou, tout au moins, qu’il s’agissait du plus subtil des quatre éléments. Pythagore pensait que le monde était animé et intelligent, que l’âme de cette grosse machine était l’éther d’où sont tirées les âmes particulières. Toutefois, l’usage du mot « éther » dans l’œuvre de Platon laisse supposer que cette notion a déjà perdu quelques-uns de ses privilèges, conservant seulement du feu initial les caractères de finesse et de pureté. L’éther devient ainsi une sorte de matière subtile qui semble intermédiaire entre le feu, dont elle reste une dégénérescence, et la terre, dont elle constitue la partie la plus pure : « Ce qui vient hiérarchiquement après le feu, c’est l’éther. Il sert à l’âme pour façonner des vivants qui ont pour propriété de contenir en majeure partie la substance même de ce corps » (Platon, Epinomis). Pourtant, en dépit de ce rôle éminent, l’éther paraît lié aussi aux sédiments terrestres qui en constituent, à leur tour, une dégradation. Ainsi, l’éther constitue une matière subtile dont la nature s’apparente à celle du feu et à celle de la terre. Par exemple, l’optique d’Aristote rattache de façon assez indécise l’intervention de l’éther à la constitution même du « diaphane », c’est-à-dire des milieux transparents perméables à la lumière. Aristote superpose un cinquième élément, qui sera plus tard la « quintessence » des scolastiques et qu’il appelle pour sa part « premier corps » ou « éther ». Alors que la génération circulaire des éléments, rendue possible par le fait qu’ils communiquent un à un par l’une de leurs qualités (le froid pour la terre et l’eau, l’humide pour l’eau et l’air, le chaud pour l’air et le feu, le sec pour le feu et la terre), rend compte des changements au niveau du monde sublunaire, l’éther, substance constitutive des astres, est immuable, encore que cette immuabilité soit celle d’un mouvement éternel. L’espace est donc rempli d’éther ! L’étude de la lumière, qui a toujours pour terrain d’élection une théorie des milieux, est aussi le départ de l’idée intuitive d’éther. Néanmoins, c’est seulement au début du XVIIème siècle que s’affirme, souvent maladroitement, l’autonomie de la notion d’éther. En effet, si la lumière est considérée comme un corps qui se propage, l’éther subtil doit se confondre avec elle ; l’introduction de cette notion ne peut mener qu’à une théorie de l’émission. Telles étaient les nombreuses conceptions qualifiées habituellement de « théories de l’éther ». Qu’il s’agisse de « fluide universel », de « feu artiste », d’ »élément subtil spécifique », le mouvement de l’éther luminifère s’identifie à la propagation même du mobile lumineux. Si la lumière est, au contraire, une action spécifique, l’éther devient un support autorisant une propagation de proche en proche tout en restant, en général, immobile. C’est ce rôle de l’éther et non sa nature qui justifie l’intervention de ce milieu subtil. Sa structure, continue ou corpusculaire, reste alors tout à fait accessoire. Ses propriétés doivent simplement permettre la propagation des phénomènes lumineux et expliquer leurs caractères. Or, au début du XVIIème siècle, la multiplication des machines à faire le vide avait montré que la lumière se propage dans un milieu rebelle à tous les artifices qui pourraient l’éliminer. Ainsi, l’analogie entre la lumière et le son – analogie qu’avait soupçonnée Léonard de Vinci – se révèlait limitée dans son principe même. La physique de Descartes suppose que l’Univers plein est constitué par des milieux plus ou moins grossiers. Pour ne laisser aucun vide, des mouvements tourbillonnaires prennent naissance. Quant à la lumière, c’est une pression, une « tendance au mouvement » que transmet le milieu le plus subtil. Celui-ci fait fonction d’un éther immobile et rigide, support d’actions lumineuses instantanées. L’éther de Descartes est donc bien matériel et corpusculaire. Toutefois, la lumière reste une action, une pression qui se propage à une vitesse infinie par l’intermédiaire de ce milieu. L’optique de Newton, comme sa mécanique, est cependant loin d’éliminer l’idée d’éther. Newton se demande même si l’éther qui baigne les corps célestes est identique à celui qui permet la propagation des phénomènes lumineux. Une renaissance des théories de l’éther s’amorce au XIXème siècle avec les travaux de Thomas Young et, surtout, d’Augustin Fresnel. L’expérience cruciale permit de trancher en faveur de la théorie ondulatoire confirmait l’hypothèse des ondulations de l’éther. « La conclusion de ce travail, écrit François Arago, consiste à déclarer le système de l’émission incompatible avec la réalité des faits. » L’existence de ce « fluide universel » dont la lumière est l’ »un des modes de vibration » repose alors sur des résultats si concluants qu’en 1852 Gabriel Lamé peut écrire : « L’existence du fluide éthéré est incontestablement démontrée par la propagation de la lumière dans les espaces planétaires et par l’explication si simple, si complète, des phénomènes, de diffraction dans la théorie des ondes. » Ainsi triomphent les théories de l’éther. Cependant, pour expliquer les caractères des ondes transversales, il faut construire une théorie de l’éther, préciser sa structure et ses propriétés. Or ces dernières se révèlent bientôt paradoxales : l’éther doit en effet présenter une rigidité infinie pour permettre la propagation des ondes transversales et, en même temps, une résistance au mouvement à peu près nulle pour ne pas gêner le mouvement des corps célestes. Ces propriétés surprenantes éveillent la méfiance des physiciens et Arago lui-même refuse de suivre Fresnel dans ses « acrobaties ». Néanmoins, celui-ci réussit à interpréter au moyen des vibrations éthérées l’ensemble des phénomènes de polarisation, y compris la polarisation chromatique découverte en 1811 par Arago. Seules les propriétés de l’éther lui-même restaient à justifier.