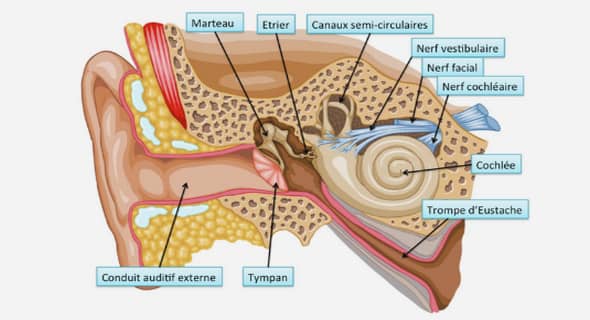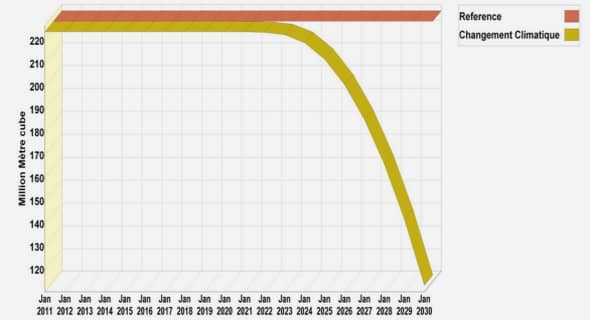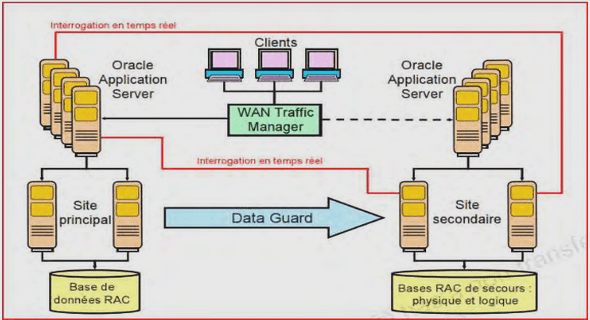L’angle du Life-Span
La relation entre les enfants jumeaux ne s’élabore pas à leur naissance mais dès leur conception in utéro, ce qui rend cette relation singulière. Pour le montrer, Castiello, Becchio, Zoia, Nelini et leurs collaborateurs (2010) ont mené une observation sur cinq couples de jumeaux durant la grossesse (à l’aide de l’échographie en 4D1). Dès la 14ème semaine de gestation, les bébés n’affichent plus uniquement des mouvements autodirigés ou orientés vers la paroi utérine. La propension des mouvements visant spécifiquement le cojumeau augmente entre la 14ème et la 18ème semaine de gestation, en termes de fréquence et de durée. Les mouvements vers le cojumeau sont de plus en plus longs alors que ceux dirigés vers la paroi utérine ou autodirigés deviennent moins réguliers. Les bébés jumeaux in utéro, et plus particulièrement les MZ, utilisent des formes variées de communication comme des contacts de la tête et des différents membres du corps, qui peuvent être plus ou moins doux allant de l’enlacement au baiser (Pons, Charlemaine & Papiernik, 2006). Le baiser des jumeaux survient aux alentours du 5ème mois de grossesse en même temps que se développe la vision. Ces interactions précoces entre les bébés jumeaux in utero ne signifient pas, pour autant, qu’ils « entretiennent déjà des relations complexes ou sociales, ni éprouvent des sentiments compliqués d’amour, de jalousie ou de désir » (op. cit., 80). Piontelli (2002), qui a mené une observation de trente couples de bébés jumeaux avant et après la naissance, souligne une continuité entre cette vie in utéro (dès le 5ème mois de grossesse) et la vie post-natale. Selon elle, une mère qui ressent un enfant plus actif que l’autre pendant sa grossesse, percevra ce même comportement à la naissance des enfants.
La naissance biologique et la naissance psychologique de l’individu ne coïncident pas : « la première est un évènement dramatique, observable et bien circonscrit ; la seconde est un processus intrapsychique qui se déroule lentement » (Mahler, Pine & Bergman, 1975, 19). L’élaboration du processus de séparation-individuation s’inscrit dans une période qui s’étend du 4/5ème mois au 30/36ème mois de l’enfant. Si la séparation caractérise d’indifférenciation, de fusion avec la mère, dans lequel le « je » ne se différencie pas encore du « non-je » et où le dedans et le dehors n’en viennent que graduellement à être sentis comme différent » (op. cit., 82). Au cours de cette phase, débute le processus « d’éclosion » caractérisé par l’attention du nourrisson qui, progressivement, se décentre de la symbiose avec la mère pour se diriger vers l’extérieur. La seconde sous-phase est celle des essais. Elle s’illustre par des essais auxquels « « l’oisillon-impatient-de-voler » aime se livrer dans sa relation naissante avec l’univers « autre-que-la mère » » (op. cit., 119). De 10/12 mois à 16/18 mois, grâce à l’acquisition de la locomotion verticale, se crée ce que Greenacre (1957) nomme l’histoire d’amour avec le monde. A la troisième sous-phase, grâce au processus d’éclosion, l’enfant atteint la conscience d’être une entité individuelle séparée. En effet, « vers le milieu de la deuxième année (…), il devient de plus en plus conscient d’être physiquement séparé et il en fait un usage de plus en plus extensif » (op. cit., 133). La notion de rapprochement » caractérise également cette sous-phase où un conflit s’opère avec la mère. Ce conflit se construit d’une part avec le désir de la repousser et, d’autre part, de s’en rapprocher. Ce rapport ambivalent est observable chez l’enfant par ses comportements de filature2 et de « départ-précipité-en-flèche loin d’elle ». Mais c’est aussi au cours de cette phase de rapprochement que l’enfant développe des relations avec des personnes de son entourage autres que la mère et le père. Enfin, la quatrième et dernière phase réfère à la consolidation de l’individualité et aux débuts de la permanence de l’objet émotionnel. Au cours de la troisième année de l’enfant, un sentiment stable d’entité (limite du self) y est atteint lorsque « la permanence de l’objet se trouve bien amorcée (…), qu’il peut y avoir, pendant son absence physique, substitution, au moins partielle, à la mère, grâce à la présence d’une image intérieure fiable qui demeure relativement stable, indépendamment de l’état de besoin pulsionnel ou d’inconfort interne » (op. cit., 198). Contrairement aux trois autres sous-phases, cette dernière ne connait pas de fin.
Le développement gémellaire durant cette période, et plus précisément au cours des deux premières années de vie des enfants (en référence aux trois premières sous-phases du processus de séparation-individuation), est caractérisé par une relative indifférence des enfants jumeaux quant à la présence de l’autre (Leonard, 1961). Les travaux du psychanalyste Ortemeyer (1970) indiquent que la relation gémellaire se développerait après le sixième mois des enfants. En effet, les premières interactions entre les enfants jumeaux seraient, initialement, purement symbiotiques, en raison de la non-différenciation des enfants entre eux (Mahler & al., 1975). D’après Ainslie (1997), le lien gémellaire ne se construirait et ne se fortifierait qu’aux alentours du 36ème mois des enfants soit, à partir de la quatrième sous-phase du processus de séparation-individuation, au moment où les enfants ont un sentiment stable d’identité et de permanence de l’objet émotionnel. En d’autres termes, l’enfant intériorise progressivement l’imago maternel qui lui permettra, notamment avec le développement de ses aptitudes motrices, de s’autonomiser, de s’individualiser et d’explorer le monde qui l’entoure (Bernier, 2006). De ce fait, dès la fin de la sous-phase du rapprochement, où l’enfant commence à entretenir des relations avec d’autres personnes que les parents, le cojumeau devient alors un objet ou un partenaire facilement accessible pour l’exploration du monde environnant. C’est pourquoi, pour Ainslie (1997), le renforcement de la relation s’opère à ce moment de leur développement. Au cours de cette phase de séparation-individuation, les enfants jumeaux intériorisent qu’ils sont deux individus à part entière. Les processus d’autonomisation, d’individuation et de différenciation s’activent alors. Ils différencient les limites entre le « self » et le cojumeau, ce qui peut engendrer au sein du couple la jalousie, la rivalité voire un rapport de domination. Si pour Ainslie (1997) le lien gémellaire trouve son origine dans l’accomplissement du processus de séparation-individuation, pour Houssier (2005), il se construirait dans ce qu’il nomme l’absence parentale. La mère et le père, en s’absentant « pour se désirer » (op. cit., 101), délaisseraient les enfants jumeaux qui n’auraient d’autres choix que d’être ensemble, et donc de construire leur relation. Constat d’autant plus marqué pour les enfants jumeaux que pour les frères et sœurs non-jumeaux, en raison de l’absence d’écart d’âge entre les enfants. Cette période développementale s’achève par une double séparation : la première avec la mère et la seconde avec le cojumeau (Leonard, 1961 ; Pons, Charlemaine & Papiernik, 2006). A notre connaissance, aucune recherche n’évoque la séparation au père.
La phase qui suit la petite enfance est marquée par une absence de travaux relatifs au développement des enfants jumeaux. Seules les études menées à Londres dans le cadre du Twins Early Development Study (TEDS) permettent d’appréhender la période de l’enfance. Le TEDS est un large recueil de données réalisé au Royaume-Unis, où le développement d’une cohorte de jumeaux nés en Angleterre et au Pays de Galle entre janvier 1994 et décembre 1996 a été examiné. Plus de 15000 familles ont accepté de participer à l’étude longitudinale. Le recueil des données a débuté aux 2 ans des enfants pour se poursuivre à leurs 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14 et 16 ans (Haworth, Davis & Plomin, 2012 ; Trouton, Spinath & Plomin, 2002). L’accent a particulièrement été mis sur le développement du langage entre 2 et 12 ans (Hayiou-Thomas, Dale & Plomin, 2012), sur le développement cognitif au cours de la petite à la moyenne enfance (Davis, Haworth & Plomin, 2009), sur la réussite scolaire et sur la santé (Haworth & al., 2012). Néanmoins, malgré une population d’étude considérable, aucun des travaux réalisés à l’issue de cette cohorte ne s’est intéressé au développement de la relation gémellaire durant cette période. Ce constat s’étend à l’ensemble de la littérature sur cette thématique de recherche et sur cette tranche d’âge-là. En effet, les travaux débutent à la période in utero, s’étendent à la petite enfance et se prolongent au cours de l’adolescence. La période de l’enfance est donc caractérisée par une absence de travaux sur le développement de la relation entre les enfants jumeaux.
L’adolescence est une « tempête développementale » qui réfère à une grande intensité du développement tant sur le plan corporel, intellectuel, émotionnel que social (Cloutier, 1996 ; De Léonardis & Oubrayrie, 1995 ; Oubrayrie & Lescaret, 1997). Il s’agit d’une phase où les jeunes sont en opposition au monde des adultes et s’affirment. Cette étape est marquée par une désidéalisation des figures parentales où les adolescents remettent en cause non seulement les valeurs de ces derniers (Steinberg, 1989) mais aussi leur contrôle (Hay, 1999 ; Klein, 2003). Pour les adolescents jumeaux, ce stade est marqué par une double désidéalisation qui impose également de désidéaliser leur cojumeau (Ainslie, 1997 ; Hay, 1999 ; Klein, 2003 ; Leonard, 1961 ; Pons & al., 2006). En effet, l’enfant jumeau s’identifie simultanément aux parents et au cojumeau. Dans ce cas, « l’adolescence est souvent vécue comme une période difficile car tout est rejeté et le jumeau perd tous ses repères » (Droehnlé-Breit, 2001, 48). De cette désidéalisation va apparaitre le désir très net de se différencier de l’autre mais aussi de s’affirmer, au même titre que dans la relation aux parents (Droehnlé-Breit, 1998). Pour Zazzo en 1995, au cours d’un entretien mené par Monique Robin, « c’est à l’adolescence que se manifeste ce désir de ne pas être confondu avec son jumeau. Cela n’a rien d’étonnant puisque pour tous les individus, l’adolescence est une période d’affirmation de soi, de recherche d’identité. C’est pourquoi nombreux sont les jumeaux qui rejettent la gémellité et qui sont très irrités qu’on les confonde ou qu’on s’extasie de leur ressemblance » (cité par Papiernik, Zazzo, Pons & Robin, 1995, 177). À ce titre, Scheinfeld (1973) considère l’adolescence, pour les jumeaux, comme une période charnière. Bien qu’elle soit identifiée comme une phase où le conflit et la jalousie sont omniprésents au sein des couples gémellaires, elle est également caractérisée par la nécessité d’avoir un proche confident (Rosambeau, 1987). Dans le cadre de la gémellité, le cojumeau peut répondre parfaitement à ce besoin, notamment dans certaines situations sociales difficiles (Hay, 1999, Scheinfeld, 1973).
Concernant l’âge adulte, Bernier (2006) a réalisé une étude comparative entre des fratries gémellaires et des fratries ordinaires (où l’écart d’âge entre l’ainé et le cadet est faible) âgées de 20 à 40 ans. Elle a montré que les adultes jumeaux continuent à établir avec leur cojumeau un mode de communication intime qui se caractérise par une syntonie affective. Cependant, Bernier (2006, 53) souligne que même « si les jumeaux ne rapportent pas de problèmes particuliers à se séparer, leur comportement traduit néanmoins, à la différence des singuliers, une hésitation à s’impliquer intimement dans une autre relation, ce qui suggère une difficulté à désinvestir le lien gémellaire ». Dans cette perspective, Neyer (2002a) s’est également questionnée sur le développement de la relation gémellaire à l’âge adulte. Pour cela, elle a interrogé 193 couples de jumeaux (133 MZ, 60 DZ) âgés en moyenne de 71 ans sur différentes périodes de leurs vies telles que la construction de la vie de couple et l’évolution de la vie de famille (avec l’arrivée des enfants jusqu’à leur départ de la maison…). Parallèlement, les adultes jumeaux étaient interpellés sur leur relation avec leur cojumeau au cours de ces différents moments de transition. Les résultats indiquent qu’une courbe en « U », similaire à celle perceptible dans le cadre du développement général des relations fraternelles, est observable. Aux alentours de 30/40 ans, les rapports entre frères et sœurs jumeaux et non-jumeaux diminuent. Ils ont souvent tendance à s’éloigner naturellement au cours de cette période, en raison de leurs carrières respectives et de l’éducation de leurs enfants. L’intensité des relations ainsi que la proximité spatiale augmentent à nouveau lorsque les enfants quittent la maison, après l’étape du « nest stage » c’est-à-dire du « nid vide ». Bien que les relations gémellaires évoluent à l’âge adulte de la même manière que les relations fraternelles ordinaires, le cojumeau est davantage perçu comme la personne comprenant le mieux l’individu et avec lequel les secrets sont le plus échangés. Aussi, les contacts téléphoniques sont plus fréquents comparativement aux fratries ordinaires (Bernier, 2006).
Les caractéristiques développementales relatives à la gémellité
Les chercheurs ayant travaillé sur le développement des jumeaux et ce, quel que soit l’âge de ces derniers, évoquent le terme de « difficulté » pour qualifier certains aspects développementaux : difficultés d’acquisition d’une identité distincte, difficultés à se différencier de l’autre, difficultés à se séparer… (Bernier, 2006 ; Tourrette, Robin & Josse, 1988 ; Zazzo, 1960). Le terme « difficulté » nous semble être relativement normé et normatif pour appréhender la gémellité. Si la notion de spécificité apparait être plus adaptée, pour Zazzo (cité par Papiernik & al., 1995), elle n’est pas appropriée pour évoquer le développement des enfants jumeaux. Pour lui, ils sont des êtres non différents des non-jumeaux et c’est surtout « la façon dont on les traite qui peut les rendre particuliers » (op. cit., 175). Nous préférerons donc le terme de caractéristique développementale relative à la gémellité. Par conséquent, nous envisageons l’élaboration de la construction identitaire, de la différenciation à l’autre et de la séparation à l’autre comme relevant de caractéristiques propres à des enfants ayant le même âge et se développant dans le même milieu. Pour présenter ces caractéristiques, nous évoquerons dans la partie suivante, les termes tels qu’ils le sont dans les articles et dans les ouvrages. Le but étant de montrer la manière dont le développement des enfants jumeaux est perçu par une grande majorité de chercheurs de la communauté scientifique.
Le développement identitaire
Pour Zazzo (1960), la mentalité gémellaire (qui se particularise par les ressemblances entre les jumeaux) se compose de trois éléments : un déficit de sociabilité, une syntonie affective et des difficultés dans l’acquisition de la conscience de soi et des problèmes d’identité. Pour chacune de ces caractéristiques, les effets sont plus marqués pour les MZ, en raison de leurs ressemblances physiques parfois « frappantes » (Ackerman, 1975 ; Bernier, 2006 ; Burlingham, 1952 ; Leonard, 1961) et plus précisément pour les garçons (Robin, 1990). Au sujet de la troisième caractéristique, afférente à la conscience de soi et à l’identité, Tourrette, Robin et Josse (1988, 546) évoquent que « le problème le plus important pour les enfants jumeaux est de se différencier l’un de l’autre afin d’acquérir chacun leur individualité ». Les processus de différenciation à l’autre et d’indifférenciation du moi occupent une place centrale dans les recherches sur le développement de l’enfant issu d’un couple gémellaire (Houssier, 2005). Durant les premières années de vie, ils ne parviendraient pas à se distinguer pleinement l’un de l’autre, d’où l’utilisation dans leur langage du « nous » avant le « je » pour certains d’entre eux (Zazzo, 1960). Par ailleurs, « l’identification de l’image physique et mentale est retardée chez les jumeaux, elle ne s’opère pas avant 3 ou 4 ans, à l’inverse des non-jumeaux chez qui elle apparaitrait vers 2 ans et demi » (Pons & al., 2006, 184). Pour certains enfants jumeaux, la confusion du corps peut être alors totale, impliquant l’acquisition d’une identité personnelle plus complexe à élaborer qu’un enfant issu d’une grossesse unique. Le jumeau se retrouve être non seulement un individu à part entière mais aussi membre d’un couple et ce, dès sa conception. La problématique gémellaire reposerait alors sur le principe suivant : les jumeaux doivent concilier à la fois le désir de conserver un lien unique avec le cojumeau mais également de définir leur propre identité en tant que sujet singulier. Il s’agit, dès lors, de « trouver la juste distance entre soi et l’autre » (Scelles, 2004, 76). Papiernik, Zazzo, Pons et Robin (1995, 145), sur la question du retard d’acquisition de la conscience de soi, indiquent qu’il « se pourrait que, parallèlement, à une prise de conscience de soi individuelle, puisse se construire une conscience de statut de jumeaux, comme s’il existait un troisième personnage qui serait le couple des jumeaux ». Dans ce cas, la quête identitaire gémellaire est perçue comme faisant partie intégrante du développement des enfants jumeaux dans la mesure où ils « ne passent pas par les mêmes étapes d’identité que les non-jumeaux, lesquels acquièrent un sens de l’identité et de reconnaissance individuelle » (Pons & al., 2006, 185).
Plusieurs facteurs sont avancés par les chercheurs depuis les années 1950 pour montrer que « la condition gémellaire affecterait l’évolution de ces enfants » (Bernier, 2006, 9), notamment dans la construction d’une identité distincte. Burlingham (1952) mentionne une image indifférenciée renvoyée par l’environnement qui provoque, de fait, une « difficulté identitaire » propre à chacun, alors que Leonard (1961) évoque le passage simultané dans les différents stades développementaux. Pour Lassers et Nordan (1978), les enfants jumeaux n’expérimenteraient pas les angoisses et la solitude associées au processus de séparation-individuation. Ils devraient donc à la fois se séparer du substitut que représente le cojumeau dans le processus de séparation à la mère, mais également, définir les frontières avec ce dernier, d’où une difficulté singulière que ne rencontrent pas les enfants non-jumeaux. Adelman et Siemon (1986) suggèrent, quant à eux, une profonde intimité entre les enfants. Enfin, Davidson (1992) met l’accent sur la relation de rivalité réciproque. Pour Bernier (2006, 10) « l’ensemble de ces facteurs conduirait à une difficulté identitaire que les jumeaux ne pourraient jamais complétement surmontée ». Elle s’est donc demandée si la présence permanente du cojumeau « interfère systématiquement dans l’acquisition d’une identité distincte » (op. cit., 9) à l’âge adulte. La méthodologie de sa recherche s’élabore principalement à partir de deux types de techniques psychométriques que sont l’entretien (basé sur la perception, les sentiments, le comportement du sujet vis-à-vis du lien gémellaire ou fraternel) et les questionnaires. Les patterns d’attachement ont été appréhendés à partir du Reciprocal Attachment Questionnaire (West & Sheldon-Keller, 1994a) et le concept de soi par le biais du Tennessee Self Concept Scale (Marsh & Richards, 1988). Les résultats indiquent qu’au sein des couples d’adultes MZ âgés de 20 à 40 ans, une instabilité de l’image de soi et une instabilité identitaire persistent. De plus, elle a mis en évidence une vulnérabilité des jumeaux en ce qui tient à l’acquisition d’une identité bien distincte » (op. cit., 62).