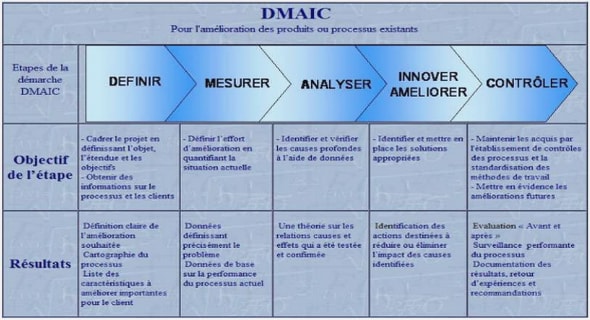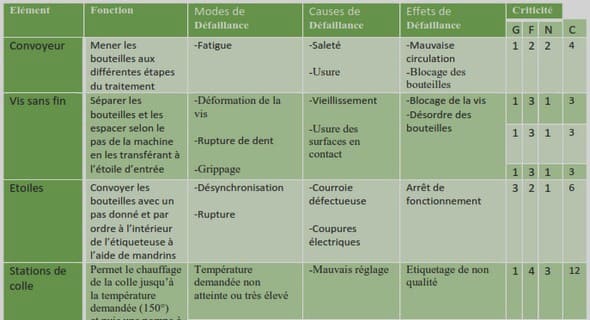La séparation langue et culture
Cette séparation entre la langue et la culture est belle et bien une réalité dans l’enseignement des langues étrangères, que l’on rencontre encore trop régulièrement. Dans la plupart des Universités françaises, les enseignants, qu’ils soient face à leurs élèves ou à leurs recherches, s’adonnent soit à la langue (principalement la grammaire), soit à la culture, soit à la littérature, etc. D’après Hanne Leth Andersen, « cette première séparation semble provenir des programmes d’études et de la présentation du sujet, ce qui influence nécessairement les futurs enseignants de langue. »14
La distinction entre langue et culture peut être liée aux domaines d’intérêt des enfants, à l’influence d’autres matières notamment l’anglais, à l’enseignement de la langue maternelle, aux programmes spécifiques de la deuxième langue étrangère et, bien sûr, aux approches pédagogiques et la présentation de l’enseignement par les enseignants. Les élèves dont le professeur n’accordera pas ou peu d’intérêt, et/ou de temps à la dimension culturelle mais optera davantage pour un cours magistral de grammaire à apprendre par cœur, ne développera pas cette curiosité culturelle attendue et souhaitée chez nos élèves.
Beaucoup d’auteurs, tels que Leylavergne et Parra, expliquent le déséquilibre entre apprentissage culturel et apprentissage linguistique par le fait que « de nombreux enseignants, devant faire face à des contraintes de temps pour boucler les programmes imposés par leurs institutions, privilégient les aspects strictement linguistiques de la communication au détriment de la dimension culturelle qui devient ainsi le parent pauvre de leur enseignement. C’est infiniment dommageable car, non seulement on rend moins attractif son enseignement, en termes de motivation pour les apprenants mais, de plus, on réduit très sensiblement les aptitudes des apprenants dans leur compréhension de la langue cible. »15
Jony Pereira, dans le cadre du séminaire de monographie déclare que « le problème est que le professeur traditionnellement donne peu d’importance à la culture, et que les manuels apportent des images déformées, des mondes idéaux que les élèves ne prennent pas au sérieux. »16 Par le fait, priver les élèves de cette dimension culturelle prive d’intérêt la production langagière qui, en dehors du cadre de référence fixé par la culture, perd tout son sens.
D’après Hanne Leth Andersen, cette distinction entre langue et culture peut également provenir « de différentes intelligences ou bien d’une évolution liée à l’âge : certains enfants s’intéressent aux langues pour le son, la musique ou la communication, sans avoir beaucoup d’intérêt pour le pays ou la culture qui peut même leur sembler un domaine intellectuel distant, réservé aux adultes. D’autres ont découvert un désir de communiquer lors de voyages avec les parents et s’intéressent surtout aux expressions liées à des situations précises ou à un vocabulaire fonctionnel. On peut dire en général que pour beaucoup des élèves, surtout les plus jeunes, la culture n’est pas au centre de leurs intérêts bien que certains phénomènes comme par exemple les grandes villes, le football ou la musique puissent les intéresser et les motiver à s’engager dans l’apprentissage de la langue. »17 En tant qu’enseignante, j’ai d’ailleurs pu noter que certains élèves motivés par l’esprit du football, ou d’autres sports, paraissent davantage intéressés lorsque la séance porte sur les sports pratiqués dans les pays anglophones ou sur les grandes villes, qui sont le théâtre de rencontres sportives telles que les matchs de football.
La séparation pédagogique entre langue et culture peut être justifiée par le fait que la langue peut exister, et existe bel et bien, d’une façon autonome. Cependant, un enseignement purement théorique d’une langue n’est, pour moi, qu’un enseignement incomplet dont on ne pourra pas exploiter la totalité dans un environnement étranger au notre et qui ne correspond nullement aux attentes institutionnelles, ni au désir d’évoluer de façon autonome dans le ou les pays de la langue étudiée. Et donc ne renvoie pas à l’idée de tolérance et d’ouverture aux autres que l’on voudrait inculquer à nos élèves.
Quels liens existent-t-ils entre la langue et la culture ?
Avant tout, rappelons que la culture peut se définir de maintes façons. Comme déjà énoncé en introduction, nous choisirons de retenir la suivante : la culture apparaît comme « l’ensemble des phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe ethnique ou une nation, une civilisation, par opposition à un autre groupe ou à une autre nation. » 18 d’après le dictionnaire Larousse.
Mais pourquoi apprendre la culture d’un autre pays ? Ne pouvons-nous pas simplement nous contenter de l’apprentissage linguistique pur et dur ?
Comme le souligne le site de référence Eduscol, « Il n’est pas de langue qui ne soit de culture, la langue étant fondamentalement une représentation du monde, qui s’ancre dans le réel et dans l’imaginaire. Elle est la manifestation d’une identité. L’approche culturelle intègre la notion de point de vue, de mode de représentation. »19 En effet, nous sommes de plus en plus appelé à la diversité et au mélange culturel : tout au long de notre scolarité, lors d’une écoute musicale dans notre quotidien, lorsque nous allumons la télévision, au sein de nos différents milieux professionnels, lorsque nous voyageons, ce que nous mangeons, … Apprendre la culture d’un pays, c’est apprendre à connaître le pays et sa population, c’est intégrer et comprendre une communauté. Mais c’est également adopter une vision du monde qui peut être différente de la nôtre et ainsi nous aider à développer notre sens critique en ayant plusieurs points de vue d’un même phénomène. Et c’est exactement ce que souhaitent encourager le Socle commun de connaissances, de compétences et culture mis en place dès la rentrée 2016, lorsque nous lisons les compétences suivantes :
• Favoriser un développement de la personne en interaction avec le monde qui l’entoure.
• Ouvrir à la connaissance, forme le jugement et l’esprit critique, à partir d’éléments ordonnés de connaissance rationnelle du monde.
C’est cette idée d’ouverture au monde que nous souhaitons inculquer et encourager chez nos élèves, que l’on retrouve dès les premières lignes du Daily guide to language and culture learning, d’Allison Howell, déclarant : « there is a West African proverb which says, “If you don’t taste the food, you do not know if the salt is there or not.” It is like that with people. If you want to know what they are really like, you must get to know them. You get to know people through talking with them and understanding their ways. »20
De plus, l’apprentissage d’une langue étrangère suggère presque automatiquement la présence de mécanismes culturels. Il semble difficile, d’organiser un enseignement en langue vivante étrangère sans présenter géographiquement, socialement, le pays dans lequel la langue étudiée est parlée, ou encore, sans aborder les comportements quotidiens, où les échanges langagiers prennent forme, par exemple : le fait de se saluer diffère d’un pays à un autre. Non seulement en terme de langue mais également en terme de comportements, de gestes ou d’attitudes. Il pourrait être intéressant, au cycle 2, d’accompagner la séquence travaillant la compétence « se saluer », d’une séance de salut « à l’anglaise » pour leur présenter le fameux « hug » anglais qu’on ne retrouve que très rarement en France ou alors dans un environnement proche.
Ensuite, la langue apparaît comme un des marqueurs de l’identité culturelle. Ce phénomène est déjà observable à l’échelle régionale voire nationale. En effet, le français ne se résume pas uniquement à la France. Notre langue est parlée au Canada, en Belgique, en Suisse, en Algérie, etc. Cependant, tout comme au sein de nos propres régions françaises, l’accent français ainsi que ses expressions, diffèrent d’un pays ou d’une région à une autre. Les Marseillais, les Belges ou les Canadiens, s’exprimeront tous en français tout en s’appropriant la langue. Des manifestations culturelles existent dans la langue, nous ne pouvons donc pas les séparer. Ces mêmes manifestations persistent lorsque l’on écoute des variantes de la langue, c’est à dire le français parlé en Provence, en Belgique, en Suisse ou encore au Canada. Mais au delà de ces variantes de la langue, il existe aussi d’importantes références culturelles dans l’emploi de la langue. Dans le langage, par le choix du vocabulaire et la construction des phrases, on apporte nos convictions, nos attitudes personnelles, sociales et politiques. C’est donc pour cela que la langue et la culture sont liées, car la langue incarne en effet, les valeurs et les significations d’une culture, « elle signale l’identité culturelle d’un individu. ». Les accents régionaux sont propres à une culture régionale, comme peut l’être « l’habillement, le logement, ou les institutions sociales. »21 tel que le démontre Michäel Byram.
Certaines expressions idiomatiques montrent bien à quel point un système linguistique est le reflet de la culture de la communauté qui utilise cette langue. Ainsi, en espagnol, une expression telle que despedirse a la francesa » « filer à l’anglaise », qui stigmatisent un départ impoli, nous rappellent que l’ennemi n°1 n’est pas le même des deux côtés des Pyrénées. »22 Chrystelle Fortineau et Gabrielle Le Tallec-Lloret.
Le rôle identitaire de la langue et la formule « une langue, un peuple, une nation » contribuent au XIXème siècle à la délimitation de territoires nationaux, menant à la création d’une « conscience nationale ».
De façon plus évidente, la langue est l’outil même de la culture. Par le fait, « la langue se distingue par ailleurs d’autres manifestations culturelles dans la mesure où l’on emploie pour y faire référence ».23
Claude Lévi-Strauss définit quant à lui, la culture fidèlement associée au langage, et par extension, à la langue : « Toute culture peut être considérée comme un ensemble de systèmes symboliques au premier rang desquels se placent le langage, les règles matrimoniales, les rapports économiques, l’art, la science, la religion. »24 La transmission de cette culture se fait par le discours, et donc par extension, la langue elle-même. Au sein des séances de langue vivante étrangère, l’enseignant a recours à des échanges langagiers pour s’adresser à ses élèves et ainsi leur communiquer des valeurs et des symboles propres à la dimension culturelle de la langue étudiée. Ainsi, on trouve ici l’un des premiers intérêts à lier la langue et la culture.