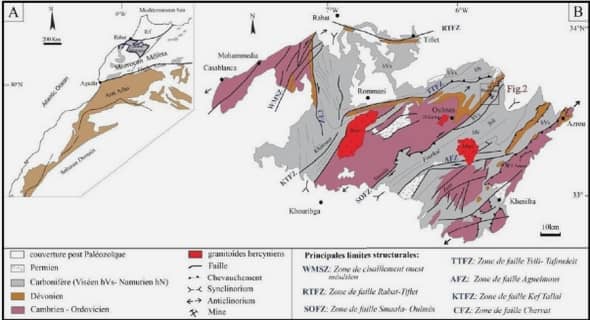Repenser l’éthique de la recherche en génomique humaine à l’ère des infrastructures de recherche
La population génomique en pratique
La génomique est intimement liée aux pratiques de taxonomies – qu’il s’agisse de différencier le normal du pathologique ou de distinguer des individus, voire des groupes. Elle permet de sonder la variabilité humaine à l’échelle moléculaire et de catégoriser des populations, ou plus précisément des populations de gènes. La construction de ces populations peut avoir un impact profond sur les catégories d’appartenance et de différence, auxquelles elle confère une assise biologique. Les catégories ethniques notamment sont aujourd’hui revisitées à l’aune de la génétique des populations qui permet d’établir la relation entre un groupe humain, un territoire, une histoire et un set de biomarqueurs situé sur l’ADN d’individus. Différentes disciplines sont susceptibles d’exploiter ces découvertes scientifiques – au titre desquelles la médecine bien sûr mais aussi l’expertise médico-légale, la paléontologie ou la recherche en généalogie. La question est de savoir comment on construit ces populations de gènes et quel rapport ces constructions scientifiques entretiennent avec d’autres modes d’être du collectif
Qu’est ce qu’une population génomique ?
La génétique des populations consiste à appliquer les principes fondamentaux de la génétique mendélienne à l’échelle des populations. Elle permet d’étudier la distribution et les changements de fréquences des versions d’un gène (les allèles), dans les populations d’êtres vivants. Initiée pendant l’entre-deux-guerres, cette discipline a permis de faire la synthèse entre la génétique mendélienne et la théorie de l’évolution, donnant ainsi naissance au néodarwinisme (théorie synthétique de l’évolution) et à la génétique quantitative. La génétique des populations est utilisée dans différents champs scientifiques. Elle a des applications en épidémiologie où elle permet de comprendre la transmission des maladies génétiques. Elle permet également de comprendre les mécanismes de conservation et de disparition des espèces et des populations qui les constituent ainsi que des phénomènes de migration et de mélanges de populations. La génomique peut donc contribuer à l’histoire de nos origines. La variabilité génétique d’une espèce se structure à quatre niveaux : la métapopulation, la population, l’individu, le gamète. – La métapopulation constitue un ensemble fermé qui n’échange pas de gènes avec l’extérieur : c’est le niveau qui correspond à celui de l’espèce. – La population, sous-population ou dème correspond à une subdivision géographique. Les dèmes échangent du matériel génétique avec les dèmes voisins et maintiennent ainsi une certaine diversité génétique mais en cas d’isolement géographique ou culturel (forte endogamie), une forme d’isolement génétique peut avoir lieu qui explique que différentes fréquences d’allèles existent dans différentes populations. – L’individu est diploïde (c’est-à-dire porteur au même locus de deux allèles provenant l’un du père, l’autre de la mère, un sur chaque chromosome homologue) et peut donc être soit homozygote (porteur de deux allèles identiques), soit hétérozygote (porteur de deux allèles différents. Suivant le jeu d’activation/répression de l’expression de ses allèles, un individu hétérozygote pour un grand nombre de ses gènes disposera d’un nombre considérablement plus grand de modes de fonctionnement qu’un individu plus homozygote sur un plus grand nombre de positions. Il y a donc d’importantes différences de variabilité génétique au niveau individuel. Plus elle est forte, plus on doit s’attendre à ce qu’elle soit associée à une plus grande homéostasie (vigueur hybride) et à une plus grande variabilité des gamètes. Inversement, plus la variabilité génétique d’un individu sera réduite, plus il risquera d’être fragile, mais plus sa production gamétique sera stable.
Population génomique et race
On peut s’étonner de ce que la définition de « population » chez Foucault soit si proche des notions développées dans le champ de la génétique des populations. Mais cette accointance n’est pas fortuite. Elle résulte des connaissances génétiques de Foucault et notamment de son intérêt pour les travaux de Jacques Ruffié, un hématologue, généticien et anthropologue français qui a fondé l’hémotypologie (l’étude des caractéristiques sanguines permettant de retrouver l’historique des populations, leurs migrations et leurs métissages successifs). Foucault, dans le Monde, avait écrit un article en 1976 pour expliquer comment les découvertes de l’hémotypologie, ancêtre de la génétique des populations humaines, permettaient d’enrayer la notion de race humaine: « Bref, les « marqueurs sanguins » sont aujourd’hui pour le problème des races ce que furent les «caractères sexuels» pour les espèces à l’époque de Linné. À cela près que la typologie sexuelle a permis de fonder pour longtemps les grandes classifications botaniques alors que l’hémato-typologie autorise actuellement à dissoudre l’idée de race humaine. Par toute une série de recoupements avec la préhistoire et la paléontologie, on peut établir qu’il n’y a jamais eu de «races» dans l’espèce humaine ; mais tout au plus un processus de « raciation », lié à l’existence de certains groupes isolés. Ce processus, loin d’avoir abouti, s’est inversé à partir du néolithique et, par l’effet des migrations, déplacements, échanges, brassages divers, il a été relayé par une « dé-raciation » constante. (…) C’est l’histoire qui dessine ces ensembles avant de les effacer ; il 202 ne faut pas y chercher des faits biologiques bruts et définitifs qui, du fond de la « nature », s’imposeraient à l’histoire. » (Foucault 1976, p. 5) Dans ce texte, Foucault défend l’idée que l’argument scientifique selon lequel l’homogénéité biologique de certains groupes humains s’expliquerait par des facteurs sociohistoriques suffise à rompre avec l’idée de race. On peut donc comprendre son intérêt pour ces travaux et la façon dont cette façon de concevoir la population comme « biologisation de la communauté » a pu sembler séduisante. La notion de race a été utilisée à partir du dix-huitième siècle pour distinguer des groupes humains possédant des critères physiques transmissibles, dans le prolongement des généalogies bibliques puis des grandes taxinomies de Linné. Mais depuis le milieu du vingtième siècle, des études scientifiques fondées sur la génétique, comme celles de Jacques Ruffié, que cite ici Foucault, ont montré que le concept de race n’était pas pertinent pour caractériser les différents sous-groupes géographiques de l’espèce humaine car la variabilité génétique entre individus d’un même sous-groupe est plus importante que la variabilité génétique moyenne entre sous-groupes géographiques. Le consensus scientifique actuel rejette donc en tout état de cause l’existence d’arguments biologiques qui pourraient légitimer la notion de race humaine, reléguée à une représentation arbitraire de la différence, selon des critères essentialisés que ceux-ci soient morphologiques, ethnico-sociaux, culturels ou politiques. Pourtant nombreux sont les auteurs de bioéthique et d’études de sciences qui alertent aujourd’hui sur les confusions que pourraient générer des pratiques scientifiques distinguant des populations sur la base d’arguments biologiques (Braun et al. 2007; Duster 2003, 2015; Montoya 2007; Shields et al. 2005). Deux types de rapprochements pourraient en effet être faits entre les races, que l’on considère comme des entités socioculturelles complexes et les catégories génétiquement déterminées que les chercheurs sont amenés à construire dans les pratiques de recherche en génomique. – Une première source de confusion pourrait venir de ce que la discrimination raciale, la stratification sociale, les disparités en matière de santé et la méfiance de certains groupes d’individus envers les institutions médico-scientifiques se répercutent sur la santé des individus. – Une seconde source de confusion tiendrait quant à elle de ce que l’on associe des catégories génétiquement déterminées à des communautés géographiquement situées – passant ainsi d’une catégorie purement construite à des fins méthodologiques à un 203 groupe d’individus réels. C’est ainsi que des généticiens en viennent à parler explicitement de l’importance de considérer les « races humaines » dans les études biomédicales (Burchard et al. 2003).
REMERCIEMENTS |