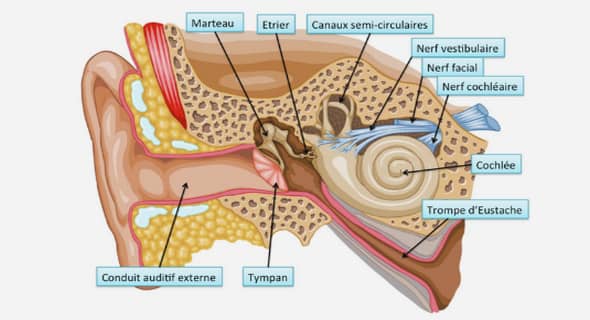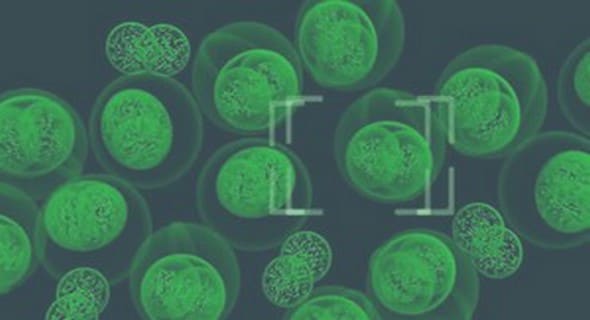Les leviers efficaces
La commission des déterminants sociaux de la santé de l’Organisation Mondiale de la Santé a énoncé en 2009 des recommandations pour agir sur ces déterminants. Les actions recommandées sont structurelles :
• « Améliorer les conditions de vie quotidienne
• Lutter contre les inégalités dans la répartition du pouvoir, de l’argent et des ressources
• Mesurer le problème, l’analyser et évaluer l’efficacité de l’action ».
Particulièrement, le rapport décrit la nécessité d’ « instaurer l’équité dès le début de la vie en permettant à tous les enfants et toutes les mères de bénéficier d’un ensemble complet de programmes de qualité » [4].
Au-delà des leviers de lutte contre les inégalités sociales de santé, les modalités des stratégies d’action font débat. En effet, les groupes sociaux les plus favorisés sont souvent les premiers et principaux bénéficiaires des actions universelles lorsqu’elles s’adressent à la population générale [25]. Les actions universelles tendent à augmenter les écarts entre les groupes sociaux. En France, les politiques de lutte contre le tabagisme en France en sont un exemple, comme le montre ces résultats présentés dans la figure 5 :
Ces résultats montrent « la différenciation sociale de l’appropriation de la prévention » qui est identifiée dans plusieurs champs « de la prévention primaire (l’alimentation, la vaccination), secondaire (le dépistage du cancer) ou tertiaire en termes d’inégalités territoriales de l’offre et de l’accès aux programmes » [25].
Égalité en santé et équité en santé sont deux notions distinctes. Lise Rochaix et Sandy Tubeuf précisent : « l’égalité est jugée à la lumière de critères normatifs d’équité et partagée entre les inégalités jugées inéquitables et les inégalités dites attendues, légitimes ou acceptables. »
• Le concept de l’équité rejoint la définition du bien-être individuel, qui serait trop restrictive si elle ne prenait en compte qu’un seul attribut. Les économistes soutiennent une définition du bien-être basée sur plusieurs déterminants tels que le revenu, la santé, l’éducation, etc. » [27].
Michael Marmot, président de la commission des déterminants de la santé préconise d’agir universellement mais selon des modalités ou une intensité proportionnelle aux besoins de chaque groupe social [4]. Il a proposé ainsi des stratégies dites d’universalisme proportionné. La figure 6. empruntée au Guide d’optique et d’équité [28] illustre ces notions :
Cependant, les démarches ciblées et proportionnées font débat : définir des seuils, des critères de catégorisation sociale soulèvent des questions éthiques [25].
Les inégalités sociales de santé : périnatalité et enjeux
Les connaissances actuelles issues de l’épidémiologie sociale, l’épidémiologie biographique et l’épigénétique convergent toutes vers un intérêt fondamental pour la santé périnatale lorsqu’il s’agit de lutter contre les inégalités sociales de santé. Il s’avère essentiel de s’interroger sur la considération des inégalités sociales de santé dès le début de la vie.
Promouvoir la santé des femmes enceintes et mères est donc essentiel et l’accompagnement à la parentalité est l’une des principales stratégies efficaces pour y contribuer [29–32].
La période périnatale a été définie par l’Organisation Mondiale de la Santé comme la période située entre la vingt-huitième semaine de grossesse (environ 6 mois) et le septième jour de vie après la naissance. EURO-PERISTAT a constitué une liste des indicateurs de santé périnatale pour les pays européens. Ils sont regroupés en quatre thèmes : la santé fœtale, néonatale et infantile, la santé maternelle, les caractéristiques de la population et les facteurs de risque, et les services de santé.
La parentalité est un terme né il y a une cinquantaine d’années, sa définition diffère selon le champ dans lequel il est utilisé : sociologique, juridique, psychologique, éducatif [33]. En effet, d’une part la parentalité ne relève pas uniquement du ressort individuel des parents [34,35], d’autre part la parentalité est unique pour chacun, affectée par les attentes culturelles et sociétales, les modes de vie [36]. Béatrice Lambloy montre que le terme est polysémique et propose dans le champ de l’action politique et sociale de se référer au dictionnaire d’action sociale qui indique : « la parentalité apparaît comme un terme spécifique du vocabulaire médico-psycho-social qui désigne de façon très large la fonction d’être parent en y incluant à la fois des responsabilités juridiques telles que la loi les définit, des responsabilités morales telles que la socio-culture les impose et des responsabilités éducatives »[33].
En France, la Haute Autorité de Santé (HAS) énonce des recommandations concernant les principaux dispositifs de prise en charge français et leur coordination allant du projet de grossesse au retour à la maison après la naissance.
En période prénatale :
-L’entretien prénatal précoce : « permet de coordonner les actions des professionnels autour de la femme enceinte, impliquer la femme et le couple dans une démarche d’évaluation, d’éducation et d’orientation (….), repérer les situations de vulnérabilité et proposer une aide » [37–39].
-Les séances de préparation à l’accouchement : le document de référence de bonne pratique s’intitule « préparation à la naissance et à la parentalité »
-Le suivi clinique et paraclinique : la prise en charge, et le transfert éventuel, dans une maternité adaptée au risque pour la santé de ma mère et ou de l’enfant.
Pour l’accouchement et durant le séjour à la maternité :
-Accouchement : des recommandations précises pour la prise en charge clinique. Le document de référence de bonne pratique s’intitule « accouchement normal : accompagnement de la physiologie et interventions médicales ». Des recommandations sont déclinées pour des situations cliniques particulières dans des documents complémentaires (en lien avec la césarienne, l’hémorragie du post partum…)
Après la naissance :
-le suivi postnatal précoce à domicile. Dans un contexte de « bas risque », les sorties précoces (à 72h heures après l’accouchement par voie basse) sont encouragées, accompagnées d’un suivi avec un professionnel référent (médecin généraliste, sage-femme). Le document de référence de bonne pratique est intitulé « Sortie de maternité après accouchement : conditions et organisation du retour à domicile des mères et de leurs nouveau-nés ».
Cependant, dans ces recommandations, la problématique des inégalités sociales de santé n’est pas explicitée.
En France, la prise de conscience de l’importance de l’accompagnement à la parentalité en matière de lutte contre les inégalités sociales de santé s’est notamment concrétisée par l’édition de deux rapports de l’Inspection Générale des Affaires Sociales, proposant des pistes d’action en matière de lutte contre inégalités sociales de santé (2011) [40], et particulièrement dans la période de la petite enfance (2015) [41]. Ce dernier rapport rappelle qu’en France, la prématurité est deux fois plus élevée chez les salariées de services aux particuliers que chez les cadres (taux de 6.4% contre 3.9%). La proportion des enfants hypotrophes est de 10.8% pour les femmes en situation de précarité, contre 7% pour les autres [41]. Ces données nationales de santé périnatale rejoignent des données européennes montrant le lien entre niveau d’éducation des mères et faible poids gestationnel et la prématurité [42]. Les pistes principales proposées dans ce rapport sont :
• connaître et rendre visibles les inégalités sociales de santé dans l’enfance en développant une meilleure connaissance du gradient social, et étudiant la faisabilité d’exploiter des données territorialisées ;
• comprendre les mécanismes de constitution des inégalités sociales de santé dans l’enfance pour mieux identifier les leviers d’action. Il est proposé de réaliser des suivis de cohorte pour comprendre l’imbrication entre les déterminants de la santé et la façon dont ils agissent. Il est préconisé de mobiliser l’expertise collective. Les recherches sur l’efficacité des actions nécessitent d’être développées ;
• construire la stratégie autour de grands principes d’action.
Le rapport précise des principes fondamentaux encadrant les actions à mener :
Les autorités publiques contribuant à la stratégie de réduction des inégalités sociales de santé intègrent dans leur action les principes suivants :
◦ les actions en direction des enfants et de leurs familles sont organisées selon une logique d’universalisme proportionné : tout ménage peut disposer du même socle d’intervention, complété par des prestations spécifiques en fonction de ses besoins particuliers. Ces besoins doivent être appréciés le plus individuellement possible, de façon à ce que l’accompagnement des familles ne conduise pas à une stigmatisation de populations qui seraient considérées « à risque » ;
– une priorité est donnée à l’action la plus précoce possible en direction de l’enfant et de la famille ;
– les actions menées doivent prendre en compte conjointement, autant que possible, les besoins des enfants et ceux de leurs familles ;
– la place donnée aux parents dans les milieux de vie de l’enfant et dans les actions menées à leur endroit est un critère d’appréciation de la qualité des dispositifs mis en œuvre. Elle ne doit pas se contenter de proposer une information, mais offrir une participation active aux parents et plus largement aux personnes en charge de l’enfant;
– identifier des facteurs protecteurs ou néfastes pour la santé n’autorise pas la prescription de comportements aux personnes ;
– l’appui à la fonction parentale ne doit pas conduire les professionnels à se substituer aux parents dans la relation avec l’enfant. [41]
Très récemment, à l’automne 2019, le gouvernement a mis en place la Commission des 1000 premiers jours de la vie de l’enfant, en référence au rapport de l’UNICEF [43]. La commission réunit un comité d’experts composé de chercheurs et spécialistes en neuropsychiatrie, obstétrique, pédiatrie, néonatalogie, médecine générale, psychiatrie, psychologie et maïeutique. Le comité est « chargé de travailler conjointement avec les acteurs, pour formuler des préconisations sur les politiques publiques qui peuvent être menées ».
Le Ministère des Solidarités et de la Santé « légitime un investissement le plus précoce possible en accompagnant au mieux les parents pour répondre de manière adaptée aux besoins de leurs enfants. » (tiré du communiqué de presse du 19 septembre 2019, disponible sur le site du Ministère des Solidarités et de la Santé).
Problématique de recherche
Les inégalités sociales de santé sont majeures et ne se réduisent pas, particulièrement en France. Parmi les leviers d’action, l’accompagnement à la parentalité constitue une stratégie considérée comme efficace.
De très nombreuses actions, organisations, politiques d’accompagnement à la parentalité sont conçues, mises en œuvre et évaluées. Cependant, demeure la question essentielle de la prise en considération des inégalités sociales de santé dans ces démarches.
Les évaluations de ces interventions (en particulier conduites par des chercheurs) prennent-elles en compte la dimension des inégalités sociales de santé ? Les acteurs de l’accompagnement à la parentalité et les décideurs en santé intègrent-ils la dimension des inégalités sociales de santé dans leurs pratiques et décisions ?
Objectif de la thèse
Objectif général
L’objectif de cette recherche était d’élaborer un cadre conceptuel établissant les conditions de réussite des interventions, politiques et organisations d’accompagnement à la parentalité visant à réduire ou prévenir les inégalités sociales de santé pour la mère et l’enfant dans la période périnatale.
Alors qu’il existe de nombreuses interventions efficaces dans le cadre de l’accompagnement la parentalité, et que cet accompagnement est vu comme un levier efficace de réduction des inégalités sociales de santé, notre hypothèse était que les inégalités sociales de santé ne sont pas explicitement prises en compte par les acteurs, les chercheurs et les décideurs du domaine.
Dans cette recherche et dans ce mémoire, la parentalité a été considérée dans sa définition la plus large, comme « la fonction d’être parent en y incluant à la fois des responsabilités juridiques telles que la loi les définit, des responsabilités morales telles que la socio-culture les impose et des responsabilités éducatives »[33].
Dans cette recherche et dans ce mémoire, nous utilisons le terme intervention dans son acception la plus large incluant les actions, programmes, organisations, dispositifs, politiques de santé.
Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques consistaient à :
1. Analyser les composantes et caractéristiques des interventions efficaces relatives à l’accompagnement à la parentalité,
2. Évaluer la prise en compte des inégalités sociales de santé dans le cadre de ces interventions,
3. Élaborer une théorie d’intervention caractérisant les interventions d’accompagnement à la parentalité qui contribuent à réduire les inégalités sociales de santé.
Pour répondre à ces objectifs nous avons réalisé une revue systématique de la littérature et une évaluation de type réaliste basée sur une étude de cas multiples.
Pour répondre à ces trois dimensions des objectifs spécifiques, nous avons procédé comme suit:
1. La revue de littérature a permis de répondre à l’objectif spécifique 1 et a contribué à l’objectif spécifique 2 du point de vue de la recherche.
2. L’étude de cas a permis de répondre à l’objectif spécifique 2. Cette approche complémentaire de la revue de littérature scientifique a permis d’expliciter le fonctionnement contextualisé des interventions.
3. A partir de la littérature nous avons proposé une première théorie. Enfin, à partir de la capitalisation de l’ensemble des investigations, nous avons proposé théorie affinée par étude de cas de type réaliste.
Méthodes
Revue systématique
De nombreuses revues de la littérature ont été effectuées dans le domaine de l’accompagnement à la parentalité. Pour cette raison, nous avons choisi pragmatiquement d’effectuer une revue des revues plutôt qu’une revue de travaux individuels.
Schéma d’étude
Les étapes de sélection, admissibilité et inclusion ont été conduites et sont présentées selon le modèle Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) [14,42,43].
La population étudiée était celle des femmes enceintes, des parents de nouveau-nés et des nouveau-nés (d’âge élargi jusqu’à 3 ans, avant scolarisation). Les interventions concernaient la promotion de la santé périnatale et plus particulièrement des programmes et actions d’accompagnement à la parentalité considéré sous l’angle des disciplines potentiellement concernées : l’obstétrique, la pédiatrie, la psychologie, la sociologie, l’éducation, la santé publique au sens large. Les comparateurs ne concernaient pas cette étude. Tous les résultats ont été recueillis, qu’ils soient favorables ou non, en les évaluant selon leurs effets sur les inégalités sociales de santé, effets psychosociaux et effets sur la santé perçue. Toute durée des interventions a été considérée. Le tableau I. présente les critères PICOTS [50] sur lesquels reposent les termes de la stratégie de recherche.