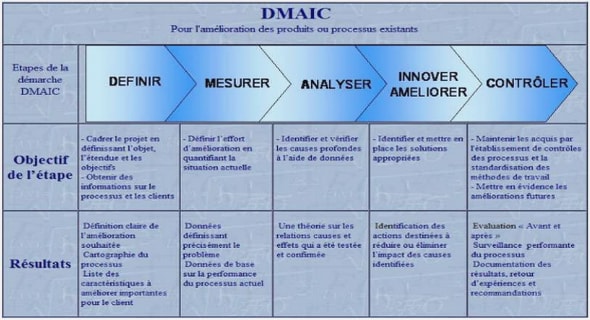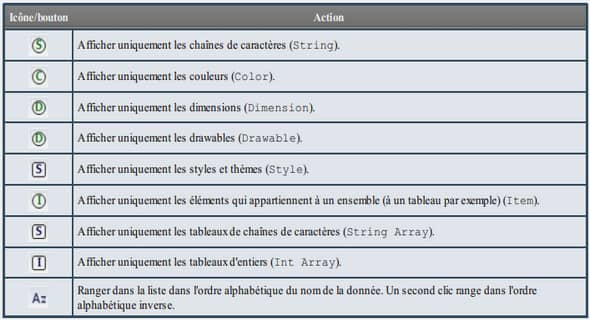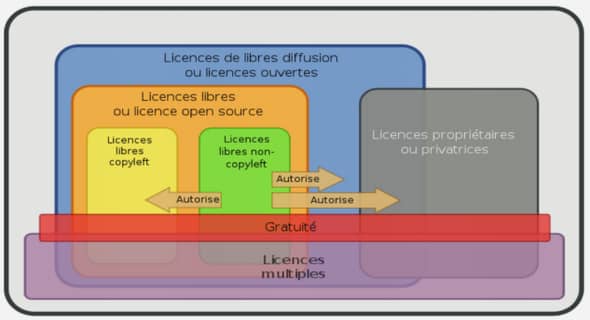S’inscrire dans le débat entre savant et populaire
Le débat entre culture savante et culture populaire semble encore vif. Pas d’autres issues que l’affronter. D’autant plus que la démarche d’enquête retenue pose d’emblée la question de la légitimité culturelle dans le rapport du chercheur au terrain d’investigation. En effet, il s’agit de faire une recherche savante sur une culture considérée de prime abord comme populaire.
De ce fait, établir un état des lieux de la recherche sur la culture populaire parait primordial.
Si Théodore W. Adorno et Max Horkheimer mobilisaient déjà la notion de culture de masse au milieu du XXe siècle (Adorno, Horkheimer, 1983), Richard Hoggart est l’un des premiers analyser la culture populaire en partant d’une étude ethnologique sur une classe sociale distincte. Richard Hoggart analyse un milieu au sein duquel il a vécu : la classe populaire anglaise (1957). En utilisant l’autobiographie, il analyse la culture populaire, la culture du pauvre, de l’intérieur et renouvelle ainsi les analyses réalisées antérieurement sur le sujet. Il considère la classe populaire comme une communauté distincte, plutôt homogène. Il s’intéresse plus spécifiquement à la consommation de biens culturels (presse, littérature) de cette classe dans un contexte de production de masse et observe des changements engendrés par la massification.
Richard Hoggart remarque que les frontières d’appartenance aux classes sont en train de se transformer en raison de consommations culturelles communes au sein de la société moderne. Néanmoins, il affirme que les différences de classes jouent toujours un rôle dans la consommation de biens culturels ou de ressources médiatiques (Hoggart, 1970 : pp 395-396). En ce sens, il soutient la thèse de l’existence de frontières de classes et, conjointement, d’une conscience de classe. L’auteur tente de démontrer comment la mutation industrielle a entrainé le passage d’une culture de classe présentant un « brave type bien de chez nous », à une culture « sans classe » qui diffuse l’image du « brave type de tous les pays » (Hoggart, 1970 : 401). La culture populaire, si elle répond de logiques de classes, ne semble pas inférieure ou moins complexe que la culture savante.
Définir le populaire
La notion de populaire, comme la notion de peuple, dispose de charges symboliques fortes.
Elle fait l’objet de nombreux débats en sciences humaines et sociales. Dans son sens le plus positif, l’adjectif « populaire » désigne un élément qui plait au peuple, c’est-à-dire au plus grand nombre. En langue anglo-saxonne, le mot people, qui se traduit littéralement « peuple » en français, désigne les personnalités célèbres. On utilise communément la notion de peuple pour faire figurer un ensemble d’individus formant une communauté dont les frontières sont plus ou moins explicites (Cuisenier, 2017).
travers l’expression « culture populaire », il faudrait donc comprendre « culture d’un peuple ». Reste à déterminer de quel peuple il s’agit : d’un peuple-classe (en l’occurrence des classes sociales les plus basses ?) ou à l’inverse d’un peuple souverain, dont la force réside dans la cohésion ? Pour qui et par qui la culture populaire est-elle produite ? Est-elle par exemple réalisée par des individus ne bénéficiant pas du statut d’artiste légitime pour répondre aux goûts uniformisés de la masse ?
De leur côté, les cultures savantes sont facilement définissables par leurs caractéristiques. Coût de production élevé, complexité nécessitant l’intervention de médiateurs, public restreint et ciblé doté d’un capital culturel élevé (Jacobi, 2014). Or, s’il est plus facile d’identifier les cultures savantes, il est moins aisé de distinguer les cultures populaires étant donné leur éclectisme. Les autres formes de cultures ne faisant pas partie de la culture savante sont donc désignées sous l’appellation générique de « culture populaire » en dépit de leur diversité.
Il est néanmoins possible de catégoriser les arts populaires à partir de trois critères selon l’ethnologue et ancien conservateur du musée national des arts et traditions populaires de Paris Jean Cuisenier (Cuisenier, 2017). Nous préférons adapter ces critères à l’ensemble de la culture populaire et non plus uniquement aux arts. Le mode de transmission constitue le premier critère. Souvent issues de traditions anciennes, les cultures populaires se transmettent oralement. Le second critère est l’origine populaire de ceux qui produisent la culture populaire et de ceux qui la consomment : les destinataires appartiennent eux aussi aux classes populaires. Ceux qui produisent la culture populaire sont souvent spécialisés ce qui leur permet de créer des œuvres typiques. La création d’œuvres populaires repose sur la répétition des gestes, l’imitation des modèles, la perpétuation des traditions. Enfin, le troisième et dernier critère, plus discutable, repose sur la méthode de fabrication, souvent archaïque, mise l’écart des évolutions de la société. La culture populaire utilise un savoir-faire essentiellement rural, en marge des modes de vie citadins. Ce denier critère semble faire confondre culture populaire et culture traditionnelle folklorisée.
La culture populaire dénigrée par les sciences ?
partir des deux définitions de culture savante et populaire, deux territoires respectifs semblent se dessiner pour chacune d’entre elles. La culture savante, par la clarté de sa définition, recouvre un périmètre restreint. La culture populaire semble quant à elle représenter un territoire beaucoup plus large, car elle réunit un ensemble très hétéroclite : industries culturelles, pratiques amateurs, loisirs, activités socioculturelles, etc. Par conséquent, elle regroupe également beaucoup de plus de participants.
La recherche sur certains objets de la culture populaire issus de l’industrie culturelle est courante à l’instar du cinéma et de la musique. En revanche, l’étude d’objets populaires exclus de cette industrie est plus rare. Et ce, comme si certains objets pourtant potentiellement nombreux à étudier, des supporters de rugby à la pratique de la pétanque, présentaient un intérêt moindre. Il s’agit pourtant d’authentiques formes de cultures en regard des définitions de la culture rappelées ci-dessus.
En plus de cette possible dépréciation et de la valeur péjorative de certains objets populaires, les critiques faites à l’encontre de la culture populaire sont nombreuses d’après Richard Shusterman : l’art populaire ne procure qu’une fausse satisfaction, l’art populaire ne propose aucune activité, aucun effort, mais simplement une réponse passive, l’art populaire manque de dignité esthétique, l’art populaire manque de forme. Théodore W. Adorno et Clement Greenberg repèrent d’autres critiques pouvant être faites à la culture populaire, ces dernières étant valables surtout pour la culture de masse : l’art populaire présente un défaut d’originalité par définition, elle présente un caractère simpliste en raison des formules familières qu’elle emploie face au récepteur. L’art populaire a un caractère intéressé en raison de son potentiel commercial. Pire, la culture populaire présenterait même des risques : encourager un commercialisme excessif, destructeur de haute culture, corrompre le public de la haute culture, abaisser la qualité intellectuelle de la société dans son ensemble, entrainer une forme de passivité (Shusterman, 1993).
Richard Shusertman précise que les défenseurs de la culture populaire ne sont pas très nombreux parce qu’ils ne voient pas l’intérêt de trouver quelconque justification tant qu’ils éprouvent du plaisir au contact des objets populaires. L’art populaire ne serait bon que pour ceux qui n’accèdent pas à la valeur esthétique des arts savants du fait de leur manque d’éducation ou de culture. Pourtant, les pratiques populaires concernent le plus grand nombre, y compris les catégories supérieures comme le concept d’omnivorisme le présuppose. Ne méritent-elles donc pas que l’on s’y intéresse sans préjugé et sans faire l’apologie de ces défauts ?
Le populaire entre tradition et folklore
Si la course camarguaise, et plus largement, la culture taurine camarguaise, semblent s’apparenter à la culture populaire, peut-on préciser encore davantage sa nature ? La course camarguaise est-elle par exemple une tradition ou une manifestation folklorique ? D’après une définition attribuée à Marcel Mauss, est populaire tout ce qui n’est pas officiel. C’est-à-dire que ce qui non-institutionnalisé et fait partie des aspects souterrains de la vie sociale est considéré comme populaire (Pamart, 2014). Sont considérées comme folkloriques l’ensemble des manifestations de la vie populaire : « Est populaire tout ce qui relève du folklore, même si aujourd’hui le populaire couvre un champ beaucoup plus large que le seul champ folklorique. » (Pamart, 2014 : 34).
Le folklore est censé recueillir et transmettre des productions collectives. Il comporte une dimension traditionnelle dans le sens où les pratiques qui en font partie relèvent de civilisations antérieures ayant perdu leur signification dans le monde moderne dans lequel on prétend les perpétuer. Ce sont donc des pratiques disparues, ou en voie de disparition, qui sont reproduites à l’identique et qui revendiquent leur authenticité, car elles conservent une valeur identitaire revendiquée sur un territoire (Duflo-Priot, 1995.)3 Sauf exception, elles sont reproduites, transmises et répétées de manière traditionnelle.
Selon Eric Hobsbawm, les traditions sont des pratiques ayant à la différence des conventions et des routines ordinaires, une fonction symbolique ou rituelle significative4 (Babadzan, 1999 : 14). Elles sont rigides contrairement aux coutumes qui seraient, elles, plus malléables : L’objet et la caractéristique des « traditions », y compris des traditions inventées, c’est l’invariabilité. Le passé, réel ou fictif, auquel elles se réfèrent implique des pratiques stables, formalisées de manière normative se prêtant à la répétition. Dans les sociétés traditionnelles, la coutume a la double fonction du moteur et du volant. Elle n’exclut pas jusqu’à un certain point, l’innovation et le changement […] » (Hobsbawm, 1995 : 75.)
De plus, on parait parler encore davantage de traditions lorsque celles-ci ont cessé d’exister d’après Edgar Morin : « C’est parce que le passé est bien mort qu’il ressuscite esthétiquement. » (Morin, 1967 : 237)5. Par ailleurs, Eric Hobsbawm remarque à propos de la tradition inventée que « les vieilles méthodes sont vivantes, les traditions n’ont besoin d’être ni renouvelées ni inventées. Pourtant, on peut supposer que là où elles sont inventées, c’est souvent non parce que les vieux modèles ne sont plus valables ou viables, mais parce qu’ils ne sont pas ou plus utilisés (Hobsbawm, Ranger : 2006 : 196).
En regard de ces définitions du folklore et de la tradition, il semble que la course camarguaise soit exclue de l’une comme de l’autre. En effet, la course camarguaise ne symbolise pas une culture passée, présentée et célébrée à l’identique.
Citée par Emilie Pamart (2014 : 36)
D’après Alain Babadzan, Eric Hobsbawm ne délivre pas de définition précise de la tradition dans son ouvrage The Invention of Tradition (traduit en français en 1995). Il interprète donc l’expression suivante : « une fonction symbolique ou rituelle significative » (Hobsbawm, 1995 : 175) comme un élément de définition. Alain Babadzan utilise lui-même la notion de tradition comme une culture et désigne comme tradition les cultures ayant un ordre symbolique, tandis qu’Eric Hobsbawm ne fait pas de la tradition et de la culture des synonymes.
Certes, elle présente quelques aspects traditionnels que nous nous attacherons à détailler (costumes) et rituels (capelado), mais son inscription dans le cadre d’un championnat sportif et son lien avec l’économie locale font d’elle une culture bien vivante et en constante évolution. Pour autant, les spectateurs de course camarguaise que nous avons rencontrés la distinguent-ils de ces deux aspects ?
Finalement, la course camarguaise semble bien s’inscrire dans la catégorie de la culture populaire. La transmission orale, la production d’origine populaire, le manque d’intérêt scientifique pour cette dernière sont les éléments qui, en tout cas, permettent de l’exclure de la catégorie de la culture savante. Le parti retenu pour cette recherche est d’ignorer l’antagonisme culture populaire/culture savante et en tout cas de ne pas filtrer les recherches de terrain par des a priori nécessairement réducteurs.
La construction d’un champ comme fil conducteur de la recherche
Une notion est utilisée de manière récurrente dans cet écrit : il s’agit de celle de champ. Nous avons choisi de lui accorder une place centrale après mûre réflexion. Dès les premières observations, nous avons pu constater que différents groupes sociaux semblaient reliés. Ils ont un point commun : la course camarguaise. Il nous fallait pouvoir désigner cet ensemble. Milieu ? Monde ? Système ? Sphère ? Ecosystème ? Après avoir testé plusieurs appellations, nous sommes revenue à celle que nous avions d’emblée empruntée à Pierre Bourdieu. Il apparaît que la notion de champ semble la plus adéquate pour désigner l’ensemble social en mouvement que représente la course camarguaise. Explications…
Dans son ouvrage Les Règles de l’art (1992), Pierre Bourdieu tente de dégager les propriétés générales des champs sans pour autant y apporter une définition précise qui pourrait déboucher sur une théorisation applicable à différents domaines (et ce, à l’inverse des notions d’habitus et de capital qui, elles, peuvent s’appliquer à toutes les configurations sociales. Le champ » est un ensemble de relations structurales (Bourdieu, 1992). Pierre Bourdieu affirme que le travail de la théorie des champs pourrait aussi s’appeler la « pluralité des mondes », ce qui montre la difficulté que lui-même rencontre pour s’arrêter à une seule et unique dénomination. Le champ est un système dont la mise au jour est rendue possible par l’analyse des unités qui le composent. Toutefois, l’absence de formation théorique applicable du champ pose problème en ce qu’elle engendre quelques incertitudes : à quelles organisations sociales appliquer, ou non, cette notion ? Jean-Louis Fabiani explique que seule l’enquête réalisée in situ permet d’attribuer la notion de champ à telle ou telle organisation : « La théorie des champs ne vaut que si elle s’éprouve dans l’espace de l’enquête. » (Fabiani, 2016 : 37.)
Selon Jean-Louis Fabiani, deux mots peuvent aider à définir le champ : « système » et concurrence ». Tout d’abord, les positions au sein du champ forment un système et permettent de structurer le champ. Cet aspect est significatif de la pensée structuraliste de Pierre Bourdieu. Le champ est le concept central de la théorie sociale, car « C’est à partir de la notion d’espace positionnel qu’on peut comprendre tous les modèles de l’action, quel que soit le domaine où ils exercent. » (Fabiani, 2016 : 51.)
Puis, le mot « concurrence » qualifie le champ comme un espace de compétition et donc de concurrence entre des agents ou des institutions. Néanmoins, en dépit de cette concurrence, l’auteur souligne que Pierre Bourdieu note lui-même l’existence d’une fonction commune des agents au sein de chaque champ. Ainsi, la théorie des champs apporte une réflexion sur la pluralité des logiques correspondant aux différents mondes, c’est-à-dire aux différents champs, comme lieux au sein desquels se construisent des éléments en commun : des sens communs, des lieux communs, des systèmes de topiques irréductibles les uns aux autres. (Bourdieu, 1987)7. La définition que nous retenons est que, finalement, le champ se caractérise par sa structure, d’une part, et par les relations entre les agents qui composent le champ d’autre part, qu’il s’agisse de relations concurrentielles ou au contraire de relations productives.
Notons que pour établir sa théorie du champ, Pierre Bourdieu s’est inspiré d’autres théories.
D’après Bernard Lahire, il s’est inspiré de Max Weber et Emile Durkheim (Lahire, 2001)8.
La notion de champ a aussi beaucoup emprunté à celle de field développée en psychologie sociale par Kurt Lewin (Fabiani, 2016). Bourdieu s’inscrit donc dans cet héritage entre Max Weber, Emile Durkheim et Kurt Lewin. Le champ n’est pas pour autant synonyme de société » ou de « sphère ». Le champ est un espace social donné à voir comme « un système de relations que viennent moduler les formes variables de dispositions acquises (l’habitus) ou le niveau inégal de ressources mobilisables (le capital) (Fabiani, 2016 : 37).
Or chez Emile Durkheim, qui développe le modèle de société, la compétition interindividuelle ou interinstitutionnelle n’est pas mise en avant. Pour Pierre Bourdieu, le sens de la compétition fonde et garantit l’espace commun du champ. Le champ est une sorte d’arène de combat au sein de laquelle l’enjeu des luttes est identique pour chaque agent : l’emporter sur la concurrence. Les nouveaux entrants dans le champ essayent de bouleverser les règles qui garantissent la reproduction de la domination dans le champ d’autant plus que les agents disposent de ressources inégales. Le champ est donc une structure dans laquelle le rapport au pouvoir se joue en permanence. Même le plus dominant est à son tour dominé par le champ à cause des rapports de force qui existent dans cet espace (Fabiani, 2016). La relation du champ au pouvoir est une épreuve pour tout champ ce qui relativise son autonomie.
Pierre Bourdieu se différencie de la notion de « sphère d’activité » d’Emile Durkheim et de Max Weber en singularisant partiellement la répartition par fonctions : le champ n’a pas une seule et même fonction malgré l’enjeu productif qui en résulte : « Pour qu’un champ marche, il faut qu’il y ait des enjeux et des gens prêts à jouer le jeu, dotés de l’habitus impliquant la connaissance et la reconnaissance des lois immanentes du jeu, des enjeux, etc. » (Fabiani : 48)9. Pierre Bourdieu nomme illusio l’existence de cet accord entre les joueurs et les structures du monde social et donc le fait de jouer le jeu. Ainsi, les sphères d’activités une fois différenciées, des champs peuvent se multiplier : « La multiplication des champs relativement autonomes est indissociable des processus de différenciation entre les sphères d’activités, sous l’effet de ce que Durkheim appelait la division du travail social. » (Fabiani, 2016 : 29).
La notion de champ de Pierre Bourdieu peut également être rapportée au concept d’ « écologie » développé par Andrew Abbott. Contrairement au champ, l’écologie d’Abbott est un processus au sein duquel il y a différentes espèces, également nommées « acteurs ». Ce processus inclut compositions et décompositions : For all its appearance of dynamism, Bourdieu’s concept of field is largely static (cf. Fabiani 1999). Its dynamism is purely oppositional, a sort of mechanized dialectic in which avant garde succeeds avant garde and so on. By contrast, the concept of ecology is far more fluid and dynamic, capturing more aspects of difference and more empirical diversity in the way actors act and groupings of actors change. » (Abbott, 2011)10.
Apparue plus tardivement que la notion de champ, l’initiateur du concept d’écologie, Andrew Abbott, la considère comme plus vaste que le champ, mais aussi différente dans la mesure où elle ne comporte pas de rapports de domination11.
Une dernière notion nous intéresse dans la dénomination du milieu social de la course camarguaise : celle de « monde ». Howard Becker explique qu’un « monde de l’art » se compose de toutes les personnes dont les activités sont nécessaires à la production des œuvres bien particulières que ce monde-là (et d’autres éventuellement) définit comme de l’art. (Becker, 2010 : 58). Les membres du monde de l’art coordonnent les activités axées sur la production de l’œuvre et coopèrent régulièrement en formant des chaînes de coopération qui relient les participants selon un ordre établi. Les conventions du monde facilitent l’activité collective. Les œuvres d’art sont donc le résultat de la production de l’ensemble de ces personnes et non plus seulement de l’artiste (à qui toutefois une importance spéciale est accordée puisque ce dernier « possède le don »).
Comme le précise Howard Becker, les mondes de l’art n’ont pas de frontières précises qui permettraient de dire que telle personne appartient à un monde et telle autre non. Il n’existe pas de ligne de démarcation entre un monde de l’art et le reste du monde. Howard Becker s’intéresse plutôt aux groupes d’individus qui coopèrent pour produire en formant un réseau. Un monde n’est donc pas un espace symbolique avec des places, mais plutôt une activité en train de se faire. Contrairement au champ, ce n’est pas une structure ni une organisation. Les mondes de l’art entretiennent des relations avec d’autres mondes dont ils essaient de se différencier et se caractérisent par leur degré variable d’indépendance tandis que Pierre Bourdieu parle d’autonomie (bien que parfois remise en question) pour le champ.
Les chaînes de coopérations créent la dynamique du monde : « […] l’interaction de tous les participants engendre un sentiment commun de la valeur de ce qu’ils produisent collectivement. » (Becker, 2010 : 63). Néanmoins, la coopération est rendue possible dans le respect de certaines règles. En effet, le « monde de l’art » est constitué de l’ensemble des agents qui respectent des règles bien établies et dont les activités sont nécessaires pour la production et pour la réception des œuvres caractéristiques à ce monde plus fluide et dynamique, capturant plus d’aspects de la différence et plus de diversité empirique dans la manière dont les acteurs agissent et les groupements d’acteurs changent » (Abbott, 2011), (traduction personnelle).
L’auteur insiste sur l’idée que l’art est une action collective. La coopération de nombreux agents dans le cadre d’activités variées engendre la création d’œuvres. Différentes catégories d’agents existent. Les premiers agents sont ceux qui fournissent des matériaux ou des financements et qui exercent l’activité de soutien, les seconds sont des artistes, les personnalités ayant des dons particuliers qui mènent l’activité artistique. La troisième activité qui est capitale selon l’auteur est celle de consommation de l’art. La production d’œuvres d’art exige qu’un personnel spécialisé coopère selon des modalités bien définies. Il faut que les participants arrivent à s’entendre sur ces modalités. Pour cela, ils s’appuient sur des conventions antérieures : les conventions fixent une norme.