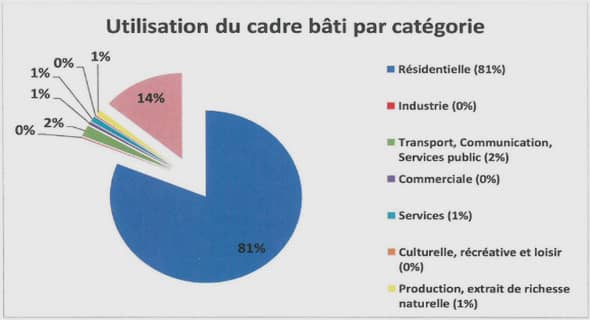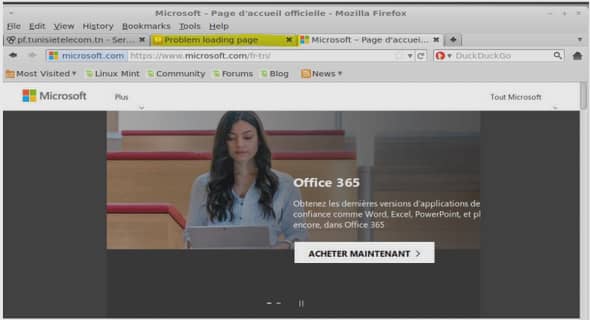Valeur historique des Gesta Berengarii
Le règne de Bérenger Ier d’Italie (888-924) :
Bérenger naît vers 85094. Il est issu d’une des plus puissantes familles carolingiennes, les Unrochides, possessionnée en Flandres, en Souabe et dans le nord-est de l’Italie. Son père, Evrard, est un proche de l’empereur Louis le Pieux, qui le nomme marquis de Frioul et lui donne en mariage sa fille, Gisèle. En contact avec de nombreux intellectuels, comme Gottschalk d’Orbais, Raban Maur, Hincmar ou Sedulius Scottus95, Evrard possédait une des plus riches bibliothèques laïques de son époque96.
Au début des années 870, Bérenger épouse Bertilla97, fille de Suppo II, ce qui renforce les liens entre sa famille et celle des Supponides, installée principalement à Brescia et en Émilie98. À la même époque, il succède à son frère aîné, Unroch, à la tête de la marche de Frioul99. Durant les années 870-880, il soutient la politique des Carolingiens de Francie orientale en Italie. Ainsi, en 875, à la mort de Louis II, roi d’Italie, Bérenger se range du côté de Louis le Germanique et de son fils Carloman plutôt que de soutenir son oncle Charles le Chauve. Il est particulièrement proche de Charles le Gros devenu roi d’Italie en 879. En 887, il est à Waiblingen auprès de l’empereur afin de plaider sa cause dans un conflit qui l’oppose à l’évêque Liutward de Verceil100. Il est possible que ce soit cette rencontre entre Charles et Bérenger qu’évoquent les Gesta Berengarii au début du livre I (I, 30-42)101.
Lorsque l’état de santé de Charles ne lui permet plus de régner, l’unité de son empire se délite et on assiste à l’élection de plusieurs reguli102. En janvier 888, le Bosonide Rodolphe devient ainsi roi de Bourgogne transjurane. En mars 888, Gui de Spolète, futur adversaire de Bérenger en Italie, est élu roi de Francie occidentale à Langres103. Mais ses soutiens sont rares en dehors de la Bourgogne Cisjurane et il ne peut rivaliser avec le parti d’Eudes de Paris, élu à son tour roi de Francie occidentale à Compiègne le 29 février 888. À la même époque, entre la fin décembre 887 et le début février 888, Bérenger est élu roi d’Italie à Pavie104.
Abandonnant pour le moment ses ambitions au nord des Alpes, Gui retourne en Italie avec une partie de ses soutiens bourguignons, qui décident de tenter leur chance à ses côtés dans la péninsule105. Fin octobre 888, Gui et Bérenger s’affrontent près de Brescia. L’issue du combat n’est pas certaine mais Bérenger a dû rester maître du champ de bataille. Les deux camps instaurent une trève jusqu’à l’épiphanie106. En décembre 888, Bérenger rend hommage à Arnulf de Carinthie à Trente107, puis est de nouveau obligé de marcher contre Gui, qu’il affronte en janvier 889 sur les rives de la Trébie. Contrairement à la première rencontre, le rapport de force est à l’avantage de Gui, qui peut compter sur ses soutiens bourguignons et spolétains, ainsi que sur ses alliés toscans. En face, l’armée de Bérenger est composée d’éléments provenant du nord de l’Italie et de Souabe. Bérenger est défait et contraint de se retirer sur ses terres108. Gui se fait élire roi en février 889109. Deux ans plus tard, Etienne V le couronne empereur à Rome, le 21 mai 892, Lambert est couronné empereur par Formose à Ravenne112. Il faut attendre la fin de l’année 893 pour que Bérenger retrouve le devant de la scène. En automne 893, une ambassade du pape et de plusieurs grands d’Italie se rend à Ratisbonne auprès d’Arnulf pour l’inviter à venir chasser les Widonides113. Il est probable que Bérenger a joué un rôle dans cette demande, peut-être était-il du voyage comme le raconte Liudprand (Antap. I, 20).
Arnulf place son fils Zwentibold à la tête d’une expédition contre Gui de Spolète. Zwentibold rejoint Bérenger en novembre 893, assiège avec lui Pavie114, sans succès, et retourne auprès d’Arnulf, qui décide de prendre les choses en main et traverse les Alpes dès le mois de janvier 894. Bérenger et Arnulf prennent Bergame, ce qui entraîne le ralliement des cités lombardes, Milan et Pavie notamment, et oblige Gui à se réfugier prudemment en Italie centrale. Durant cette expédition, Bérenger est relégué au second plan par un Arnulf qui agit en roi et s’apprête même à se débarrasser de son encombrant allié en projetant de l’aveugler. Bérenger a vent du projet et se réfugie sur ses terres, entraînant la défection d’une partie de la noblesse nord-italienne, dans un premier temps ralliée à Arnulf. Face à ces revirements, le roi de Francie orientale, qui ne peut se fier davantage aux marquis de Toscane, doit renoncer à marcher sur Rome pour être couronné empereur et rentre avec peine en Germanie (fin avril), sans passer par le col du Brenner, dont l’accès lui est sans doute coupé par les forces fidèles à Bérenger.
Quelques mois plus tard, à la fin l’année 894, meurt Gui de Spolète115. La situation semble favorable à Bérenger, qui décide de pousser jusqu’à Milan, où il entre le 2 décembre 894. Mais Lambert et Ageltrude, la veuve de Gui, le forcent à retourner sur ses terres. Dès janvier 895, Pavie est à nouveau aux mains des Widonides. La situation reste ainsi jusqu’en octobre 895, lorsqu’Arnulf passe à nouveau les Alpes, avec l’intention de s’emparer de la couronne impériale. Pendant cette seconde expédition, il démet, en quelque sorte, Bérenger de ses fonctions en nommant le comte de Vérone Walfred, un des proches de Bérenger116, à la tête du nord-est de l’Italie, le nord-ouest revenant à Maginfred de Milan117. Lambert se réfugie à Spolète et laisse la défense de Rome à sa mère Ageltrude. Bérenger, obligé d’accompagner Arnulf dans sa marche vers Rome, parvient à lui échapper vers février 896 et reprend Vérone à Walfred dans les mois qui suivent118. Pendant ce temps, Arnulf s’empare de Rome119 et est sacré empereur par Formose à la fin du mois de février120. Il fait alors route vers Spolète mais tombe malade et doit rentrer en Germanie, en évitant, encore une fois, les terres contrôlées par Bérenger121. Bérenger et Lambert se rencontrent à Pavie en octobre ou novembre 896 et concluent une trêve fixant la limite de leurs territoires au niveau de l’Adda122. La situation reste la même jusqu’à la mort de Lambert, durant une chasse près de Marengo, le 15 octobre 898.
Cette mort permet à Bérenger de reprendre le contrôle d’une bonne partie de l’Italie. C’est cette époque notamment qu’il unit sa fille, Gisèle, à Adalbert, fils du puissant marquis d’Ivrée, Anschaire. L’arrivée d’une armée hongroise en 899 met un terme à cette éphémère stabilité politique. Le 24 septembre 899, l’armée italienne menée par Bérenger, rongée par les divisions internes, est défaite par les Hongrois, pourtant inférieurs en nombre, sur les rives du Brenta. Après cette défaite, Bérenger ne cherchera plus à affronter les Hongrois en rase campagne, préférant promouvoir une politique défensive, basée sur la fortification des cités. Il va, en outre, plusieurs reprises négocier avec les Hongrois, les utilisant même parfois contre ses adversaires politiques. Cette politique très controversée met à mal le ralliement aussi récent que fragile d’une partie de la noblesse du nord de l’Italie et de la Toscane à la cause de Bérenger. Jusqu’à sa mort, ses opposants vont régulièrement inviter des candidats non-italiens à venir s’emparer de la couronne italienne.
Mené par le marquis de Toscane, Adalbert, et sa femme, Berthe, ce front hostile à Bérenger établit, durant l’été 900, des relations avec Louis de Provence, fils de Boson et d’Ermengarde, et le fait venir en Italie. Louis est couronné roi à Pavie en octobre 900123. La rapidité de ce couronnement illustre la fragilité de l’hégémonie de Bérenger sur les terres situées au sud du Pô et à l’ouest de l’Adda. Ne rencontrant pour le moment pas d’opposition, Louis est sacré empereur à Rome par Benoît IV en février 901124. Bérenger ne parvient à chasser Louis d’Italie qu’au milieu de l’année 902, en lui faisant promettre de ne jamais revenir125. Pourtant, dès 904, Berthe et Adalbert de Toscane font, de nouveau, appel à Louis, qui est à Pavie en juin
Durant cette seconde expédition de Louis, Bérenger perd momentanément le contrôle de Vérone, où Louis fait son entrée le 21 juillet sans coup férir, croyant peut-être aux rumeurs annonçant la mort de Bérenger. Ce succès n’est que de courte durée : dans les jours qui suivent, Bérenger s’empare de la ville sans combattre et fait aveugler Louis, le rendant ainsi inoffensif sur le plan politique126.
Commencent alors pour le roi d’Italie, quinze années d’une relative tranquillité, qui se traduisent par la stabilité de sa chancellerie. Son beau-frère, Ardingus, reste archichancelier de février 903 à 922, ce qui contraste avec les trois années précédentes, qui ont vu trois archichanceliers se succéder. Cependant, durant ces années, Albéric de Spolète et Adalbert d’Ivrée l’empêchent de se rendre à Rome127. La mort du marquis de Toscane en août 915 débloque la situation et Bérenger se voit, à son tour, couronné empereur à Rome les 25 et 26 novembre ou les 2 et 3 décembre de l’année 915128.
Je passerai plus rapidement sur les neuf dernières années du règne de Bérenger, car celles-ci sortent du cadre chronologique du récit des Gesta Berengarii.
Malgré ce succès politique, le parti hostile à Bérenger ne s’avoue pas vaincu. Dirigée, notamment, par Berthe de Toscane et Adalbert d’Ivrée, remarié depuis peu à une fille de Berthe, cette faction fait de nouveau appel à un roi non-italien en invitant en Italie Rodolphe II de Bourgogne. En février 922, Rodolphe est à Pavie et oblige Bérenger à se replier sur ses terres129. Une partie importante de l’Italie reste néanmoins fidèle à Bérenger. Les deux camps s’affrontent le 17 juillet 923 à Fiorenzuola d’Arda130. Au terme d’une sanglante bataille, Bérenger est finalement vaincu. L’empereur, très affaibli politiquement, meurt assassiné le 7 avril de l’année suivante devant l’entrée de l’église San Pietro à Vérone.
888-915 sont rares, les plus détaillées étant l’Antapodosis de Liudprand de Crémone (rédigée une quarantaine d’années après les Gesta), la « Continuation de Ratisbonne » des Annales de Fulda et la chronique contemporaine de Réginon de Prüm131. Pour compléter cette documentation limitée, les historiens ont, depuis longtemps, utilisé le panégyrique de Bérenger Ier comme une source historique, non sans montrer souvent une certaine réticence. Ils se sont contentés de puiser dans le poème les informations qui ne se trouvaient pas dans les autres textes ou qui les précisaient. Ces réserves s’expliquent par la nature de cette œuvre, qualifiée, dans le manuscrit de Venise, de panegyricon. C’est, en effet, un poème, qui plus est encomiastique, c’est-à-dire une œuvre qui n’est pas soumise à une chronologie fixe, qui peut recourir à l’ellipse, une œuvre partiale et donc partielle.
Le poète affirme au début du livre I que sa « Thalie ne peut pas tout rapporter » (« Nam cuncta nequit mea ferre Thalia » Gesta, I, 15). Dans la logique du passage, cette formule annonce que le poète ne va faire qu’un rapide tour d’horizon de la généalogie du prince italien. Mais, placée juste après le proemium, une telle formule est loin d’être anodine. Elle vaut pour l’ensemble du poème et constitue, en quelque sorte, à la fois un programme et une clé de lecture. Le poète explique d’emblée qu’il ne va pas offrir un exposé complet des événements. Son récit est donc le résultat d’un tri dans la matière historique. C’est cette opération que je souhaite étudier ici, en m’arrêtant moins sur les écarts entre les faits historiques et la façon dont ils sont rapportés par le poète que sur les raisons et les fonctions de ces écarts. En tant que panégyrique rapportant des faits récents, les Gesta Berengarii posent, de façon particulièrement intéressante, la question du rapport entre discours poétique et discours historique.
Pour bien saisir les intentions de l’auteur dans cette œuvre, il convient d’abord de chercher comprendre ce que le poète anonyme entendait par « panégyrique » en confrontant textes théoriques et passages métatextuels. Une fois définies ce qu’étaient pour lui les caractéristiques d’un panégyrique, il est possible de confronter les intentions et leur réalisation poétique. Il en ressort que ce texte poétique peut être lu selon plusieurs points de vue qui nous renseignent autant sur les événements qu’il rapporte que sur le public pour lequel il a été composé.
Fuldenses sive Annales regni Francorum orientalis, éd. Friedrich KURZE, Hannover, 1891 (MGH Script. rer. Germ., 7) ; Liudprandi Cremonensis opera omnia, éd. Paolo CHIESA, Turnhout, 1998 (Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis, 156) ; Reginonis abbatis Prumiensis Chronicon cum continuatione Treverensi, éd. Friedrich KURZE, Hannover, 1890, (MGH Script. rer. Germ., 50).
Qu’est-ce qu’un « panégyrique » au Xe siècle ?
Sens du terme panegyricum employé dans le titre donné par le manuscrit
Le titre Gesta Berengarii Imperatoris n’a été donné qu’à partir du XVe siècle sur le modèle des Gesta Ottonis de Hrotsvitha ou des Gesta Friderici d’Otton de Freising132. Dans le manuscrit de Venise, le texte133 s’intitule pompeusement en grec ΤÒ ΠΑΝΗΓUΡΙΚÒΝ ΒΕΡΕΝΓΑΡÍΟU ΤΟŶ ἈΝΪΚΉΤΟU ΚΑÍϹΑΡΟϹ (« le panégyrique de l’invincible empereur Bérenger »). Le poème se revendique donc clairement comme étant un panegyricon, mais qu’entendait par là le poète ? Le choix de ce terme pour désigner un poème d’éloge épique est singulier à l’époque carolingienne. Les textes se rapprochant le plus des Gesta Berengarii, comme le poème d’Ermold le Noir en l’honneur de Louis le Pieux, ne l’utilisent pas. Cette réapparition du terme « panégyrique » a d’ailleurs déjà été soulignée par Francesco Stella, qui décrit ainsi le poème : « gli anonimi Gesta Berengarii narrano in quattro libri di circa 1090 versi le guerre italiche e descrivono l’incoronazione imperiale del 915 con stile sicuro ed elegante, capace di amalgamare senza visibili suture massicce riprese da Stazio e dall’Ilias Latina, riesumando dopo un silenzio di secoli il termine Panegirico scritto in greco nella titolazione del poema »134.
Si l’on examine les emplois du nom dans ses différentes versions orthographiques (panegyricum, panegyricus, panagericus, panagiricum …135) et de l’adjectif panegyricus à l’époque carolingienne, on peut distinguer deux grands emplois, l’un positif, l’autre négatif136. Le terme est parfois employé simplement comme un synonyme recherché de laus. C’est le cas sous la plume de Milon de Saint-Amand dans son De Sobrietate (I, 427)137 ou plus tard dans ces vers de Sigebert de Gembloux où le terme prend même le sens éminemment positif d’hagiographie en qualifiant les vies métriques de saint Germain, de saint Ursmer, de saint Cuthbert et de saint Amand composées respectivement par Heiric d’Auxerre, Hériger de Lobbes, Bède le Vénérable et Milon de Saint-Amand (Passio sanctorum Thebaeorum, Mauritii, Exuperii et sociorum, prol. 109-112) :
Cantat Heiricus Germanum Ursmarum Herigerus
Chutberto chordas Beda movet lyricas,
Sobrius et Milo gratatur amanter Amando,
dant panegyricum quique suis proprium138.
Mais le plus souvent, le terme est employé de façon négative et renvoie à un discours d’éloge excessif voire mensonger. Paschase Radbert, par exemple, dans son Expositio in Psalmum, présente le panégyrique comme un genre où l’on porte aux nues ce qu’on a décidé de louer139. Au XIe siècle, Hermann Contract utilise ce mot pour désigner un discours creux140. Cette condamnation des panégyriques à l’époque carolingienne vient des auteurs tardo-antiques et notamment de Jérôme pour qui le panégyrique est, par nature, mensonger :
Testor Iesum, cui illa servivit et ego servire cupio, me in utraque parte nihil fingere, sed quasi christianum de christiana, quae sunt vera, proferre, id est historiam scribere, non panegyricum, et illius vitia aliorum esse virtutes. (Epistola 108, 21, éd. J. LABOURT, Paris, 1955 (CUF), p. 189 ; cf. PL 22, col. 898)141
La définition la plus répandue du panégyrique est celle d’Isidore qui reprend les critiques de Jérôme. C’est cette définition que l’on retrouve dans les glossaires, comme le Liber Glossarum, à l’époque carolingienne :
Panegyricum est licentiosum et lasciviosum genus dicendi in laudibus regum, in cuius conpositione homines multis mendaciis adulantur. Quod malum a Graecis exortum est, quorum levitas instructa dicendi facultate et copia incredibili multas mendaciorum nebulas suscitavit (Isidore, Etym. VI, 8, 7)142.
« Heiric chante Germain, Hériger Ursmer, / Bède fait jouer les cordes de sa lyre pour Cuthbert, / Et le sobre Milon loue aimablement Amand, / Chacun offre son propre panégyrique à son saint » (Sigebert de Gembloux, Passio sanctorum Thebaeorum, Mauritii, Exuperii et sociorum, éd. Ernst DÜMMLER, Sigebert’s von Gembloux Passio Sanctae Luciae Virginis und Passio Sanctorum Thebeorum, Preussische Akademie der Wissenschaften Berlin, Abhandlungen der historisch-philologischen Klasse, 1893, p. 44-125, (p. 47)).
« Sed est repetitio nominis tropice figurata more panegyrico quo genere laudatores apud rhetores et saeculares viri loquuntur quando suis efferunt praeconiis quod laudare decreverunt » (Expositio in Psalmum XLIV).
« Crede, panegyricis non haec me fingere vanis » (Hermann Contract, Chronicon, éd. Georg Heinrich PERTZ, Hannover, 1843, [MGH, Scriptores, 5] p. 131).
Dans cette lettre, Jérôme fait l’oraison funèbre de sainte Paule. Il se défend ici de faire un éloge mensonger comme le font les panégyristes. Cette condamnation revient plusieurs fois chez Jérôme : « Me non panegyricum, aut controversiam scribere, sed commentarium, id est, hoc habere propositum, non ut mea verba laudentur, sed ut quae ab alio bene dicta sunt, ita intelligantur ut dicta sunt » (Ad Galatas, PL 26, col. 327) ; cf. aussi, Epist. 65, 11, éd. J. LABOURT, Paris, 1953, p. 151 = PL 22 col. 629.
Le panégyrique est un genre exagéré et excessif [c’est-à-dire « débridé et maniéré »] qui consiste à louer les rois et dans lequel les hommes sont flattés par de nombreux mensonges. Ce fléau est apparu chez les Grecs dont la légèreté pourvue d’une éloquence et d’une faconde incroyables a suscité des nuées de mensonges ».
Ainsi, les éléments constitutifs du panégyrique d’après Isidore sont le mensonge, la flatterie et l’excès, la démesure. Cet extrait d’Isidore se trouve dans le chapitre DE GENERIBVS OPVSCVLORVM où il présente différents genres d’opuscules en prose. Contrairement à la source de sa définition, Lactance, il ne fait pas explicitement référence aux panégyriques en vers. Mais sa définition s’applique autant aux discours en prose, comme le panégyrique de Trajan, qu’à ceux en vers comme les panégyriques de Claudien143.
Cette définition isidorienne est reprise par deux gloses marginales contenues dans le manuscrit de Venise au fol. 1v. : « Panigiricum est licentiosum et lasciuiosum genus dicendi in laudibus regum. ─ Hoc genus dicendi a Grecis exortum est ».
Que ces gloses proviennent de l’auteur ou d’un contemporain, on voit qu’elles sont une version bien édulcorée de la définition isidorienne. On ne parle plus des « nombreux mensonges » (« multis mendaciis » et « multas mendaciorum nebulas ») ; on a cherché à rendre le plus neutre possible cette description (« quod malum » devient par exemple « hoc genus dicendi »). Sortis de ce contexte négatif, les adjectifs licentiosum et lasciuiosum perdent en partie leur connotation morale et redeviennent des termes techniques qui caractérisent tout discours poétique et non plus seulement les textes épidictiques. Les deux mots, en effet, étaient déjà associés pour qualifier la poésie chez Quintilien qui expliquait que la narration dans un discours ne doit pas être sans ornement mais qu’elle ne doit pas non plus se laisser entraîner (lasciuire) en imitant les excès des poètes (« imitatione poeticae licentiae »)144. Plus proche du poète, le commentaire de Remi d’Auxerre à Martianus Capella − commentaire que connaissait l’auteur des Gesta145 − affirme au début du livre I : un panégyrique est un genre où l’on loue les rois avec l’excès et la liberté de ton propres aux poètes »147. Pour le milieu dans lequel le poème a été composé et glosé, le genre panégyrique se définit d’abord par sa liberté dans le fond et dans la forme, liberté qu’il partage avec les autres textes en vers148. Il n’est donc pas étonnant que le poète se revendique de la muse de la comédie, Thalie. L’adjectif lasciuiosus et Thalie sont souvent associés en effet, soit que le terme
qualifie la muse elle-même, soit qu’il désigne les poèmes qu’elle inspire149. Le poème 664 de l’Anthologie latine en est probablement l’exemple le plus répandu. Ce texte, où chaque muse est décrite en un vers, nous présente « la comique Thalie qui se réjouit avec des paroles folâtres » (« comica lasciuo gaudet sermone Thalia », Anth. Lat. 664, 3).
Ce rapide tour d’horizon nous permet de constater que la définition du panégyrique donnée dans le manuscrit de Venise ─ définition qui provient sans doute de l’auteur du poème lui-même150 ─ est originale car elle ne reprend ni les connotations négatives du terme ni son acception large comme synonyme de laus. Cette singularité s’explique peut-être par l’influence sur le poète anonyme des panégyriques tardo-antiques de Claudien ou de Sidoine. Ces textes, qui se présentent eux aussi comme des panégyriques, étaient peu diffusés à l’époque mais certains parallèles textuels laissent penser que le poète a pu connaître une partie des carmina maiora de Claudien et peut-être certains panégyriques impériaux de Sidoine Apollinaire151 car, si les parallèles textuels sont minces avec les poèmes de Sidoine, une glose des Gesta (II, 82.3.) cite plusieurs vers du panégyrique de Majorien (Carm. V, 40-42 et 46). Je n’ai pas trouvé de citations de Sidoine dans les sources utilisées par les gloses des Gesta et l’hypothèse la plus simple pour le moment est d’imaginer que le poète a eu accès aux panégyriques du poète auvergnat. Cette connaissance des panégyriques tardo-antiques pourrait expliquer que le titre grec utilise le mot dans un sens bien plus technique que les usages contemporains.