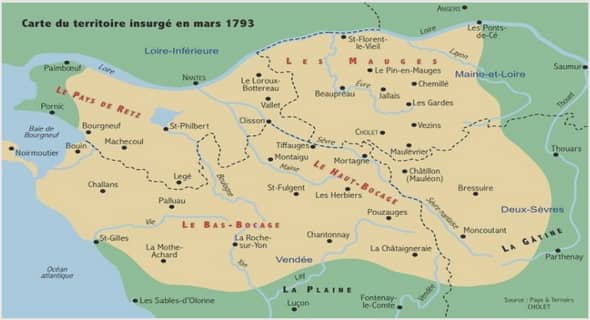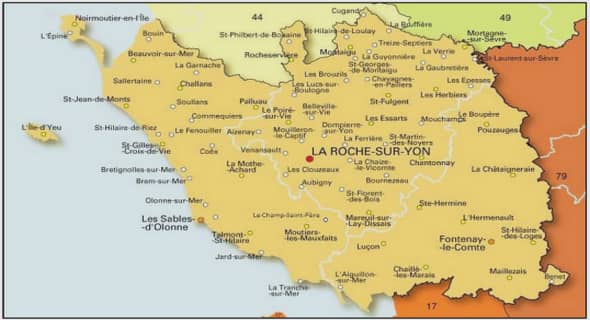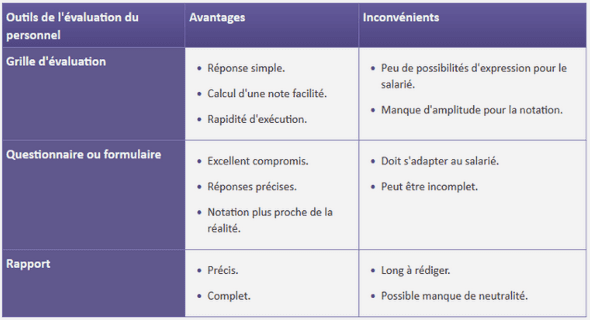DES HIÉRARCHIES DANS L’ILLÉGITIME
Utilisé par les bibliothécaires pour mettre à distance toute la littérature illégitime, l’argument du conformisme accompagne des pratiques différenciées : s’il justifie le rejet des « romans de gare » considérés comme indignes des bibliothèques, il sert à disqualifier la plupart des bestsellers, sans pour autant conduire à leur exclusion puisqu’ils sont massivement présents en bibliothèque. La bibliothécaire présentant les polars lors des réunions d’établissement des listes de propositions d’acquisitions présente ainsi un certain nombre des livres critiqués comme de la « grosse cavalerie américaine », expression qui lui sert à désigner un type de littérature construite sur des modèles récurrents à l’efficacité prouvée, une littérature sans grande surprise donc mais qui peut parfaitement tenir en haleine et remplir son rôle de divertissement :
Il y en a que je prends pour les lire, je suis partie pour les lire en entier et puis je m’aperçois rapidement que ça appartient à tel… à ce que j’appelle la grosse cavalerie américaine, hein, donc va marcher, c’est sûr, il n’y a pas de problème, mais ce n’est pas vraiment la peine d’aller jusqu’au bout : on sait comment c’est fabriqué, hein, c’est vraiment… il y a un processus de fabrication qui est mis en place par les éditeurs américains et auquel les auteurs ne peuvent pas ne pas se plier, donc ça veut dire trois rebondissements dans le livre à des pages absolument calibrées, donc on sait ce que c’est et puis on sait que ça fonctionne, que ça marche très bien, donc on sait que nous en France, Dieu merci, on n’a que la crème, hein… Le nombre de romans policiers publiés aux États-Unis est dix fois ce que nous recevons, donc on sait qu’on a le meilleur et que ça va forcément marcher, hein, c’est… c’est fait pour, c’est… c’est un produit fabriqué, hein, donc ce n’est pas la peine d’aller… de lire ces livres-là jusqu’au bout. » (bibliothécaire spécialisée dans le roman policier, entretien du 3 août 2007)
De tels « produits fabriqués » ne sont pas exclus des listes quand ils sont passés par le filtre de la traduction : ce sont des livres qui « vont marcher », qui « trouveront leur public » et qui sont « bons pour les statistiques. » Au sein même des genres les moins légitimes s’opèrent ainsi des hiérarchisations entre ce qui est tolérable (au nom de la demande et des statistiques) et qui ne l’est pas.
Cette admission partielle des genres les moins légitimes permet à une conservatrice de se défendre de l’accusation d’ostracisme, tout en pointant la moindre qualité de ce qu’elle qualifie de « littérature au mètre » : « Je veux dire, il n’y a pas d’ostracisme. Alors en général, quand on les voit, parce qu’il y en a quand même un certain nombre qui passent sur listes, la remarque de mon adjointe, c’est : il en faut ! Effectivement il en faut. Maintenant c’est quand même de la littérature au mètre. » (conservateur, femme, 53 ans, responsable d’une grande bibliothèque, entretien du 29 juillet 2010)
Quelle littérature sentimentale ?
Les littératures populaires sentimentales constituent un bon exemple de cette logique de différenciation et de compromis. Elles font en effet l’objet, de la part des bibliothécaires, de discours de mise à distance voire de rejet, mais font partiellement l’objet d’acquisitions massives, avec des différences marquées selon les auteurs et selon les éditeurs. Des auteurs comme Barbara Cartland et des éditeurs comme Harlequin, symboles du genre, suscitent une très forte réticence d’une grande majorité de bibliothécaires, tandis que la minorité qui les défend relève souvent du corps des conservateurs, c’est-à-dire des personnels les plus titrés et souvent les plus dotés en capital scolaire et culturel.
Une conservatrice, docteur en histoire, évoque ainsi le cas de romans de Barbara Cartland dont elle a fait l’acquisition contre l’avis de ses collègues qui refusaient non seulement de les acheter mais même de les cataloguer, comme s’ils étaient « pestiférés » :
Pas une littérature Barbara Cartland – moi j’en ai acheté quelques uns dans le treizième, mais je faisais sensation et mes collègues refusaient de les acheter, de les cataloguer…
Enfin, je veux dire, c’était… vous voyez… comment on dit… C’était fou, à ce point. Alors je les ai achetés. J’en ai acheté… C’était… ça coûtait rien, hein. J’en ai acheté six par an, je les cataloguais moi-même, ça me faisait rire parce qu’ils étaient comme pestiférés. Voilà, pestiférés. Et ça sortait évidemment très très bien ! Évidemment ! Alors ça c’est…
je l’ai vu un peu, mais c’est… je l’attribuerais au fait qu’énormément de bibliothécaires sont parfois issus de milieux socialement et culturellement modestes et donc ont fait leur propre parcours et réussite professionnelle par les études et donc ne souhaitent pas être…
C’est inconscient tout ça, mais… revenir dans cette littérature de entre guillemets bas étage qui sera le roman feuilleton, Barbara Cartland, etc. Halte là, on n’en veut pas. Sauf qu’on se coupe de toute une partie de la population. » (conservateur femme, doctorat d’histoire, responsable d’une grande bibliothèque, entretien du 28 mai 2008) La force des termes utilisés (« pestiférés », « halte là ») dit bien l’enjeu de cette exclusion en terme d’image.
Quelques rares bibliothèques du réseau parisien, implantées plutôt dans des quartiers populaires, ont fait le choix d’intégrer à leurs fonds les romans roses de Barbara Cartland, symboles du genre, avec un certain succès. Une recherche menée dans le catalogue des bibliothèques de la Ville de Paris639 fait apparaître 32 titres de cet auteur (qui en a produit plusieurs centaines), dont 30 sont effectivement présents dans le réseau, et, à deux exceptions près (romans présents dans deux grandes médiathèques) en un seul exemplaire (c’est-à-dire dans une seule des 58 bibliothèques du réseau) dont 2 à la Réserve centrale. Au moment de la recherche, les deux exemplaires de la Réserve centrale ne sont pas empruntés. On peut faire l’hypothèse que les lecteurs de ce type de littérature ne sont pas les premiers utilisateurs de la Réserve, qui demande de savoir à l’avance le titre qu’on veut, d’en faire la demande et de patienter quelques jours pour l’avoir – démarche qui ne semble pas coïncider avec celle de la lecture divertissante de la romance. Sur les 28 titres présents en bibliothèques, douze sont dans des bibliothèques des 18e et 20e arrondissements : six à Porte-Montmartre (18e arr.), quatre à Louise Michel (20e arr.), deux à Clignancourt (18e arr.). Un titre est disponible à la bibliothèque Château d’eau (10e arr.). Sept exemplaires sont présents dans les récentes médiathèques Marguerite Yourcenar (15e arr. ; 4 exemplaires) et Marguerite Duras (20e arr.) : il s’agit d’une édition en gros caractères dont la couverture présente un graphisme rafraîchi. Huit titres sont des acquisitions récentes de la bibliothèque Parmentier (11e arr.), signe d’une politique volontariste en la matière ; quatre de ces huit titres étaient empruntés au moment de l’observation640, avec trois dates de retour différentes de quelques jours, qui laissent supposer des usagers différents. Une date de retour identique pour deux des romans empruntés à Parmentier permet à l’inverse de postuler un usager unique emprunteur simultané de deux titres. Il en va de même pour les deux titres empruntés à la bibliothèque Porte-Montmartre, ce qui va dans le sens d’une pratique de lecture sérielle de ce genre de littérature641 (une observation menée en octobre 2010 faisait de même apparaître l’emprunt simultané des quatre titres de Barbara Cartland disponibles en gros caractères à la médiathèque Marguerite Yourcenar). Une telle pratique de lecture sérielle épuise vraisemblablement très vite le faible nombre de titres de l’auteur disponible dans chaque bibliothèque.
La collection « J’ai lu pour elle » (ou la précédente « Aventures & passions » qui en est désormais une sous-section) des éditions J’ai lu fait l’objet d’une exclusion semblable642 : alors que le catalogue de l’éditeur recense 277 titres dans cette catégorie643, seuls 31 titres sont présents dans le réseau des bibliothèques parisiennes, et ils le sont à un seul exemplaire (une fois à deux exemplaires), essentiellement à la médiathèque Marguerite Duras pour les titres postérieurs à 2005 et à la bibliothèque Louvre pour les titres plus anciens. Les quatre titres de la bibliothèque Port-Royal s’expliquent par la spécialité « science-fiction » de cet établissement. En dehors des 13 exemplaires de la nouvelle médiathèque Marguerite Duras, le réseau compte 17 exemplaires dans des bibliothèques accessibles au public, parmi lesquels 7 sont empruntés au moment de l’observation.
Autre symbole de la littérature sentimentale « bas de gamme », les éditions Harlequin ne font elles aussi l’objet que d’achats exceptionnels, dont une très faible part relève de cette littérature sentimentale bas de gamme à proprement parler. Une requête par éditeur dans le catalogue commun des bibliothèques parisiennes fait apparaître 63 titres présents, mais chaque titre n’est présent qu’à un exemplaire dans l’ensemble du réseau644. Comme symbole d’une position inférieure dans la hiérarchie des légitimités, c’est la maison d’édition elle-même qui fait l’objet d’un ostracisme de la part des bibliothécaires, au point de faire rejeter un livre d’un auteur suivi quand il publie chez d’autres éditeurs.
La responsable d’une grande bibliothèque rapporte un épisode témoignant de l’attitude de rejet immédiat et complet (désignée par les expressions de « branle-bas de combat dans Landerneau » et de « levée de boucliers »), suscitée par la seule étiquette Harlequin » chez ses collègues bibliothécaires et conservateurs : « Il y a eu un phénomène assez drôle sur la dernière liste. […] Ça a été le branle-bas de combat dans Landerneau parce qu’il y avait un livre de chez Harlequin ! […] Je crois que c’était un Martha Grimes, qu’on prend d’habitude, mais là c’était un Harlequin ! Alors, c’est drôle parce qu’au SDE, lever de boucliers : [ton hargneux] “On ne va pas faire passer un Harlequin sur liste !” Et puis même chose ici [dans la bibliothèque]. Je leur ai dit : “Écoutez, l’étiquette d’accord, mais si on prend l’auteur d’habitude, je trouve ça un peu limité de ne pas le prendre uniquement parce qu’il est dans…” Mais c’est drôle, hein ? Parce qu’il a fallu que je leur force ma main ! Alors est-ce que c’était un Martha Grimes d’une autre veine que ceux qu’on connaît ? Ce qu’on en avait comme renseignements ne permettait pas de le dire. Ça m’a fait rire, quand même. » (conservateur, femme, 53 ans, responsable d’une grande bibliothèque au fond plutôt intellectuel, entretien du 29 juillet 2010). C’est significativement la responsable de la bibliothèque, qui appartient au corps des conservateurs, le plus élevé dans la hiérarchie, qui tient le discours le plus relativiste en matière de hiérarchie de légitimités.
Parmi les 63 titres des éditions Harlequin présents dans le réseau parisien, les différentes collections (correspondant à différents sous-genres) sont inégalement présentes. Les romans de fantasy et les romans historiques sont pour ainsi dire absents (respectivement 1 et 2 exemplaires). Les romans sentimentaux « à l’eau de rose » (collection « Jade »), auxquels l’éditeur est traditionnellement identifié, ne représentent que 10 exemplaires dans le réseau (dont 50% sont empruntés au moment de l’observation), répartis dans 5 bibliothèques et proportionnellement très présents à la bibliothèque Clignancourt (qui possède 60% des exemplaires). En revanche deux collections sont beaucoup plus présentes dans le réseau : la collection « Red dress ink », qui correspond aux romances urbaines de « chick lit », est présente avec 26 exemplaires (dont 42% d’empruntés) et la collection « Mira » (et assimilés), qui regroupe les romans policiers, est présente avec également 26 exemplaires (dont 31% d’empruntés au moment de l’observation). Toutefois, malgré un même nombre global d’exemplaires, la collection de polar est présente de manière plus générale (dans 16 bibliothèques) que celle de « chick lit » (présente dans 7 bibliothèques seulement), signe d’un différentiel de légitimité des deux genres : la « chick lit » bénéficie d’une légitimité un peu supérieure à celle du roman sentimental traditionnel mais moindre que celle du polar, qui a conquis ses lettres de noblesse645.
De la quasi-absence des romans de Barbara Cartland, de la collection « J’ai lu pour elle » et des éditions Harlequin, on ne saurait toutefois déduire l’absence générale de la littérature sentimentale. Une enquête menée sur la présence des romans de Danielle Steel (édités aux Presses de la Cité) dans le catalogue des bibliothèques de la Ville de Paris646 révèle ainsi que cette auteure, à la différence de Barbara Cartland, est très suivie, d’année en année et de bibliothèque en bibliothèque, par les bibliothécaires et les lecteurs. Les cinq derniers romans disponibles en français sont ainsi présents dans la quasi-totalité des bibliothèques du réseau et font l’objet d’emprunts massifs, d’autant plus importants que le livre est récent (pour le dernier roman, 69 % des exemplaires sont empruntés ; pour l’avant-dernier, 59 % ; pour l’antépénultième, 55 % ; pour le précédent, 47 % ; pour celui d’avant, 41 %).
Les romans de Danielle Steel font même l’objet d’achats dans des éditions visant des publics spécifiques : livres en gros caractères (éditions Feryane, disponibles dans de nombreuses bibliothèques du réseau), enregistrements sur CD (2 titres647, respectivement dans 10 et 17 bibliothèques), livres en version originale anglaise, traductions en vietnamien (6 titres à la bibliothèque Melville, 13e arrondissement) et en arabe (5 titres à la bibliothèque Couronnes, 18e arrondissement).