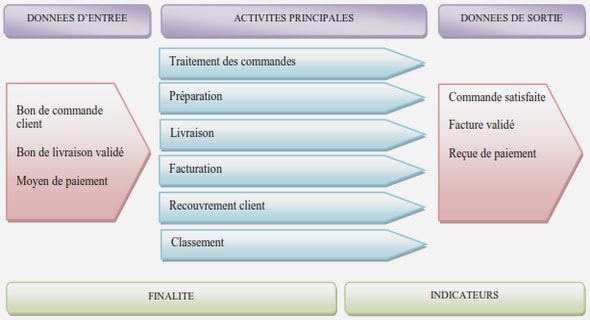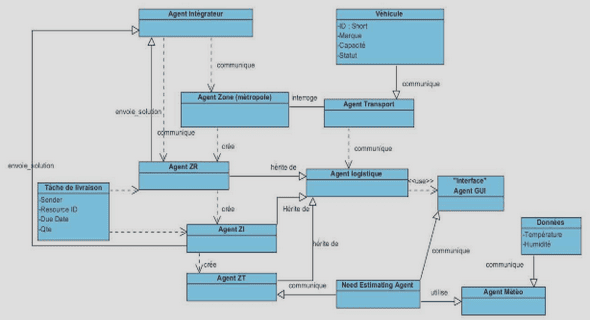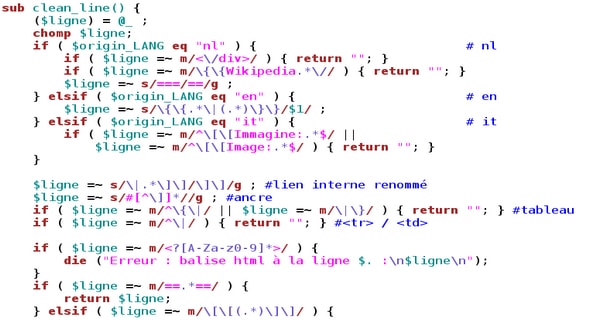Quatre lignées d’interventions préexistantes
Nous pourrions, pour présenter les lignées d’action préexistantes à l’accueil en résidence comme forme identifiée, paraphraser A. Abbott dans son article « Things of boundaries » à propos du travail social : « En 1870, le travail social n’existait pas »45 (Abbott, 2001 : 266). Au début des années quatre-vingt, l’accueil en résidence n’existe pas dans le domaine des arts plastiques. Certaines associations accueillent des artistes pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, leur fournissant des moyens matériels et un « personnel de renfort » (Becker, 1989). Mais cette activité n’est pas encore qualifiée de « résidence »46.
En revanche, quatre grands types d’activités, ayant pour vocation de prendre en charge le travail de l’artiste, peuvent être identifiés, au tournant des années soixante-dix et quatre-vingt, au niveau local ou national :
le travail d’animation
l’attribution d’ateliers
les bourses
les commandes
Ces quatre types d’activités constituent les « lignées » (Abbott, 2001) d’interventions disponibles lorsque la forme résidence va émerger et se constituer, à la fin des années quatre-vingt. Nous les présentons succinctement car l’accueil en résidence va se définir relativement à ces formes préexistantes qui lui serviront de références. Nous montrerons en effet, dans la prochaine partie, qu’au cours du processus d’institution des résidences, les lignées qui servent de point d’appui vont se déplacer, du binôme bourse-atelier, au binôme commande- animation.
« In 1870, social work did not exist… »
Au contraire des pays anglophones (États-Unis, Royaume-Uni, Australie) où des programmes d’Artist-In-Residence existent déjà. Notons toutefois, que dans quelques lieux, comme les écoles d’art d’Aix en Provence ou de Nice, on trouve déjà la trace de la notion « d’artiste résidents » (c’est le cas aussi au CIRVA à Marseille).
L’artiste animateur, tentatives de conciliation entre le travail de vocation et le second métier.
Dès les années soixante-dix, des expériences existent en régions qui prennent en charge et financent le travail de l’artiste, mais dans une conception élargie de ses compétences, entretenant une frontière floue entre le « métier de vocation » et le « second métier » :
La frontière entre l’animation comme activité secondaire ou principale n’est pas toujours évidente et la période d’absence d’œuvres a favorisé la substitution de l’animateur au créateur, de même qu’elle a autorisé l’extension, apparemment sans limite, du champ d’activité auquel est conféré ce label artistique » (Moulin, 1995 : 111).
Parmi les expériences associant le soutien au travail de l’artiste et des missions d’animation, on peut citer l’exemple de la Chartreuse de Villeneuve les Avignon. L’association « Centre international de recherche, de création et d’animation » est créée en juillet 1973 pour définir le projet culturel de la Chartreuse, sous l’impulsion de Jacques Duhamel, alors ministre des Affaires culturelles, secondé par Jacques Rigaud. Un journaliste, Bernard Tournois, est chargé de réaliser une étude sur la réutilisation du bâtiment. Son rapport, rendu en 1974 préconise les orientations culturelles du lieu. En mai 1977, un dossier spécial est consacré à la Chartreuse dans le bulletin d’information du ministère de la Culture et de l’Environnement (Tournois, 1977). Bernard Tournois y explique le principe qui a présidé à la définition des orientations de la structure culturelle. Tandis qu’il a écarté un projet de « Parador », réutilisant les cellules de chartreux pour une hôtellerie de luxe (des plans d’architecture avaient été conçus dans cette direction), une seconde option était de « faire de la Chartreuse une “villa Médicis” à la française » :
Je pense que la Villa Médicis telle qu’elle a été conçue répondait à une idée du XIXe siècle qui, aujourd’hui n’a plus de sens, notamment par le mode de sélection et la mise en cocon du créateur. Je veux faire ici autre chose : protéger le travail du créateur, lui donner des outils et des facilités certes, mais lui demander en contrepartie un travail tourné vers l’extérieur »47 (Tournois, 1977 : 24).
En ce qui concerne le principe de séjour des équipes de création, il faut insister sur le fait que le cahier des charges proposé et adopté, prévoit leur accueil sous réserve qu’elles consacrent une partie de leur temps à des ateliers de formation. C’est là, la philosophie profonde de l’aventure : réintégrer les créateurs dans le monde qui les entoure et non les mettre à l’écart dans une coquille complètement protégée. Tout en leur laissant une totale liberté d’action, nous leur demandons en contrepartie, car il y a toujours une contrepartie dans toute entreprise, d’animer des activités d’ateliers dirigés soit vers les enfants et le milieu scolaire, soit vers le secteur des adultes dans le cadre de la formation permanente, soit vers l’animation de groupes de personnes âgées. » (Tournois, 1977 : 23)
Deux autres exemples de cette lignée peuvent être repérés dans le rapport intitulé Pour une nouvelle condition de l’artiste et rendu en 1978 au ministère de la Culture et de la Communication. Ce rapport a été dirigé par Jean Cahen-Salvador, Conseiller d’État, et compte Michel Troche parmi les coauteurs (Cahen-Salvador, 1978). De longs développements concernent la politique qui doit être menée en terme de construction ou d’aménagement d’ateliers, de « cités d’artistes », et en termes d’adaptation des mesures fiscales (loyers, diminution des charges, etc.), visant avant tout à assurer une politique redistributive auprès d’une population large d’artistes. Mais c’est au chapitre de la rétribution des artistes que des formules de rémunération du travail de l’artiste sont regardées favorablement » par le groupe de travail.
Tout d’abord, les rédacteurs du rapport prennent acte des limites du seul mode de rétribution valant alors, uniquement fondé sur « l’aliénation de l’œuvre produite sur un marché essentiellement constitué par le système des galeries » (Cahen-Salvaldor, 1978 : 35). Or les auteurs considèrent que le développement de nouveaux circuits de diffusion de l’art qui « n’ont pas pour finalité la vente mais la mise en contact des œuvres et des publics de plus en plus vastes, implique une transformation profonde du mode de rétribution du travail artistique » (Cahen-Salvaldor, 1978 : 36). Refusant le principe selon lequel l’artiste devrait se sentir « honoré » d’une exposition, sans que cela ne justifie de rétribution, les auteurs décrivent un fonctionnement original justifiant la rémunération du travail par son lien avec un contexte local.
Des manifestations ont lieu où des œuvres inédites sont conçues en fonction directe avec une situation locale ou particulière et, par voie de conséquence, avec un public, celui qui fréquente telle galerie ou telle Maison de la Culture, ou même la population générale d’un territoire donné. En échange, les artistes créateurs bénéficient d’honoraires » (Cahen-Salvaldor, 1978 : 38).
Le CRACAP, Centre de recherche, d’animation et de création pour les Arts plastiques, installé au Creusot, est cité à titre d’exemplarité.
Le second exemple, tiré du même rapport, concerne un programme artistique développé en Mayenne, avec l’aide du ministère de l’Éducation. Ce programme invite des artistes plasticiens à de courts séjours, en vue de « rencontres » avec des enfants.
Arrivés sur place, les enfants sont mis en contact avec les artistes invités par l’association qui leur demande non pas de prodiguer un enseignement au sens classique du terme mais tout simplement d’établir des relations très détendues avec les jeunes, de montrer leur propre travail, d’expliquer le « comment » et le pourquoi » de leurs réalisations afin de déboucher tout naturellement sur la notion même de création artistique » (Cahen-Salvaldor, 1978 : 48).
On peut observer l’insistance avec laquelle les auteurs tentent de distinguer cette rencontre », d’une activité « classique » d’enseignement, en gommant les frontières entre activité de vocation et second métier. Tout semble mis en œuvre par ces auteurs pour diminuer l’idée de contrainte de cette « contrepartie ».
travers ces quelques exemples, on voit se dessiner une logique d’action de l’État qui va dans le sens d’une contrepartie socioculturelle (sous la forme d’actions de médiations variées) au soutien matériel apporté à des artistes. Nous verrons que cette logique a progressivement constitué une lignée d’intervention mobilisée dans la mise en forme de la catégorie résidence.
La politique des ateliers
La politique des ateliers d’artistes remonte presque à la création du ministère des Affaires culturelles, avec l’inscription au budget de 1963 d’une somme pour la création d’ateliers. Dans une logique d’État providence, il s’agit de :
donner aux artistes la possibilité de travailler sans être gênés par des contraintes matérielles. Il n’y a pas de conditions de fourniture d’œuvres, l’artiste logé n’ayant pas l’obligation de livrer des travaux aux collections nationales » (Cascaro, 1999 : 656).
Mais c’est avec le ministère Lang en 1981, que cette politique va se développer fortement, reconnaissant le déficit d’équipements, notamment à Paris, et reprenant ainsi à son compte ce qui constituait l’une des principales revendications des artistes ayant participé aux États généraux des arts plastiques, à Créteil (Chalumeau, 1985, Monnier, 1995).
Nous basons l’analyse qui suit sur le « rapport Troche », que l’on peut considérer comme la « boite à outils » de la politique des arts plastiques du ministère Lang. Ce rapport a en effet largement inspiré les « 72 mesures pour les arts plastiques » annoncées par le ministre dans son discours de Lille le 20 juin 1982. Le rapport de la commission présidée par Michel Troche donne une image assez précise de l’absence d’orientation programmatique de cette politique des ateliers, cette aide étant à comprendre avant tout comme une intervention sociale auprès des artistes (Troche, 1982). Dès le premier chapitre, « Vie Professionnelle », une grande partie des mesures proposées est consacrée aux ateliers. De nombreux points concernent diverses mesures d’urgence, par rapport à des situations spécifiques d’expulsion d’artistes, de démolition, de mauvais entretiens d’immeubles ou de « cités d’artistes », expression qui n’est aujourd’hui plus employée mais qui, en 1981, y compris dans les comptes rendus des États généraux des Arts plastiques, se réfère à un modèle reconnu d’occupation collective de bâtiments par des artistes (Compte rendu États Généraux, 1981). Vient ensuite la proposition d’une politique conséquente de construction d’ateliers », essentiellement pour Paris mais aussi pour les grandes villes de la Région, par anticipation des effets (pervers) de la politique volontariste de l’État : « Les perspectives de décentralisation devraient être la source de besoins de même nature dans les régions », (Troche, 1982 : 36). Puis sont évoqués tous les cas où les artistes sont installés « dans des locaux initialement prévus à d’autres fins (…) locaux artisanaux, industriels ou commerciaux », (Troche, 1982 : 36) qu’il s’agisse de les subventionner ou d’adapter le régime immobilier à leur activité.
L’ambition des différentes mesures évoquées réside dans leur longue durée. Tous ces ateliers, qu’ils soient considérés pour un usage individuel ou collectif, ont vocation à être attribués aux artistes de façon pérenne, selon un bail qu’il s’agirait d’adapter. La légitimité du soutien de l’État n’est pas assortie de contraintes ou de contreparties. Elle n’est pas fondée, par exemple, sur une logique de programmation, qui exigerait un renouvellement, ou une adaptation du temps d’accueil avec la durée nécessaire à la réalisation d’une « production ». Le lieu est clairement distinct d’une orientation artistique décidée par un organe décisionnaire. Les seules réflexions en termes d’organisation de ces lieux concernent « les normes générales de construction », qui nécessiteraient « la consultation des artistes et de leurs organisations » (Troche, 1982 : 35), et la gestion des bâtiments dans le cas d’un groupe d’artiste : « la création contemporaine exige la réalisation de grands ateliers collectifs gérés par des associations et des coopératives d’artistes », (Troche, 1982 : 36). Ces deux aspects n’articulent donc pas la logique des ateliers avec celle d’une structure culturelle qui assurerait une programmation artistique ou une organisation intégrée des ressources. Ainsi, D. Cascaro conclut-il à propos de la politique d’ateliers qu’ils ne constituent pas un outil important de la politique de la DAP :
Ils ne servent qu’eux-mêmes. Les ateliers ne servent pas à développer une politique d’aménagement du territoire, ils ne cherchent pas à situer les artistes dans la cité, ils ne sont pas construits en synergie avec d’autres institutions » (Cascaro, 1999 : 654).
Les bourses
La rémunération du travail de création consistant à attribuer aux artistes une bourse de recherche trouve sa première légitimation en 1881 lorsque le Conseil Supérieur des Beaux-arts reprend, en le modifiant, le principe du Prix du Salon, et propose non pas à des artistes de parfaire leur formation à Rome, mais de voyager pendant un an en dehors du territoire national, sans contrainte de rendu ou de retour. A. Bonnet montre la façon dont ces bourses révèlent un nouveau cadre de relation entre l’État et les artistes :
Si l’Académie avait des pensionnés, l’État élevait des nomades. Il s’agit là de deux conceptions résolument opposées à la fois de la formation des artistes, mais, au-delà, de ce que doit être un artiste et de ce à quoi doivent servir les œuvres. La liberté accordée aux boursiers dans le choix du voyage, dans l’indépendance envers l’État, peut être mise en parallèle avec les théories économiques visant à apporter un soutien aux producteurs sans les contraindre par ailleurs. » (Bonnet, 2008)
L’ambiguïté ou l’inconsistance programmatique de cette bourse qui, tout en évoluant, ne disparaîtra qu’en 1966, donne prise aux mêmes critiques qui seront faites au système de bourses notablement augmenté à partir de 1981 :
Comment évaluer l’attribution des bourses aux artistes ? S’il est possible de contrôler la réalisation du projet présenté dans le dossier sélectionné (l’œuvre achevée, le voyage effectué, ou bien encore la formation transmise), il paraît en revanche plus difficile de savoir qu’il l’a été de façon enrichissante pour l’artiste. (…) Le Conseil de l’Europe a évalué la politique culturelle de la France en 1988 et considéré que l’aide aux créateurs est certainement l’aspect de la politique culturelle le plus difficile à évaluer » (Cascaro, 1999 : 488).
Pourtant, c’est dans un esprit proche de celui du Conseil Supérieur des Beaux-arts, que le rapport Troche fixe les ambitions des programmes de bourses. Le rapport distingue les bourses sur le territoire national et les bourses définies sur une échelle internationale, qui ont en commun d’opérer sur une logique de soutien individualisé, à des artistes placés en situation d’autonomie.
l’échelle du territoire français, le premier dispositif concerne les « bourses de recherche », dont il est rappelé qu’elles « ne relèvent pas de l’aide sociale ». Leur objectif est donc à interpréter dans le cadre de la politique volontariste de soutien à l’innovation soutenant sa propre justification : « elles sont une incitation à la création, et par leur objectif, contribuent à l’enrichissement de la vie culturelle » (Troche, 1982 : 41). Il est d’ailleurs rappelé que l’efficacité de ces bourses n’est à considérer que dans la perspective du parcours artistique de chaque artiste, sans être rapportée à un cadre d’évaluation plus large : « elles ont l’intérêt de permettre aux artistes de diversifier leurs expériences ». La question de la difficulté d’évaluation du dispositif ne semble pas constituer un obstacle pour la commission, qui préconise d’augmenter le nombre de ces bourses de recherche.