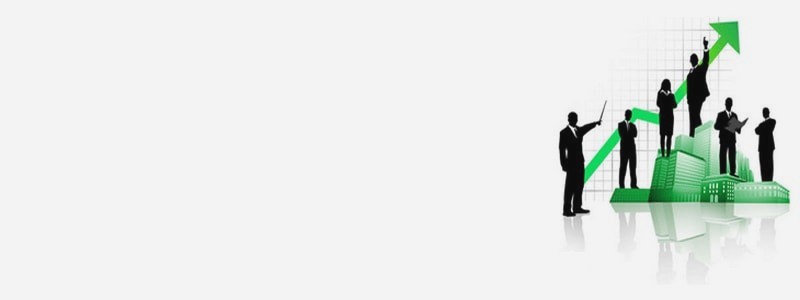Enjeux soulevés par la démocratie participative
La démocratie participative consiste essentiellement à rechercher un équilibre entre gouvernés et gouvernants afin qu’il puisse exister cette attitude d’écoute de la part de ce dernier .
Recherche d’équilibre : La démocratie participative redonne au citoyen, n’importe quel citoyen, une place centrale dans le processus démocratique. En effet, la démocratie participative inaugure l’idée que le bien commun ne se réalise que dans la contribution du peuple à celui-ci. Sans remettre en cause le savoir politique des élus ni les connaissances des experts, cette nouvelle forme de partage du pouvoir nécessite en amont de sa réalisation la reconnaissance d’une expertise citoyenne légitime. C’est là, pour Jacques Roncière, «la puissance subversive toujours neuve et toujours menacée de l’idée démocratique»:l’établissement d’un pouvoir fondé ni sur la naissance, ni sur l’argent, ni sur le savoir. La reconnaissance du « pouvoir des n’importe qui », « pouvoir de ceux qui n’ont pas plus de titre à gouverner qu’à être gouvernés ».Et cela afin d’éviter cette peur qui réfugie, au sein des démocraties, la prééminence de la légitimité des sachants, gouvernants ou experts, ainsi que la contestation de la légitimité populaire, stigmatisée comme « populiste » lorsqu’elle s’oppose à la logique élitiste dominante. Ici, l’on fait donc appel à ce « bon sens », qui doit être rigoureusement distingué du « sens commun », à la formation d’une opinion éclairée, sur la base d’une information suffisante, et fonde en politique la notion même de démocratie : la reconnaissance pour tous les citoyens d’une égale dignité de principe.
Attitude d’écoute : Plus encore, la démocratie participative permet à de nouveaux acteurs de la scène politique locale de s’illustrer davantage .Parmi ceux-ci figurent le citoyen qui se retrouve dans l’éventail des mécanismes de participation décrits plus hauts. Celui-ci a dorénavant les moyens de faire connaître son opinion et d’influencer la prise de décision des élus d’une manière plus directe et formelle. Des instances spécifiques sont ainsi créées pour permettre l’exercice de cette nouvelle forme de citoyenneté : conseils de quartier, comité de citoyens, associations de résidents, etc. La démocratie participative rompt donc avec la conception que seulement les élus détiennent une légitimité politique ou d’action.
Pratiques territorialisées de la démocratie participative
Pratique territorialisée dans le sens que, dans la plupart des Etats, c’est surtout dans les collectivités territoriales telles que la commune et les « Fokontany »,que l’ on rencontre le plus souvent cette forme de démocratie. Ce qui est à l’origine de l’appellation même de «démocratie locale participative». Emblématique de ce phénomène est la pratique des réunions publiques de consultation, essentiellement au niveau des «Fokontany» permet de créer des lieux de concertation et de faire des collectes d’avis. Cette forme de démocratie se mêle souvent à la concertation des territoires et un certain flou entoure la place du «citoyen» dans ces grand-messes d’acteurs territoriaux. Cette pratique est souvent utilisée lorsque les communes, les « Fokontany » et même parfois, les Régions, par exemple, souhaitent solliciter le citoyen sur des sujets transversaux qui touchent profondément la vie de la localité concernée.
C’est ainsi que l’on note la tenue de plus en plus fréquente d’ateliers citoyens mis en place dans les Régions françaises ou encore la diffusion de l’utilisation de l’internet pour créer un espace d’échanges généralistes. On note en écho à cette démarche une hésitation constante dans l’emploi du vocable de «démocratie participative» qui est souvent remplacé par « relation aux citoyens ».
Gestion politique de la démocratie locale participative
Evoquer l’engagement des « régions » dans la participation citoyenne, c’est en réalité faire l’état de l’engagement d’une poignée de nommés régionaux accompagnés par des administrations configurées de manière très disparates. La démocratie participative reste en effet le fait d’un petit groupe de personnes nommées ou élues comme les Maires, les chefs « Fokontany », etc., ayant investi cette thématique comme mesure phare de leur mandat (Poitou Charente, Pays de la Loire).Les initiatives en matière de démocratie participative relève souvent d’entreprises « individuelles » d’un membre ou d’une coalition de membres de l’exécutif régional. Ces élus ont pour caractéristique d’investir la démocratie participative par le biais de leur mandat régional. Qu’est-ce à dire ? Qu’une fraction d’individus se saisit d’un mandat régional comme d’une scène politique suffisamment crédible pour être investie de sens démocratique.Le stigmate de ce phénomène reste l’apparition en 2004,en France, de vice présidents spécifiquement en charge de ces questions de démocratie participative au sein de plusieurs régions françaises.
Les risques liés à la participation citoyenne
Les adversaires de la démocratie directe invoquent trois arguments majeurs. Le premier est que l’initiative populaire représente une surcharge de l’agenda des autorités publiques causée par un excès de demandes et de revendications, ce qui complique et alourdit la gouvernabilité. Le second est la prolifération des blocages par le droit de veto populaire, ce qui peut provoquer sinon un immobilisme et une paralysie décisionnelle, tout au moins un ralentissement significatif du processus décisionnel engendrant ainsi des conséquences allant à l’encontre du bien commun. Enfin, le troisième argument massue invoqué constamment par les partisans du statu quo est la peur des dérapages démagogiques et populistes qui pourraient conduire à des droits humains. C’est la peur des excès du pouvoir du peuple, de la dictature de la majorité silencieuse et ignorante au détriment de différentes minorités ; c’est la peur de se voir imposer contre son gré des choix qui heurtent principalement nos valeurs morales et nos croyances religieuses ; c’est aussi la crainte de voir l’opinion publique manipulée et trompée à la faveur d’un déséquilibre des options en jeu à cause des règles de formulation de questions de financement inéquitable voire carrément inexistants.
Table des matières
INTRODUCTION
Ière Partie : DE LA DEMOCRATIE SANS LE PEUPLE A LA DEMOCRATIE AVEC LE PEUPLE
HISTORIQUE (préliminaire)
CHAPITRE I : LES FONDEMENTS DE LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
Section I : les références théoriques
§1: Conditions de fonctionnement
Les principes démocratiques :
1) Les libertés et droits fondamentaux
2) Élections
3) L’Etat de doit
4) La séparation des pouvoirs
§2 : Caractéristiques : débats et décisions
Section II : Enjeux soulevés par la démocratie participative
§1 : Recherche d’équilibre (entre gouvernants et gouvernés
§2 : Attitude d’écoute
CHAPITRE II : CONCRETISATION DE LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
(La démocratie locale participative)
Section I : Constats
§1 : Les pratiques « territorialisées » de La démocratie participative
§2 : Aspects de la participation citoyenne
A/Expériences locales de la participation
1 : Pratiques communautaires
2 : gestion politique de la démocratie locale participative
B/ soutien à la gouvernance locale
Section II : les verrous principaux à une délibération généralisée et les axes pour une démocratie de discussion
§1 : Les verrous
A/ absence d’autonomie du conseil et confusion des pouvoirs
B/ le cadre institutionnel
§2 : Les axes de discussion
A/Lisibilité du gouvernement local
B/l’émergence obligatoire d’un cadre participatif
IIème PARTIE : LES LIMITES DE L’EFFECTIVITE DE L’APPLICATION DE LA DEMOCRATIE LOCALE PARTICIPATIVE
CHAPITRE I : OBSTACLES A LA BONNE MARCHE DE LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
Section I : Le problème de la représentativité
§1 : Le non-choix électoral
§2 : La confiscation technocratique
A/ gestion contre intérêt général
B/ présidentialisme associatif
Section II : l’illusion de la participation citoyenne
§1 : Décrochage citoyen
§2 : Manque de civisme et nécessité d’apprentissage
§3 : Absence d’éthique sociale partagée
CHAPITRE II : PROCESSUS DE MAINTIEN ET DE CONSOLIDATION DE LA DEMOCRATIE LOCALE PARTICIPATIVE
Section I : Elaboration de nouvelles formes de participation
§1 : Méthodes délibératives
§2 : Communication authentique élargie
§3 : Démocratie directe et référendum
Section II: Les risques liés à la participation citoyenne Et les perspectives d’avenir
§1 : Les problèmes liés à la participation citoyenne
§2 : Les perspectives élaborées pour aboutir à un « juste équilibre »
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE