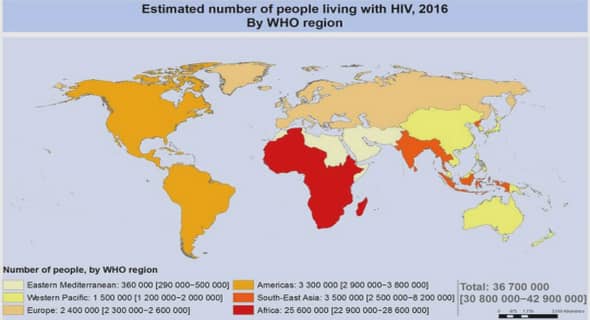Études antérieures
Pour situer nos recherches, nous avons eu recours à plusieurs études antérieures, dont un peu plus de la moitié était écrite en français. Peut-être dû en partie au fait que Taïa était le premier auteur marocain à se déclarer ouvertement homosexuel, ce qui a attiré une attention considérable dans les médias, ainsi qu’au fait que plusieurs de ses ouvrages ont été traduits en différentes langues, nous avons également trouvé de nombreux articles scientifiques écrits en anglais, que nous résumerons ici conjointement avec ceux écrits en français, pour éviter l’accusation d’avoir ignoré ces premiers.
Alessandro Badin a écrit un article dans lequel il avance que l’écriture d’Abdellah Taïa et de Rachid O. met en question la virilité maghrébine tout en proposant un nouveau modèle de masculinité (2016 : 119), ce qui nous a motivé en premier lieu à consacrer une partie de notre approche théorique à la thématique des masculinités maghrébines. Khalid Zekri a également écrit sur la « déconstruction de la masculinité » chez Taïa et O. dans L’Armée du salut et L’Enfant ébloui (2011 : 49), une thématique qu’il reprend dans d’autres article publiés plus récemment (2016 : 45-47 ; 2017 : 26-29).
Contrairement à Zekri, Jean Zaganiaris met l’accent sur les « figures protéiformes de l’amant » dans la littérature maghrébine, ainsi que sur leur nature activiste (2013 : 368, 378). Tina Dransfeldt Christensen se concentre également sur le côté activiste de l’œuvre de Taïa (2017), ainsi que sur le fait que son choix d’écrire le « je » [writing the self] peut être intréprété comme un acte de résistance en soi (2016 : 873-874). Pourtant, il est discutable que Rachid O. ait les mêmes intentions activistes que Taïa, puisque ce dernier a été le seul des deux à s’engager directement dans le débat public à travers des médias, ce que Zaganiaris souligne lui-même dans un autre article publié deux années plus tard (2015 : 33, 35). De plus, non seulement Zaganiaris semble confondre la relation entre le protagoniste dans L’Enfant ébloui et son professeur avec celle que ce premier entretient avec le Français Antoine, il ne distingue pas entre les relations pédérastes et pédophiles (2013 : 378).
Dans une collection d’articles qu’elle a également éditée, Claudia Gronemann a écrit sur la manière dont Abdellah Taïa a créé une nouvelle version de la masculinité dans son roman Une mélancolie arabe, en empruntant la notion de mélancolie qui, selon elle, a été longtemps établie dans la pensée européenne (2018 : 173-194), ce qui reflète l’influence du contexte postcolonial, dans lequel les idées, les traditions et les formes littéraires s’entremêlent. En 2016, Nadra Hebouche a publié un article dans lequel elle soutient que l’écriture d’Abdellah Taïa dans L’Armée du salut « reste inexorablement contaminé par et fondé sur une dialectique orientaliste et (néo)coloniale », qui est à la fois favorable et défavorable à la révolution littéraire de l’autofiction coming-out maghrébine que son œuvre est censée représenter (2016 : 143), un constat qui souligne encore une fois l’importance des enjeux postcoloniaux pour les auteurs nés dans les anciennes colonies et immigrés en France, qui écrivent en premier lieu pour le marché littéraire français. Mehammed Amadeus Mack (2014), quant à lui, s’est penché sur le rôle qu’a joué la collaboration traditionnelle entre écrivains français et informants maghrébins dans la création d’une littérature sur la sexualité masculine maghrébine destinée aux lecteurs occidentaux, ce qui nous a également rappelé de prendre en considération les contraintes du marché littéraire français contemporain. Selon lui, cette collaboration, qui était d’abord caracterisée par un esprit de coopération, s’est métamorphosée plus récemment en expressions de ressentiment (2014 : 341).
Plusieurs chercheurs ont également travaillé sur la capacité de l’écriture postcoloniale de traverser les langues et les frontières. Dans un article publié en 2018, Camilla Erichsen Skalle et Anje Müller Gjesdal ont examiné la relation entre les théories de Bakhtin sur l’hétéroglossie et les représentations des masculinités dans un contexte transfrontalier méditerranéan. Selon elles, le simple fait de changer de langue a une incidence fondamentale sur le développement de l’identité masculine (2018 : 158). Joseph Pomp, quant à lui, soutient que le langage littéraire de Taïa fait montre d’un engagement de « traduire » les expériences, pour qu’elles puissent traverser non seulement les langues, mais aussi les différents types de médias et les frontières (2018 : 488). Il suggère également que Taïa a délibérément choisi d’écrire dans un langage simple pour rendre son œuvre plus accessible aux lecteurs n’ayant pas le français comme langue maternelle (Pomp 2018 : 487), une notion que Taïa lui-même semble contredire dans une entrevue menée par Alberto Fernández Carbajal l’année précédente, dans laquelle Taïa a déclaré qu’il aime simplement donner l’impression que son écriture est moins « française » (Fernández Carbajal 2017 : 499).
Gibson Ncube a rédigé une thèse de doctorat à l’Université de Stellenbosch en Afrique du Sud, ainsi que plusieurs articles, en français et en anglais, sur les ouvrages autobiographiques de Rachid O. et d’Abdellah Taïa, se concentrant essentiellement sur la thématique de la « marginalité » sexuelle, identitaire et littéraire de la sexualité minoritaire » (2013, 2014a, 2014b, 2014c, 2018). Selon lui, l’instabilité provoquée par le déplacement transfrontalier et interculturel de leurs protagonistes joue un rôle essentiel dans la construction de leurs identités respectives (2014c : 131), un constat qui nous semble assez évident. William Spurlin a également écrit sur la manière dont l’œuvre des auteurs comme Rachid O. et Abdellah Taïa peut créer de nouveaux liens entre les gens ayant une sexualité minoritaire, qui vont au-delà des frontières nationales ou régionales du système d’Etat-nation (2016 : 118). Quant à Alexandru Matei, il met l’accent sur la double « nature » du corps et de l’esprit en Occident, qui, selon lui, a permis au protagoniste de L’Armée du salut de devenir homosexuel, tout en gardant son identité marocaine, ce qui aurait été impossible au Maroc, où cette liberté d’une double nature n’existe pas (2014 : 872). Pourtant, il est très discutable si une identité homosexuelle, essentialiste et universelle peut vraiment traverser toutes les frontières culturelles ainsi que, si le désir de « sauver » les natifs des anciennes colonies ayant une sexualité minoritaire en leur imposant une telle identité ne constitue pas une nouvelle forme de colonisation.
Ismael Navarro Solera a écrit sur la transgression (poétique et politique) et le corps dans les ouvrages autobiographiques d’Abdellah Taïa, concluant que l’auteur utilise « des stratégies de décatégorisation pour se débarrasser d’une identité assignée par les autres », tout en reformulant son propre corps et en créant « une nouvelle image de l’homme […] et surtout de l’éconciation autofictionnelle » (2017 : 140), une notion qui nous a incité à consacrer l’autre axe de notre approche théorique à la thématique de l’assignation identitaire.
Quant aux travaux académiques publiés dans les universités suédoises, nous n’avons trouvé qu’un seul mémoire de licence écrit à l’Université de Dalécarlie par Johanna Östlund sur les romans L’Armée du salut et Le Jour du roi d’Abdellah Taïa, qui se concentre surtout sur la relation compliquée entre l’homosexualité et l’islam (2015), une approche qui nous semble quelque peu tendancieuse, la religion ne jouant qu’un rôle mineur dans l’œuvre de Taïa.
La plupart des études antérieures que nous avons consultées ne traitent donc qu’un ou deux ouvrages d’Abdellah Taïa ou de Rachid O. et généralement de manière assez fugace pour illustrer une théorie plus globale concernant la littérature maghrébine en tant que genre littéraire. Si le livre de Khadija El Achir, publié en 2014, explore en partie des aspects de la masculinité et des quêtes identitaires en étudiant plusieurs ouvrages de Rachid O., il ne traite pas son ouvrage le plus récent, Analphabètes. En outre, il ne se concentre que sur un seul auteur et sans doute pas celui dont l’œuvre a fait le plus d’échos dans le monde littéraire français.
Si plusieurs des études décrites ci-dessus nous ont fourni des pistes théoriques générales pour nos recherches, pour autant que nous le sachions, personne n’a encore entrepris une comparaison approfondie de la manière dont ces deux auteurs d’origine marocaine ont construit l’identité sexuelle dans une sélection plus étoffée de leurs ouvrages d’inspiration autobiographique, tout en prenant en considération ceux publiés plus récemment, tels que Analphabètes et Celui qui est digne d’être aimé, raison pour laquelle nous avons opté pour une telle approche dans notre étude.
Délimitations
Cependant, il faut souligner que les ouvrages choisis pour la présente étude ne constituent qu’une partie de l’œuvre des deux auteurs et ne peuvent donc pas être considérés comme représentatifs de tous les thèmes que leurs œuvres contiennent. Cela étant dit, ils donnent une bonne indication surtout des thématiques abordées concernant les pratiques homoérotiques.
La disposition du travail
Dans les chapitres qui suivront, nous résumerons en premier lieu notre approche théorique et méthodologique, qui juxtaposera des théories sur les masculinités maghrébines et l’hybridité culturelle. Ensuite, nous analyserons les ouvrages en question en suivant l’approche indiquée, avant de résumer notre discussion pour tenter de répondre à nos questions de recherche et d’en tirer des conclusions.