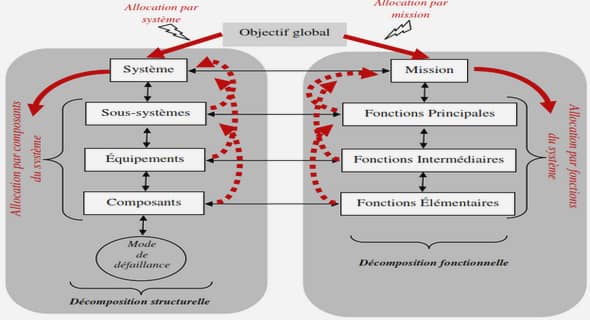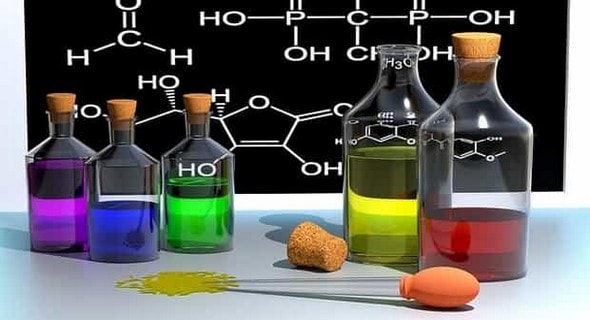Largument de la modernisation
Laccélération des rythmes de vie est généraleme nt associée aux notions de progrès et de modernité190. Les nouvelles technologies sont souvent présentées, selon un optimisme technologique191, comme porteuses de promesses et de rêves dans tous les domaines auxquels elles appliquents. Leurs vertus sont largement vantées et mises au service du progrès. On se souvient de Jeanierre Raffarin qui, alors qu il venait dêtre nouvelle ment nommé Premier Ministre en 2002 et quil était invité à se pronon cer sur la nécessité pour la France de combler son retard technologique, a déclaré que les TIC permettent de « mettre de la rapidité dans ce qui est lent, de la fluidité dans ce qui est lourd, de ouverturel dans ce qui est fermé 192».
Julie Bouchard193 rapportait que déjà en 1750 dans son Tableau philosophique des progrès de espritl humain , Turgot utilisait la métaphore de la « marche » de l humanité sur la voie du progrès, dans un récit qui ordonnait littérairement les peuples « en devanciers et en suiveurs » puisquils ne marchent pas tous dun pas égal. Ceci témoigne du fait que la rhétorique du retard et du rattrapage est produite par idéologie mê me du processus évolutif du développement des sociétés, lequel processus est par essence inégalitaire puisque tous les pays ne se développent pas au même rythme, ni de la même manière.
Dans sa philosophie de la modernité (Georg Simmel, Philosophie de la modernité, Paris, Payot, 1989.), Georg Simmel explique comment la « grande ville » a été utilisée comme espacel privilégié de la modernité sociologiqu e où se manifestent de nouvelles formes particulières de socialisation qui transforment profondément les modes de vie des citadins. Ceci pourrait constituer une piste dexplication de la man ière dont les TIC accompagnent, voire accélèrent le phénomène durbanisation.
Pour des références plus détaillées sur le « technooptim isme » lié à la diffusion des TIC et à avènementl d’Internet, consulter : Alvin Toffler, The Third Wave, Bantam Books, 1980 ; Nicholas Negroponte, Being Digital (Londres : Hodder and Stoughton, 1995) ; John Naisbitt, Megatrends : Ten Directions Transforming Our Lives (Warner Books, 1982) ; Michael L. Dertouzos, What Will Be : How the New World of Information Will Change Our Lives (HarperEdge, 1998).
RAFFARIN Jeanierre , « Déclaration sur la nécessité pour la France de combler son retard dans le domaine des TIC et sur les grandes orientations en faveur du développement du commerce électronique et de aménagementl numérique du territoire.», Assemblée Générale de Electronic Business Group, Paris, le 12 nov embre 2002, p.2 [En ligne] : http://lesdiscours.viepu blique.fr/pdf/023003624.pdf
Faisant le bilan des relations internationales contemporaines194, Marcel Merle soutient que évolution de histoirel a été scandée par une série dinnovations techniques qui ont mené à deux mouvements contradictoires à savoir, dune part la tendance à l uniformisation de la condition humaine et dautre part à la di scrimination croissante entre ce quil appelle les « bénéficiaires » et les « laisséspourcompte » du progrès.
Partant de là, hypothèsel de universalité du progrès social et technique, comme moyen de sortir de la crise et de passer dune situation de pauvreté et de vulnérabilité à une sit uation de prospérité et de bienêtre, est étroitement liée à la théorie de la moderni sation et à idéologie de développement. Daprès LaburtheTo lra et Jeanierre Warnier : « Historiquement, la modernisation est le processus de changement vers ces types de systèmes sociaux, économiques, politiques qui se sont développés en Europe occidentale et en Amérique du Nord depuis le 17ème siècle jusquau 19 ème, et se sont ensuite répandus dans dautres pays. » 195. Cette position est partagée par de nombreux précurseurs de ethnol ogie ou anthropologie culturelle qui associent également le caractère univoque du développement à la circulation à sens unique de innovationl du sommet vers la base, du centre vers la périphérie, de Occidentl moderne vers des civilisations en retard dont les modes de pensée sont qualifiés de « préscientifiques », « préogiques », voire « irrationnelles ». Pour le géographe, Yves Lacoste196, il agits d« une façon occidentale de se représenter le monde ». Plus radicales, les courants du « refus du développement » dénoncent, au nom du relativisme culturel, le projet global de modernisation uniforme du monde. Pour Serge Latouche, par exemple : « Le développement, cest aspirationl au modèle de consommation occidentale, à la puissance magique des Blancs, au salut lié à ce mode de vie [ ] Il signifie en clair, pour les masses affamées du Tiers Monde, une consommation comparable à celle des Américains moyens et pour les gouvernements des pays humiliés, enl trée dans le club des grandes puissances197 ». Cette vision du monde, censée se répandre au nom des libertés et du bien de humanité,l impose finale ment sa manière denvisage r « les conditions idéales de existencel sociale 198 » les rapports humains, leur organisation, plus particulièrement les échanges économiques mondiaux au détriment des pays « souséveloppés » auquel on conditionne « aidel » à acceptationl dun m odèle économique ultraibéral, fixé par les institutions multilatérales, Fonds Monétaire International et Banque mondiale en tête.
Nous pouvons souligner ici que la remise en cause des traditions et des modes de vie communautaires des peuples du Sud, en les traitant de « sous éveloppés » parce quils ont pas la qualité dêtre moderne 199, constitue une vision impérialiste de reproduction du modèle culturel ou le projet civilisateur de transposition dans les sociétés traditionnelles dune conception wébérienne200 de la modernité, visant l extension territoriale dune sphère culturelle dinfluence occidentale. Largument du retard culturel a be aucoup été évoqué au cours de la décennie de 1950expliquer incapacitél des pays du Sud à appliquer des politiques institutionnelles, infrastructurelles, économiques et sociales adéquates. Cest certainement parce que cette invitation à la modernité peut paraître comme une forme de « culture de la nouveauté » opposant à la tradition et à anciennetél que Herbert I. Schiller y voit les manifestations de «l impérialisme culturel » quil définit en 1976 comme : « la somme des processus par lesquels une société est introduite au sein du système moderne mondial et la manière dont sa couche dirigeante est amenée, par la fascination, la pression, la force ou la corruption, à modeler les institutions sociales pour qu’elles correspondent aux valeurs et aux structures du centre dominant du système ou à s’en faire le promoteur. »201.
Pour que les pays du Sud rattrapent leur retard, les théoriciens202 de la modernisation préconisent que ces pays passent obligatoirement par des stades de réformes institutionnelles, politiques et économiques de leur système de gouvernance, en ayant recours à aidel et à assistancel technique des pays industrialisés du Nord. Ces t ainsi que de nombreux projets de coopération technique ont vu le jour avec des vagues importantes de transfert de compétences du Nord vers le Sud (à travers envoil de coopérants et de conseillers techniques dans les différents secteurs du développement), mais aussi du Sud vers le Nord ou vers Estl (à travers envoil de boursiers et de stagiaires des pays du Sud pour quils aillent se former en occi dent afin dacquérir expertisel dont leur pays a besoin)203.
Ce nest que depuis les années 1990 que la coopération technique Nordud a pris le virage des TIC, avec le déploiement massif des infrastructures de communication et de télécommunication dans les pays en développement. Les économistes du développement véhiculaient alors idéel 199 Nous reprenons ici les termes de Françoisené de Chateaubriand qui indiqu e être l’inventeur du terme modernité dans la quatrième partie de son ouvrage les Mémoires doutretombe (1849). selon laquelle les TIC pouvaient servir de levier au développement socioéconomique en aidant entre autre à améliorer la qualité de enseignement,l les systèmes déc hanges commerciaux, les flux de communication et aussi en accélérant la croissance de la productivité204, unl des facteurs dattractivité des territoires. Dans unl des documents pr éparatoires à la quarantecinquième session de la Commission économique pour Afrique,l on peut lire ceci : « Le boom des technologies de informationl et de la communi cation (TIC), de Internetl et du phénomène « dotcom » a encore enjolivé imagel du marché, renforcé influence politique du sect eur des entreprises et entraîné une exubérance irrationnelle qui est maintenue j usquau milieu de la décennie suivante, en dépit de la crise estia tique (1997) et de éclatement de la bulle Internet (2000) »205. Les TIC sont alors perçues comme des dispositifs sociotechniques de transmission206 de modernité et des agents de développement social et économique207.
Ceci renvoie à une acception diffusionniste de la communication pour le développement partagée par Nora Quebral208, Everett Rogers209 ou encore Daniel Lerner. Ce dernier, dans son ouvrage « The Passing of Traditional Society, Modernizing the Middle East » (1958), explique le rôle des moyens de communication (les mass médias, en particulier la télévision qui était un nouveau média à époque)l en tant que vecteurs universels de modernité, influençant par leur pouvoir, le passage des « jeunes nations » (nouvellement indépendantes) du Sud des modes de vie traditionnelle vers des formes de sociétés plus » modernes « , calquées sur le modèle normatif de Occidentl.
Cest aussi la démonstration fa ite par Yvonne MignotLefebvre quand elle utilise exemple des télévisions éducatives pour décrire comment les TIC pouvaient contribuer à faire changer la donne internationale pendant la période de décolonisation, au cours de laquelle ces pays nouvellement indépendants cherchaient des voies de développement autonome et fondaient leurs espoirs de décollage économique sur les nouvelles technologies. Yvonne MignotLefebvre, évoquant les télévisions éducatives, écrit : « Elles se situaient dans un secteur résolument de pointe, celui de informationl et de la communi cation et appliquaients au champ de éducationl de base qui était la préoccupation première des responsables de cette période. Cellesi furent objet,l au moins en leur début, dun engouement ex traordinaire de la part tout à la fois des promoteurs, des financiers et des bénéficiaires.» 210
Cependant, il est à souligner que idéel dun e nécessaire modernisation du Sud induisait a contrario, pour certains, un argument de mauvaise foi, car les pays du Nord soucieux de leur propre croissance, auraient tout intérêt à maintenir les pays pauvres (alors regroupés sous appellation le « Tiers Monde ») dans une situation économique déficitaire et dans un état permanent de sousveloppement st ructurel, politique et technologique sur la base déchanges commerciaux déséquilibrés et inégaux211. Cest la « théorie de la dépendance » 212 qui est restée en vogue jusquà la fin des années 1960 avant de se muer en arguments de la postodernisation. Cette théorie constitue une vision défensive qui exprime entre autre idéel que l es TIC font partie des moyens utilisés par les pays industrialisés pour étendre leurs sphères dinfluence géopolitique et mieux contrôler les besoins en technologies des pays en développement, en les maintenant dans une situation de consommation, de dépendance et endettement 213 technologique. En délégitimant le volontarisme des politiques réformistes véhiculées par les thèses modernisatrices, les tenants de la dépendance critique violemment objectifl même de développement en tant que symbole dune croissance illimitée du marché et promes se de progrès social via la diffusion des TIC. Cependant, échecl quil faut tout de même pointer ici, nest pas tant celui des modèles théoriques du développement que celui des stratégies et pratiques dictées par industrialisation.
Il arrive que certains modèles technocratiques survalorisent les besoins en développement des populations assistées et avèrs ent inapplicables à cause du manque de pragmatisme et des décalages avec les contraintes du terrain. En revanche les politiques volontaristes affichées en matière déquipement et de développement de capacités technologiques peuvent complètement se détourner de leurs objectifs initiaux en privilégiant des stratégies démagogiques et des pratiques bureaucratiques loin des véritables aspirations de développement économique et humain. Léchec des stratégies internationales de développement structurel imposées par les Nationsnies à travers le consensus de Wa shington (Banque Mondiale, Fonds Monétaire International, Programme des Nationsnies pour le Développement) ont péché en justesse et en efficacité dautant plus que «l ajustement structurel 214 » préconisé était paradoxalement mal ajusté au contexte local dinstabilité politicoéconomique que traversai ent les pays en développement, en particulier les pays dAm érique latine et dAfrique dans les années 90.
Le choix des stratégies indus trialisation et de croissance (marché ou état, dérèglementation ou régulation, importation ou exportation, auto entrage ou extraversion, ), privilégiant des objectifs quantitatifs, comptent autant que le choix des modèles de modernisation sociétale, avec leurs objectifs qualitatifs. Audelà des modèles et des stratégies mis en uvre, ce qui importe encore plus estc optimisationl du coût des réform es à mener. Ainsi, sur le plan technologique, le défi qui se présentait aux pays africains était de pouvoir supporter les coûts ou de fournir dimportants efforts dinvestisse ments en matière dacquisition de nouvelles technologies, sur un intervalle de temps court. Ainsi, comme le rapportent Jean Jacques Guibbert et Olivier Sagna : Pris dans le maelström de la mondialisation, les Etats africains, bien quutilisant faiblement les TIC et ne les produisant quasiment pas, ont été amenés, à partir du milieu des années 1990 à appliquer de gré ou de force, des politiques publiques visant à préparer leur entrée dans « èrel » de la « société deinformationl La rhétorique du rattrapage technologique et industriel à travers argumentl du « leapfrogging » constitue une approche naïvement optimiste qui rend crédible cette possibilité pour les pays en développement, ayant une faible capacitation technologique, de sauter les différentes étapes du processus de développement pour rapidement rattraper leur retard et entrer à pieds joints dans la société dite de informationl.
Largument du le apfrogging
De tous les arguments utilisés dans la rhétorique du rattrapage, celui du « leapfrogging » est le plus efficace car constituant une combinaison de ensemble des autres arguments déjà évoqués précédemment (retard, urgence, modernisation et développement). Cest même argumentl qui illustre le mieux imagel du rattrapage puisquil identifie le « bond technologique » à un « saut (leap) de grenouille (frog) ». Nous convenons avec Gado Alzouma quen ce qui concerne Afrique,l depuis la fin du col onialisme et le début des indépendances, chaque décennie a été marquée par arrivéel dune technologie nouvell e, présentée comme outil qui permettra au continent de surmonter les éternels maux qui minent son développement. Ainsi, èrel des tracteurs et des machines agricoles (1960) a précédé èrel de la radiodiffusion et de la télévision (1970vant que ne installe èrel des ordinateurs, du téléphone et de Internetl dans les années 198090 216.
Selon Jeanichel Severino, ancien Directeur de Agencel française de développement (AFD), une nouvelle ère en Afrique, avènementl des TIC in augure en Afrique une nouvelle ère, celle de « Afriquel branchée » ou de la « cybera frique ». Il explique que le phénomène du leapfrogging se produit « lorsquun pays brûle les étapes du développeme nt en accédant à des technologies de pointe sans passer par la génération technologique précédente, souvent plus chère et moins efficace217 ». Ce saut en avant est beaucoup plus facilement perceptible dans les pays en développement partant dun faible niveau technologique que da ns les pays industrialisés qui ont déjà atteint un niveau très élevé daccès et dutilisation des équipe ments TIC. De nombreux rapports officiels entretiennent ainsi cette idée du saut technologique, qui serait nécessaire à réaliser par les pays en développement pour réduire la fracture numérique Nordud et accroître leur productivité économique. Sans pour autant prétendre à exhaustivité,l nous citerons ici chronologiquement les plus significatifs de ces études et rapports.
Dabord, cest Organisationl de coopération et de développement économiques (OCDE) qui interroges dès 1991 sur la capacité des pays en développement à accéder aux technologies de informationl et à pouvoir en tirer profit dans une perspective de décollage de économiel.
Létude menée par Cristiano Antonelli sur la diffusion des télécommunications de point e dans les pays en développement218 en rend bien compte. Quelques années plus tard, le Rapport mondial sur la communication et informationl 1999 publié par UNESCOl en 1999 fut unl des tout premiers à insister sur la cour se au numérique. Il donne espoirl à la classe dirigeante des pays en développement de appuyers sur les i nnovations dans les domaines des télécommunications et de infol rmatique pour améliorer les performances et la productivité de économiel afin de rattr aper leur retard: « Lidée la plus répandue était que les TIC permettraient à ces pays de sauter étapel de industrialisatio n et de faire entrer leurs économies dans une ère postindustrielle. Ils ont donc élaboré des politiques et des programmes afin dêtre parties prenantes dans les communications internationales par satellite et dans les réseaux déchanges de données transnationaux.219».