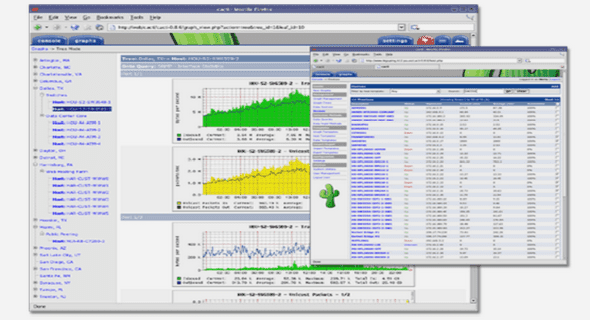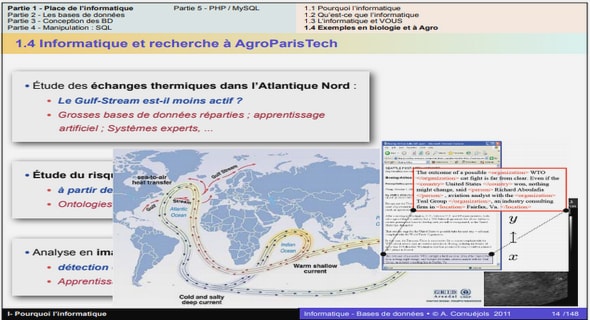But du mémoire et délimitations
Le phénomène qu´est le ne explétif nous intéresse depuis longtemps. Le but de cette étude est de trouver une réponse possible à la question : comment expliquer le fait que ce petit mot se maintient toujours, alors que d´autres ont disparu ou sont remplacés par d´autres mots. Il serait aussi intéressant de s´interroger sur l´évolution de sa fréquence. A cette fin, nous nous sommes proposé de faire une étude sur le ne explétif et sur l´évolution de sa fréquence pendant environ les derniers mille ans, principalement en trois périodes ou tranches, en nous concentrant sur les conjonctions avant que, à moins que et sans que. En même temps, nous tenons à préciser que nous avons inclu, dans notre étude, les conjonctions devant que, devant ce que et sanz ce que, prédécesseurs de avant que et de sans que qui ont, celles-ci le sens de avant que et celles-là de sans que.
Comme nos recherches portent sur la littérature au sens propre, les journaux ont été exclus, à ´exception d´un exemple relatif à la commercialisation d´une marchandise ainsi qu´un livre plutôt de genre biographique.
Pour trouver une base représentative de ce mémoire nous avons étudié la littérature depuis le chroniqueur Joinville (Les croisades du roi Saint Louis) en passant par La Fontaine (Les Fables) pour terminer avec un choix de littérature de ce que nous appelons « le français contemporain », c´est-à-dire avant tout des années 1950 et en avant.
Les grammaires à notre disposition traitent le ne de la même manière, qui l´appellent discordantiel ou explétif. La particule ne se rencontre dans des subordonnées introduites par que et des contextes qui permettent au ne explétif de régir le subjonctif. Ce ne explétif est souvent lié à un registre soutenu (Grevisse 1991 : 20).
Muller (1991. : 381) fait l´hypothèse que c´est par l´école et l´apprentissage de la langue littéraire que se maintiennent les constructions avec ne explétif. Au maintien de ce ne contribue sans doute aussi la coquetterie que de savoir maîtriser la « difficulté » qu´est le ne explétif.
Françoise Gadet (1997 : V) présente un autre niveau sur ce qu´elle appelle « le français ordinaire » qui « doit être compris par référence à ce à quoi on peut l´opposer. » Et ce n´est pas le français soutenu, recherché, littéraire ou normé. C´ est surtout le français familier : la langue de tous les jours, « qui n´est pas définissable comme un ensemble puisqu´elle est différente pour chacun, …», mais malgré son hétérogénéité nous concevons la langue comme une variation réglée, (Gadet 1997 : 141), appartenant à la gamme des registres de langue (Riegel et al. 2009 :21).
Recherches précédentes
Origine et développement
La langue française possède une série d´éléments linguistiques pour nier une phrase qu´on a groupés sous la dénomination négation, apportant la même information que pas, point, de, dé, non , in- ir- dans par exemple n´avoir pas d´argent, démuni, non-emploi, inachevé, irréprochable. Le français dispose aussi d´un ne préverbal qui a joué dans l´histoire de la langue le rôle de négation et dont la fonction est encore discutée. (Gaatone 1971 : 8). Ce terme préverbal semble avoir une ressemblance au ne explétif, qui se trouve dans certaines subordonnées.
Nous commencerons notre présentation du sujet dans l´ordre diachronique. Cet ordre se compose dans notre étude principalement du Moyen Âge, du XVIIe siècle et du franςais contemporain. Nous avons estimé utile de donner des informations assez détaillées sur l´évolution de la négation franςaise, comme il semble, parfois enchevêtrée avec ne explétif.
L´évolution de la négation s´est passée par étapes où nous considérons le latin et le Moyen Âge (476-1453, PL en couleurs 1989 : 662) comme le premier pas dans l´ évolution. En latin il y avait, entre autres, les négations non et ne(n), « l´élément essentiel et primitif de la négation » (Brunot 1909 : 3 : 1-2 : 619).
Sneyders de Vogel (1927 : 369, 375) fait valoir que déjà le latin se servait d´un non explétif devant le verbe en répétant la négation non avec en plus la négation nec/neque dans l´occurence: (9) Recomponere se non potest nec similari sibi non potest, Mulomedicina Chironis, 24, 24.3 Muller (1991 : 381) s´interroge si ce ne qui est l´objet de notre étude est un emprunt savant au latin. Mais il le tient pour exclu et prétend qu´ on a vu que dès les plus anciens textes, les principaux emplois de ne se trouvent après les verbes de crainte. En voici une occurence en latin : (10) Timeo ne sit aeger = en français contemporain : je crains qu´il ne soit malade . (Sneyders de Vogel 1927 : 165).
Le subjonctif présent dans cette occurence exprimait à l´origine un optatif, un désir réalisable (Sneyders de Vogel 1927 : 154, Ahlberg-Thunell 1955 :153).
Nen disparaît vers la fin du Moyen Âge, mais s´est maintenu dans nenni qu´ on trouve encore chez par exemple
La Fontaine:
(11) dites-moi ; n´y suis-je point encore ? Nenni. (La fable : « La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le boeuf », Vers 8).
Pourtant, une nouvelle étape a commencé de s´etablir dès l´époque de Commynes, né vers 1447 (Lanson-Tuffrau 1953 :82) , où le sens négatif se déplace de la particule ne aux mots pas et point . Mais bien avant cette époque nous pensons avoir trouvé un pas seul dès Le Roman de la Rose (1965 : 1: 175) :
(12) Sez tu pas qu´il ne s´ensuit mie, se lessier veill une folie, que fere doie autele ou graindre ? (Vers 5699). En français contemporain : Ne sais-tu pas qu´il ne s´ensuit nullement, si je m´abstiens d´une folie, que je doive en faire une semblable ou une plus grande ? Le Roman de la Rose. 1961:132, traduit par André Mary.
La négation a longtemps oscillé entre les formes ne et pas pour se stabiliser avec ne – pas vers le XVIIe siècle, par suite d´une règle donnée par Charles Maupas4, un des grammairiens du XVIIe siècle (Brunot 1909 :3 : 1-2 : 615, 1924 :4 :2 : 1038) et à l´encontre de Vaugelas (1585-1650)5 qui, en 1647, publie ses Remarques sur la langue franςaise, où il exprime son opinion sur la particule ne. « Mais il est incomparablement meilleur & plus élégant sans pas. » (1934 : 408).
Malgré la réforme de Maupas on trouve jusqu´ au XVIIe siècle des occurences, par exemple chez Rabelais et
Racine, où ne seul suffit à exprimer la négation :
(13) Je ne suis nay en telle planette et ne m´advint oncques de mentir, ou asseurer chose que ne feust véritable. (Pantagruel 1964 : 45).
(14) Je tremble qu´Athalie, […], N´achève enfin sur vous ses vengeances funestes […]. (Racine Athalie : 18)
Trembler = craindre.
Même dans le franςais contemporain il y a un groupe d´occurences où l´on trouve encore des restes de la particule ne seule pour exprimer l´idée négative. Donc, à ne pas confondre ce ne avec le ne explétif !
On peut à ce sujet citer des locutions archaïques:
(15) Ne vous en déplaise. (Edström 1969 : 209).
(16) S´il a besoin d´un guide, que ne vous en occupiez-vous ? (Gaatone 1971 :74).
Question introduite par que au sens de pourquoi, mais ce que a aussi un sens de reproche selon Lerch (1929 : 1 : 243).
Avec il n´y a, il n´est + sujet :
(17) Où femme y a, silence n´y a (Plattner 1920 : 261).
Avec mot :
(18) Et je ne dis mot (Joinville : 531).
Après si conjonction conditionnelle :
(19) Myriam est un vrai coeur d´artichaut, tous les six mois, depuis l´âge de quinze ans (ce qui doit faire à peu près trente-huit fois si je ne m´abuse, […]. (Gavalda 1999 : 124).
Il y a plus d´exemples de cette catégorie, mais elle n´est pas l´objet essentiel de notre étude et nous nous contentons d´ en faire une vue sommaire.
L´époque classique (Lanson-Tuffrau 1953 : 155) ici représentée par les Fables de La Fontaine est une période intéressante dans ce contexte, mais aussi un peu imprécise en ce sens que les locutions conjonctives, faisant l´objet de notre étude, n´entraînent pas régulièrement le ne explétif. Tantôt le ne est présent, tantôt il ne l´est pas. L´indicatif existe à côté du subjonctif. C´est que « La syntaxe de ne dans la proposition subordonnée est encore très incertaine ». (Brunot 1909 : 3 :1-2 :624).
Cette époque est dominée par les batailles linguistiques dans le cadre de l´Académie Franςaise sur la négation et le ne explétif ensemble avec les conjonctions de notre étude. Ces débats furent menés entre Franςois de Malherbe (1555-1628, Lanson-Tuffrau 1953 :954), Charles Maupas, Antoine Oudin (1595-1653)6
et Vaugelas (1585-1650, Svensk Uppslagsbok 1961 :30 : 1207), tous grammairiens qui ont formé le noyau de ce qui est devenu en 1635 l´ Académie Franςaise. Le résultat de ces discussions fut une séparation en une langue vulgaire et une langue littéraire, d´origine aristocratique. « C´est l´événement capital de ce siècle ». (Brunot 1909 : 3 :28).
Ces discussions linguistiques au XVIIe siècle n´ont pas été nettement expliquées, à notre avis, dans les livres à notre disposition, entre autres Brunot, qui écrit (1924 :4 :2 : 1037) : « Il eut à l´Académie une discussion très serrée, mais qui n´aboutit pas ». Nous avons demandé des renseignements sur ce sujet à l´Académie Franςaise7 qui, cependant, n´a fait que confirmer notre impression qu´il est difficile de déterminer l´année où une décision concluante sur la négation ne … pas fut faite. Selon l´Académie, « Ce débat occupe une bonne partie du XVIIe siècle ».
Damourette & Pichon (1911 :I : 134-135 (= § 115) avancent l´idée qu´il semble bien qu´il y ait une nuance sémantique entre avant que avec ou sans ne, que »Quand ne n´est pas présent, la phrase ne marque qu´une pure succession chronologique … « . Et « Au contraire, la présence de ne … insiste sur la durée qui s´est écoulée avant l´intervention du fait nouveau ; […]. Damourette & Pichon (1911 :5 : 533) écrit : « Nous avons essayé d´indiquer au § 115 la nuance sémantique entre le tour avec ne et le tour sans ne dans la langue d´aujourd´hui : le premier marquant une pure succession chronologique, le second insistant sur la durée écoulée avant l´intervention du fait nouveau ; « . Ces énoncés dans 1911 :1 et 1911 : 5 nous semblent contradictoires.
Selon Damourette & Pichon (1911 : I :134, 1911 :5 :532) avant que avec ne a pris son essor au XIXe et au XXe siècle et s´épanouit au XXe siècle. Ils soutiennent leur déclaration en citant une vingtaine d´ occurences, dont certaines avec « des racines anciennes ». (1911 :5 : 533).
On se serait attendu par exemple à des statistiques comme une base plus stable de leur raisonnement.
On peut se demander ce que Damourette & Pichon entendent par l´expression « la langue d´aujourd´hui » (1911 : 5 :533), alors qu´ils allèguent des occurences dont certaines nous semblent trop âgées pour être en accord avec cette époque (1911 : 5 :532).
A part cela nous n´avons pas relevé de telles idées chez les autres grammairiens dans notre étude, qu´il s´agisse du franςais contemporain ou qu´il s´agisse des époques d´auparavant. C´est pourquoi nous mentionnons les pensées de Damourette & Pichon.
Aussi bien Damourette & Pichon (1911 :I : 134), Muller (1991 :377) que Togeby (1965 :789) sont d´avis que avant que avec ne est rare pendant la période classique. C´est sans doute dû au fait qu´après avant que l´Académie Franςaise n´admet pas le ne.
D´une édition à l´autre des Lettres persanes Montesquieu se corrige et supprime le ne qui s´était glissé dans la première (1721) (Brunot 1909 : 6 :2 : 1866). Mais dans l´usage ce particule se répand de plus en plus (Brunot 1909 : 6 :2 : 1866). Beaucoup d´écrivains rejettent le ne après avant que (Brunot 1909 : 6 :2 : 1866), tandis que d´autres, au fur et à mesure, utilisent les deux manières d´écrire, sans considération à l´opinion de l´Académie, comme par exemple l´auteur Jean Franςois Marmontel, 1723-1799, historiographe de France et en 1783 élu secrétaire perpétuel de l´Académie Franςaise (Brunot 1909 :6 :2 : 1866-1867), dont nous présentons deux occurences :
(20) « avant que vos trompettes ne vous échappent » (Pharsale I. VII, Brunot 1909 :6 :2 :1867).
(21) « avant que les premiers accens de la désolation aient éclaté » ; (Pharsale : 132).
Par contre, l´abbé (Antoine Franςois) Prévost (1697-1763 (Lanson & Truffaut 1953 :369) semble s´être adapté à la décision de l´Académie Franςaise :
(22 ) Je l´avais préparée, avant qu´il fût venu, […]. Prévost. Manon Lescaut :111).
A moins que … ne et sans que… ne est devenu la règle parce que l´Académie Franςaise l´a demandé (Lerch 1929 : 2 : 319, 329, Lexique de Corneille 1862 :2 : 109) et par là on peut dire que les conjonctions à moins que et sans que se sont suivies quant à l´usage du ne explétif. L´Académie corrige les textes d´entre autres Molière qui en manquent (Brunot 1909 :6 :2 :1865).
(23 ) « A moins que vous ne cessiez, Madame, d´être aimable » (Molière). (Brunot 1909 : 6 :2 :1866).
Selon Togeby (1965 : 790) et malgré la règle de l`Académie Franςaise concernant sans que… ne cette conjonction est rare à l´époque classique et il y a des auteurs qui écrivent sans ne, par exemple Marivaux (1688-1763) (Lanson-Tuffrau 1953 : 356):
(24) « sans que personne les fasse » ( Brunot 1909 : 6 :2 : 1866).
Certains verbes comme savoir se construisent avec ne seul pour marquer un doute. Savoir avec une négation complète nie de savoir. (Brunot 1909 : 3 : 1-2 : 616).
(25) Je ne sais s´il fît, dès le soir même, quelques démarches pour nous découvrir […] ( Prévost. Manon Lescaut : 94).
(26) Je ne le sais pas très bien, mais, [… ] (Prévost. Manon Lescaut : 67).
En revanche, nous avons vu réapparaître un pas seul en négation :
(27) Est-ce pas aujourd´hui qu´il revient ? (Gide. Le retour de l´enfant prodigue 1948 : 193).
D´après Togeby (1982 : IV : 302) ne explétif après sans que est un phénomène récent datant du XIXe siècle. Le point de vue extrême semble être l´avis de Plattner (1920 : 423) qui nie ne après sans que.
Description des grammaires
Pour notre étude sur le ne explétif relatif aux conjonctions avant que, à moins que et sans que nous avons pris comme point de départ quelques grammaires éditées au cours du XXe siècle. Parmi elles il y a deux grammaires allemandes (Plattner 1920 et 1957), une grammaire néerlandaise (Sneyders de Vogel 1927), deux grammaires de Togeby, dont une en danois (1965) et l´autre en franςais (1982) et une grammaire suédoise (Edström 1969). L´oeuvre de Togeby (1982) se compose de cinq volumes. En plus, il y a quatre grammaires françaises, à savoir Damourette & Pichon (trois volumes 1911-1936), Grevisse (1949, 1955 et 1991), Wagner-Pinchon 1962 et Riegel et al. (1994, 2009). Toutes les grammaires sont destinées à l´enseignement public.
Nous avons choisi de faire un exposé des cas où ces grammaires se ressemblent et diffèrent. Nous commenςons par les grammaires les plus anciennes qui réfèrent en général à un style soutenu de la langue. Nous avons divisé, selon notre opinion, les grammaires en catégories classiques et modernes, où « classique » représente une grammaire prescriptive, préconisant un style soutenu (Grevisse 1991 : 20), tandis que « moderne » désigne plutôt descriptif (Grevisse 1991 : VIII).
D´après nous, il faut compter la grammaire de Damourette et Pichon (1911-1936) parmi les grammaires classiques. Leurs explications grammaticales sont exhaustives et accompagnées de bon nombre d´occurences de toutes époques. Cependant, les dénominations des phénomènes grammaticaux sont tout autrement que celles des autres grammairiens. Ils élaborent un raisonnement sur la question de l´absence ou de la présence du ne explétif utilisé par exemple avec avant que. Ils se demandent si l´utilisation chez les Français du ne explétif est basée sur un sentiment linquistique ou sur le hasard.
Plattner (1920 :422) présente le ne explétif en mettant en avant que ce ne seul se place dans des subordonnées où il n´y a pas de négation. Plattner explique que ce ne semble nécessaire aux Franςais sauf après craindre, douter, nier qui, dans la langue ordinaire, s´utilisent le plus souvent sans ne. Plattner (1920 : 424) avance la pensée que l´usage du ne explétif pour les Français n´a pas d´interprétation logique comme en latin, c´est-à-dire le souhait du contraire, mais que la construction franςaise n´est qu´une imitation extérieure du latin.
Selon Plattner (1920: 423) ne figure seulement là où le verbe précédent n´a pas de sens négatif, n´est pas suivi de négation ou de sans, n´est pas utilisé interrogativement ou conditionnellement.