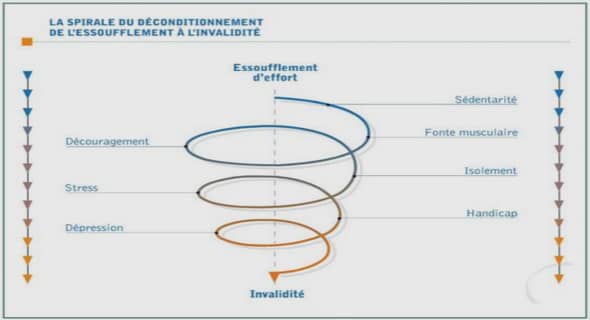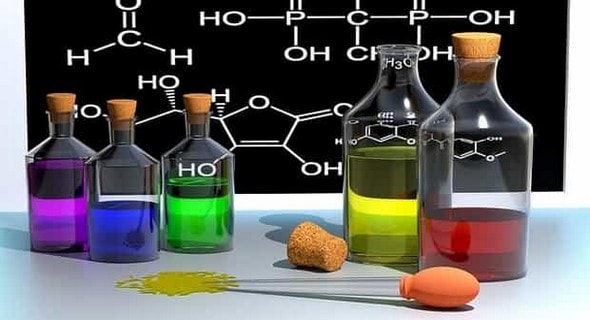Intérêt de la pluviométrie
La pluviométrie est un facteur écologique essentiel, c’est-à-dire qu’il est un élément d’un milieu naturel, capable d’influencer directement sur les êtres vivants. Il est donc utile de connaître la pluviométrie puisqu’elle permet de déterminer une région, le climat, la nature, la biodiversité, le fonctionnement des écosystèmes, etc.
C’est aussi un enjeu politique (et plus précisément géopolitique) puisque c’est elle qui influence le développement des sociétés humaines. Par exemple, les régions au climat désertique qui ont une pluviométrie très faible, ne sont pas favorables au développement.
Pluie
La pluie désigne une précipitation d’eau à l’état liquide tombant des nuages vers le sol . Formation des pluies : La pluie se forme à partir de la condensation de la vapeur d’eau qui a été évaporée par le soleil et qui s’est condensée dans le nuage par refroidissement adiabatique dû au mouvement ascendant de l’air. Les cristaux de glaces situés au sommet du nuage tombent à cause de leur masse et des turbulences incapables de les retenir ; dans leur chute, ils rencontrent de l’air chaud et des gouttes surfondues : c’est l’effet de coalescence ou de captation .
Différents types de pluie
Il existe différents types de pluie : La bruine, composée de très petites gouttes provenant de nuages bas, comme les stratus, et ne produit que très peu d’accumulation au sol.
La pluie fine laisse moins de 25 mm d’eau au sol par heure. La pluie modérée, l’eau va de 25 à 76 mm par heure au sol.
La pluie forte, plus de 76mm d’eau au sol par heure. Alors que les pluies continues proviennent généralement de nuages épais, comme les nimbostratus, les averses se forment plutôt dans les cumulonimbus .
Types de précipitations
Il existe différents types de précipitations : les précipitations convectives, les précipitations orographiques et les précipitations frontales ou de type cycloniques.
Précipitations convectives : Elles résultent d’une ascension rapide des masses d’air dans l’atmosphère. Elles sont associées aux cumulus et cumulo-nimbus, à développement vertical important, et sont donc générées par le processus de Bergeron. Les précipitations résultantes de ce processus sont en général orageuses, de courte durée (moins d’une heure), de forte intensité et de faible extension spatiale.
Précipitations orographiques : Comme son nom l’indique (du grec oros, montagne), ce type de précipitations résulte de la rencontre entre une masse d’air chaude et humide et une barrière topographique particulière. Par conséquent, ce type de précipitations n’est pas « spatialement mobile » et se produit souvent au niveau des massifs montagneux.
Les caractéristiques des précipitations orographiques dépendent de l’altitude, de la pente et de son orientation, mais aussi de la distance séparant l’origine de la masse d’air chaud du lieu de soulèvement. En général, elles présentent une intensité et une fréquence assez régulières .
Précipitations frontales ou de types cycloniques : Elles sont associées aux surfaces de contact entre deux masses d’air de température, de gradient thermique vertical, d’humidité et de vitesse de déplacement différents, que l’on nomme « fronts ». Les fronts froids (une masse d’air froide pénètre dans une région chaude) créent des précipitations brèves, peu étendues et intenses. Du fait d’une faible pente du front, les fronts chauds (une masse d’air chaude pénètre dans une région occupée par une masse d’air plus froide) génèrent des précipitations longues, étendues, mais peu intenses.
Mesure des précipitations
Pluviomètre : C’est un instrument de base de la mesure des précipitations liquides ou solides. Il indique la quantité d’eau totale précipitée et recueillie à l’intérieur d’une surface calibrée dans un intervalle de temps séparant deux relevés.
La valeur donnée par le pluviomètre correspond à la hauteur d’eau recueillie sur une surface plane. Elle s’exprime en millimètre et parfois en litre par mètre carré (1litre/m²=1mm). Les valeurs obtenues à l’aide d’un pluviomètre ne sont que des valeurs dans une petite surface ; mais pour obtenir des données pluviométriques dans une région ; on utilise le radar météorologique.
Pluviographe : C’est un instrument captant la précipitation de la même manière que le pluviomètre mais avec un dispositif permettant de connaitre, outre la hauteur d’eau totale, leur répartition dans le temps, autrement dit les intensités .
Table des matières
INTRODUCTION
PARTIE.1 : GENERALITES SUR LA PLUVIOMETRIE
I.PLUVIOMETRIE
I.1. Intérêt de la pluviométrie
I.2. Pluie
I.2.1. Définition
I.2.2. Formation des pluies
I.2.3. Différents types de pluie
I.3. Précipitation
I.3.1. Définition
I.3.2. Formation des précipitations
I.3.2.1. Pluie et bruine
I.3.2.2. Verglacée
I.3.2.3. Neige et grêle
I.3.3. Types de précipitations
I.3.3.1. Précipitations convectives
I.3.3.2. Précipitations orographiques
I.3.3.3. Précipitations frontales ou de types cycloniques
I.3.4. Mesure des précipitations
I.3.4.1. Pluviomètre
I.3.4.2. Pluviographe
PARTIE.2 : METHODOLOGIE DE L’ETUDE
II.1. Localisation de la zone d’étude
II.2. Présentation des données
II.3. Analyse en Composantes Principales (ACP)
II.3.1. Introduction
II.3.2. Objectifs de l’ACP
II.3.3. Données
II.3.4. Etapes de l’analyse
II.3.4.1. Présentation de la matrice d’entrée en ACP
II.3.4.2. Calculs mathématiques de l’ACP
II.3.4.3. Choix des axes à retenir sur l’analyse
II.3.4.4. Représentation des individus et du cercle de corrélation des variables
II.3.4.5. Interprétation des axes
II.4. Méthode statistique de détection de rupture
II.4.1. Définitions
II.4.2. Test d’homogénéité
II.4.3. Détection de rupture
II.4.4. Calcul des variations moyennes
II.5. Méthode de modélisation
II.5.1. Généralités sur le modèle ARIMA
II.5.1.1. Processus ARIMA (p, d, q)
II.5.1.2. Processus ARIMA saisonnier ou SARIMA (p, d, q) (P, D, Q) S
II.5.2. Méthodologie de Box-Jenkins
II.5.2.1. Identification du modèle
II.5.2.2. Test de stationnarité
II.5.2.3. Analyse graphique de corrélogramme
II.5.2.4. Différenciation saisonnière
II.5.2.5. Estimation du modèle
II.5.2.6. Validation du modèle
PARTIE.3 : RESULTATS ET INTERPRETATIONS
III.1. Analyse en Composantes Principales
III.1.1. Matrice initiale de l’ACP
III.1.2. Moyenne et écart-types des pluies
III.1.3. Choix des axes à retenir
III.1.4. Variables
III.1.4.1. Matrice de corrélation des variables
III.1.4.2. Coordonnées, contributions et cosinus carrés des variables
III.1.4.3. Cercle de corrélation des variables
III.1.5. Individus
III.1.5.1. Coordonnées, contributions et cosinus carrés des individus
III.1.5.2. Répartition des individus
III.1.6. Régionalisation
III.2. Analyse de rupture
III.2.1. Test d’homogénéité
III.2.2. Détection de rupture
III.2.3. Calcul des variations moyennes
III.3. Modélisation
III.3.1. Zone pluvieuse
III.3.1.1 Etude de la stationnarité
III.3.1.2. Etude graphique de corrélogramme
III.3.1.3. Différenciation saisonnière
III.3.1.4. Analyse des FAC et FACP de la série pluviométrique désaisonnalisée
III.3.1.5. Détermination des paramètres du modèle
III.3.1.6. Validation du modèle SARIMA (13,0,12) x (2,1,0)12
III.3.1.7. Calcul des valeurs de la prédiction pluviométrique
III.3.2. Zone moyennement pluvieuse
III.3.2.1. Etude de la stationnarité
III.3.2.2 Etude graphique de corrélogramme
III.3.2.3. Différenciation saisonnière
III.3.2.4. Analyse des FAC et FACP de la série pluviométrique désaisonnalisée
III.3.2.5. Détermination des paramètres du modèle
III.3.2.6. Validation du modèle SARIMA (2,0,12) x (1,1,1)12
III.3.2.7. Calcul des valeurs de la prédiction pluviométrique
III.3.3. Zone sèche
III.3.3.1. Etude de la stationnarité
III.3.3.2. Etude graphique de corrélogramme
III.3.3.3. Différenciation saisonnière
III.3.3.4. Analyse des FAC et FACP de la série pluviométrique désaisonnalisée
III.3.3.5. Détermination des paramètres du modèle
III.3.3.6. Validation du modèle SARIMA (3,0,12) x (2,1,2)12
III.3.3.7. Calcul des valeurs de la prédiction pluviométrique
III.3.4. Zone moyennement sèche
III.3.4.1. Etude de la stationnarité
III.3.4.2. Etude graphique de corrélogramme
III.3.4.3. Différenciation saisonnière
III.3.4.4. Analyse des FAC et FACP de la série pluviométrique désaisonnalisée
III.3.4.5. Détermination des paramètres du modèle
III.3.4.6. Validation du modèle SARIMA (12,0,12) x (2,1,2)12
III.3.4.7. Calcul des valeurs de la prédiction pluviométrique
CONCLUSION
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ANNEXES
ANNEXE A : Matrice initiale de l’ACP
ANNEXE B : Tableaux des valeurs de MAPE pour chaque modèle ARIMA possible à chacune des zones
ANNEXE C : Tableaux des valeurs de MAPE pour chaque modèle SARIMA possible à chacune des zones
ANNEXE D : Tableaux des valeurs de la prédiction pluviométrique pour chaque zone