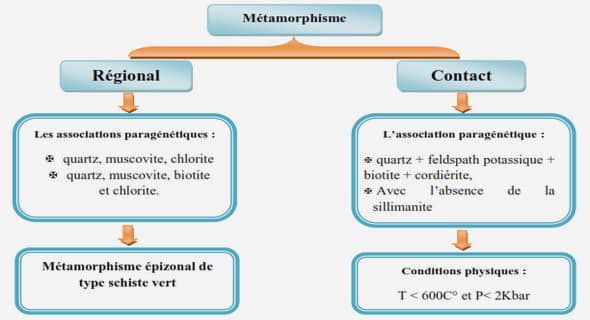Dans les « histoires de la chanson » : l’exemple de l’Histoire de la chanson française de Claude Duneton
Parmi les approches ordonnées, la mise en histoire de la chanson et la mise en patrimoine semblent les plus usitées et autorisées. Elles sont d’ailleurs inextricablement liées. Tout travail d’« histoire » de la chanson présuppose une conception de l’objet et des critères définitoires d’inclusion – et donc d’exclusion – des œuvres recensées et rassemblées. Au nom de quelles valeurs, de quels critères, de quels présupposés ces histoires de la chanson incluent et valorisent-elles certaines chansons et en excluent et dévalorisent-elles d’autres ?
Le préambule de l’Histoire de la chanson française en deux volumes, « Généralités nécessaires sur la chanson » (DUNETON 1998 : [vol. 1] 9-25), relève du paratexte56, plus précisément de la sous-catégorie péritexte57 auctorial et non d’une introduction à proprement parler, dont l’absence est remarquable : la démarche historique n’est pas présentée ni la problématique, énoncée ; ne sont exposés ni les fondements théoriques, ni les grandes lignes méthodologiques, ni les enjeux d’une « histoire de la chanson française ». Manifestement non scientifique, cette somme conserve un statut indécis, malgré le volume impressionnant58 d’informations de tous ordres sur les chansons, de citations de chansons ou de textes de tous types, assemblée par un amoureux de la chanson, fin connaisseur et collectionneur d’éditions originales. Un grand flou baigne ces Généralités nécessaires sur la chanson » qui postulent d’emblée une nature émotionnelle de cet art, nature qui semble fonder un impératif tenant lieu de méthode : le lecteur, à la suite de l’auteur, doit s’impliquer personnellement et émotionnellement dans ce qui se trouve essentialisé comme « histoire » de la chanson : Le XXe siècle fut un siècle de découpage chirurgical des sujets, dans un climat de détachement scientifique qui présida à l’établissement des « sciences humaines ». Ce siècle prisa par-dessus tout la lucidité intellectuelle, une lucidité génératrice d’opinions fortes et définitives […]. Une période pareillement guidée par l’amour de l’objectivité semblait peu propice, en effet, à des recherches visant à une compréhension « émotive » du passé. Or, pour aborder l’histoire de la chanson, qui porte en elle l’histoire des émotions, il est nécessaire de se plier au mouvement inverse : il faut, avec beaucoup de modestie, se glisser soi-même dans l’histoire autant que faire se peut. Participer d’abord…
LA-chanson » / « une chanson » : aporie d’une appréhension totalisante et méandres de la catégorisation
Au-delà de ce qui pourrait ressembler à un règlement de compte avec le monde universitaire en général et l’objectivité scientifique, l’attitude prônée ici est l’immersion subjective dans les répertoires de la chanson à travers les âges : « se plier » à la fiction d’un voyage personnel à travers plusieurs époques du passé, en rejetant une objectivité supposée desséchante. Or, sentiments et émotions font l’objet de recherches historiques sérieuses et l’« histoire culturelle », l’« histoire des sentiments », l’« histoire des mentalités », qui ont leur place au sein de la discipline historique scientifique, sont portées par des chercheurs remarqués59. Ce discours péritextuel qui revendique le rejet de l’objectivité comme principe fondateur d’une « histoire » se veut prescriptif sur la question – importante – de la prise en compte de la mélodie dans le format chanson, mais d’une façon singulière : par l’interdiction de lire sans mélodie les textes de chansons et l’injonction à improviser des airs provisoires « de remplacement »60, qui reviennent avec une insistance remarquable tout au long de l’ouvrage61. Manifestation de l’inquiétude du connaisseur/amoureux de chansons de tout temps quant à la réception de ces œuvres par un public d’aujourd’hui qui pourrait ne pas y être sensible, ou tentative de compensation de l’absence de partitions mélodiques pour la moitié environ des textes de chansons cités dans l’ouvrage, cette consigne réitérée laisse perplexe. L’auteur a pu sentir son discours légitimé – pure hypothèse – par une préface tardive de BÉRANGER commentant la liberté qu’il prenait de « [se] dégager un peu des formes rythmiques auxquelles [il se] soumettai[t] constamment » : On s’en apercevra à l’absence d’un choix d’airs pour beaucoup de ces dernières chansons, ce qui ne m’a pas empêché de me les chanter souvent sur des airs improvisés. (BÉRANGER 1857 : 13)62
Simple exemple parmi d’autres éminents chercheurs : Stéphane AUDOIN-ROUZEAU (directeur d’études à l’EHESS) qui a mené des travaux remarquables sur la Première Guerre mondiale, révolutionnant le discours historique et la vision sur le sujet, notamment par une recherche très rigoureuse des attitudes et mentalités des hommes et femmes qui ont vécu la période analysée.
« On doit créer à son propre usage une musiquette de remplacement […]. Nous devons imaginer une mélodie qui, à notre sentiment spontané, pourrait s’accorder au ton du texte, à son époque. » (DUNETON 1998 : 13).
Sous la forme de la reprise de deux phrases à l’impératif en gros caractères italiques souvent en fin de chapitre – deux phrases mises en valeur dans cette préface : « Lisez une chanson avec un air en tête : le sien ou le vôtre ! », « Ne lisez jamais un texte de chanson sans un air en tête ».
Cité dans LETERRIER 2013 : 57.
Il s’agissait là d’un changement de procédé d’écriture d’un auteur (un parolier, dirait-on au XXe siècle), qui par cela même, s’éloigne délibérément du souci musical-mélodique pour façonner des objets de nature prioritairement littéraire. Comment appréhender des œuvres dans leur intégrité en en bricolant une part aussi constitutive que la ligne mélodique ? Si l’on comprend bien le souci de ne pas exclure les lecteurs ne sachant pas lire la notation musicale occidentale moderne – un louable souci civique de démocratie culturelle –, l’approximation avouée63 conduit à une inacceptable altération des œuvres, si consciente et assumée soit-elle.
En outre, cette entreprise d’écriture d’une « Histoire de la chanson française » ne présente ni ne discute les critères qui président au choix des chansons reproduites et plus ou moins commentées et au rejet de celles qui ne sont pas mentionnées dans l’ouvrage. Rien n’est indiqué sur leur représentativité pour l’étude des périodes.
Ainsi, si l’on peut reconnaître à cet auteur le souci d’enrichir l’approche de l’histoire de ce qu’on nomme « chanson », de la prise en compte de l’articulation texte-musique et d’une dimension émotionnelle de ces formats, l’ouvrage présente des failles méthodologiques : il y a en effet contradiction, par exemple, entre la préconisation de bricolage de mélodies provisoires et l’affirmation que c’est la musique qui « investit » de « sens » le texte d’une chanson (DUNETON 1998 : 10). Pour ce qui est de la méfiance, voire du mépris, qu’il énonce à l’égard de la recherche scientifique, et de l’insistance à combler par un expédient qui mutile et défigure les chansons étudiées ou simplement prises en exemple, l’attitude générale de l’auteur peut être soupçonnée de populisme, au sens que lui donnent PASSERON et GRIGNON64. DUNETON concède en effet que la « musiquette de remplacement » est « approximative bien sûr » (DUNETON 1998 : 13).
In : GRIGNON & PASSERON 1989. Présentées comme devant être dépassées tout comme le « misérabilisme » DUNETON postule une évaluation d’évidence ou de sens commun qui tracerait une démarcation entre chansons « bonnes » et mauvaises, « belles » et laides, ou « grandes » et petites, échelles de valeur plus ou moins superposables65 : les textes de chansons – et je crois pouvoir dire des « bonnes chansons » – se distinguent des poèmes littéraires en ce qu’ils sont généralement « maigres ». (DUNETON 1998 : 10)
Une telle entreprise évaluative devrait appeler une exposition rigoureuse des critères mobilisés ; à la place s’alignent des notations floues : « maigres », « poétiques », « plats », « charge poétique », « fonctionnent », « délicieux », « admirable composition », « des chansons peu suspectes que chacun s’accorde à trouver infiniment belles » (DUNETON 1998 : 10-11). Enfin, un axiome66 postule un peu plus loin que la qualité d’une chanson est inversement proportionnelle à la qualité littéraire de son texte. L’exemple donné est l’œuvre de Georges Brassens, dans laquelle se trouvent des poèmes qu’il a mis en musique – et qui ne seraient pas ses « plus belles chansons » – et celles qui ont été « écrites par lui-même » – les « grandes chansons de Brassens ». Pourquoi ? Parce que. Cela relève d’une évidence : les textes « maigres », « plats », écrits « à la main, sur le fil du rasoir » (DUNETON 1998 : 11), font les grandes chansons ; les « poèmes littéraires » à « l’enveloppe sonore subtile », les « très beaux poèmes », des chansons médiocres67.
Un gabarit est ici proposé, qui produit nécessairement des restes, des déchets. L’établissement de normes (qui peuvent varier selon les histoires de la chanson68) semble répondre, dans de telles entreprises qui ambitionnent de constituer une somme, à l’impératif de trouver une unité à l’objet, de délimiter un périmètre net en dehors duquel est rejeté tout ce qui n’est pas LA-Chanson. Le postulat, parfois informulé, qui commande une telle exigence unitaire est celui d’une essence de la Chanson, à la fois intuitivement préhensible et éternellement à inventer. Les histoires de la chanson formalisent des normes (dimension évaluative) qui participent d’une mise en genre de la chanson, à problématiser, notamment à travers l’inventaire des rebuts de la chanson que ces normes produisent.
L’objet hétérogène
La lumière de cette diversité de possibles, l’approche consiste à tenter un premier niveau, provisoire, de clarification et de voir ainsi sous le terme, qu’il soit à portée particularisante ou englobante/totalisante, une instance articulant trois plans de questionnements étroitement corrélés entre eux : (a) le plan de l’artefact ; (b) le plan esthétique ou stylistique ; (c) le plan de l’occurrence historique ou située. Ces trois plans sont autant d’entrées « directes » – elles peuvent s’enchâsser mutuellement et recouvrir d’autres possibles – sur l’objet. La distinction offre toutefois l’intérêt, face au foisonnement discursif prédiquant l’objet de manière particularisante ou englobante, totalisante, de mettre l’accent plutôt sur telle ou telle caractéristique, sans négliger pour autant de circuler aux autres niveaux.