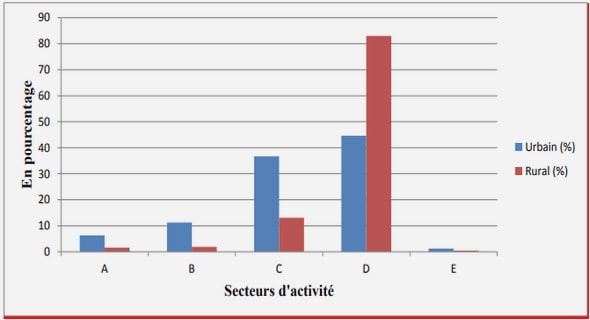Le milieu économique
La population est composée principalement d’agriculteurs, de pêcheurs et d’artisans. Globalement, les activités économiques sont basées sur les activités agricoles, para et non agricoles. Mais l’essentiel de l’économie continue à reposer sur les activités agricoles.
Les activités agricoles : les cultures de rentes : la zone d’étude pratique deux cultures de rente primordiaux dont le girofle et le litchi et quelques cultures de rente secondaire : la canne sucre, l café, la banane, la vanille, la noix de coco,….
les cultures vivrières : la culture rizicole connaît une extension de plus en plus marquée des superficies cultivées. Les paysans de la région s’adonnent à deux modes de culture de riz : la riziculture pluviale et la riziculture irriguée. Toutefois, l’autosuffisance est loin d’être atteinte. En outre, la production de manioc et du maïs sont en quantité non négligeable par contre les autres cultures vivrières se limitent souvent à de terre située autour du village. L’élevage : le petit élevage commence à avoir plus de place dans notre zone d’étude.
Les activités para agricoles : Les principales activités para agricoles s’articulent autour de la distillation de l’essence de girofle et la production de vin de canne «betsabetsa». Ces activités ont une importance particulière dans le revenu des paysans.
Les systèmes de culture
Les cultures vivrières : Suite à la domination des cultures pérennes sur les tanety, la diminution des surfaces exploitées en riz de tavy et la réduction de temps de friche de 4 à 5 ans avaient été observée. Par conséquent, l’extension de la riziculture des bas fonds était très remarquée. Pour cela les agriculteurs adoptaient le même itinéraire technique que celle du système agraire précédent. Mais la semence utilisée est le « vary JAVA » qui a un cycle de 6 mois et le « vary VATO » variété photopériodique qui fleurit en avril.
Les cultures d’exportation
Le girofle : Les premiers girofliers dans la zone avaient été introduits au début du XXème siècle. Et, les premiers alambics pour la distillation de l’essence virent le jour après le passage du cyclone de 1927. Le défrichement était effectué seulement sur la ligne de plantation. Le giroflier est un arbre rustique, il poussait même sur des sols dégradés.
Profitant de cette rusticité, les paysans se limitaient à n’apporter à leur champ de giroflier que le minimum de soin : entre la mise en place et la première récolte, ils ne débroussaillaient qu’une ou deux fois les pieds des jeunes arbustes. Le café : Le cafier était introduit dans cette zone avant le giroflier. Pour cela, la semence utilisée était le café bourbon venant de La Réunion connu par ses feuilles larges et ces cerises un peu plus grandes par rapport au café robusta nommé localement « café be » et ce n’était qu’après la crise de 1917-1918 que les colons avaient introduit le café robusta. Le bananier C’était la première plante fruitière exportée dans la région. Il avait été introduit par les migrants indonésiens (RAVOHITRARIVO C. P., 2004) mais c’était durant la colonisation où son exportation avait lieu que cette culture était bien développée. Auparavant, les bananes étaient considérées comme des produits de cueillette.
Les systèmes d’élevage
L’élevage bovin : Les bêtes étaient toujours en divagation sauf qu’elles recevaient un peu de soin. Pendant la moisson, elles étaient ramenées à la rizière pour pâturer les restes de la végétation après la récolte « matrangy ».
Le petit élevage : Toutes les espèces aviaires domestiques : poule, canard, oie,… étaient présents. Ces oiseaux vagabondaient sans abri. Les animaux cherchaient eux même leur nourriture et leur nid qui pouvaient être sur les arbres ou en dessous du logement de leur propriétaire.
La riziculture des bas fonds
Le bas fond peut être classé en : « kôkagna » : rizière aménagée à partir de marais où la gestion de l’eau est possible. « kôkagna » peut être se subdivisé à son tour en deux groupes : la partie où l’eau est disponible toute l’année « akadrano » : la pratique de la double riziculture annuelle peut se produire. Pour cela le « vary taogno » ou le riz de la deuxième saison est la plus productive.
La partie marécageuse ou « lalin-drano » : rizière non drainée sur laquelle les paysans ne pratiquent qu’une simple riziculture annuelle qui est le « vary taogno ». Cette partie est très sensible à l’inondation.
« hôba » : rizière aménagée sur les plaines alluviales où la gestion de l’eau dépend du débit et du niveau d’eau de la rivière ou du fleuve qui les entourent : cas des rizières de la majorité des gens du village nommé « Andaly » dans le fokontany Rantolava, des rizières qui se situent entre la rivière Manjorozoro et le fleuve
« Maningory ». Dans ces rizières contrairement à celle de « akadrano » le riz de la première saison est plus productif que celle de la deuxième saison. Vu cette classification de bas fond, les zones les plus vulnérables aux cyclones et aux inondations sont les « hôba » et les « lalin-drano ».
Les dégâts Les inondations prolongées entraînent : la pourriture des plants déjà repiqués à cause de l’eau stagnante dans la rizière ; L’érosion : certaines terres des rizières en amont sont emmenées recouvrant celles en aval.
Table des matières
INTRODUCTION
PARTIE I : LE MILIEU D’ETUDE
1. LA SITUATION GEOGRAPHIQUE
2. LE MILIEU PHYSIQUE
2.1. La géologie
2.1.1. Les terrains sédimentaires
2.1.2. Le socle cristallin
2.2. Le relief
2.2.1. Les plaines
2.2.2. Les collines
2.3. L’hydrographie
2.3.1. Les fleuves et les rivières
2.3.2. Le lac Tampolo
2.4. La pédologie et la végétation
2.4.1. Les sols hydromorphes à tourbe des bas fonds
2.4.2. Les sols sableux dunaires
2.4.3. Les sols limono- sableux du « baiboho » ou « hôba »
2.4.4. Les sols ferralitiques
2.5. Le climat
2.5.1. La pluviométrie
2.5.2. La température
2.5.3. Le vent
2.5.4. Les cyclones
2.6. Les différents terroirs
3. LE MILIEU SOCIO-ECONOMIQUE
3.1. La démographie
3.2. Les pratiques traditionnelles : les Us et Coutumes
3.3. Le milieu économique
3.3.1. Les activités agricoles
3.3.2. Les activités para agricoles
3.3.3. Les activités non agricoles
PARTIE II : MATERIELS ET METHODES
1. LA PROBLEMATIQUE
2. LES HYPOTHESES DE RECHERCHE
3. LES MATERIELS ET METHODES
3.1. La méthodologie adoptée
3.1.1. La recherche bibliographique
3.1.2. Les visites sur terrain
3.1.3. Les enquêtes par questionnaire (ANNEXE II)
3.1.4. Les traitements des données
3.2. Le matériel
3.3. Les limites du travail
PARTIE III : LES SERIES EVOLUTIVES DES SYSTEMES AGRAIRES
1. L’ECOSYSTEME ORIGINEL
2. LE SYSTEME AGRAIRE AVANT LA COLONISATION MERINA : culture itinérante sur brûlis
associé à la chasse et à la pêche
2.1. Le climat
2.2. l’historique du peuplement
2.3. L’habitat
2.4. Les systèmes de productions
2.4.1. Système de culture d’abattis brûlis des milieux boisés
Itinéraire technique
Les ennemis de la culture
Destination de la production
2.4.2. Système d’élevage bovin
2.5. Les autres activités
2.5.1. La chasse
2.5.2. La pêche
2.6. Organisation et fonctionnement du système social productif
2.6.1. Acquisition des terres
2.6.2. Organisation et structure familiale
3. Le système agraire pendant la colonisation Merina : un Système agraire d’abattis brûlis
avec une friche boisée de 10 à 25 ans associé à la riziculture de bas fonds, intégration de
l’élevage bovin à l’agriculture
3.1. Etat du milieu
3.2. Village
3.3. Description des systèmes de production
3.3.1. La riziculture de bas fonds
3.3.2. Système d’élevage bovin
3.4. Autres activités
3.4.1. Artisanat
3.4.2. Commerce.
3.5. Organisation sociopolitique
4. Les transformations imputables à la colonisation Française : développement des cultures d’exportation, extension de la riziculture de bas fonds et déboisement intense
4.1. Etat du milieu
4.2. Les systèmes de culture
4.2.1. Les cultures vivrières
4.2.2. Les cultures d’exportation
Le girofle
Le café
Le bananier
4.3. Les systèmes d’élevage
4.3.1. L’élevage bovin
4.3.2. Le petit élevage
4.4. Les autres activités
4.4.1. L’exploitation forestière
4.4.2. La pêche
4.5. L’organisation sociale productive
5. Le système agraire pendant la première la république
6. Système agraire actuel
6.1. Etat du milieu
6.2. Etude des systèmes de production
6.2.1. Moyens de production
La terre
Le travail
Le capital
6.2.2. Les systèmes de cultures
6.2.3. Système d’élevage
Elevage bovin
Elevage porcin
L’aviculture
L’apiculture
6.3. Autres activités
6.3.1. La pêche
6.3.2. L’exploitation forestière
QUELLES SONT ALORS LES ACTIVITES AGRICOLES LES PLUS TOUCHEES ET COMMENT LES
PAYSANS S’ADAPTENT- ILS ?
6.4. Etat actuel du climat
6.4.1. La riziculture des bas fonds
6.4.2. Le riz de « tavy »
6.4.3. Les autres cultures vivrières et les arbres fruitiers
6.4.4. Les girofliers
6.4.5. L’élevage
6.4.6. Environnement : dégradation de la couverture végétale et du sol
6.4.7. L’effet positif du changement climatique
6.5. Typologie des exploitations
6.6. Chronogramme des activités
6.7. Etude économique de chaque catégorie
PARTIE IV : COMMENTAIRE ET RECOMMANDATIONS
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
GLOSSAIRE
ANNEXES