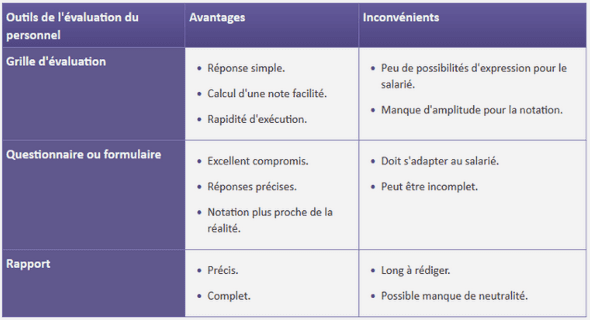La France sous la IIIème République : la naissance du « problème » de l’immigration
De 1860 à 1880, la France voit son empire colonial se développer : le pays accueille des migrants en provenance d’Algérie et d’Amérique latine mais aussi de Belgique, d’Italie, d’Espagne, d’Allemagne et de Suisse, qui viennent travailler dans l’industrie de transformation. Dans la seconde moitié du 19ème siècle, l’immigration devient un problème du fait d’une contradiction14 : le phénomène migratoire s’accentue pour l’intérêt de l’économie alors que se développe un processus de construction sociale de la nation « France » pour transcender les particularismes locaux et les différences de classes (création de la carte d’identité, distinction entre nationaux et étrangers). Face à cette contradiction, l’intervention de l’État dans le domaine de l’immigration devient légitime. Le « problème » de l’immigration fait irruption dans le débat public français entre 1880 et 1900. C’est à cette période que naît l’opposition entre national et étranger. Les pouvoirs publics mettent en avant le « génie assimilateur15 » de la France : les provinces constitutives de la France, d’abord étrangères les unes aux autres, se seraient fondues dans le creuset national et la Révolution aurait donné une conscience collective au pays.
La France est le pays d’Europe où l’État se reconstitue le plus vite après l’effondrement de l’Empire carolingien. Les rois capétiens étendent leur territoire à l’aide de guerres et d’alliances. La royauté conforte sa légitimité en s’appuyant sur l’Eglise chrétienne, le roi étant considéré comme l’envoyé de Dieu sur Terre. Le caractère sacré de la monarchie capétienne explique l’importance attachée à l’unité de la foi dans le royaume. Les dissidences religieuses sont combattues, les « hérétiques » (les cathares puis les huguenots) et les juifs sont persécutés. Au début de la IIIème République, sur 36 millions d’habitants, la France comprend 35.4 millions de catholiques (Noiriel, 2007). C’est au début de la IIIème République que les rois imposent aux curés (qui s’occupent des registres consignant l’identité des sujets du royaume) de rédiger ces registres en français. C’est par le biais de ces documents que des millions de paysans sont mis en contact avec la langue de l’État. Autres facteurs facilitant l’émergence de la langue française à travers les provinces françaises : l’invention de l’imprimerie, qui accroît les possibilités de communication à distance, la création de l’Académie française, chargée de codifier et d’imposer les normes de la langue officielle du royaume et la naissance de la société de cour implantée au Château de Versailles à l’initiative de Louis XIV. C’est toute une culture française qui s’invente.
Louis XIV confie des fonctions administratives et judiciaires à des bourgeois, qu’il anoblit. Ces derniers devant tout à leur prince, le servent avec beaucoup de zèle. En 1789, 2 000 personnes contrôlent tout le royaume. Sous leur impulsion, le domaine royal devient un espace public géré par un corps d’administrateurs détachés du service domestique du roi. L’État français moderne se construit. La principale tâche de ces administrateurs est de renflouer les caisses de l’État, asséchées par les entreprises guerrières de la monarchie. C’est la première forme d’économie : le mercantilisme, fondée sur une comptabilité rigoureuse des importations et des exportations. Sont créés les premiers instruments pour recenser les ressources du royaume. Durant le dernier siècle de l’Ancien Régime une « mise en écriture » des activités économiques et sociales est effectuée, embryons de recensement.
L’« immigration » correspond au déplacement des individus d’un endroit à un autre et le franchissement d’une frontière. Qualifier l’immigration implique que l’État prenne possession d’un territoire bien délimité, sur lequel exercer sa souveraineté. Pendant l’Ancien régime, le roi exerce son pouvoir sur des sujets, non sur un espace. Le pouvoir du roi repose alors sur les allégeances personnelles des sujets car il n’existe pas de moyens techniques pour imposer son pouvoir à distance. Le roi prend appui sur des « corps intermédiaires » qui représentent les différentes communautés cohabitant sur le territoire : le roi ne cherche donc pas à « assimiler » les populations qui dépendent de lui. Dans les territoires, les gens ont leurs coutumes propres et parlent leur langage. A partir de 1750, la mobilité des hommes se développe. Les deux préoccupations pour l’État sont d’assurer la sécurité des hommes qui circulent sur le territoire et de trouver des moyens pour surveiller tous les inconnus qui sillonnent l’Europe. Dans un monde où les rapports sociaux reposent sur l’interconnaissance, l’étranger est celui que l’on n’a jamais vu. On le juge sur sa mine et ses manières. La maréchaussée en milieu rural et la police en milieu urbain permettent d’améliorer la sécurité. L’outil de la police pour gérer les problèmes de mobilité est le passeport. Il permet de canaliser les déplacements pendant les périodes de crise : on interdit l’entrée des villes aux vagabonds et aux mendiants en les rapatriant dans leur paroisse d’origine. Sous l’Ancien régime, tous les habitants nés sur le territoire d’une seigneurie ont la nationalité française car ils sont considérés comme les « hommes » du seigneur. Ils lui doivent obéissance, il les protége en contrepartie. A partir du 19ème siècle, l’État monarchique s’approprie les prérogatives des seigneurs. Les personnes nées dans le royaume sont considérées comme françaises. Les étrangers qui s’installent dans le pays bénéficient de la protection royale mais doivent en échange payer des taxes. Pour remplir les caisses de l’Etat, une taxe visant les chefs de famille étrangers résidant en France et leurs descendants (9 000 personnes entre 1697 et 1707) est créée en 1697. La création de cette taxe constitue une initiative inédite, l’édit de 1697 étant la première tentative d’identification de la population étrangère dans le royaume. Cette tentative est un échec du fait du manque de moyens pour distinguer les nationaux et les étrangers.
Nous l’avons vu, le roi s’appuie sur la bourgeoisie pour développer les fonctions administratives de l’Etat : la noblesse d’épée s’en trouve appauvrie. Le développement de la culture écrite et les rivalités entre noblesse d’épée et noblesse de robe sont des objets de controverses publiques. L’aristocratie dénonce le pouvoir administratif qui anéantit ses libertés. Pour les aristocrates, les privilèges de l’aristocratie sont justifiés car ils descendent de la « race » qui a vaincu les Gaulois. A l’époque, « nation » et « race » sont interchangeables : ils désignent un groupe d’individus ayant en commun la même naissance, c’est le sens médiéval de « lignage » qui domine. Les aristocrates dénoncent les pratiques monarchiques d’anoblissement qui créent une noblesse « artificielle » car on ne peut pas « changer le sang » par un acte administratif (Boulainvilliers). Des écrivains comme Montesquieu contestent l’importance accordée à la « race » et soulignent le rôle du « climat » (du milieu) dans l’histoire des peuples. Le mot « nation » désigne alors la communauté issue de la fusion des groupes ethniques initiaux, c’est-à-dire le tiers-état ». A la veille de la Révolution française, les élites aristocratiques et bourgeoises ont intériorisé les normes de la culture officielle française, mais pas les classes populaires : la société française est caractérisée par une grande hétérogénéité. Le manque de moyens explique l’incapacité du pouvoir central de franciser les régions très éloignées de Paris. De plus, la mise en place de la société de cour attire la noblesse à Versailles et affaiblit les relais qui permettaient de maintenir le lien entre le centre et la périphérie. A noter également l’illettrisme de la majeure partie de la population paysanne. A la Révolution de 1789, la bourgeoisie qui a combattu l’absolutisme royal et les privilèges de l’aristocratie prend le pouvoir. Le discours du pouvoir révolutionnaire est le suivant : c’est le tiers-état qui détient la souveraineté, non plus le roi. Dès lors, la vie publique s’incarne dans le Parlement et l’opinion publique est véhiculée par la presse (création du Journal des débats en 1789 qui informe quotidiennement les citoyens sur les péripéties de la vie politique). Une importance considérable est accordée à l’égalité des droits et le rejet des discriminations fondées sur l’origine : c’est la suite du combat mené par l’élite bourgeoise contre les privilèges de l’aristocratie. En effet, au 19ème siècle, l’infériorité des bourgeois n’est pas économique et culturelle mais juridique et symbolique, c’est pourquoi les révolutionnaires pensent qu’établir l’égalité des droits va permettre d’accéder à l’égalité des conditions. On assiste à l’émergence d’un espace national juridiquement homogène, reposant sur un appareil administratif centralisé et fortement hiérarchisé commandé par l’échelon supérieur dont les rouages sont regroupés à Paris, relayé par les autorités cantonales et départementales, qui exerce son action dans les 36 000 communes de France. L’homogénéisation du territoire français entraîne la démarcation nette entre l’intérieur et l’extérieur.
Dans les premières années de la Révolution, la définition de la nationalité est civique : l’étranger est considéré comme un citoyen s’il se comporte comme un patriote. Ce n’est pas l’origine ni le lieu de naissance qui importe mais l’engagement politique. La question nationale ne se pose aux européens que lorsque la République entre en guerre contre ses voisins. La bataille de Valmy entraîne une bouffée de nationalisme et une chasse aux espions. Le 1er août 1793, la Convention décrète que ceux qui viennent de pays en guerre avec la République et qui ne sont pas domiciliés en France doivent être arrêtés ou expulsés.
La Révolution donne lieu à la nationalisation de la société française : le Code civil nouvellement créé donne les mêmes droits à tous les français. Mais ce premier stade de la nationalité ne suffit pas à assurer l’intégration verticale de toutes les classes au sein de l’Etat.
Avec la suppression des privilèges, la propriété privée triomphe, la noblesse et la bourgeoisie se fondent dans une nouvelle classe dirigeante : les notables, de grands propriétaires vivant de leurs rentes et qui constituent des relais essentiels entre l’Etat central et la société locale. Ils sont hostiles à la démocratie car ils estiment que les classes populaires ne sont pas assez éduquées pour participer pleinement à la vie politique. Pour Guizot, président du Conseil des Ministres, les classes supérieures ont pour mission de « représenter » les classes pauvres et de les protéger. Jusqu’au Second empire, l’industrie textile prédomine, les usines s’installent à la campagne, l’exode rural est faible, les migrations demeurent internes au monde rural, des migrants saisonniers sont recrutés dans l’agriculture. Entre 1801 et 1846, la population de Paris double (547 000 / 1 million). Les migrants viennent de France et des pays voisins (37 000 étrangers en 1832). Chaque groupe se spécialise dans une activité particulière. Tous ces migrants se regroupent en petites communautés en fonction de leur origine locale ou régionale. Ils possèdent leurs sociétés de bienfaisance, leurs églises, leurs écoles. L’intensification des mouvements migratoires entraîne la multiplication des conflits entre nouveaux venus et sédentaires. Dans les villes, les conflits se produisent surtout pendant les périodes de crise économique. Les gens du pays reprochent aux « étrangers » de venir « manger leur pain » et de travailler à des tarifs inférieurs aux usages locaux (Noiriel, 2007, p. 39). Les urbains rédigent des pétitions et des « placards » pour exiger des autorités l’expulsion des envahisseurs. Ces conflits illustrent l’ampleur des cloisonnements entre des micro-sociétés locales, ce qui alimente des préjugés sur les groupes minoritaires (les gitans égorgeurs d’enfants, les juifs trafiquants…). Jusqu’en 1848, le clivage nationaux / étrangers n’est pas au centre des conflits car ce sont toujours les appartenances locales qui priment. Dans les années 1849, Louis Desnoyers publie un ouvrage consacré aux « étrangers à Paris » qui souligne, à force de comparaisons stéréotypées certes, que tous ces étrangers (belges, polonais, russes, espagnols…) sont « très proches de nous » (Noiriel, 2007, p. 42). En revanche, dans un contexte de conquête militaire de l’Algérie, il existe une ligne de fracture sensible : les arabes. Dans le chapitre intitulé « l’arabe » de l’ouvrage de Louis Desnoyers, la description n’est pas hostile ni méprisante mais l’ouvrage indique que « la foule se presse autour d’eux avec une muette curiosité et se demande si ce ne sont pas là des hommes d’un autre type et d’une autre nature qu’elle » (Noiriel, 2007, p. 42).
Dans les années 1840, la classe ouvrière est assimilée par les notables à la classe dangereuse. Les ouvriers se sont instruits, savent lire et écrire : émerge une élite du monde ouvrier artisanal qui prend la parole publique en éditant ses propres journaux (la Ruche ouvrière, l’Atelier). Pour Gérard Noiriel, la Révolution de 1848 est l’aboutissement de ce processus : les classes populaires de Paris représentent le « peuple », en opposition à la bourgeoisie. La révolution de 1848 est une étape essentielle dans le processus qui relie la question nationale au thème migratoire. Lors des revendications populaires, les individus s’en prennent aux étrangers : des belges, des anglais, des prussiens. Des rivalités se renforcent dans l’industrie houillère (en mars 1848, 2 000 mineurs se mobilisent pour faire fuir 300 à 400 italiens).
Sous le Second empire, l’immigration en provenance des pays voisins se développe fortement (381 000 étrangers en 1851, 655 000 en 1866). La construction du réseau ferré, le développement de la production métallurgique et minière, la mécanisation de l’industrie textile poussent les entreprises à chercher davantage de main d’œuvre. Ce brutal développement de l’immigration crée des tensions avec la population locale, conflits internes au monde ouvrier. Mais l’immigration étrangère et ses problèmes ne sont pas relayés dans le discours public. Ce qui inquiète à l’époque c’est la paupérisation des classes ouvrières qui créent désordre et révolution. Le développement des moyens de communication rend les frontières archaïques, les hommes sont libres de circuler (traités de libre-échange avec la Grande Bretagne et la Belgique en 1860), le libéralisme se renforce. La France est célébrée pour son hospitalité, Paris est vendue comme « un immense creuset » (Noiriel, 2007, p. 76). Pour preuve, le recensement de 1856 ne mentionne pas la nationalité des individus. Celle-ci n’apparaît dans les recensements qu’à partir de 1861. Règne alors un climat libéral, Napoléon III indique que « le droit doit se garder d’entraver, en aucune mesure, les établissements créés par des étrangers en France [car] la crainte de perdre leur nationalité pourrait en détourner beaucoup de venir importer chez nous leurs capitaux et leur industrie16 ». Ainsi, le législateur supprime en 1867 les discriminations qui touchent les naturalisés. Pour pouvoir demander sa naturalisation, un étranger doit avoir vécu en France trois ans au lieu de dix. Il n’y a plus aucune distinction entre ces nouveaux français et les français de naissance. En 1856, après le conflit entre la France et la Russie, Napoléon décide de ne pas mettre en place de mesures de rétorsion à l’égard de la colonie russe présente sur le territoire national car « il fait la guerre aux princes, pas aux peuples ». En 1870, pour les mêmes raisons, il refuse l’internement de dizaines de milliers d’émigrés allemands travaillant en France. En 1865, les indigènes algériens ne sont plus considérés comme des étrangers : « l’indigène musulman est français » (Noiriel, 2007, p. 78).
En 1856, la réflexion sur les « races » connaît une nouvelle impulsion avec les travaux publiés par les naturalistes et les anthropologues. L’ouvrage de Darwin sur la sélection des espèces représente une date fondamentale car un nombre important d’émules tente de reprendre ses analyses pour comprendre le fonctionnement de la société. En 1853, Arthur de Gobineau publie son « Essai sur l’inégalité des races humaines ». Cet auteur est souvent présenté comme le fondateur du racisme. A ses yeux « la question ethnique domine tous les autres problèmes de l’histoire […] L’inégalité des races dont le concours forme une nation suffit à expliquer tout l’enchaînement des destinés des peuples17 ». Les alliages successifs entre les groupes ethniques qui se sont fixés sur le territoire auraient provoqué la dégénérescence du peuple français qui n’a pas conservé le même sang dans les veines. Pour démontrer que l’assimilation n’est pas possible, il prend l’exemple des algériens. Les musulmans formeraient une « race » très mélangée, ce qui expliquerait leur instabilité : « l’islamiste est arrogant, peu inventeur et déjà d’avance conquis aux deux tiers à la civilisation greco-asiatique » (Noiriel, 2007, p. 80). Même type de raisonnement pour l’Afrique Noire : « l’européen ne peut pas espérer civiliser le nègre » (De Gobineau, 1884, pp. 182-185). Ces analyses sont similaires pour le contexte national, caractérisé par de nombreuses divisions locales : « tout le monde sait combien le Normand, le Provençal, le Gascon se ressemblent peu » (De Gobineau, 1884, p. 80). La division notables / paysans est claire : il n’existe pas à l’époque de « territoire national » unifié.
La guerre de 1870 est une rupture essentielle dans l’histoire de la France républicaine. La défaite de Napoléon III devant la Prusse achève de discréditer les notables. Les dirigeants de la IIIème République mettent en chantier les réformes de démocratisation de la vie politique française. L’espace public est restructuré autour de la politique, du journalisme et de la science. Le principal objectif de la IIIème République est d’intégrer les classes populaires à l’Etat-nation. La démocratisation de la vie politique impose un nouveau système de représentations collectives. Grâce au suffrage universel masculin, les classes populaires participent indirectement à la vie politique en votant et en achetant le journal. Pour que cette nouvelle forme de démocratie fonctionne, il faut rompre avec l’hétérogénéité de la société, passer du particulier au général à l’aide de trois type d’acteurs. Les hommes politiques s’adressent aux classes qu’ils représentent et contribuent à les faire exister dans l’espace public. La popularité du discours sur la lutte des classes encourage les hommes politiques à parler au nom de la nation. Les syndicats et associations constituent des collectifs grâce auxquels les citoyens peuvent faire entendre leur voix dans l’espace public. Les journalistes écrivent leurs articles sur le registre agresseurs / victimes et se présentent comme les porte-parole des ces dernières : c’est la fonction du journaliste dans l’espace public. Enfin, les juristes fabriquent la notion de « personne morale » et jouent un grand rôle dans la définition des catégories d’ayants droits produites par les nouvelles lois sociales. Durant les dernières décennies du 19ème siècle, la France élabore les nouvelles nomenclatures des recensements. La nationalité et la catégorie socioprofessionnelle sont les principaux critères retenus pour appréhender la société française. L’appareil statistique fixe les grandes lignes du « modèle républicain ». Les tentatives pour enregistrer les « races », les religions ou les groupes ethniques sont abandonnées au nom des Droits de l’Homme. Jusqu’au milieu du 19ème siècle, les recensements servent à évaluer les ressources du royaume. Sous la IIIème République, les statistiques « descriptives » cèdent la place aux statistiques prescriptives » : les catégories administratives affectent désormais les intérêts et l’identité individuelle ou collective des citoyens, les catégories statistiques ont des effets puissants dans la construction des groupements sociaux. Le mouvement d’intégration nationale passe par la diffusion des normes élaborées par la société de cour dans toutes les couches qui ont accès à la communication écrite. Cette culture, parisienne dans la première moitié du 19ème siècle, devient nationale sous la IIIème République. La population étrangère double entre 1872 et 1886, soit 1,2 million de personnes. L’immigration de voisinage explose en raison de la signature des traités de libre circulation des hommes et des marchandises. Entre 1886 et 1914, la population étrangère se renouvelle : les nouveaux migrants sont allemands, espagnols, anglais et suisses. Des réfugiés russes arrivent en petit nombre pour échapper au régime du Tsar. La seconde révolution industrielle donne lieu à l’arrivée massive des italiens : ils forment la première communauté étrangère de France dès le début du 20ème siècle. Le faible exode rural entraînant un manque de main d’œuvre, les entreprises embauchent des étrangers dans les grandes villes et les paient moins. L’intensification du recours à la main d’œuvre étrangère exacerbe les tensions au sein du monde ouvrier : se consolide le clivage entre les ouvriers locaux et ceux qui viennent d’ailleurs. Les conflits atteignent leur paroxysme pendant la crise entre 1880 et 1890.
L’affaire dite « des Vêpres marseillaises » représente un tournant car, pour la première fois, un conflit entre ouvriers au niveau local est décrit comme un problème politique national. L’écho donné par la presse parisienne à cet événement incite le gouvernement républicain à se pencher sur ces rixes. Juillet 1881 : le ministère de l’Intérieur commande une étude dans toutes les préfectures pour avoir une vue d’ensemble sur les relations de travail entre « ouvriers français et étrangers ». A partir de cette date, les incidents locaux sont décrits comme des conflits nationaux. La centralisation de ces informations accroît leur visibilité, ce qui permet aux journalistes de les utiliser dans leurs articles. L’affaire « des Vêpres marseillaises » joue un rôle essentiel dans l’invention du problème de l’immigration. A partir de 1881, de nombreux articles de presse sont consacrés aux étrangers en France. Deux nouveaux thèmes font leur apparition : l’espionnage et les conflits entre les travailleurs de différentes nationalités. Alors que les journaux insistaient jusqu’alors sur les conflits patrons / ouvriers, l’accent est désormais mis sur le clivage national. La « fait-diversification » de la politique dans la presse de masse joue un rôle essentiel dans le triomphe d’un nouveau discours public sur l’étranger, présenté à la fois comme un espion, un anarchiste, un criminel, suspecté de déloyauté et usurpant le travail des nationaux. Les français deviennent les victimes de cette menace incarnée par l’étranger. A la fin du 19ème siècle, c’est le stéréotype du barbare qui s’impose dans le discours sur l’immigration et qui justifie une politique sécuritaire à l’égard des étrangers. Avec l’arrivée de migrants en provenance de l’empire colonial, le stéréotype du sauvage différencie les « primitifs » des colonies sont présentés sur un mode humoristique. On retrouve le même registre dans les journaux pour enfants, à tel point que pour Marc Angenot qui a étudié l’ensemble des écrits publiés en 1889 « il n’est pas exagéré de dire que l’apprentissage du mépris racial est la visée dominante de la presse pour la jeunesse18 ». Ces stéréotypes véhiculés par la presse seront repris par les hommes politiques français pour alimenter leurs luttes de concurrence. La IIIème République assiste à la politisation des problèmes d’immigration qui s’effectue par une mise en équivalence de tous les éléments qui définissent l’étranger comme un ennemi de l’intérieur : espion et criminel, il prend le travail des Français et grève les budgets d’assistance » (Noiriel, 2007, p. 165). L’étranger qui n’était qu’un acteur des récits des faits divers devient un personnage central du discours politique. Cette politisation de l’immigration donne lieu à une réflexion relative à la nationalité française. Le 26 juin 1889 est adoptée une loi qui constitue le fondement de l’actuel Code de la Nationalité : elle fait une place plus grande au droit du sol en permettant aux enfants d’étrangers nés en France de devenir français à leur majorité, sauf s’ils refusent la nationalité française. Cette loi abaisse également les droits de sceau pour l’accès à la naturalisation : on estime qu’un million de personnes est devenu français dans les décennies qui ont précédé la Première Guerre Mondiale, en application de la loi de 1889. Cette loi donne lieu à un important débat qui aboutit à une réforme en 1893 qui fixe sur le plan juridique deux groupes d’individus jugés inassimilables. Les premiers sont les étrangers qui menacent la nation française :
ce sont les « barbares » évoqués plus haut. Les seconds sont les indigènes des colonies, les sauvages » qui ne peuvent avoir les mêmes droits que les autres car ils ne sont pas civilisés. Les lois de 1889 et 1893 institutionnalisent la puissante ligne de démarcation qui sépare désormais nationaux et étrangers.
Autre événement, l’affaire Dreyfus joue un rôle fondateur dans l’histoire de la stigmatisation des origines. C’est à cette période qu’apparaît le lexique utilisé aujourd’hui pour nommer la haine de l’Autre : « antisémitisme », « racisme », « xénophobie ». Avec la publication de « La France Juive » d’Edouard Drumont en 188619, la croyance dans la malfaisance des juifs se répand dans l’opinion publique. Cette publication est considérée comme le point de départ de l’antisémitisme en France. Cet ouvrage rassemble tous les préjugés traditionnels à l’encontre des juifs et l’auteur doit son succès à la rhétorique spécifique qu’il utilise pour convaincre ses lecteurs. Cette rhétorique consiste à reprendre l’actualité que la grande presse met à l’ordre du jour, présenter un diagnostic sur les malheurs du peuple et proposer des remèdes politiques.
Edouard Drumont parvient à nouer une complicité tacite avec son public ; son ouvrage devient un best-seller. L’ouvrage provoque une vive polémique et fait naître en France un « problème juif ». L’antisémitisme se constitue alors en courant politique reposant sur l’idée que les juifs « posent problème ». Cette politisation du « problème juif » s’accompagne de sa laïcisation : une nouvelle mise en équivalence juif / étranger domine le discours public. Drumont parvient, avec son ouvrage puis son journal « La Libre Parole », à construire un personnage mis en scène dans des situations constamment négatives. C’est dans ce contexte qu’éclate l’Affaire Dreyfus. Elle débute le 15 octobre 1894, jour de son arrestation, et s’achève le 13 janvier 1898, par la publication de l’article d’Emile Zola « J’accuse ! ». À la fin de l’année 1894, le capitaine de l’armée française Alfred Dreyfus, polytechnicien, juif d’origine alsacienne, accusé d’avoir livré aux Allemands des documents secrets, est condamné au bagne à perpétuité pour trahison et déporté sur l’île du Diable. À cette date, l’opinion, comme la classe politique française, sont unanimement défavorables à Dreyfus. Certaine de l’incohérence de cette condamnation, la famille du capitaine, derrière son frère Mathieu, tente de prouver son innocence, engageant à cette fin le journaliste Bernard Lazare. Parallèlement, le colonel Georges Picquart, chef du contre-espionnage, constate en mars 1896 que le vrai traître est le commandant Ferdinand Walsin Esterházy. L’État-major refuse pourtant de revenir sur son jugement et affecte Picquart en Afrique du Nord. Afin d’attirer l’attention sur la fragilité des preuves contre Dreyfus, sa famille contacte en juillet 1897 le respecté président du Sénat Auguste Scheurer-Kestner qui fait savoir, trois mois plus tard, qu’il a acquis la conviction de l’innocence de Dreyfus, et qui en persuade également Georges Clemenceau, ancien député et alors simple journaliste. Le même mois, Mathieu Dreyfus porte plainte auprès du ministère de la Guerre contre Walsin-Esterházy. Alors que le cercle des dreyfusards s’élargit, deux événements quasi simultanés donnent en janvier 1898 une dimension nationale à l’affaire : Esterházy est acquitté, sous les acclamations des conservateurs et des nationalistes ; Émile Zola publie « J’Accuse…! », plaidoyer dreyfusard qui entraîne le ralliement de nombreux intellectuels. Un processus de scission en deux de la France est entamé, qui se prolonge jusqu’à la fin du siècle. Des émeutes antisémites éclatent dans plus de vingt villes françaises. On dénombre plusieurs morts à Alger. La République est ébranlée, certains la voient même en péril, ce qui incite à en finir avec l’affaire Dreyfus pour ramener le calme. Malgré les menées de l’armée pour étouffer cette affaire, le premier jugement condamnant Dreyfus est cassé par la Cour de cassation au terme d’une enquête minutieuse, et un nouveau conseil de guerre a lieu à Rennes en 1899. Contre toute attente, Dreyfus est condamné une nouvelle fois, à dix ans de travaux forcés, avec, toutefois, des circonstances atténuantes. Épuisé par sa déportation de quatre longues années, Dreyfus accepte la grâce présidentielle, accordée par le président Émile Loubet. Ce n’est qu’en 1906 que son innocence est officiellement reconnue au travers d’un arrêt sans renvoi de la Cour de cassation, décision inédite et unique dans l’histoire du droit français. A l’époque, la plus grande partie des juifs cherche à échapper à la stigmatisation en affirmant qu’il n’y a pas de problème juif » en France. Refuser d’admettre le « problème » mis sur la place publique par le camp adverse est un réflexe constant chez les personnes victimes du racisme. Selon la psychologie sociale, les individus stigmatisés s’efforcent généralement de soustraire au regard dominant les éléments de leur identité personnelle qui sont publiquement montrés du doigt. Ce type de réflexe explique qu’un grand nombre de juifs ne se soit pas mis en avant au moment de l’affaire Dreyfus, estimant que toute manifestation publique de solidarité avec le capitaine serait interprétée par les antisémites comme une preuve de la justesse de leur analyse sur la « solidarité des races ».
De la Première Guerre Mondiale à 1945 : une politique d’immigration en chantier
Après la Première Guerre Mondiale, les frontières américaines se ferment et le phénomène migratoire s’accroît. Plusieurs vagues de réfugiés de différentes origines (russes, arméniens, géorgiens, juifs, antifascistes italiens, hongrois, roumains, tchécoslovaques…) ainsi que des immigrés venant d’Italie, de Pologne, de Tchécoslovaquie et des réfugiés affluent en France. Au début des années 1920, l’immigration nord-africaine, non désirée, se développe. En 1924, elle est d’ailleurs interdite à l’occasion d’une poussée du chômage en métropole. Puis des régularisations massives ont lieu à la fin des années 1920 (21 620 en 1928, 43 928 en 1929, 60 000 en 1930) (Weil, 2005, p. 27). De la fin du 19ème siècle à la fin des années 1930, le déficit démographique de la France a de lourdes conséquences sur le marché de la main d’œuvre et sur les besoins de recrutement de l’armée, qui fait venir de la main d’œuvre étrangère. Cette main d’œuvre, recrutée dans les industries de transformation est une « immigration de voisinage » (Weil, 2005, p. 23) en provenance d’Allemagne, de Belgique, du Luxembourg, des Pays Bas, de Grande Bretagne. Ainsi, en 1930, la France est le pays qui compte le plus fort taux d’étrangers (515 pour 100 000 habitants contre 492 aux États-Unis). Dans les années 1920, les immigrés ne sont pas des privilégiés : ils subissent un contrôle social contraignant, reçoivent un salaire modeste et sont exposés, dès les années 1930, à la crainte du retour forcé en cas de chômage ou de non renouvellement de titre. Philippe Serre, sous-secrétaire d’Etat chargé des services de l’immigration et des étrangers auprès de la présidence du Conseil puis Secrétaire d’Etat au travail, favorise une immigration économique, utilitariste : il développe une politique de sélectivité professionnelle en fonction des besoins en main d’œuvre. Les populations immigrées sont choisies en fonction de leur capacité (supposée) à s’assimiler : l’immigration « néfaste » est opposée à l’immigration « utile ». Patrick Weil parle de « politique de sélectivité ethnique ». C’est le début de l’ « immigration choisie ».
Lors de la crise des années 1930, l’immigration continue de croître alors que le Parlement prend des mesures restrictives, poussé par l’opinion publique. La crise économique aboutit à la loi du 10 août 1932 accordant la priorité du travail à l’ouvrier français dans l’industrie en instaurant des quotas d’ouvriers étrangers dans les entreprises. La loi du 10 août 1930 autorise le gouvernement à prendre des décrets, à la demande des organisations syndicales ou patronales, pour fixer la proportion maximale de travailleurs étrangers (des quotas) dans les entreprises. Le 21 avril 1933, la loi Armbruster limite l’exercice de la médecine aux seuls français. En juin 1934, les avocats français font voter une loi interdisant aux français naturalisés l’exercice de professions publiques instituées par l’Etat ou l’inscription au barreau. Dans un climat de xénophobie généralisée, l’Administration fait du zèle répressif en dépit du gouvernement du Front populaire. En 1935, un nombre important d’étrangers fait l’objet de départs contrôlés (surtout des ressortissants polonais). En dépit de la xénophobie ambiante et de l’arrêt des flux, l’accès à la nationalité française est facilité par une loi sur la naturalisation entérinée le 10 août 1927.