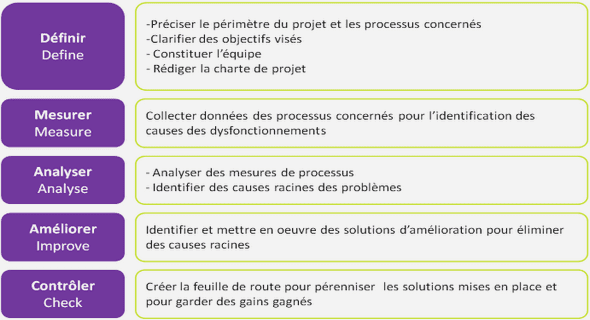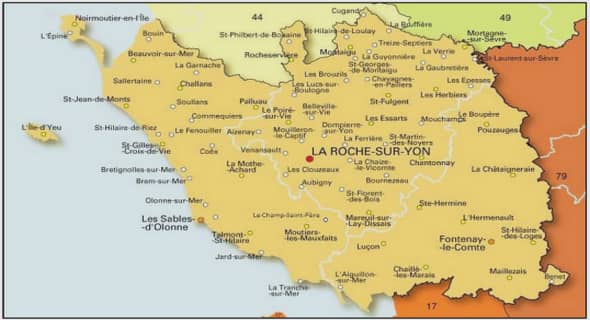Un droit intrinsèquement contradictoire
C’est parce qu’elle est formulée de manière abstraite par la Nation231 que la protection de la santé s’incarne dans des droits dérivés, dont le droit d’accès aux soins. S’ils sont complémentaires, les droits- créances et les droit – libertés, composant ce dernier, peuvent entrer en tension, dès lors qu’ils portent des objectifs potentiellement divergents. En outre, chacun de ces droits dérivés peut lui-même s’avérer intrinsèquement contradictoire. C’est pourquoi un déséquilibre entre les différentes polarités du droit d’accès aux soins viendrait fragiliser l’effectivité même de ce dernier. Composite et intrinsèquement contradictoire (§1), le droit de la protection de la santé trouve sa cohérence par la conciliation des droits dérivés qui le mettent en œuvre (§).
Un droit à « double face »
Enoncé comme un idéal, le droit à la protection de la santé est incarné, au sein du droit positif, par effet de ricochet233, par le droit d’accès aux soins. Contribuant ainsi à l’effectivité du droit à la protection de la santé, le droit d’accès aux soins se trouve à la croisée des prestations de soins et des prestations sociales. « Double » droit-créance, à ce titre, le droit d’accès aux soins se traduit également par l’exercice de libertés.
Dérivé du droit à la protection de la santé, le droit d’accès aux soins est composé de droits créances (A) et de droits-libertés (B).
Un double droit- créance
Inscrivant la protection de la santé dans l’ordonnancement positif (1), le droit d’accès aux soins forme un droit créance composite (2).
La portée juridique indirecte du droit d’accès aux soins
Consacré à de multiples reprises par le juge constitutionnel comme principe constitutionnel234, le droit à la protection de la santé demeure assorti d’une portée juridique incertaine235, due à son énonciation « vaguement programmatique »236, conforme aux intentions du Constituant de 1946237. Ainsi, la jurisprudence constitutionnelle consacre le droit la protection de la santé sous, au moins, trois vocables différents, sans que ces « glissements sémantiques »238 puissent être rattachés à une logique juridique particulière.
Formulant le droit à la protection de la santé comme un « principe239 », un « objectif défini par le préambule240 » ou encore un « impératif »241, la variété terminologique de la jurisprudence constitutionnelle en consacre la complétude, sans en lever, pour autant, l’indétermination originelle. La portée juridique attribuée au droit à la protection de la santé se révèle, en effet, instable. Si l’ordre judiciaire, en vertu de l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution, a explicitement reconnu la valeur constitutionnelle du droit à la santé et au repos242, le Conseil d’Etat s’est, en revanche, refusé à admettre la qualité de liberté fondamentale du droit à la santé243.
D’« une valeur juridique précise et indiscutable »244, le droit à la protection de la santé disposerait il paradoxalement d’une portée juridique chimérique ? La Nation appréhende la santé sous l’angle de sa protection, laquelle implique « un engagement à agir 245», formulé par l’expression « doit être mis en œuvre (…) », figurant à l’article inaugural du CSP246. Dès lors, on considérera qu’incarné en droit positif par le droit d’accès aux soins, le droit à la protection de la santé bénéficie d’une charge juridique « indirecte ».
Représentant in concreto le droit à la protection de la santé dans sa dimension la plus « tangible, et [la] plus exigible »247, le droit d’accès aux soins constitue un droit-créance. En effet, le droit d’accès aux soins commande la délivrance de « prestations matérielles »248 pour ses bénéficiaires, investis du « pouvoir d’exiger quelque chose »249.
Un droit-créance « mixte250 »
Un diptyque de droits-créance, d’une part, les prestations de soins, assurées notamment par les établissements de santé et d’autre part, les prestations sociales, versées par les organismes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire compose le droit d’accès aux soins251. En ce sens, susceptible d‘exercer son droit à des prestations de soins qu’il finance par le biais de ses cotisations sociales, le patient, assuré social, incarne, par lui-même, la « bipolarité » structurelle du système de santé, en tant que créancier-débiteur252.
Logiquement, le droit d’accès aux soins repose sur un principe d’égalité, résultant de la rencontre du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 avec les articles un et six de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789253. L’accès égalitaire aux soins emporte « un principe fondamental de non-discrimination »254 s’exerçant « au bénéfice de toute personne 255», hormis les cas de refus de soins par le médecin, lesquels sont expressément prévus par le législateur256. A l’égalité d’accès aux prestations de soins répond donc l’égalité d’accès aux prestations financières des soins. La mise en place d’un droit universel et solidaire à des prestations sociales participe de l’absence de discrimination et contribue à l’égalité de tous dans l’accès aux soins. L’article L160-1 du CSS dispose, en ce sens, que « toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé (…) ». Par conséquent, le droit d’accès aux soins est un droit-créance, présentant une double dimension, individuelle et collective. Qualifié d’objectif au regard de ses bénéficiaires258, le droit d’accès aux soins interroge, néanmoins, sur son éventuelle « tournure subjectiviste 259».
Sous l’angle de la santé publique, entendue par le Haut Comité de Santé Publique (HCSP) comme « un domaine d’action dont l’objet est l’amélioration de la santé de la population », la dimension objective du droit d’accès aux soins ne fait pas débat260. Ainsi, la Haute juridiction a considéré que la prohibition de publicité des produits du tabac est fondée sur « les exigences de la protection de la santé publique, qui ont valeur constitutionnelle 261», sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre. De même, instaurant, dans un objectif de protection de la santé publique, une taxe sur des boissons fortement alcoolisées, la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2003, a été confirmée dans sa conformité à la Constitution262.
J-M. Auby263 relève, toutefois, que poursuivant un objectif d’intérêt général et collectif, la santé publique emporte des bénéfices secondaires et indirects pour les individus, de sorte qu’une* incontestable dimension individuelle» ne peut être détachée droit d’accès aux soins264. En outre, si par son financement collectif et solidaire, le droit à la protection de la santé peut être qualifié de « propriété sociale partagée265 », il n’en reste pas moins que l’accès aux soins s’opère au regard des besoins sanitaires individuels de la personne266.
C’est pourquoi, adoptant la distinction, opérée par le Constituant lui-même, entre les bénéficiaires du droit à la protection de la santé, le juge constitutionnel appréhende le droit d’accès aux soins comme un droit « catégoriel ». L’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 singularise, au motif de leur vulnérabilité accrue, trois catégories de bénéficiaires que sont les mères, les enfants et les vieux travailleurs. Ainsi, la protection de la jeunesse est érigée en catégorie spécifique de « l’objectif de protection de la santé publique267 », tandis que la décision dite « IVG II » reconnait expressément le « droit à la protection de la santé de la femme 268». Les catégories peuvent être également caractérisées par des critères économiques ou juridiques, dès lors qu’ils sont corrélés à un surcroît de vulnérabilité. En ce sens, le juge constitutionnel consacre la protection particulière des salariés et des étrangers en situation régulière269.
Cependant, relevée par la doctrine, la circonspection du juge constitutionnel envers la qualification des conséquences individuelles du droit aux soins270 » invite à la prudence, d’autant qu’un « (…) objectif constitutionnel ne peut se matérialiser par un droit subjectif susceptible d’être invoqué tant à l’égard des pouvoirs publics que dans le cadre de relations de droit privé 271». Sans s’ériger en droit subjectif, le droit d’accès aux soins peut s’énoncer comme l’aptitude d’un individu à rencontrer, au motif de son état de santé272, une offre de soins appropriée. Il s’ensuit que l’organisation de l’accès aux soins, bien qu’appréciée au regard des besoins sanitaires de chaque personne, ne constitue pas en elle-même un droit subjectif, mais doit être considérée à l’aune de la protection de la santé publique273. N’ayant pas la consistance d’une liberté fondamentale274, et sa mise en œuvre s’exerçant dans la limite des moyens disponibles275, le droit d’accès aux soins demeure un droit objectif fortement coloré par une dimension individuelle.
Un droit- liberté dédoublé
En tant que droit-liberté, le droit d’accès aux soins s’exerce différemment selon que son titulaire est patient ou médecin (1). Il est par ailleurs d’une portée juridique limitée (2).
Une liberté de choix en miroir
Le droit d’accès aux soins est un droit-liberté spécifique consistant en la faculté d’exercer un droit créance276. Ainsi, le patient dispose d’un droit au consentement préalable aux soins qui lui sont proposés277. Fondé par « l’autonomie de la volonté de la personne »278, le droit au consentement préalable aux soins assure le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine et de la primauté de la personne279. En ce sens, si un « droit à la santé » n’a pas été reconnu au nombre des libertés fondamentales280, le droit reconnu au patient majeur, en état de s’exprimer, de consentir à un traitement médical revêt, en revanche, le caractère de liberté fondamentale281. Sous réserve d’une information claire, loyale et complète, la personne malade peut accepter ou refuser les actes à visée diagnostique ou thérapeutique qui lui sont proposés, au cours d’un colloque singulier, par un praticien. De même, le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être recherché, en complément de celui qu’exerce le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur.
La liberté reconnue à toute personne malade de choisir « son praticien et son établissement »282 peut s’analyser comme la faculté de choisir à qui et où « confier la protection de sa santé 283 ». La liberté de choix doit être respectée et facilitée par les médecins284. Obligatoirement affichée dans tous les établissements de santé, indépendamment de leur statut juridique, la charte de la personne hospitalisée285 rappelle à cet effet que « toute personne est libre de choisir l’établissement de santé dans lequel elle souhaite être prise en charge ». Par voie de conséquence, l’admission d’un patient dans un établissement de santé n’est soumise à aucune condition de résidence. La loi LMSS286 a, en outre, étendu le libre choix du patient au « mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile287 » en particulier lorsqu’il relève de soins palliatifs. La portée concrète de cette nouvelle avancée est à nuancer dès lors qu’« il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge288». Reste néanmoins que le libre choix du praticien par le patient289, placé à l’hôpital public dans la position statutaire d’usager, peut être tempéré par l‘organisation et la sécurité du service public hospitalier, dès lors que « dans les disciplines qui comportent plusieurs services, les malades ont, sauf en cas d’urgence et compte tenu des possibilités en lits, le libre choix du service dans lequel ils désirent être admis ». Autrement dit, dans le cadre du service public hospitalier, la liberté de choix du médecin, exercée par le patient est conditionnelle, et ne peut s’imposer à l’institution hospitalière, en particulier, pour des motifs religieux290. L’organisation administrative de la sectorisation psychiatrique291 laisserait penser qu’elle déroge à l’exercice du principe de libre choix des personnes malades292. L’admission d’un patient dans les établissements de santé spécialisés en psychiatrie procède en effet d’une double compétence : ratione loci, dès lors que la prise en charge d’un patient est « rattaché » à un secteur en fonction de l’adresse de son domicile et ratione materiae » orientant le patient selon son âge soit vers la psychiatrie générale et adulte soit vers la psychiatrie infanto-juvénile. Aucun obstacle n’est opposé in fine à l’exercice du principe de libre de choix du patient, dès lors que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques ou sa famille dispose du droit de s’adresser au praticien ou à l’équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence293 ».
82. Corollaires du libre choix du patient294 et résultant d’une obligation déontologique295, les libertés d’installation et de prescription 296 prévalent pour les professionnels de santé, médecins. La liberté d’installation se décompose en une liberté géographique, et en une faculté d’exercer soit en secteur libéral soit sur le mode salarial, sans considération des besoins sanitaires de la population. C’est au titre du respect de la liberté d’installation que les dispositions du schéma régional de santé (SRS)297 ne sont pas opposables aux professionnels de santé libéraux298, nonobstant les zones établies à l’issue d’un processus de concertation, par profession de santé et selon leur densité d’offre, par le directeur général d’agence régionale de santé299.