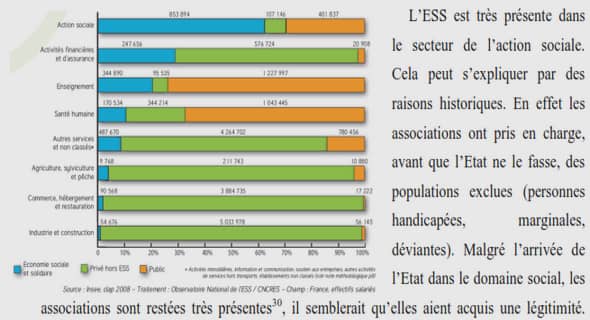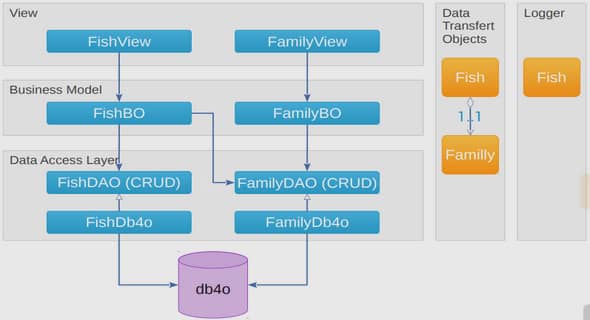La multiplicité des représentations et des pratiques d’un théâtre à vocation sociale
Le théâtre que Romain Rolland développe à la fin du XIXe siècle se dit « social » et repose sur la nécessité de sensibiliser le monde ouvrier à sa propre condition1. Ce théâtre, très proche des mouvements socialistes2, souhaite ni plus ni moins émanciper la classe ouvrière à travers son instruction.
Le théâtre « populaire » que Jacques Copeau défend à partir des années 1920 s’inscrit dans la tradition universaliste du théâtre, et a pour ambition de participer à l’unification nationale du pays3. Dans ce théâtre de tradition barrésienne, le peuple est alors défini dans une globalité transcendant les clivages de classe. Ce théâtre populaire sera réactivé à partir de la seconde guerre mondiale mais dépouillé de son caractère nationaliste1.
A partir des années 1960, le caractère unificateur du théâtre est contesté au profit de la défense d’un théâtre de classes. On parle alors, à partir des années 1970, d’un théâtre « politique » dont l’objectif principal est la politisation de la classe ouvrière2.
Enfin, ces dernières décennies ont vu s’imposer l’expression de « théâtre public » : constitué comme une catégorie s’opposant en tous points au théâtre privé, le « théâtre public » renvoie en réalité à des modes d’organisation juridique et administrative en même temps qu’à l’imaginaire d’un théâtre financé par tous et donc accessibles à tous.
Ainsi le rôle social du théâtre répond-il à des représentations différentes du monde social, influencées par l’époque dans laquelle il s’inscrit. En fonction des contextes politiques et des représentations dont le monde social fait l’objet, le théâtre peut ainsi revêtir un rôle éducatif, politique ou encore civique3.
Ces représentations appellent en réponse des pratiques tout aussi différenciées et mobilisent des moyens théâtraux spécifiques : la constitution d’un répertoire adapté, la recherche de publics populaires, l’engagement politique des artistes sont autant de vecteurs qui ont été utilisés par les agents du champ théâtral pour toucher la population et prendre part aux enjeux sociaux qui traversent leur époque. Déconstruire les catégories précitées de théâtre social », « populaire », « politique » ou « public », nécessite ainsi de comprendre les enjeux soulevés par la relation du théâtre au monde social à chacune des époques considérées et de prendre en compte la totalité des pratiques mises en œuvres pour toucher le monde social. La démarche socio-historique nous a paru répondre à ce projet4.
Comprendre la genèse des formes d’engagement théâtral
Un des objectifs de la socio-histoire est de comprendre comment le passé pèse sur le présent à travers l’étude de la construction historique des catégories et des évidences qui gouvernent les représentations que les agents se font du monde social. L’étude de la genèse des phénomènes sociaux permet de saisir au mieux les contraintes implicites comme les normes historiquement situées qui pèsent sur les individus. Concernant le théâtre français, il apparaît que l’injonction à faire du théâtre un outil au service du monde social a été historiquement constituée au XIXe siècle puis renforcée à partir de l’après-guerre. Cette thèse ambitionne de comprendre comment la vocation sociale du théâtre s’est progressivement imposée chez les agents au point d’être encore aujourd’hui un dilemme pour beaucoup d’entre eux. Cette question en amène d’autres : tandis que cette vocation s’est imposée à une fraction assez intellectualisée du champ théâtral, on peut se demander comment elle a été articulée aux normes esthétiques qui fondent l’avant-garde et la légitiment. Un travail socio-historique autour de cet équilibre entre vocation sociale et vocation artistique du théâtre nous permettra de dépasser la simple opposition entre animation et création1 en la resituant historiquement.
La socio-histoire propose également d’étudier spécifiquement la manière dont s’organisent les relations entre individus. Notre thèse s’intéresse principalement aux trajectoires individuelles d’un certain nombre d’agents représentatifs du champ théâtral2 mais les resitue constamment dans leurs différents groupes d’appartenance, dans lesquels ils inscrivent leurs pratiques et développent leur carrière. Cette démarche nous permettra de relier habilement les enjeux artistiques, professionnels comme institutionnels tout en comprenant les logiques d’interdépendances qui gouvernent les relations sociales. Cette perspective socio-historique nous amène à analyser l’évolution de la relation du champ théâtral au monde social en tenant compte des transformations internes qui l’affectent mais aussi des liens qu’il entretient avec l’État, le champ militant et le champ intellectuel. Nous serons donc amenés à nous intéresser tout à la fois aux représentations véhiculées dans et en dehors du champ théâtral susceptibles de faire évoluer le rôle social du théâtre et à les confronter à la réalité des pratiques mises en œuvre par les agents.
Le cadre théorique de cette thèse, construit au fil de notre recherche empirique, se situe l’articulation de plusieurs méthodes et outils des sciences sociales relevant tout à la fois de la sociologie de l’art et de la culture, de la sociologie des mobilisations et de la science politique. La sociologie de l’art et de la culture est spécifiquement marquée par l’opposition entre une sociologie inspirée des travaux de Pierre Bourdieu, centrée sur une analyse en termes d’autonomisation des champs et des espaces de production symbolique, privilégiant l’objectivation statistique1, et une sociologie centrée sur les interactions et les pratiques des individus – qui s’inscrit dans la tradition interactionniste2. Si nous souscrivons aux critiques d’une approche strictement statistique des trajectoires, trop peu attentive aux contextes dans lesquels des dispositions peuvent (ou non) s’actualiser et aux interactions au travers desquelles elles s’expriment, nous rejoignons, à l’opposé, les critiques des travaux qui omettent d’inscrire les acteurs dans l’espace social ou qui privilégient les logiques individuelles au détriment des logiques d’organisation ou encore des logiques macrosociales. Nous ne rentrerons donc pas dans cette opposition mais proposons plutôt d’articuler ces deux approches afin d’apporter des éléments de réponse aux questions du « pourquoi » et du « comment »3 des agents en viennent concevoir un engagement social au cœur de leur pratique artistique. Nous utiliserons la notion de champ mais dans une labilité certaine, n’hésitant parfois pas à nuancer les propriétés d’autonomie ou de position supposées le caractériser, et n’excluant pas de nous intéresser à des champs annexes4 comme aux relations de coopération gouvernant les relations entre individus5.
De l’animation à la création, du profane au sacré : problématique de recherche et construction de notre objet
Notre problématique de recherche s’inscrit dans la réflexion suivante : si le théâtre public » a fondé sa légitimité sur son caractère social, il s’est affirmé, de manière concomitante, dans une autonomisation croissante vis-à-vis du monde social, à travers la définition de critères esthétiques propres et un mouvement accru de professionnalisation et d’institutionnalisation6. Cette thèse ambitionne de comprendre comment les agents du champ, qu’ils soient animateurs ou metteurs en scène, ont concilié engagement auprès du monde social et exigences propres au champ théâtral tout au long de la seconde moitié du XXe siècle. Cette recherche est l’occasion de renouveler l’histoire du théâtre en l’abordant sous un angle nouveau (le rôle social qui lui est dévolu) ; elle représente également une contribution supplémentaire à la compréhension des formes d’engagement artistique1.
Afin de préciser les enjeux que notre recherche soulève et les sujets qui y seront articulés, il apparaît nécessaire d’expliquer la manière dont notre sujet peut être traité entre des contextes historiques en évolution, différents champs d’activités, et une multiplicité d’agents.
Articuler différents niveaux d’analyse
Une des difficultés soulevées par l’étude socio-historique du rôle social du théâtre est celle du niveau d’analyse adéquat. Notre sujet et notre démarche, en réclamant d’articuler théâtre et monde social dans une perspective historique, appelaient à une analyse multi-située.
Le rôle social du théâtre au prisme du champ théâtral
Il est rapidement apparu qu’on ne pouvait saisir l’importance du rôle social assigné au théâtre sans comprendre les évolutions qui ont traversé le champ théâtral depuis 1945. La constitution du théâtre public en champ autonome, doté de ses propres normes esthétiques et professionnelles et de son propre système de hiérarchie et de consécration, a en effet influencé les manières de concevoir le rôle du théâtre dans la société.
Les évolutions esthétiques du champ tendent en effet à transformer la place de l’innovation formelle dans le processus de consécration et, par conséquent, celle du public. L’institutionnalisation progressive du secteur renforce en outre la place des pouvoirs publics dans l’organisation du champ et dans l’objectivation de compétences spécifiques au théâtre public. Enfin, la professionnalisation du secteur favorise la division du travail et la constitution de fonctions spécialisées qui vont également affecter la relation du champ au monde social. Ces premiers constats nous amènent à nous intéresser tout à la fois à la révolution esthétique qui s’opère à la période considérée, au processus d’institutionnalisation qui organise le secteur ainsi qu’à la professionnalisation du champ qui contribue à diviser le travail artistique. C’est la raison pour laquelle nous travaillerons tout à la fois sur les organisations professionnelles (syndicats, associations) et institutionnelles (théâtres, commissions) ainsi que sur les espaces de production des œuvres et du jugement artistique (critiques, spectacles, programmations).
Notre objectif est de saisir la manière dont le rôle social du théâtre est appréhendé par ses agents selon plusieurs variables inhérentes à l’évolution du champ : place de l’engagement social dans la réussite d’une carrière, type d’engagement selon la position dans le champ1 et les dispositions des individus2, importance des relations interindividuelles dans les choix opérés3 sont autant d’éléments qui nous permettront de comprendre l’effet des transformations du champ théâtral sur la vocation sociale du théâtre.
Le rôle social du théâtre au prisme du contexte historique
Le second niveau d’analyse relève plus spécifiquement des contextes historiques et sociaux dans lesquels l’activité des agents étudiés s’inscrit. La période sur laquelle nous travaillons a en effet été traversée par des changements profonds à même de bouleverser la relation du théâtre au monde social.
La morphologie de la population française d’abord a changé : l’augmentation du nombre de diplômés a contribué à transformer le profil des prétendants à la carrière théâtrale mais également la composition des publics4. La relation au politique aussi a évolué: c’est à la fois le régime politique et les modalités d’action publique5 qui ont évolué, mais également les partis politiques et les formes de mobilisations qui se sont profondément transformés entre 1945 et les années 19806.
Enfin, cette période a été traversée par des événements qui ont affecté tout à la fois le champ théâtral et les modalités de l’engagement artistique : la seconde guerre mondiale, les guerres de décolonisation puis bien sûr Mai 68 ont marqué la trajectoire des metteurs en scène et des animateurs de théâtre. Ce constat appelle à mener une analyse historiquement située des trajectoires des agents et des formes d’engagement auprès du monde social. Il nous faudra dans ce cadre interroger l’effet de la génération sur les choix et les pratiques des agents étudiés1.
En nous intéressant de près aux trajectoires des individus, nous verrons en effet que ces différents événements n’ont eu un effet sur les croyances ou les pratiques des individus que lorsque des dispositions antérieures ou des positions dans le champ le favorisaient. Dans cette perspective, nous souhaitons particulièrement déconstruire la catégorie des « soixante-huitards », à laquelle nombre de metteurs en scène qui ont « marqué » l’histoire du théâtre sont supposés appartenir. Souvent présenté comme un tournant politique majeur en France, Mai 68 est réputé avoir renversé les hiérarchies artistiques précédemment en vigueur2 et séparé de manière durable la création théâtrale de l’animation culturelle3. Appréhender, sur le modèle proposé par Julie Pagis4, la manière dont Mai 68 a agi sur les agents permettra d’affiner ces assertions en considérant le processus général de transformation du champ théâtral au niveau des individus. Si Mai 68 a pu représenter une rupture fondamentale chez certains individus (qui se sont révélés à l’aune des manifestations ou ont au contraire été disqualifiés en raison de leur distance aux événements), il n’a parfois rien produit chez certains agents et n’a eu que peu d’effet sur des trajectoires biographiques ultérieures.
Le rôle social du théâtre au prisme des autres champs
Notre analyse appelle enfin à nous intéresser aux champs connexes à celui du théâtre. Comprendre le rôle social du théâtre à l’aune des seules pratiques artistiques ne fait en effet pas sens. Ce serait occulter la complexité de la construction des convictions et des pratiques chez les agents.
Nous avons précisé l’importance qu’ont pu avoir les pouvoirs publics sur l’organisation du champ : nous travaillerons ainsi à comprendre comment se sont articulées les relations entre membres du champ théâtral et fonctionnaires d’État et élus politiques. La porosité des liens ou au contraire l’opposition entre agents ont contribué à façonner le processus d’institutionnalisation du théâtre et les contours de la catégorie de théâtre public. Mais il faut tout autant prendre en compte la relation toute spécifique que certains metteurs et animateurs ont pu nouer avec le Parti communiste, le Parti socialiste et la gauche en général pour saisir tout la fois l’éventuelle construction commune d’un modèle d’intervention politique en matière culturelle et la circulation des idées relatives au rôle du théâtre dans une société.
Nous nous intéresserons bien entendu aux différents champs intellectuels (universitaire, journalistique, artistique) avec lesquels les agents que nous analysons sont fréquemment en contact. Ces espaces intellectuels ont joué un rôle très important dans la reconnaissance de certaines formes esthétiques et dans la conviction que le théâtre devait jouer un rôle auprès du monde social. A ce titre, les travaux touchant à la sociologie des intellectuels nous seront d’un précieux intérêt1 et nous permettront de resituer notre questionnement à la lumière de la relation des intellectuels aux classes populaires.
Notre démarche souhaite en effet interroger l’hypothèse selon laquelle l’autonomisation des champs artistiques aboutirait à la sacralisation de l’acte créateur. En analysant les différentes tentatives historiques menées dans le champ théâtral pour rapprocher l’art et le peuple et désacraliser ainsi l’œuvre d’art, notre ambition est de deux ordres. Nous souhaitons d’une part questionner la teneur réelle des expériences menées en direction du peuple. D’autre part, notre démarche permettra d’interroger le processus de séparation entre culture légitime et culture populaire2.
Cette analyse multi-située suggère une démarche méthodologique pragmatique susceptible de prendre en compte tout à la fois les effets de position et de lutte dans un champ, en même temps que les dispositions parallèlement acquises dans d’autres champs ou à la faveur d’un contexte spécifique. Nous ne pouvons en effet comprendre les trajectoires et les raisons d’agir des agents (et ainsi, les évolutions plus générales des pratiques et des représentations) sans une analyse complexe de la totalité des facteurs susceptibles d’orienter leur démarche comme leurs convictions.
Voir notamment Gérard Noiriel, Les Fils maudits de la République : l’avenir des intellectuels en France, Paris, Fayard, 2005 ; Christophe Charle, Naissance des intellectuels. 1880-1900, Paris, éd. Minuit, 1990.
Espaces empiriques pour penser l’articulation entre champ théâtral et monde social
Après avoir défini les différents niveaux d’analyse de notre enquête, nous pouvons maintenant en venir aux questions empiriques que notre problématique soulève. Si le rôle social du théâtre doit être compris à l’aune de différents contextes sociaux et historiques, il prend également des formes très différenciées, qu’il faut toutes prendre en compte dans l’analyse. Le parti-pris politique d’un artiste en faveur d’une mobilisation, la recherche d’un public populaire » comme l’intégration de problèmes politiques au cœur des répertoires mis en scène sont en effet autant de manières de relier le théâtre au monde social et de s’engager1.
Lier engagement politique et pratique artistique
Nous définissons ici l’engagement comme le fait de prendre parti sur des problèmes politiques et sociaux par son action et ses discours2. Dans le cadre de cette thèse, nous nous intéresserons spécifiquement aux ressorts et aux modalités de l’ « engagement artistique », c’est-à-dire à des partis-pris formulés à partir d’une position publique d’artiste ou d’une pratique artistique. Les ressorts de l’engagement sont généralement situés dans les trajectoires des individus qui s’y rallient3. C’est à ce titre qu’il est essentiel de rapporter les pratiques des agents à leurs socialisations antérieures4 pour comprendre les raisons qui les amènent à s’investir dans une mobilisation ou à s’indigner pour une cause. Il s’agit de prendre en compte une définition large des socialisations antérieures intégrant la prime enfance des individus, les contextes socio-historiques dans lesquels ils ont par la suite évolué et les rencontres et événements susceptibles d’avoir provoqué chez eux une rupture biographique1. Dans le cas du théâtre, l’intrication entre travail créateur et signification militante est parfois telle que l’investissement dans une voie artistique s’explique conjointement à l’engagement politique. C’est le cas par exemple des individus socialisés au théâtre par le biais de l’éducation populaire. Nous analyserons ainsi l’entrée dans les carrières artistiques et militantes de manière corrélée. Une analyse sur le temps long des trajectoires nous permettra de cette manière de mettre distance le spectre de la vocation, toujours prégnant quand on traite de prises de positions artistiques ou politiques. La vocation sous-entend le plus souvent le sentiment d’être « fait pour une activité » et s’entend généralement pour des activités de type désintéressées2. Face à ces poncifs, il faut d’abord prendre en compte le phénomène d’inculcation de la vocation, que ce soit par le travail, en amont, de formation des esprits et des croyances, et en aval, par l’institution qui consacre certains individus au détriment d’autres (les non consacrés intériorisent au contraire le fait qu’ « ils n’étaient pas faits pour ça »). Ensuite, il faut considérer les ressources qu’un individu peut tirer d’une activité, si désintéressée qu’elle soit : il peut s’agir de ressources symboliques bien sûr (qui plus est dans le cas du pôle le plus pur et sacré de l’art), mais également de ressources sociales et économiques cumulées qui sont, dans le cas du théâtre, fortement influencées par l’institutionnalisation3. Ainsi, ce « sentiment qu’on est fait pour quelque chose » coïncide le plus souvent avec ce que Bourdieu appelle une « correspondance entre dispositions et positions4 ».