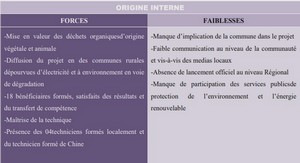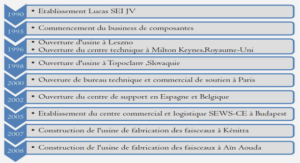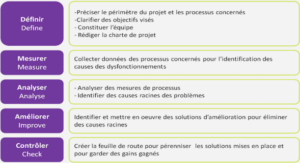La quête d’une identité cinématographique
Jusqu’à la fin des années 1920, le modèle d’un cinéma typiquement brésilien passait par la représentation de thèmes brésiliens. Ensuite, comme dans le Romantisme et dans le Modernisme, la quête d’une identité cinématographique est aussi passée par la notion de « culture populaire », comme synonyme d’authenticité et de national, opposée à celle d’imitation et d’inauthenticité, copie de l’étranger symbolisée par la culture bourgeoise, même si on pourrait dire que, au cinéma, cette quête d’une identité a été moins artificielle et plus spontanée, dans la mesure où, du moins dans un premier temps, elle n’était pas vraiment recherchée. Si l’on considère sa représentation et son succès dans les derniers films chantants de la Belle Époque du cinéma brésilien, on pourrait dire que le populaire s’est imposé de lui-même ; que ces films cherchaient à plaire, à avoir du succès, à être rentables sans vraiment se préoccuper de l’origine et du nationalisme de la production. Il n’y a pas eu de discussions autour d’une définition ou sur comment devraient être et quels éléments un supposé cinéma brésilien devrait contenir. Les premières tentatives de théorisation du populaire comme un paradigme possible pour le cinéma brésilien ne commencent qu’à partir de la seconde moitié des années 1950, particulièrement, dans les années 1960, quand il y a eu une instrumentalisation des arts en général et que le terme populaire a acquis une connotation de transformation sociale, de populaire révolutionnaire et est devenu un concept synonyme de national. C’était l’époque du « seulement ce qui est populaire est national196», où populaire avait le sens de culture révolutionnaire faite pour le peuple et les arts se sont transformés en instruments d’éducation et de formation populaire. Néanmoins, si l’on fait un petit historique sur la quête d’un cinéma national, nous nous apercevons que les premières discussions sur l’envie d’un cinéma national, qui a dû toujours bercer les rêves des professionnels du métier, commencent à prendre corps dans la deuxième moitié des années 1920 avec la campagne menée par Cinearte, l’une des plus grandes revues spécialisées et grande référence des cinéphiles de cette période. Copie conforme de ses congénères américaines et presque entièrement consacrée à ce cinéma, elle réservait très peu d’espace au cinéma local, commenté dans deux sections, Chronica (Chronique) et Filmagem Brasileira (Tournage Brésilien). La revue, qui aimait publier les photos des grandes stars du cinéma américain, est considérée comme la pionnière du star system brésilien, contribuant ainsi à la création et à la diffusion des premiers mythes du cinéma national. A travers des articles pointus sur les techniques du cinéma, la revue cherchait à influencer l’opinion de son public et à contribuer au développement et à l’amélioration du cinéma SODRÉ, Nelson Werneck. Raízes históricas do nacionalismo brasileiro. Rio de Janeiro : ISEB, 1960. p.32. 196 La quête d’une identité cinématographique 100 national. Les deux principaux rédacteurs de la revue étaient Pedro Lima et Adhemar Gonzaga, deux des critiques brésiliens les plus influents et respectés de tous les temps. Les discussions au sein de la rédaction de Cinearte ne concernaient pas encore la recherche d’une authenticité pour un cinéma national, même si ses rédacteurs avaient une idée très nette du genre de film qu’ils envisageaient pour ce cinéma, autant que sur ce qu’ils n’aimeraient pas y voir. On ne peut pas encore vraiment parler de quête d’un cinéma typiquement brésilien, mais plutôt de revendication d’une industrie cinématographique brésilienne dont les principaux objectifs « étaient de diffuser les films nationaux, de créer des contacts avec plusieurs groupes de production parsemés à travers le pays et de comprendre les principaux problèmes qui contrecarraient le développement de la production197». On est loin d’une quête d’authenticité ou d’un cinéma typiquement national, mais proche d’une quête d’un espace propre pour la production et pour l’industrie cinématographique brésilienne en devenir. Selon les rédacteurs de l’éminente revue, le cinéma qui devait prévaloir devait être proche du modèle américain. Un cinéma photogénique, aseptisé et qui ne devait montrer que la beauté de la population blanche et les aspects les plus positifs de la population, ce qui leur faisait détester les documentaires et le réalisme du cinéma soviétique. Selon cette recette, qui défendait un modèle fantaisiste du cinéma en prônant le bannissement de toute forme de réalisme des écrans, les films devaient se transformer dans une sorte d’assainissement de la réalité et ne montrer que « notre progrès, les œuvres d’ingénierie moderne, nos beaux Blancs, notre nature. Rien de documentaire, puisqu’il n’y a pas de contrôle total sur ce qui se montre et que des éléments indésirables peuvent s’infiltrer ; il faut un cinéma de studio, comme le cinéma nord-américain, avec des intérieurs bien décorés et habités par des gens sympathiques ». Outre la claire envie de projeter le pays dans une modernité qui lui faisait encore défaut et le déni flagrant de la réalité brésilienne, ce qui se dégage de ce texte, qui ne dissimule pas son élitisme et son racisme, typique d’une incommensurable partie des classes dominantes, c’est la proposition d’un modèle de cinéma totalement « aryennisant », aliénant, et qui n’avait rien de national, dans la mesure où il prônait l’imitation d’une forme de vie étrangère à celle de la grande majorité des Brésiliens. Il est surprenant que cette idéologie raciste, produit de la plume de critiques admirés et d’intellectuels confirmés, n’ait jamais été attaquée et condamnée avec la vigueur qu’elle aurait méritée. Maintenant, voyons comment ce nationalisme et cette quête d’authenticité se sont manifestés dans les films des années 1950, afin de vérifier comment les chanchadas ont été influencés par ce contexte et comment cela s’est répercuté sur leur représentation de la culture populaire.
Les chanchadas
l’analyse du genre Les chanchadas sont le résultat d’une envie de faire un cinéma national et populaire qui parlât la langue, représentât la culture du peuple et pût assurer un début d’industrie du cinéma brésilien. Et la meilleure manière de maintenir un dialogue de longue durée avec le spectateur passait par la représentation de la culture populaire érigée en modèle d’identité nationale et cinématographique. Ce public étant en grande majorité analphabète ou peu accoutumé à la lecture, la forme de ces films ne devrait pas être très compliquée. Ainsi, la structure des films a privilégié l’utilisation d’un humour facile et de la musique populaire brésilienne pour mieux représenter, de façon légèrement critique, l’univers difficile des classes subalternes. Très influencées par le cirque, la radio et le théâtre de revue, les chanchadas des années 1950, période que nous analysons, étaient avant tout des comédies, pouvant être aussi des comédies musicales ou des comédies avec insertions de numéros musicaux fréquemment, mais pas toujours, indépendants du récit. Si ces films, très commerciaux, ont emprunté les règles consacrées du genre comique et musical au cinéma américain, ils ont su se démarquer de la rigidité monolithique des valeurs assises sur une opposition morale entre héros et vilain pour imposer une thématique entièrement brésilienne. Cette différence n’a pas été immédiatement remarquée par une critique qui insistait sur l’idée que ces films n’étaient que de simples copies des films américains. Or, l’une de leurs qualités était justement la conscience qu’ils n’avaient ni la compétence ni les ressources financières et techniques de leur voisin, ce qui a amené leurs réalisateurs à tourner en autodérision leurs difficultés, représentées clairement dans le film Carnaval Atlântida198 , et à créer une forme de réalisation qu’ils considéraient plus adaptée à un cinéma qui – reproduisant la situation politique, économique et sociale du pays – était encore en voie développement. La précarité et l’improvisation dominaient la production de ces films où, assez souvent, les acteurs étaient obligés d’apporter leurs propres habits et les professionnels responsables de la production et de la réalisation avaient de multiples fonctions dans le but de réduire les coûts de production et de mieux la rentabiliser. C’est ce qui ressort du témoignage de Carlos Manga, l’un des grands réalisateurs du genre, au Musée de l’Image et du Son de Rio de Janeiro (MIS) : « L’Atlântida, pour moi, était une institution de fable (…), c’était la Metro [MGM]. J’y suis arrivé en pensant : je vais connaître un superbe studio. J’imaginais d’énormes escaliers en marbre, pleins de gens (…). Mais tout de suite, j’ai commencé à m’écrouler. Je suis arrivé avec Cyll Farney [l’une des grandes stars de la compagnie Réalisé par José Carlos Burle en 1952. 198 102 qui jouait souvent le rôle du héros, allié du comique] dans un parking (…), le sol sale (…). Cyll a désigné l’homme à l’égoïne et a dit : « celui-là c’est Watson Macedo » [cinéaste qui a reformé le genre]. Voilà, moi qui pensais que je rencontrerais Watson dans un énorme bureau tapissé, avec trois ou quatre secrétaires sur les bras. C’est alors que j’ai commencé à connaître la réalité nationale199 ». Ajoutons à cette précarité un récit cinématographique proche du rudimentaire. A partir d’une caméra quasiment immobile placée invariablement du côté du quatrième mur, on y voyait se succéder les plans américains ou de gros plans, quand il fallait valoriser les acteurs ou souligner un trait particulier de leur jeu. L’intrigue des films était aussi très simple et se résumait pour Carlos Manga à héroïne et héros en danger protégés par les comiques, le vilain prenant temporairement le dessus jusqu’à ce que la situation se renverse et que le vilain soit vaincu. Les films possèdent un montage basique et une narration entièrement linéaire (dans le film Garotas e samba il y a deux flashbacks qui expliquent les raisons du départ des personnages Zizi et Didi vers Rio de Janeiro, et quelques images mentales dans Carnaval Atlântida). Il y avait aussi beaucoup de gros plans de façon à privilégier les détails, notamment les jeux des acteurs avec leurs grimaces, entre autres expressions corporelles. Dans les films Tudo Azul et Minervina vem aí, il y a une petite narration en voix off. Dans Minervina vem aí, la voix off est intéressante car elle semble se moquer de l’utilisation de certaines voix off. La voix, celle d’un présentateur de télévision connu, commente de façon redondante et ironique la scène très simple que nous voyons. Carlos Manga, peut-être en raison de sa passion pour le cinéma américain, est le seul réalisateur à avoir tenté quelque chose de plus soigné – ou de moins banal – esthétiquement. Dans ce but, il a travaillé avec deux grands photographes de l’époque : l’Italien Amleto Daissé – qui a aussi travaillé avec les cinémanovistes Nelson Pereira dos Santos (Boca de Ouro) et Roberto Farias (Assalto ao trem pagador) – et le Turc Ozen Sermet, invité à travailler au Brésil par Alberto Cavalcanti. Les deux ont contribué à une certaine amélioration de l’esthétique des films.