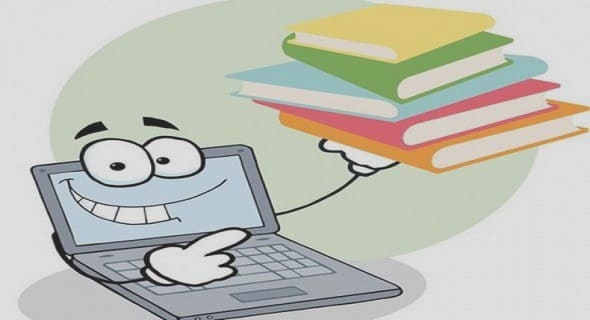Le contexte du partenariat international pour le Développement
Le droit international du développement est un droit dont la finalité vise à la résorption des inégalités de développement entre pays riches et pays pauvres. Cette approche, relativement tranchée, ne doit pas masquer les vicissitudes de ce droit longtemps chahuté par la doctrine. Tantôt vu comme un « frère bâtard »1 du droit international public, tantôt comme un « droit du sous-développement »2, le droit international du développement est régulièrement la proie des discours dénonçant l’impérialisme des États riches sur les États pauvres3. Soutien des revendications de ces derniers au lendemain de la décolonisation, la conjugaison des termes de « droit » et de « développement » donnera lieu à la formation d’une « idéologie »4 dont les anciens colonisateurs se protègeront avec force et détermination tout au long du 20ème siècle. Dans sa conception initiale, le droit international du développement est avant tout un droit au service de la paix. C’est dans cette perspective que, « dès 1948, l’Assemblée générale marque son désir de mettre en oeuvre l’article 55 de la Charte en priant le Conseil économique et social ainsi que les institutions spécialisées compétentes d’examiner la question du développement économique des pays insuffisamment développés »5.
Partant, la question du développement sera absorbée et traitée exclusivement sous l’angle économique et social dans le cadre des « décennies pour le développement » : « Adoptées par l’Assemblée générale à partir de 1960 (première décennie), jusqu’[en] 1990 où la quatrième décennie sonnera un glas discret de cette approche du développement […] marquée, dans les années 1970 lorsqu’elle est à son apogée, par la naissance du « nouvel ordre économique international »6. Le droit international du développement ne se conçoit pas alors comme un droit effectif visant à la résorption des inégalités de développement mais s’apparente simplement à une « forme de relecture des principes du droit international à la lumière des besoins et des exigences des pays en développement »1. Prenant acte de cette « relecture », le recours aux techniques juridiques employées à la constitution du droit international de l’environnement viendra en soutien à la définition d’un droit international du développement constitué d’un ensemble de règles dont « la normativité [demeure] incertaine »2. Ainsi et « selon une définition généralement admise, le droit international [du développement] est le corps de règles de droit international ayant pour objectif [la résorption des inégalités de développement entre États] »3. Plus avant, ce droit est constitué de l’ensemble des règles juridiques internationales employées au rétablissement de l’égalité de développement entre États. A ce titre, cette définition « met clairement en évidence à la fois son caractère fonctionnel [ – il s’agit d’encadrer les rapports d’assistance entre États riches et États pauvres – ] et son intégration dans le droit international général »4. Partant de cette intégration, il sera alors possible d’établir que le droit international du développement constitue « un corps homogène de règles juridiques au sein du droit international public, ayant une finalité propre »5 à savoir le rétablissement de l’égalité de développement entre États. En substance, les développements de cette première partie viseront précisément à établir un droit international du développement effectif (Titre 1er), voire autonome (Titre 2).
Un droit international du développement effectif
Le droit international du développement est un droit régulateur des rapports d’assistance entre États riches et États pauvres. Il est constitué de règles exorbitantes du droit international public général visant à la résorption des « inégalités de développement »1 entre États. Ainsi, le droit international du développement se nourrit de normes correctrices prétendant résoudre la difficile équation entre l’égalité souveraine des États, en droit, et l’inégalité de développement des États, en fait. Dans cette entreprise, dont le juriste ne peut ignorer la rudesse, il n’est pas surprenant que la « doctrine du développement », écartelée entre un droit objectif hégémonique et un droit subjectif revendicatif, n’ait pas réussi, tout au long du 20ème siècle, à s’émanciper d’un « cadre sclérosant où s’enlisent des discussions stériles »2. Longtemps prisonnier d’une dualité juridique des sources, l’une fixée à la doctrine du libéralisme économique, l’autre figée dans une idéologie humaniste, le droit international du développement s’inscrira dans de nouvelles perspectives offertes par le phénomène de mondialisation. Au lendemain de la chute du Mur de Berlin et de l’effondrement du modèle soviétique, il devient « urgent de se libérer des formules creuses, des affirmations dogmatiques, pour se tourner vers les conséquences pratiques des principes »3 attachés à la question du développement. Jusqu’ici « conçus de façon purement formelle »4, les principes servant à la résorption des inégalités de développement seront repensés à la lumière d’un nouvel ordre économique mondial. Globalisée, la matière économique revêt une nouvelle dimension spatiale et l’interdépendance économique, jusqu’ici réfutée par les États industrialisés en tant qu’elle emporte satisfaction de l’exigence de solidarité revendiquée par les « États de la périphérie »5, est aujourd’hui avérée.
Cette nouvelle donne doctrinale offre une occasion neuve de dépasser les divergences endémiques en matière de développement. L’adoption de la Déclaration du Millénaire pour le Développement sera la traduction de ce volontarisme affiché par la communauté internationale des États. Adoptée par 189 chefs d’États le 8 septembre 2000, la Déclaration du Millénaire pour le Développement a vocation à établir le « cadre d’une stratégie [de Développement] à long terme »1. Elle est le résultat d’une réflexion globale sur les stratégies qu’il convient de déployer dans la sphère internationale pour régler la délicate question des inégalités de développement entre États. Ainsi, la communauté internationale des États est résolue à repenser les principes inhérents au droit international du développement « de façon très concrète, en les confrontant avec les problèmes réels que soulève leur mise en oeuvre. Le temps paraît donc venu, au moment où les problèmes du Développement sont attaqués dans toute leur ampleur par l’Organisation des Nations Unies, de mettre un peu d’ordre dans les créations de la pratique, de prendre un peu de hauteur pour en faire la synthèse et la critique, de les raccrocher aux principes dont ils devraient constituer l’application, de jeter enfin les bases d’un véritable droit international du développement »2. Tels sont les commandements qu’il conviendra de respecter dans ce premier titre par l’exploration des axes juridiques en vigueur avant et à partir de ce texte source. Un premier travail de synthèse permettra de clarifier les principaux instruments et autres procédés de coopération interétatique établis par la communauté internationale des États et dont elle usera tout au long du 20ème siècle pour pallier l’inégalité de développement entre pays riches et pays pauvres.
Des principes directeurs visant à dépasser les clivages juridiques
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les règles de droit édictées par la communauté internationale des États en matière de développement ne permettent pas l’émergence d’un droit international du développement effectif1. Deux raisons principales peuvent expliquer cet échec. La première raison à cet échec est que le règlement de la question de l’inégalité de développement est, tout au long de la seconde moitié du 20ème siècle, envisagé sous couvert de deux axes politiques concurrents. Sans entrer dans le détail des contextes politiques et historiques qui ont conduit au vote par l’Assemblée Générale de l’ONU des deux textes sources illustrant la démonstration de ce conflit politico-juridique, il convient de noter qu’ils sont le résultat de travaux d’institutions onusiennes distinctes2. La Charte des Droits et Devoirs économiques des États de 1974, fixée au principe d’égalité souveraine des États, a conduit la communauté internationale à soumettre une première série de règles relatives au développement en droit international économique. En synthèse, le droit international du développement est alors conçu comme un droit dérogatoire aux règles du droit international économique, lequel rattachement empêchera l’émergence d’un droit international du développement « affranchi des intérêts étroitement conçus »3. La Déclaration sur le droit au développement de 1986, fixée à une exigence (voire à une obligation) de solidarité, vise précisément à détacher les règles de droit international du développement de toutes considérations économiques pour mieux l’intégrer au corpus des Droits de l’Homme. La proclamation d’un droit « inaliénable » au développement mal défini a eu pour effet non pas de compléter la Charte votée douze ans plus tôt mais au contraire, d’entretenir ce dualisme des sources. Ainsi, cette discorde politico-économique n’a pas permis, loin s’en faut, de régler la délicate question des inégalités du développement.
La seconde raison à cet échec est qu’en conséquence du premier, la question du développement ne pouvait pas faire « l’objet d’un examen systématique de la part du juriste »1 dès lors que cette dualité enferme ce dernier dans une impasse au bout de laquelle il doit irrémédiablement fixer son choix entre deux doctrines pour le moins antagonistes et pour le plus adversaires. La première, cartésienne, à partir de laquelle le juriste extraira quelques principes caractéristiques d’un droit objectif du développement en tant que sous-branche du droit international économique2. La seconde, plus propice à la théorisation, à partir de laquelle le juriste trouvera quelque intérêt à un droit subjectif au développement en tant que principe de droit international supérieur aussi séduisant que singulier et qui, in fine, restera sans effet. Il faudra attendre la Déclaration du Millénaire pour le Développement3 adoptée en 2000 pour dépasser ce dualisme et envisager l’unification des règles de droit international du développement. L’adoption de cette Déclaration permet le dépassement d’un cadre juridique sclérosé et offre l’opportunité d’un environnement normatif « neuf »4. Dès lors, l’étude systématique de règles de droit international spécifiques visant à corriger les inégalités de développement entre États devient possible à partir d’un cadre conventionnel multilatéral inédit et réconciliateur (Section 1). Après l’adoption de la Déclaration du Millénaire pour le Développement, un premier cycle de négociations internationales porte sur l’idée que les rapports d’assistance entre États doivent se concrétiser sur la base d’un nouveau « Partenariat Mondial pour le Développement ». Conçu tel un objectif que les États s’engagent à atteindre, la définition de ce Partenariat Mondial se dessinera à la faveur de la résolution de deux problématiques : le financement de l’Aide Publique au Développement (APD) et son efficacité. Traditionnellement, la question de son financement suppose « l’accroissement de l’aide publique au développement »1.
– INTRODUCTION – |