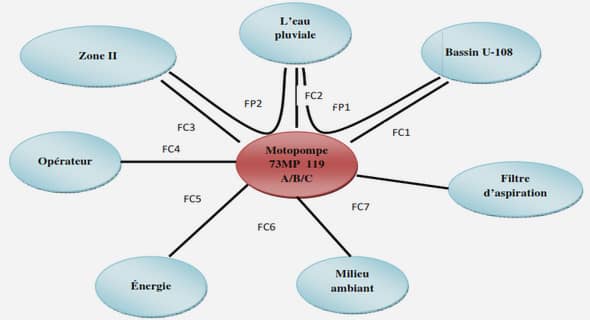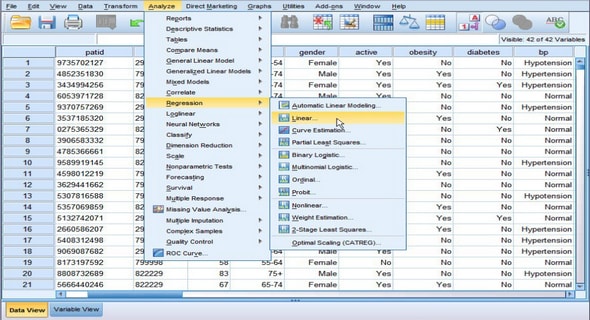Les sources de la philosophie Nietzscheenne
Nietzsche s’est attaqué à l’illusion des arrière-mondes sous toutes ses formes. Ce qui compte pour lui, c’est monde d’ici-bas, où l’homme peut jouir de sa plénitude vitale, dont le déploiement repose sur la volonté de puissance. Dans l’analyse de ce déploiement de la vie, Nietzsche a contourné les différents aspects sous lesquels s’est présentée la pensée philosophique. C’est ainsi que sa critique philosophique s’est nourrie des sources diverses dont : la pensée classique grecque ; et l’idéal esthétique de Wagner et le pessimisme de Schopenhauer A cela, s’ajoute son refus du nihilisme lié à des valeurs décadentes incarnées par le christianisme.
L’idéal esthétique de Wagner et le pessimisme de Schopenhauer
Il ne faudrait pas oublier que Nietzsche fut, d’abord, philologue et spécialiste de philologie classique. Il s’est surtout intéressé à Simonide et Diogène Laërce. Mais la philosophie de Schopenhauer le frappa également. Le monde comme volonté et comme représentation le bouleversa et imprègne profondément l’origine de la tragédie.
Nietzsche rejettera, par la suite, le pessimisme de Schopenhauer. Enfin, il a longtemps admiré Richard Wagner, dont il fit la connaissance en 1868. C’est à partir de 1875-1876 (IV Considération intempestive : Richard Wagner à Bayreuth) que ses réserves deviendront manifestes. Il reproche à Wagner, pêle-mêle, l’atmosphère de kermesse de Bayreuth, son adhésion à l’Allemagne de l’Empire, corruptrice de la civilisation.
Principe de la volonté
Pour Nietzsche, la vie est une sorte d’absolu, la seule chose à laquelle il croit. Il met la valeur suprême dans sa doctrine liée à une biologie philosophique. On peut ainsi dire une biosophie.
Selon lui, la vie est un fait primitif. C’est-à-dire qu’elle est l’étoffe de toute chose. Elle est l’être même du grand tout des stoïciens, étant son principe régulateur. Par notre être, nous n’en avons pas d’autre représentation que le fait de vivre. Ce fait nous ramène à la volonté : la vie est la volonté.
On remarque que cette volonté besoin d’amour. C’est que l’amour même incarne la manifestation de la volonté. Toute volonté véhicule la régulation de la vie. Ce que la vie s’élève sur des piliers par degrés. Le vouloir de la vie est à la fois à découvrir aux horizons lointains et à exploiter à l’échelle de ses beautés. Ici, Nietzsche développe la vie, selon la totalité de ce qui vit organiquement, dont les plantes, les animales et les hommes. C’est que le vivant, au sens de l’organique, est un domaine partial de l’étant, et il ne nous révèle pas les caractéristiques essentielles de toutes choses.
Selon Nietzsche, la vie est fondamentalement et conceptuellement peu développée. Pour lui, elle est abordée dans des paradoxes différents. C’est que l’intuition centrale de Nietzsche n’arrive pas à élaborer un système conceptuel. Et pourtant, cette intuition n’est pas vague ni estompé comme on le lui reproche souvent.
Principe de l’éternel retour
Pour Nietzsche, la conception de la vie comme « éternel retour », implique l’idée que le monde plein de bien, du mal et de tragique reviendra éternellement. Cette idée réconcilie devenir et éternité. Elle permet surtout de mesurer la force de l’esprit. C’est que le véritable immoraliste, le véritable philosophe dionysiaque sera celui qui est capable de supporter cette pensée, de vouloir l’éternel retour. Ainsi, Nietzsche répète-t-il son avertissement : « mon frère, restez fidèle al terre, de toute la force de votre amour(…). Oui vers la chair et la vie, afin qu’elle donne son sens à la terre, son sens humain ». Ce qui importe, c’est que la contemplation joyeuse du monde cruel et tragique culmine dans la pensée de l’éternel retour. Il s’agit de penser le monde, non pas sous l’espèce de l’éternité, mais sous l’espèce de devenir de l’espèce. C’est ce que Halèvy affirme : « Le retour eternel, montré aux faibles, déserteurs de la vie. »
Les acquis positifs de la philosophie de Nietzsche
Il nous paraît plus aisé de comprendre la philosophie de la vie de Nietzsche lorsque nous en comprenons les acquis positifs de sa philosophie. En ce sens, l’ensemble de l’œuvre de ce philosophe peut être compris à partir de l’angle du dépassement du nihilisme. Cependant, sa philosophie ne saurait se réduire à une simple critique de cette problématique liée au nihilisme.
Cela dit, il faut voir aussi que cet auteur s’est aventuré à proposer des réponses à cette problématique. Pour cela, il a ouvert une toute nouvelle façon d’analyser, de comprendre et de prendre soin de cette maladie de la « vie » qu’est la mort de Dieu. C’est dans cette perspective qu’il nous donne les outils de dépassement du nihilisme. Et il nous fait ainsi part de ses retrouvailles avec les principes régulateurs de l’éternel retour : le surhumain et la volonté de puissance.
Dans sa philosophie, Nietzsche nous interpelle sur la nécessité de savoir l’écouter, bien que l’interpréter ne soit pas chose facile. Il nous offre la chance, suite à un dur labeur qu’il a lui-même ressenti de nous ouvrir à de nouvelles perspectives d’assumer la vie. Il nous offre la chance de nous épanouir en tant qu’individus. Il faut nous éloigner de la masse, du commun et de la convention afin de nous forger nous mêmes par la réalisation des œuvres, nous faisons devenir ce que nous sommes. En cela, Friedrich Nietzsche apparaît tel le maître qu’il faut afin de s’éveiller à cette tâche.
Et ce faisant, il faut lui rendre l’hommage de s’élever vers soi-même : savoir ainsi gravir des montagnes de plus en plus sacrées en compagnie de Zarathoustra, ce surhomme dont la volonté de puissance lui sert de support pour enseigner la « vie ».
Table des matières
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : ETUDES DES SOURCES
CHAPITRE I : VIE ET ŒUVRE
I.1.1- vie estudiantine
I.1.2- vie professorat
I.1.3- vie errante
CHAPITRE II : LES SOURCES DE LA PHILOSOPHIE NIETZSCHÉENNE
I.2.1- La pensée classique grecque
I.2.2- L’idéal esthétique de Wagner et le pessimiste de Schopenhauer
I.2.3- Le refus du nihilisme liée à des valeurs décadentes incarnée par le christianisme
DEUXIEME PARTIE : LA VIE COMME CONCEPT PHILOSOPHIQUE DE L’EXISTENCE
CHAPITRE I : ÉTUDE DU CONCEPT DE VIE
II.1.1-De la définition biologiques
II.1.2-De la définition phénoménologies
II-1-3-Définition nietzschéenne
CHAPITRE II : LA VIE SELON NIETZSCHE
II.2.1- Principe de volonté
II.2.2- Principe de transvaluation
II.2.3- Principe de l’éternel retour
II.2.4- Principe d’existence et d’identité
TROISIEME PARTIE : EVALUATION DE LA PENSEE DE NIETZSCHE RETENUE A LA VIE
CHAPITRE I : LES ACQUIS POSITIFS DE LA PHILOSOPHIE DE NIETZSCHE
III.1.1- La découverte de la subjectivité
III.1.2- Une philosophie d’appréciations positives de l’histoire et de la vie
CHAPITRE II : LES LIMITES DE LA PENSEE NIETZSCHEENNE
III.2.1 – Le concept de vie comme concept ambigu
III.2.2- Le vitalisme de Nietzsche, incorporant une foi aveugle à l’évolution
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE