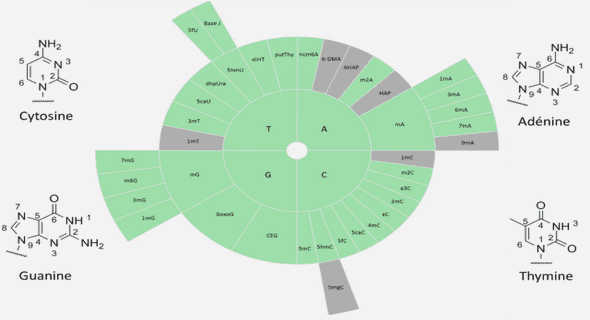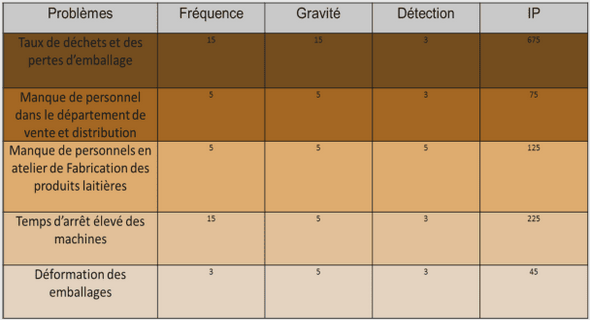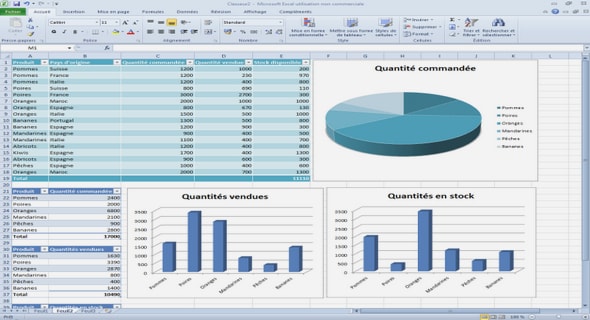Division du travail de création des auteurs
Cette deuxième partie porte sur les relations entre l’attribution des films et la division du travail cinématographique. L’association des œuvres à des noms d’auteurs a impliqué des luttes de définition de la valeur des films et de hiérarchisation des métiers du cinéma. Réciproquement, la division du travail de production, de diffusion et de valorisation des films a permis à des personnes et à des groupes de se définir et d’être reconnus comme des auteurs. La période étudiée commence avec l’émergence du cinéma et s’arrête au moment où ont été négociés la loi du 11 mars 1957 et le Copyright Act de 1976, c’est-à-dire à la fin des années 1950 et au début des années 1960. Il s’agit donc d’une histoire sociale des auteurs de films avant les Nouvelles Vagues.
Le troisième chapitre de la thèse montre que les luttes de définition des auteurs de films et de leurs droits ont contribué à la hiérarchisation du personnel cinématographique et à la différenciation du cinéma par rapport à d’autres productions économiques et culturelles. Les prétendants au statut d’auteur ont cherché à imposer des conceptions antagonistes de la division du travail et de la valeur des films. Ces luttes de définition ont été structurées par les relations entre le cinéma, la littérature, le théâtre et d’autres domaines d’activité, ainsi que par la différenciation de la valeur esthétique et de la valeur économique des films. En retour, les tentatives d’appropriation des œuvres ont contribué à l’autonomisation et à la structuration du champ cinématographique.
Le quatrième chapitre rapporte l’existence des auteurs à la division du travail de production, de diffusion et de valorisation des films. Il montre que les producteurs, les scénaristes et les réalisateurs se sont définis comme des auteurs à la faveur des caractéristiques de leurs activités, de leur pouvoir sur le reste du personnel et des concurrences entre professionnels et entreprises cinématographiques. Il examine ensuite ce que l’attribution des œuvres doit aux usages de la fonction-auteur par les critiques, des salles et des spectateurs de cinéma. Ce chapitre montre ainsi que l’appropriation des films résulte de la division et de la hiérarchisation du travail cinématographique que les luttes de définition de l’auteur visaient à légitimer ou transformer.
Le cinquième chapitre analyse la construction des hiérarchies professionnelles du cinéma au prisme des relations de genre et de classe et d’autres rapports de domination transversaux à différents champs. Les prétendants au statut d’auteur se sont servis de l’opposition entre masculin et féminin pour hiérarchiser le personnel et valoriser leurs métiers. Ces usages du genre étaient favorisés par la répartition du travail entre les sexes et ses effets sur les rapports des professionnels à la masculinité et à la féminité. Le chapitre montre aussi ce que doivent les hiérarchies de prestige entre les métiers du cinéma à l’inégale répartition de l’argent, du capital culturel et du capital social entre les groupes professionnels. On examinera plus succinctement la place du racisme, des animaux et de la religion dans les luttes de définition des auteurs.
Le sixième chapitre est consacré aux relations entre l’appropriation des films et la division internationale du travail cinématographique. Les modes de production français et américain résultent de concurrences et de circulations transnationales propices à l’internationalisation des luttes de définition de l’auteur de film. Les prétendants au statut d’auteur ont constitué des fédérations internationales pour défendre leurs droits de propriété et réguler les échanges cinématographiques. Les hiérarchies professionnelles et les auteurs de films ont été définis en référence à des modèles étrangers et au nom de différentes variantes de nationalisme et d’universalisme. Les hiérarchies professionnelles et les nationalismes qui ont servi à les construire ont été structurés par les asymétries de la production et des échanges cinématographiques mondiaux.
La valeur des auteurs : définitions de l’auteur de film et différenciation du cinéma
Avant celui des auteurs de cinéma, le droit de propriété des écrivains et des artistes a été défendu et codifié dans le cadre d’un processus plus général de différenciation de la valeur littéraire et de la valeur artistique. Alain Viala a inscrit les luttes de définition de la propriété littéraire dans le cadre de la genèse de l’écrivain et de la littérature et de leur différenciation par rapport aux savoirs érudits comme l’histoire1. En s’opposant au plagiat de leurs écrits et en assimilant ces derniers à des créations originales, des écrivains comme Erasme et Molière ont contribué à faire de la valeur d’originalité un des critères majeurs de définition et d’évaluation de la littérature. Nathalie Heinich a quant à elle associé des changements de modes de rémunération des peintres à l’émergence d’une valeur de la peinture fondée sur le renom et l’originalité du créateur2. Ce chapitre montrera que les luttes autour du droit de propriété cinématographique et plus généralement les luttes de définition de l’auteur de film ont été un enjeu et un résultat de luttes de définition de la valeur cinématographique et de ses relations avec d’autres formes de valeur. On verra ainsi que les luttes de définition de l’auteur de film ont contribué à la structuration du champ cinématographique et à son autonomisation par rapport à d’autres champs de production culturelle et économique.
Les relations entre les luttes de définition de l’auteur de film et la différenciation du cinéma ont déjà été examinées. Martine Chaudron, Nathalie Heinich et Philippe Marry ont attribué aux réalisateurs de la Nouvelle Vague l’invention de l’auteur de film et du cinéma comme art3. Si on les suit, le cinéma n’a pu ou ne pouvait devenir un art que si le réalisateur s’imposait comme son auteur contre les scénaristes, contre les producteurs, contre les acteurs et contre les techniciens. Comme l’ont écrit Martine Chaudron et Nathalie Heinich, « il ne peut y avoir véritablement « auteur » du film – celui qui appose mais aussi impose sa signature – que dans la mesure où le réalisateur, ou metteur en scène, maîtrise l’ensemble du processus de production, depuis le choix voire l’écriture du scénario jusqu’à l’ultime version du montage »4. On verra plutôt que ce point de vue – défendu par des metteurs en scène dès avant la naissance de François Truffaut – a coexisté avec des conceptions concurrentes du cinéma et de l’auteur de film : les producteurs, les scénaristes et les réalisateurs ont tous revendiqué le monopole de la production d’une valeur spécifiquement cinématographique.
Pour le montrer, on commencera par comparer les prises de position des représentants des producteurs, des écrivains, des scénaristes et des réalisateurs dans le cadre des luttes autour du droit d’auteur et du copyright. Les prétendants au statut d’auteur ont justifié leurs revendications au nom de définitions antagonistes de leurs activités, de la division du travail cinématographique et des films. Ces débats montrent que contrairement à ce que suggèrent les travaux cités précédemment, les contributions des scénaristes, des producteurs, des réalisateurs et d’autres professionnels du cinéma à la production de valeur cinématographique n’étaient pas inhérentes à leur rôle dans la fabrication des films mais pouvaient faire l’objet d’appréciations différenciées et même antagonistes. Les prétendants au statut d’auteur se sont également divisés au sujet de la définition même des films, et tout particulièrement de ses relations avec d’autres biens économiques et artistiques. Les luttes autour du droit de propriété cinématographique ont ainsi contribué à la fois à la définition de la valeur des films et à l’attribution de cette valeur.
Ce processus de définition et d’attribution de la valeur cinématographique n’était évidemment pas confiné aux négociations autour du droit d’auteur et du copyright. Dans la deuxième section de ce chapitre, on examinera ce que les conceptions antagonistes du cinéma et de l’auteur de film défendues dans ces négociations devaient aux relations entre le cinéma et d’autres productions culturelles, et tout particulièrement la littérature et le théâtre. Comme on l’a vu, les représentations cinématographiques de livres et de pièces ont été parmi les premiers films à être définis juridiquement comme des biens protégés par la propriété littéraire et artistique et à se voir associées, juridiquement, un auteur. Les adaptations littéraires, qui se sont multipliées au cours des décennies suivantes et représentaient une grande proportion de la production cinématographique, furent un enjeu et un déterminant des luttes de définition de l’auteur qui ont opposé les scénaristes, les écrivains, les réalisateurs, les producteurs et les critiques. On examinera également ce que les luttes de définition de l’auteur de film et du cinéma devaient à la participation à la production et à l’évaluation des œuvres de prétendants au statut d’auteur qui avaient préalablement ou parallèlement exercé d’autres activités artistiques ou aspiré à le faire. Dès les années 1910 puis lors de l’invention du « cinéma parlant », des écrivains, des dramaturges et des artistes qui ont mobilisé leurs savoir-faire littéraire et artistiques pour fabriquer des films s’en sont revendiqué les auteurs en s’opposant au sujet des relations entre le cinéma, l’art et la littérature. Plus généralement, c’est en référence aux hiérarchies et valeurs d’autres champs de production culturelle qu’ont été construites et légitimées les hiérarchies professionnelles du cinéma.
La troisième section sera consacrée aux relations entre les luttes de définition de l’auteur de film et la différenciation de la valeur des films de leur popularité et de leur rentabilité ou profitabilité économique. D’après Pierre Bourdieu, dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle, des écrivains ont contribué à l’émergence de « l’économie inversée » du champ littéraire, où la valeur littéraire des œuvres est détachée de leur succès commercial à court terme. A partir de cette période, le champ littéraire a été structuré par une opposition entre une production destinée à un marché restreint aux producteurs littéraires eux-mêmes, et une grande production orientée vers la satisfaction des attentes du grand public5. Selon Julien Duval, ce processus de différenciation de la valeur commerciale et esthétique des œuvres cinématographique – ou d’« autonomisation » du cinéma – a débuté dès les années 1920 mais s’est heurtée aux coûts de production des films qui rendaient impossible la fabrication des films à destination d’un marché restreint6. Pendant une bonne partie du vingtième siècle ou ses premières décennies, le cinéma n’aurait donc pas ou peu été considéré comme un art en raison de son caractère commercial et d’un public à la fois large et issu des classes populaires. Selon Martine Chaudron et Nathalie Heinich, si le cinéma n’avait pas d’auteur et n’était pas un art, c’était aussi en raison de son caractère commercial et populaire. Les acteurs et techniciens seraient restés volontairement anonymes en raison des origines foraines et populaires du cinéma, « qui le cantonnaient à n’être au mieux qu’une attraction pour goûters enfantins ou soirées mondaines ou, au pire, un divertissement réservé aux bas-fonds de la société »7. Des prétendants au statut d’auteur ont effectivement justifié leur qualité d’auteur en dénonçant les contraintes commerciales, à la rentabilité des films, et aux attentes et goûts du grand public. Cependant, d’autres prétendants au statut d’auteur et même la majorité d’entre eux ne voyaient pas d’antagonisme entre leur qualité d’auteur et l’assimilation du cinéma à un art et son caractère « industriel », « commercial » et « grand public ».
Qu’est-ce qu’un (auteur de) film ?
Les réalisateurs, les scénaristes et les producteurs ont défendu leur statut d’auteur ou de coauteur des films au nom de représentations antagonistes du cinéma et de la division du travail cinématographique. Les porte-paroles de chacun de ces groupes professionnels ont exprimé de mêmes conceptions de l’auteur de film en France et aux Etats-Unis. Leurs discours n’ont pas beaucoup varié entre les années 1920 et les années 1960. Pour mieux le mettre en évidence, on présentera successivement les prises de position des producteurs, des scénaristes et des réalisateurs dans les luttes autour du droit d’auteur et du copyright, en les regroupant par groupe professionnel plutôt que par pays ou par ordre chronologique. Les réalisateurs américains ne sont pas intervenus dans les négociations autour du copyright, pour des raisons que l’on expliquera plus loin. Dans leur cas, on présentera la conception du cinéma et de l’auteur de film défendues par trois de leurs dirigeants syndicaux.
Le producteur : entrepreneur et chef d’orchestre
A la différence des scénaristes et des réalisateurs, les porte-paroles des producteurs ont défendu leur qualité d’auteur en insistant sur le caractère collectif de la production cinématographique. En 1925, lors des auditions consacrées à l’adhésion des Etats-Unis à la Convention de Berne, le cinéma a été présenté comme une activité collective par Louis E. Swartz, l’avocat de la société Famous Players-Lasky qui présidait la commission du copyright de la MPAA8. Pour ce dernier, un auteur employé par la société de production commence par écrire une histoire d’après une idée d’un cadre de sa société. Son travail est complété par celui de deux autres auteurs, dont l’un découpe les différentes scènes du film. Ce scénario est ensuite transmis au réalisateur et au manager du studio, qui préparent le tournage en collaboration avec des architectes et d’autres artistes. Les décors sont élaborés par des architectes, des tapissiers, des décorateurs et des charpentiers. Des artistes, parfois très renommés, préparent les costumes. Le réalisateur dirige ensuite le tournage, souvent en changeant l’histoire au fil du tournage. Les scènes filmées sont transmises à un monteur que le porte-parole des producteurs assimile à un véritable auteur ». Le monteur est chargé d’éditer le film et ne retient qu’environ un dixième de la pellicule filmée. Pour l’avocat de la MPAA, le film est le résultat combiné des capitaux et des cerveaux de la société. Sa prise de position est très proche de celle des représentants des producteurs lors de la négociation de la loi du 11 mars 1957 et du Copyright Act de 1976.
Charles Delac et Adolph Schimel ont chacun énuméré plus d’une dizaine de métiers nécessaires à la création d’un film et présenté l’écriture des films comme un travail collectif. Tous deux ont hiérarchisé le personnel des sociétés de production. Charles Delac a distingué le personnel technique des « collaborateurs artistiques » et son homologue américain les « creative artists » du reste du personnel. Mais tous deux ont compté parmi les « collaborateurs artistiques » et les creative artists » d’autres travailleurs que les prétendants au statut d’auteur, comme les cameramen, les assistants-réalisateurs, les monteurs de son et les monteurs d’images. Tous ces travailleurs étaient censés influencer, à des degrés divers, la forme finale du film : Le cinéma, art d’un ordre particulier, a besoin de la collaboration de plusieurs artistes de tempérament et de savoir différents, qui agissent en parfaite harmonie pour aboutir la création de l’œuvre d’art complète que doit être un film.
Les plus universels chefs-d’œuvre littéraires ou artistiques n’ont demandé à leurs auteurs que leur incontestable génie. Un film ne peut être réalisé qu’avec le concours d’éléments de base fort coûteux, d’un outillage de plus en plus important et de plus en plus perfectionné, d’un personnel technique groupant opérateurs, photographes, électriciens, ingénieurs du son, décorateurs et architectes, dont la valeur professionnelle influe considérablement sur le résultat final, et enfin de collaborateurs artistiques du film : auteur de l’idée, scénariste, auteur du découpage, auteurs du dialogue, auteur de la musique, metteur en scène, artistes dramatiques ou lyriques, monteur de son, et monteur d’images.
Que le rôle de chacun de ces artistes ne soit pas d’égale valeur, que l’importance de leur intervention dans le film varie considérablement, la chose est indiscutable, mais, quoi qu’il en soit, artistes et techniciens restent tous solidaires les uns des autres, et le film, œuvre d’art collective, souffrira de l’insuffisance d’un quelconque de ces éléments, quel que soit le talent de tous les autres9. »
Comment les représentants des sociétés de production ont-ils revendiqué le statut de seul auteur des films tout en insistant sur le caractère collectif de leur fabrication ? Pour paraphraser le titre d’un article de Charles Delac, au nom d’une conception du métier de producteur comme entrepreneur, auteur et/ou chef d’orchestre11. Ils ont rapproché le producteur d’entrepreneurs de l’industrie ou du commerce en mettant en avant leurs capitaux et leurs investissements dans du matériel, les rémunérations qu’ils versaient à leurs employés et leur rôle de recruteur. Ils ont également attribué à cet entrepreneur le monopole des risques financiers. L’avocat italien de la Fédération internationale des associations de producteurs de films est celui qui a le plus insisté sur la qualité d’entrepreneur du producteur. Dans un rapport publié en 1950 dans Le Film français, il a considéré que les films n’avaient pas d’auteur en raison de leur production collective. Ils devaient donc appartenir à leur entrepreneur : [L’œuvre cinématographique], en effet, n’est pas seulement une création de l’esprit, comme un poème, un roman, un drame, un traité scientifique, une peinture, un dessin, une statue ; elle est en même temps une création intellectuelle, une œuvre technique et un produit industriel : plus exactement une œuvre d’art réalisée industriellement sous la conduite et sous la responsabilité d’un personnage, qui, après avoir choisi le sujet du film et l’avoir fait développer en détail par les scénaristes et les dialoguistes, recrute tous ceux dont le concours est nécessaire pour la réalisation : metteur en scène, acteurs, techniciens. etc. ; réunit les moyens financiers et techniques qu’il juge opportuns ; organise et dirige la production, dont il assure les frais et assume les risques, en vue de réaliser des bénéfices. Ce personnage est le producteur (personne physique ou société), et c’est lui qui est le pivot autour duquel tourne toute la machine extrêmement complexe de la production ; de même c’est à lui que reviennent, en définitive, le mérite de la réussite ou le discrédit de l’insuccès. Le film, au fond, est son œuvre ; il lui appartient comme l’automobile ou le bateau appartiennent aux constructeurs qui les ont fabriqués. Mais il n’en est pas l’auteur, car son travail d’organisation essentiellement industriel ne correspond pas une qualification qui suppose un travail de création purement intellectuelle. Il est un entrepreneur dans le sens de l’art. 2082 du code civil italien, à savoir un industriel, au même titre qu’un fabricant de machines ou de tissus, mais dont le trait caractéristique est de fabriquer des œuvres d’art.
En partant d’une telle constatation indéniable on arrive nécessairement à établir ce premier point cardinal : le producteur est le centre de la production du film. Celui-ci sort de ses mains, porte sa marque et indique sans aucune possibilité de doute son producteur.
Cet avocat a été le seul porte-parole des producteurs à refuser à ces derniers la qualité d’auteur. Il défendait un droit de propriété cinématographique distinct de la propriété littéraire et artistique, contrairement aux autres représentants des producteurs français et américains. Ces derniers ont plutôt insisté sur les tâches de direction et de coordination des producteurs, dont ils soulignaient le caractère « intellectuel ». Pour Charles Delac, il revenait au producteur, chef intellectuel de l’œuvre », « la lourde charge de coordonner et de guider tous les efforts » et de collaborer à tous les éléments du film13. Le producteur était « le véritable chef d’orchestre, dosant chaque apport, pour qu’aucune des parties de l’œuvre ne soit sacrifiée aux autres, apportant à chaque instant, dans ce milieu de création fiévreuse, son esprit critique, le calme de sa pondération et sa connaissance des besoins de la cinématographie ». L’avocat du même syndicat a donné à peu près la même définition du producteur dans un article publié en 1952 dans Le film français14. Il a distingué le producteur d’un commanditaire et d’un financier, ainsi que d’un directeur de théâtre et d’un éditeur qui se contentaient de diffuser l’œuvre d’un écrivain. Selon le même avocat, le producteur est celui qui « prend l’initiative du film, de sa création, qui en choisit le sujet, qui réunit les divers collaborateurs et coordonne leurs efforts – alors qu’ils n’ont pas de lien entre eux – et collabore constamment à la mise au point du découpage et de la réalisation, ce qui représente bien une intervention intellectuelle ». Pour cet avocat, sans producteur, il n’y avait pas de film et « cela est tellement exact qu’il y a des producteurs dont les films sont toujours bons et d’autres dont les films sont toujours médiocres. Car, il ne faut pas le confondre avec le financier ou le commanditaire du film. » Lors de la préparation du projet de Copyright Act de 1976, le représentant de la MPAA, Edward Sargoy, a avancé que le seul auteur est « l’entrepreneur ou producteur, qui, dans le but de la fabrication d’un film, a financé et coordonné le travail intellectuel de diverses personnes employées non seulement pour créer ou adapter des sources littéraires, dramatiques ou musicales utilisées pour le film, mais aussi le travail intellectuel de création artistique ou d’interprétation de ceux ayant joué dans le film et dirigé ces interprétations15. » Devant une commission de la Chambre des représentants, l’avocat de la Walt Disney Company a argué que tout ce qui était produit par cette société l’était par l’inspiration et les directives de Walt Disney lui-même16.
Cette conception de l’auteur de film allait de pair avec une définition des films qui différait également de celle promue par les scénaristes et les réalisateurs. Pour insister sur le caractère collectif de la production cinématographique, tous ont distingué les films des arts dits individuels. Pour le président de la Chambre syndicale de la cinématographie, les coûts de production des films, les appareils et compétences techniques mobilisés et le personnel techniques et artistiques différenciaient le cinéma de la littérature et des arts qui ne nécessitent que le génie de leur auteur17. Les porte-paroles des producteurs français et américains ont défini les films comme des œuvres originales et indivisibles, c’est-à-dire comme des œuvres distinctes des œuvres littéraires adaptées et du travail de chacun des agents ayant participé à leur production, auxquels ils n’attribuent aucune valeur cinématographique autonome. Seule la combinaison de ces « matériaux », « sources » ou « ingrédients », c’est-à-dire le film achevé, produit d’un travail de collaboration, était dotée de valeur cinématographique. Pour l’avocat de la Fédération internationale des associations de producteurs de films, Ugo Capitani, un film est la fois « une création intellectuelle, une œuvre technique et un produit industriel », tout comme des draperies, des automobiles et des bateaux18. L’avocat a opposé cette conception du cinéma à la définition des films comme éditions des scénarios ou œuvres littéraires adaptées, que défendaient les porte-paroles des écrivains et scénaristes comme on le verra. Quant aux représentants de la MPAA, lors de la négociation du Copyright Act de 1976, ils ont présenté le cinéma américain comme une « grande industrie » et mesuré sa grandeur aux centaines de millions de dollars d’investissement, de rémunérations versées aux travailleurs, de revenus perçus au box-office et de contributions à l’excédent commercial américain19.