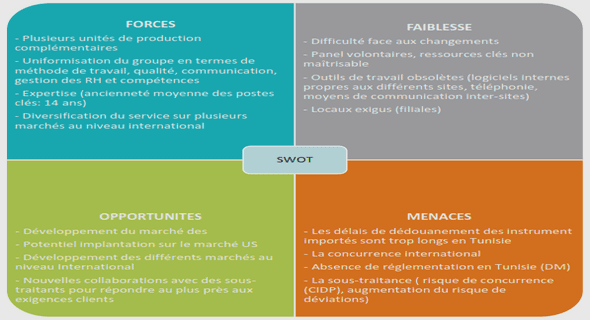De l’histoire des religions à une diversification des approches
Dans la monographie « Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains », parue en 1942, F. Cumont propose une interprétation des rites et de la symbolique funéraires en s’appuyant sur l’analyse des décors de sarcophages, des peintures, des stucs ornant les tombes. Les motifs et les thèmes reflètent, d’après l’auteur, une intention religieuse, que ce soit de la part de l’artiste ou de celle des commanditaires. Pour ce faire, il expose, dès l’introduction, sa méthode de travail qui est fondée sur l’importance accordée au contexte dans lequel ont été élaborées ces œuvres. L’histoire des religions est ainsi la discipline centrale de ce travail, la reproduction des éléments figurés sur les monuments et les commentaires de l’auteur constituent un riche catalogue et un inventaire raisonné, critique et méthodique repose sur des documents épigraphiques recueillis dans le CIL et sur l’examen des monuments funéraires publiés par E. Espérandieu. Dans un premier temps, il mène une étude statistique sur les noms de familles et les nomenclatures, associée à une analyse géographique et chronologique, dans le but de montrer leur distribution et leur développement dans le temps. Puis, il analyse les peintures et l’architecture des monuments funéraires afin de déterminer les origines des peintres et les différents courants stylistiques. Ces arguments mettent en valeur la part de l’élément autochtone dans la formation de la civilisation gallo-romaine. En somme, les vestiges archéologiques sont utilisés ici pour expliquer l’histoire sociale, l’étude des contextes funéraires étant un des vecteurs de la compréhension du monde des vivants.
Vers la fin des années 1960, la publication d’A. Van Doorselaer synthétise dans un travail sur les nécropoles d’époque romaine de la Gaule septentrionale, les données concernant la répartition des nécropoles dans le paysage et leur relation avec l’habitat, l’architecture de la tombe, le mobilier et analyse aussi minutieusement les rites funéraires .
En progressant, les recherches portent un regard plus attentif aux différentes pratiques funéraires exécutées par la société des vivants. DansDeath and Burial in the Roman World, en 1971, J.M. Toynbee, développe son propos sur les conceptions religieuses des Romains et met l’accent sur les pratiques funéraires : les funerary practices. L’auteur se tourne vers le mort qui acquiert une nouvelle place dans l’étude des rites funéraires et cherche à reconnaître les différents gestes pratiqués au cours de la cérémonie. Les pratiques funéraires considérées sont au nombre de trois : la crémation, l’inhumation et l’embaumement. L’auteur décrit les différentes étapes dufunus, mettant l’accent sur les pratiques intermédiaires entre la mort et la mise en terre, ainsi que les pratiques qui suivent l’enterrement 14, à savoir, dans le cas des crémations, le dépôt des restes osseux et des cendres dans un autre lieu. Cependant, cette approche reste fortement ancrée sur l’étude des monuments funéraires appartenant aux membres des classes dirigeantes et aristocratiques occultant les préoccupations d’une population plus modeste.
Derrière les approches historique et archéologique, c’est la volonté de comprendre les sociétés anciennes qui incite les chercheurs à prendre en considération tous les types de vestiges présents dans une structure funéraire ou un ensemble funéraire et, non uniquement, le mobilier indépendamment de son contexte. Cet élargissement des enquêtes conduit à ouvrir ce domaine à de nouvelles disciplines où chaque type de vestige fait intervenir des compétences spécifiques. L’une d’elles, l’anthropologie, contribue activement à réorienter les questionnements de base dans une perspective archéologique. Au début des années 1980, sous l’impulsion d’Henri Duday, la fouille accorde aux vestiges osseux une place centrale dans la problématique funéraire. Ces vestiges deviennent les témoins privilégiés des rites et des pratiques ayant cours lors du traitement du défunt. Henri Duday mène une réflexion sur la taphonomie des vestiges et sur l’importance du relevé des informations lors de la micro-fouille d’une sépulture afin de distinguer les processus de conservation ou de destruction des restes biologiques15. L’adoption de l’approche archéo-anthropologique a entraîné de rapides progrès dans les connaissances en matière funéraire et les résultats ont fait l’objet d’une large diffusion au cours de rencontres et colloques. Nous retiendrons les colloques : « Nécropoles à incinération du Haut Empire, en 1987 et Incinération et inhumations dans l’occident romain aux trois premiers siècles de notre ère », qui ont donné lieu à des réflexions collectives. H. Duday intervient pour illustrer le potentiel des études anthropologiques de terrain, y compris en contexte de crémation. En plus des articles thématiques, dont fait partie l’approche anthropologique, une riche documentation sur les nécropoles à incinération et inhumation du I au III s ap. J ;-C. de la Gaule méridionale sud-est et de la région lyonnaise est proposée. C’est un premier essai de la communauté qui met en avant la variabilité des pratiques funéraires adoptées en Gaule.
Lors du colloque de Mayence en 1993, un état des connaissances dans les différentes provinces romaines est proposé , ayant pour objectif de faire le point sur l’ensemble des données funéraires. Les décennies suivantes verront la publication de nombreuses monographies de nécropoles, parmi lesquelles plusieurs concernent le sud-est de la France, la nécropole de la Sainte Barbe à Marseille , la nécropole de Vernègues , la nécropole du Valladas à Saint-Paul-Trois-Châteaux 20 , la nécropole de Soumaltre à Aspiran 21 22 et la nécropole méridionale d’Aix-en-Provence .
Dans le cadre du développement de la bioarchéologie dans le domaine funéraire, les archéobotanistes et archéozoologues proposent les premières synthèses dès les années 1990, chaque discipline mettant en avant le besoin d’affiner les méthodes de travail et de prélèvements. L’archéozoologie étudie et interprète la présence de restes fauniques au sein des structures et tente de différencier les dépôts effectués au moment des funérailles sur le bûcher ou après la crémation du corps dans la tombe elle-même. La bioarchéologie fait partie intégrante des analyses d’ensembles funéraires dès les années 1980 avec pour discipline la carpologie24, l’étude des pollens25 principalement pour les inhumations et l’anthracologie sur les charbons de bois 26. Toutes ces études révèlent, avec précision, des gestes et des pratiques en cours autour et dans la tombe.
Cet enrichissement des approches démontre l’utilité de traiter l’ensemble du matériel archéologique de manière exhaustive. Conscient du risque de produire des études hyperspécialisées, les archéologues s’appliquent à interpréter les vestiges dans le cadre général de la structure funéraire. Il est intéressant de relever le point de vue de l’historien J. Scheid27. Dans la monographie sur l’archéologie du rite où il souligne la nécessité de faire appel aux différentes spécialités entourant dorénavant l’archéologie funéraire « qui révèlent avec une précision toujours croissante, les séquences d’événements qui se sont déroulés prés de la tombe, pendant les funérailles et après. »
Cette multidisciplinarité caractérise la fouille de Porta Nocera à Pompéi entreprise en 2003, avec, pour objectif, la collecte systématique et exhaustive de tout matériel révélant les rites funéraires tels que les offrandes de fruits ou d’encens, fumigations consommations de mets…
Dans l’archéologie funéraire sont à présent impliqués des archéoanthropologues, des archéobotanistes, des archéozoologues, des céramologues, des épigraphistes et des historiens des religions. Tous participent pleinement à l’étude des contextes funéraires pour penser la mort dans son ensemble.
Les orientations de la recherche actuelle en archéologie funéraire ont été définies, en 2009, dans la synthèse sur les pratiques funéraires antiques en Gaule romaine dirigée par Fr. Blaizot 30 . Cette monographie regroupe un ensemble d’études de cas archéologiques et propose d’examiner la variabilité et l’évolution des pratiques et des modes de sépultures au travers d’une analyse diachronique du IIe av. au IVe s. ap. J.-C. La nécropole et les structures la composant sont étudiées dans le but de caractériser le mode de traitement du défunt. Pour cela, les différentes étapes du rituel sont décryptées pour l’inhumation comme pour la crémation. L’enchaînement des gestes qui s’inscrivent dans la logique du rituel est décrit, et les auteurs concluent sur la nécessité de réaliser une analyse globale des espaces funéraires.
L’archéologie des structures de crémation : les outils et les méthodes derecherche
La crémation est un milieu privilégié pour appréhender la gestion des morts par la société des vivants. Elle met en œuvre une succession d’actions telles que la construction du bûcher, le dépôt du corps, le processus de combustion, les différents prélèvements et les transferts qui sont susceptibles de laisser des traces tangibles, à condition que des outils adaptés soient mis en place pour les reconnaître. Au travers de ces vestiges archéologiques, c’est une image finale de la crémation qui est observée par les archéologues et ces derniers tentent de retracer les séquences qui jalonnent le déroulement de la crémation, à l’aide de méthodes issues de disciplines scientifiques telles que la biologie végétale ou l’étude des ossements, adaptées au contexte archéologique.
Sur le terrain, l’archéologue utilise des techniques de fouille comparables à l’approche de toute autre structure archéologique. Néanmoins, la structure de crémation nécessite un prélèvement exhaustif et minutieux des restes. Cette nécessité s’est imposée au fur et à mesure que les questionnements et les outils de recherches s’affinaient. Une fois chaque structure identifiée, elle fait l’objet d’une fouille spécifique qui suit des procédures adaptées à sa nature, des procédures qui changent selon qu’il s’agit d’une structure primaire de crémation, d’un dépôt secondaire ou d’une structure annexe type fosse à résidus cendreux… 31.
En France32, l’archéologue V. Bel, dont l’objectif est de comprendre l’organisation du bûcher funéraire, a proposé une méthode de fouille pour les structures primaires de crémation. La méthode conseille la mise en place d’un carroyage qui autorise une lecture spatiale des vestiges quels qu’ils soient. Cette technique 33 , testée et validée, permet de porter une attention accrue à la disposition de tous les vestiges 34.
Pour les dépôts secondaires, qu’ils se présentent sous forme de vases ossuaires ou sous forme d’amas compact d’os, l’ensemble est prélevé en bloc pour faire ensuite l’objet d’une micro fouille en laboratoire. Précurseur dans les études concernant les ossements carbonisés, Gilles Grévin a développé une méthode de fouille en laboratoire. Cette micro-fouille trouve notamment une justification par la découverte, pour les Hydries d’Alexandrie, de la présence d’une stratigraphie interne à l’urne qui reflète la collecte des ossements sur le bûcher36. L’agencement interne des urnes est depuis systématiquement pris en compte dans la fouille des dépôts secondaires.
Les méthodes ainsi établies conduisent à prélever le matériel de manière à obtenir une répartition spatiale de la structure et du matériel qui la compose. Lors de la fouille, tous les types de mobilier sont traités de manière similaire, mais leur étude est adaptée à la nature de chacun d’eux et confiée à des spécialistes. Autour de la crémation, les différentes spécialités convergent vers un objectif commun : proposer une reconstitution des séquences qui ont pris place autour et dans la tombe. Nous proposons ici un aperçu des objectifs et des questionnements liés à chaque spécialité.
L’étude des ossements en contexte de crémation a longtemps été négligée partant du constat que la fragmentation osseuse était trop importante pour autoriser une étude approfondie. Ce constat a longtemps constitué un obstacle, les archéologues jugeant que l’étude ostéologique ne pouvait pas livrer de données satisfaisantes. Cette attitude a été abandonnée depuis qu’Henri Duday a mis en évidence les possibilités qu’offre l’étude des sépultures à crémation . En effet, en dépit de l’état des vestiges osseux, il reste souvent possible d’identifier le nombre d’individus présents dans les structures et de déterminer leur âge. Les gestes funéraires, les modalités de ramassage sur le bûcher après la crémation peuvent être appréhendés en ayant recours à une analyse pondérale. De même, G. Grévin a participé au développement des analyses des sépultures secondaires en exposant dans une publication une méthode de micro-fouille en laboratoire38. En Angleterre, en 1989, J. McKinley, agacée par une question récurrente posée par les archéologues : … but how can you tell anything from a heap of dust? … 39 souligne le manque d’importance accordée à l’étude des crémations dans son pays et propose une approche pluridisciplinaire, entre archéologues et anthropologues. Sur un plan ostéologique, elle propose une méthode d’analyse pondérale sur la base d’une comparaison avec un squelette actuel brûlé40 . Sans rentrer dans les détails d’ordre biologique, elle recommande que tout matériel présent dans les crémations tels que les charbons de bois, les scories et autres soient relevés et enregistrés . Au-delà des informations proprement biologiques, que livre l’étude des ossements, Fr. Blaizot et D. Castex défendent l’approche archéo-anthropologique en soulignant qu’elle ne se détache en rien des préoccupations de l’archéologie.
L’étude du mobilier céramique associé aux crémations s’inscrit dans une réflexion sur la présence particulière de tel ou tel objet et de son rapport avec le caractère funéraire du dépôt. Dans cette perspective, les céramologues proposent d’établir la fonction des céramiques déposées aux côtés du défunt. À titre d’exemple, à Lyon, l’étude du matériel céramique d’une tombe-bûcher, conduit à proposer une lecture des gestes liés aux différentes étapes de la crémation. Les vases déposés sur le bûcher avant la combustion, appartiennent à des types ayant servi à contenir des nourritures solides, ainsi qu’à d’autres types destinés aux liquides. La présence de ces éléments est en relation avec le repas funéraire du défunt. Les dépôts retrouvés dans la fosse, qui ont été introduits une fois la crémation terminée, sont qualifiés de secondaires et sont représentés cette fois par des vases liés à l’aspersion de parfums et aux libations de vin43.
L’étude du mobilier en verre est traitée de la même manière, en considérant sa position sur le bûcher et son apparition avant ou après la crémation. Notons que dans le cas de dépôts primaires, le feu engendre des déformations de ces objets qui rendent difficile l’identification et l’analyse typologique. Cependant, en dépit de cet obstacle, tous les types d’objets sont reconnus et attestés dans les crémations. On note, en particulier, une grande quantité de vases à parfum, tels que les balsamaires qui témoignent de la présence de parfum brûlé avec le défunt. Et, comme a pu le remarquer Valérie Bel : « à partir de l’époque flavienne, les balsamaires brûlés ou fondus deviennent prédominants par rapport à ceux déposés en offrande après la crémation ». Ces objets ne semblent pas réservés à un usage exclusivement funéraire et ce sont, pour la majorité, des objets détournés de leur usage domestique originel.
De multiples objets qui ne sont ni en céramique, ni en verre sont retrouvés dans les crémations ; ce sont des pièces de petite taille en métal ou en os pour lesquelles il est particulièrement important de prendre en examen leur répartition spatiale. Il peut s’agir, de parures, d’objets de toilette tels que les vases à parfums, des peignes, des outils … et l’analyse de ces petits objets fournit des informations d’ordre social, sur leur genre, un point sur lequel l’étude doit évidemment être confrontée avec les résultats recueillis par les anthropologues46 graines, des fruits et des charbons de bois. En effet, en dehors de contexte édaphiques particuliers (milieux humides, tourbières, milieu anaérobique), ces macrorestes ne parviennent que très rarement jusqu’à nous, détruits par la décomposition. Seule la carbonisation des vestiges assure leur préservation. En contexte funéraire dans le cas des graines et des fruits, les chercheurs tentent d’établir avant tout s’il s’agit de dépôts volontaires. La nourriture semble occuper une place importante dans les rites funéraires, mais si sa présence est suggérée par certaines céramiques il demeure difficile d’en reconnaître les traces durant la fouille. En conséquence, les études carpologiques menées sur les macrorestes végétaux tentent de différencier la part appartenant à la phase de la libation, au repas du mort et à des dons faits au mort 47. Les vestiges osseux animaux sont fréquemment retrouvés dans les structures de crémation, et l’archéozoologue participe pleinement, par ses études, à déterminer la part de pratiques rituelles dans les dépôts alimentaires48.
Pour les charbons de bois, comme nous le détaillerons dans la partie suivante, il s’agira d’identifier des pratiques liées à des dépôts primaires sur le bûcher (objets en bois) et de reconnaitre des activités d’ordre techniques liées au bûcher lui-même, à sa construction et à sa conduite.
En marge des études de terrain, la crémation a été abordée par l’expérimentation archéologique. À notre connaissance, les expérimentations de crémation ont été conduites à trois reprises, chacune d’entre elles propose des objectifs de départ ainsi que des outils variés. La première expérimentation, menée par J. McKinley et A. Marshall en 1993, a été principalement axée sur des problématiques ostéologiques, à savoir observer la position du corps après la crémation, puis analyser les ossements carbonisés. L’observation archéologique s’est concentrée sur l’examen de l’effondrement du bûcher funéraire et de son emprise sur le sol après la combustion . Le bûcher est construit à même le sol selon un entrecroisement de rondins sur une hauteur de 1,40 m environ, des pieux sont plantés aux quatre coins du bûcher et soutiennent en partie la structure. Un mouton est déposé au sommet. Une douzaine de thermocouples mesurent la température en différents points de la structure. Au bout d’1h30 de combustion, le bûcher s’effondre sur lui-même, une température de 1000° C s’est maintenue durant trois heures dans certaines parties du bûcher (Fig. 01).