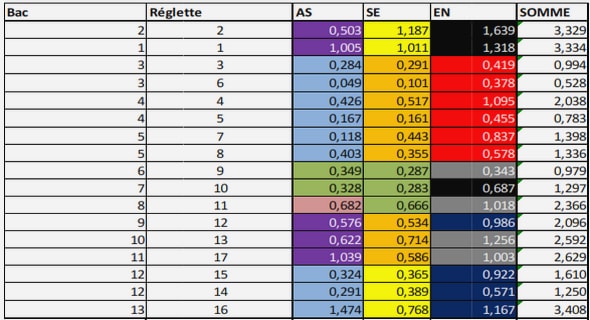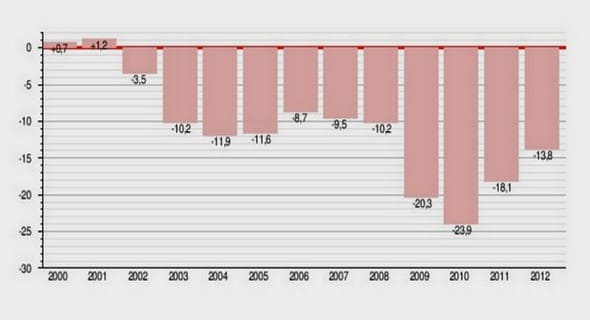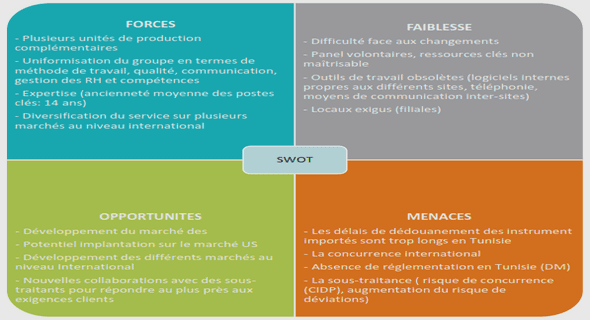Un retour incomplet au Parlement : le Parlement comme révélateur des logiques politiques générales
Depuis le milieu des années 2000 semble s’être amorcé un mouvement qui a pu être qualifié de « retour au Parlement »16 des politistes français. Cette affirmation – semblant parfois tenir autant de la prophétie auto-réalisatrice que du constat – trouve en effet un certain fondement dans la réalité, les travaux portant directement sur le Parlement s’étant multipliés sous les plumes françaises ces dernières années. Ces derniers, cependant, tendent à se cantonner dans quelques domaines bien précis17.
A la suite de l’appel d’Olivier Nay à étudier les Parlements dans une optique de sociologie de la profession politique et de l’analyse des carrières18, plusieurs travaux ont ainsi vu le jour qui s’intéressent à dresser une sociographie des députés et une sociologie de leur activité, afin d’éclairer leurs processus de professionnalisation : outre quelques articles isolés19, on pense notamment à l’ouvrage d’Olivier Costa et Éric Kerrouche20, qui interroge à la fois le profil et les comportements des députés, et plus récemment à l’ouvrage de Julien Boelaert, Sébastien Michon et Etienne Ollion, qui vient éclairer l’effet du passage au Parlement sur la carrière politique en général21. La question de la féminisation progressive du personnel politique a également été traitée, en passant le cadre parlementaire22 – ou les parlementaires au milieu d’une analyse plus générale23 – au prisme d’une approche en termes de genre. C’est dans la même perspective que l’on peut placer les travaux qui relèvent de la sociologie des rôles parlementaires, et qui tentent de mettre en lien les profils sociologiques des députés et les contraintes institutionnelles auxquelles ils sont confrontés afin de faire émerger des typologies de comportements24. Ces travaux font notamment émerger la multiplicité des contraintes auxquelles sont soumis les députés : en raison de leur positionnement, à la fois au local et au national, mais aussi comme représentants de la Nation et élus issus d’un parti. Ils cartographient alors les différentes manières qu’ont les députés de se positionner vis-à-vis d’injonctions contradictoires et souvent irréconciliables.
De manière plus générale, la question de la professionnalisation du monde politique a aussi fait fleurir les travaux portant sur la sociologie des entourages politiques, et notamment des collaborateurs parlementaires, mettant en avant le caractère de plus en plus collectif et de plus en plus institutionnalisé de l’action des députés25, qu’il s’agisse de réaliser une sociographie précise de ces entourages pour mieux comprendre leur influence sur l’activité parlementaire26, ou de comprendre les transactions financières qui ont lieu autour de ces embauches27. Dans une même perspective de sociologie du travail, plusieurs travaux ont suivi les parlementaires et leurs équipes dans le détail de leurs activités quotidiennes28 : en circonscription29 par exemple, ou au travers des personnels30 et des outils technologiques leur disposition31, afin de mettre en lumière l’organisation pragmatique et quotidienne de l’activité politique.
La fonction du Parlement étant, étymologiquement, d’être avant tout l’espace de la parole, plusieurs travaux sont également venus s’intéresser à la construction des discours parlementaires et à la rhétorique employée entre ses murs : mesure de la délibération ou de la violence verbale, historique des argumentaires utilisés, concepts de référence32… C’est le Parlement comme miroir déformant de la société civile, et les parlementaires dans leur fonction de représentation, qui sont alors étudiés : les représentants de la Nation agissent-ils conformément à la vision idéalisée de leur mission, impliquant le dialogue et la défense des intérêts de tous ? Une série de travaux traite ainsi des députés en représentation, soit pour étudier la manière de représenter sur un domaine particulier des politiques publiques33, soit pour mesurer l’écart entre les décisions produites et les attentes citoyennes34.
Preuve de ce retour en grâce du Parlement dans la science politique française : la publication en 2018 du Traité d’études parlementaires35, impressionnante somme de connaissances de plus de 700 pages qui ambitionne de tirer le bilan des recherches, anciennes et récentes, sur l’institution parlementaire en droit et en science politique, sous un prisme très largement francophone. Les auteurs y tirent cependant une conclusion que le bilan de littérature qui précède ne peut que soutenir : celle de la générale absence de prise au sérieux, dans les travaux sur le Parlement, du travail juridique et politique concrètement réalisé au sein du Parlement, loin des circonscriptions. Si l’on a pu en effet assister ces dernières années à la multiplication des travaux qui portent sur les parlementaires ou sur l’Assemblée nationale, la plupart de ces travaux ne s’intéressent pas en réalité directement au travail parlementaire, mais s’intéressent uniquement au Parlement dans la mesure où il commissions parlementaires à l’Assemblée nationale et au Sénat : un havre de paix ? », Parlement[s], Revue d’histoire politique, 2/2010, n° 14, p. 90 – 110, mais aussi aux articles de Jean-Noël Ferrié, Baudouin Dupret et Vincent Legrand, « Comprendre la délibération parlementaire – Une approche praxéologique de la politique en action », Revue française de science politique, 2008/5 Vol. 58, p. 795-815 et de Nathalie Dompnier, « La légitimité politique en jeu. Le chahut organisé des députés français sur la question des fraudes électorales depuis les années 1980 », Parlement[s], Revue d’histoire politique, 2/2010 (n° 14), p. 35-48. Pour une contribution s’intéressant un peu plus à la construction historique des discours repris à l’Assemblée, voir Éléonore Lépinard, « Faire la loi, faire le genre : conflits d’interprétations juridiques sur la parité », Droit et société 1/2006 (n°62), p. 45-66. On peut également citer des travaux un peu plus anciens mais importants, comme Jean-Philippe Heurtin, L’espace public parlementaire. Essai sur les raisons du législateur, Paris, Presses Universitaires de France, 1999, 288 pages ou Nicolas Roussellier, Le Parlement de l’éloquence. La souveraineté de la délibération au lendemain de la Grande Guerre, Paris, Presses de Sciences Po, 1998, 1997, 298 pages, ou encore l’article d’Annie Collovald et Brigitte Gaïti, « Discours sous surveillance : le social à l’Assemblée », in Daniel Gaxie, Annie Collovald, Brigitte Gaïti, Patrick Lehingue et Yves Poirmeur, Le « social » transfiguré. Sur la représentation politique des préoccupations « sociales », Paris, PUF/CURAPP, 1990, p. 9 – 54. Pour une réflexion méthodologique autour de ces enjeux, voir Claire de Galembert, Olivier Rozenberg et Cécile Vigour (dir.), Faire parler le Parlement. Méthodes et enjeux de l’analyse des débats parlementaires pour les sciences sociales, Paris, LGDJ, coll. « Droit et société », 2014, 371 pages.
Par exemple, Martin Baloge, Le travail de représentation des parlementaires français et allemands en matière de politiques fiscales, thèse de doctorat sous la direction de Daniel Gaxie, Université Paris réunit des élus au cours d’une carrière politique, qui produisent des discours et de la représentation politique… Le travail effectif des députés n’est que rarement le point focal de l’analyse. Ainsi que l’écrivent Olivier Rozenberg et Éric Thiers : Le principal manque du Traité tient sans doute dans l’absence d’un chapitre sur la sociologie du travail parlementaire. Le volume considère ce que sont les parlementaires (chapitre 19), ce qu’ils pensent (chapitre 13), comment ils sont sélectionnés (chapitre 11), comment ils votent (chapitre 14), comment le souci de réélection les habite (chapitre 12) mais aucun n’aborde directement ce qu’ils font en tant que parlementaires. Si différentes contributions apportent des éclairages, parfois approfondis, sur nombre d’aspects de l’action des parlementaires, à l’assemblée ou en circonscription – leurs stratégies d’influence (chapitre 15), leurs débats (chapitre 20) ou leurs niveaux de spécialisation (chapitre 13) notamment – il reste qu’une sociologie du travail politique n’est pas présente faute d’être véritablement étudiée dans la recherche francophone et internationale. […] La vie à l’assemblée demeure toujours « un angle mort de la science politique française » (Nay, 2003) contraignant le lecteur à se rabattre sur la description, quelque peu datée, des mœurs parlementaires par Marc Abélès (2000). »36
S’il faudra sans doute de nombreux travaux pour commencer à corriger ce manque dans la littérature des études parlementaires, le travail que l’on a voulu accomplir ici entend proposer un commencement de réponse, en apportant des éléments à la compréhension du travail législatif au concret des députés français.
Le député-législateur, une figure d’un évident anachronisme ?
Les raisons du peu de travaux sur cette question – qui apparaît de prime abord comme centrale – sont simples, et on partage d’ailleurs une partie de leurs constats. Comme on a pu le dire plus haut, le passage en France à la Vème République a donné lieu à un affaiblissement massif des pouvoirs du Parlement37, comparativement aux parlements de la IIIème et de la IVème République notamment. Ce constat se retrouve fréquemment dans les travaux de droit constitutionnel. Une revue rapide des principaux manuels universitaires en circulation montre ainsi que de manière générale, les auteurs soulignent la faiblesse du Parlement sur le plan législatif38, voire prennent directement le parti de ne pas considérer le Parlement comme titulaire du pouvoir législatif. C’est ainsi le cas dans le manuel de Jean Gicquel et Jean-Éric Gicquel : reprenant les termes du doyen Hauriou par lesquels ce dernier exprimait son interprétation conservatrice des lois constitutionnelles de 1875, les auteurs parlent pour le Parlement de la Vème de « pouvoir délibérant », et pas de « pouvoir législatif ». Ils justifient ce choix en affirmant que : « [la dénomination de pouvoir législatif] occulte la réalité contemporaine. Sous la pression de la rationalisation de l’activité parlementaire, fût-elle allégée, et de la discipline majoritaire, […] les assemblées mettent en forme juridique la volonté que [le gouvernement] exprime, sous le contrôle du Conseil constitutionnel »39.
Malgré la réforme constitutionnelle de 2008, dont l’un des objectifs était la revalorisation de la place du Parlement dans l’architecture constitutionnelle française, Armel Le Divellec parle pour la France de « parlementarisme négatif », un système qui « n’impose qu’une faible légitimation du gouvernement et de ses actions par le parlement, si bien que ce dernier n’exerce qu’une influence négative ». Un tel système permet à l’exécutif de gouverner en s’appuyant sur une majorité parlementaire qui remplit essentiellement une fonction de soutien et ne se conçoit pas tant comme une force d’impulsion que de réaction aux initiatives de l’Exécutif. La stricte discipline partisane, jointe à la révérence pour les présidents, a favorisé cette passivité »40. Le constat, sous la plume des politistes, est tout aussi sévère : ainsi Julien Boelaert, Sébastien Michon et Etienne Ollion ont-ils intitulé, sans ambiguité, « Les parlementaires ne font pas la loi » le passage de leur ouvrage où ils décrivent l’activité législative des parlementaires41.
C’est sur cette image très négative d’un Parlement entièrement soumis à l’exécutif que se fonde partiellement le rejet de l’étude du Parlement en tant que législateur en science politique : l’idée semble dater d’un autre temps, d’une autre République, et relever davantage d’une volonté normative inspirée d’une lecture paresseuse de Montesquieu – trouver, nécessairement, le pouvoir législatif au Parlement – que d’une observation du fonctionnement réel des institutions. Ainsi, dans son appel aux politistes à se saisir de nouveau du Parlement comme objet, Olivier Nay explique que : « si l’on s’intéresse aux processus d’élaboration des lois, […] l’intérêt [d’étudier le Parlement] est faible. Les régimes maladroitement qualifiés de « parlementaires » sont en effet des régimes de concentration du pouvoir aux mains des exécutifs : les techniques du parlementarisme rationalisé, le phénomène majoritaire et le rôle des administrations techniques dans la préparation des projets de loi affaiblissent considérablement l’influence des chambres dont l’activité se limite de plus en plus, aujourd’hui, à adopter les textes gouvernementaux. […] On doit convenir que les parlementaires ne font souvent qu’entériner des choix politiques forgés hors de leur hémicycle. L’intérêt d’étudier les pratiques d’assemblée est donc ailleurs »42. Clément Viktorovitch relève également, pour la contredire, cette idée qu’il ne se passerait rien » au cours du processus parlementaire. Il note ainsi que le Parlement est fréquemment décrit dans la littérature scientifique comme « l’un des nombreux théâtres de la compétition politique : il ne serait pas besoin d’y délibérer, dès lors que voter suffirait à enregistrer des rapports de forces préexistants »43. Marc Milet pose le même diagnostic dans sa revue de la littérature dans le domaine des politiques publiques : « Le Parlement n’est en second lieu pas plus considéré comme un site ou une arène clef de la décision publique : ni l’orientation de la politique publique, ni ses effets ne s’y joue(raie)nt en son sein »44.
La faiblesse du Parlement français est un fait qu’il ne s’agit pas de contester. Pourtant, il est bien évidemment excessif de considérer l’intégralité du processus législatif au Parlement comme absolument vide de portée politique et juridique. Des choses se passent entre le dépôt d’un texte et son adoption définitive : des projets de loi sortent transformés, des discussions se tiennent, des propositions et des amendements sont adoptés45. Que ces choses soient ou non de nature à modifier profondément les volontés gouvernementales – et elles le sont parfois46 – ne change pas le fait que le peu de connaissances scientifiques que l’on a sur le quotidien du travail législatif au Parlement est un manque pour notre compréhension des mécanismes institutionnels, et nous empêche de comprendre réellement les raisons pour lesquelles des acteurs continuent de s’investir dans cet espace.
Car en effet, si le discours scientifique semble avoir déjà jugé de la place des parlementaires dans le processus législatif, ces derniers, eux, ne partagent pas entièrement le diagnostic. Analysant les résultats de leur enquête par questionnaires et entretiens auprès des députés français de la XIIème législature, Olivier Costa et Éric Kerrouche notent ainsi que, si ces derniers ont peu d’illusions sur leur capacité à procéder à des changements d’ampleur sur les projets de loi gouvernementaux, cela ne les empêche pas de se mobiliser pour essayer de le faire, en ayant recours aux outils qui sont à leur disposition. Ils notent également que les députés se vivent comme plutôt libres de leurs actes, et pas pieds et poings liés à la discipline partisane : comme « une très, très belle aventure »49, un travail « passionnant », dans le cadre d’une « belle expérience »50, ou une « chance extraordinaire »51. Ces indices, mais aussi la longueur des carrières parlementaires, qui sont le plus souvent le couronnement d’une longue carrière politique antérieure et au sein desquelles il n’est pas rare que les élus se présentent de nouveau pour plusieurs mandats successifs52, forcent le chercheur à aller au-delà du diagnostic à l’emporte-pièce sur l’absence de pouvoir parlementaire : il y a quelque chose qui attache les députés à leur mandat national, et qu’il faut prendre au sérieux.
La plupart des constitutionnalistes, par ailleurs, ne s’y trompent pas : bien que déplorant régulièrement la faiblesse de l’influence législative du Parlement, ils ne concluent pas pour autant à son inexistence, au contraire. Dans les années 1980 déjà, Guy Carcassonne notait la capacité du Parlement à « se glisser dans tous les interstices pour résister à l’abaissement de son rôle »53, dans un article dans lequel il développait les conditions et les limites des modifications apportées par les parlementaires aux projets de loi gouvernementaux. Plus récemment, Olivier Duhamel et Guillaume Tusseau écrivaient également que « l’activité législative du Parlement en général, et de l’Assemblée en particulier, est sous-estimée. Il est de bon ton de dénoncer la réduction de son rôle à une chambre d’enregistrement, mais la réalité dément cette critique qui revient comme une scie »54.