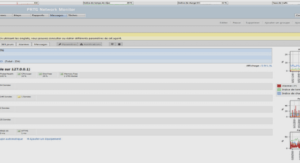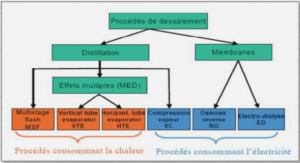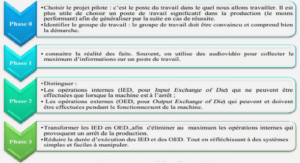LE CONCEPT DE VERITE CHEZ KARL R. POPPER
VERITE ONTOLOGIQUE : QU’EST-CE QUE L’ETRE ?
Notre réflexion montre que la question est mal posée. Où plutôt nous l’avons mal posée. Nous avons admis comme allant de soi une définition de la vérité comme conformité qui suffit peut-être aux besoins de la vie quotidienne mais qui ne suffit certainement pas pour rendre compte l’intelligibilité du monde. Car la vérité comme conformité ne tient pas compte du fondement essentiel de celle-ci, et nous devons toujours faire davantage d’efforts intellectuels pour saisir le sens de l’être tel qu’il se manifeste à nous dans notre expérience du monde. Alors il ne s’agira plus d’une conformité, mais de la reconnaissance d’une transcendance. Il est évident que la comparaison de l’être en lui-même à un concept que nous aurons fabriqué de lui, ne pourra pas rendre compte de la totalité de l’être. Dans un fragment du texte qui nous reste de lui, Parménide nous confie que cette liaison entre l’être et la vérité est toujours le tourment du philosophe ; il faut, dit la déesse à Parménide, : « que tu apprennes à tout connaître, et le cœur paisible de la vérité bien arrondie, et les opinions des mortels ». La vérité bien arrondie signifie chez Parménide 1 M. Détienne : les maîtres de vérité dans la Grèce Archaïque 2 V. Brochard : le l’erreur, 3e édition, Paris, 1929 p.5 12 que l’être est, et que l’opinion des mortels n’autorise aucune croyance vraie, c’est-elle qui s’attache à la multiplicité sensible, au devenir des choses qui sont. Et pour parvenir à la vérité, nous devons être en mesure de conclure qu’il n’y a que l’être qui est, qu’il est la seule réalité réellement réelle, la seule alors qui rend possible la vérité. Mais il ne faut pas se tromper. La pensée ne se trouve jamais devant l’Etre absolu, elle ne rencontre que des étants, des choses de ce monde. Et si la vérité consiste à accueillir le surgissement des étants du monde dans l’être, jamais cependant la philosophie ne peut se situer au moment où l’être se donne en tant qu’être. Ainsi pour le philosophe, l’être ne se manifeste qu’en tant que voilé. En somme, le fait d’être se décline toujours et seulement à travers le fait d’être ceci ou cela. Et la vérité consiste pour le philosophe en ceci qu’on ne peut vraiment parler des étants, ou du monde, qu’en les pensant dans l’horizon infini de l’être. Autrement dit, la vérité est de ne penser et de ne dire aucune chose sans faire apparaître l’horizon qui la fonde. En effet la philosophie comme principe de toute connaissance et la métaphysique comme recherche a posteriori des « raisons cachées » de l’être visent la découverte des premières bases de toute certitude et leur sens proprement ontologique. Par conséquent malgré les oppositions d’écoles, la philosophie et la métaphysique se prévalent d’une vérité unique , laquelle se veut une adéquation de l’intelligence humaine à l’être. Et la tâche de la philosophie consistera à ramener à plus d’évidence les vérités métaphysiques qui ne sont pas toujours manifestes. A la question qu’est-ce que l’être, nous avons répondu, qu’elle est mal posée. En effet lorsque nous examinons attentivement l’ontologie aristotélicienne, nous constatons, qu’elle détermine avec plus ou moins de précision l’objet de la métaphysique, et en particulier ce qu’on a appelé les trois degrés de l’abstraction. Le premier degré concerne la matière sensible, non pas la matière individuelle, mais la matière sensible commune c’est-à-dire celle qui sert de substrat aux différents types de sensibles. 13 Le deuxième degré renvoie à la matière intelligible c’est-à-dire à ce qui est obtenu par la pensée sur la matière sensible. C’est la source des axiomes mathématiques. Et le troisième degré fait abstraction de toute matière ; c’est la science du premier moteur ou de l’être pris absolument. C’est cette plurivocité du concept de l’être qui fonde l’ambiguïté de la question qu’est-ce que l’être ? Cependant, qu’on se situe dans le sensible ou en dehors de lui on voit que l’objet de toute métaphysique est l’être immatériel qui peut s’entendre de deux manières : • L’immatériel est ce qui préscinde de la matière. Ici l’immatériel n’est pas nié mais seulement négligé. L’être est envisagé ici dans toutes ses déterminations les plus universelles. • L’immatériel considéré comme ce qui existe sans matière, c’est la spiritualité dans son mode d’être fondamentalement opposée à toute corporéité. Cette pluralité sémantique du concept d’être est articulée à l’excellente synthèse que représente l’ontologie aristotélicienne. Dans sa volonté de réconcilier la conception éléatique de l’être– l’être est un tout qui gomme toute possibilité de connaissance, l’homme doit croiser les bras et écouter ce que lui dit l’être -, et le point de vue sophistique d’un langage humain capable de dire adéquatement l’être – l’homme va à la rencontre de l’être, et le conceptualise-, Aristote va faire de l’être objet de la science. Ainsi, pour lui cette notion plurivoque de l’être se dit de plusieurs manières, et selon quatre modes. C’est cette difficulté de cerner l’être du fait de son sens amphibologique qui fonde la complexité de la proposition : le vrai est ce qui conforme au réel, c’est-àdire à l’être. Et cette amphibologie suggère qu’il existe un sens fondamental et des sens dérivés de l’être 1 . Ainsi pour étudier l’être, Aristote fait une nette distinction entre science fondamentale et sciences dérivées, liées chacune à un mode de l’être. C’est le lieu de rappeler ici que chez Aristote l’univers est divisé en deux mondes hiérarchisés : le monde sub-lunaire et le monde supra-lunaire. Le premier est celui de la génération et de la corruption c’est à dire du changement et du devenir. Ce monde est inférieur , du point de vue de la dignité au second monde qui est celui de la perfection. Il n’y a pas du point 1 Chez Aristote l’être se décline de diverses manières selon les dix catégories : la substance, la qualité, la relation, la quantité, le lieu, le temps, la position, la possession, l’action et la passion et selon quatre mode d’être : l’être par essence, l’être par accident, l’être comme vrai et l’être comme puissance et actes de vue doctrinal, une homogénéité de l’univers chez le stagérite – Contrairement à son maître Platon qui établit la certitude de la connaissance en séparant le monde intelligible du monde sensible, en affirmant que celui-là est transcendant, Aristote se demande alors comment pourra-t-on expliquer l’intelligibilité du monde ? A la dichotomie platonicienne entre deux mondes étrangers l’un à l’autre, incommensurables : le sensible et l’intelligible, Aristote développe la thèse selon laquelle, l’intelligibilité est immanente au sensible. Il n’y a pas d’intelligible qui ne renvoie pas par quelque côté au sensible. Nous reviendrons sur cette question au paragraphe suivant. Cette difficulté à saisir l’être, nous amène à nous demander comment comprendre, comment connaître l’être ? Nous avons vu que Aristote distingue l’être en tant qu’être, en qui l’essence et l’existence coïncident, qui est l’objet de la philosophie première, et les êtres qui possèdent de la matière, objet de la philosophie seconde. Cette philosophie première s’occupe donc de l’être pris absolument. Cet être, dont parle Jean Marc Narbonne comme étant un « néant de déterminations », est la limite, extrême du pensable. Tandis que les êtres matériels se prêtent aux différentes sciences. Ainsi comme on le voit les différents aspects de l’épistémè tirent leurs sens et leurs objet des multiples modalités de l’être. Par ailleurs Aristote divise la matière en matière sensible et en matière intelligible. Mais chez Aristote l’intelligible prescinde du sensible, et en constitue le garant indispensable, inhérent à la théorie de la connaissance des choses. Est sensible chez Aristote toute matière qui subit le processus de génération et de corruption. Le sensible est donc pour lui la condition nécessaire de la connaissance. Grâce à la sensation l’homme forme des images sensibles appelées : concepts. Ainsi il existe trois sortes de sensibles : • Le sensible propre : celui qui est perçu par un seul sens par exemple la couleur, le son, la saveur etc • Le sensible commun à plusieurs sens par exemple la grandeur et le mouvement • Le sensible par accident. Il constitue la détermination de la chose, mais n’est pas essentielle quant à la notion par exemple l’eau est incolore. Aristote divise son épistémé en trois sciences que sont : la science pratique, la science poétique et la science théorétique. La science pratique est la science dont l’acte est immanent à l’agent. Il y a identité entre celui qui exécute l’action et le résultat de l’action exemple l’art de la danse. La science pratique est la science dont le résultat est extérieur à l’artiste. La science théorétique se divise en trois parties : sciences physiques, science mathématique et science théologique : c’est la spéculation. On sait qu’Aristote définit la matière comme ce qui a « la puissance d’être déterminé » 1 . En somme c’est ce qui sert de principe aux choses. La matière se présente alors comme le substrat de tout acte réalisé c’est à dire comme entéléchie. Elle constitue, lorsqu’elle est liée à la forme, l’élément nécessaire à cette union. Ainsi la matière est dite intelligible, lorsqu’elle se trouve dans les êtres sensibles, mais non en tant que sensible . Cela signifie que pour Aristote les êtres sont éternels incorruptibles, mais non séparés de la matière. Il trouve ces êtres dans les notions mathématiques telles que les axiome par lesquels on détermine les dimensions et les proportions, mais également l’espace, le temps et le nombre. Cette complexité de saisir l’être explique son rôle d’écran. Le mot écran se donne à comprendre ici de deux façons. Une première compréhension renvoie à ce qui fait voir, ce qui permet de mieux comprendre. Mais, écran peut également signifier opacité. Ce qui voile les rapports entre différents éléments d’une structure, d’un tout.
INTELLIGIBILITE DE LA NATURE
Devant la beauté de l’univers, les anciens philosophes ont eu l’idée d’expliquer l’harmonie du monde, l’idée que le monde est un cosmos, c’est-à-dire un ordre. Ainsi partout de cette intuition générale, ils entreprirent d’étudier les rapports et les régularités dans la nature. A partir de cet effort de compréhension de l’univers, il en viennent à concevoir un ordre plus abstrait des nombres et des idées. Et, de cette intuition de la beauté du cosmos, les anciens en tirent également la conception d’un ordre pouvant régner dans la cité des hommes. Cette nouvelle recherche de critères d’intelligibilité, de cohérence et de rationalité des principes qui régissent les phénomènes de la nature, constituent une rupture épistémologique nette avec les conceptions magico-religieuses antérieures. Mais cette démarche n’en était encore qu’à ses premiers balbutiements. C’est à Platon, à qui, il revient l’honneur de la systématiser. IL va critiquer les opinions qui prévalaient à l’époque, et qui, jusque là, tenaient lieu de philosophie. Cette critique, on la retrouve dans un dialogue comme le Phédon où il définit la physique comme une enquête sur la nature. Platon considérait que ces opinions reçues n’étaient rien d’autre que de l’historia c’est-à-dire l’ensemble des connaissances empiriques ou irrationnelles sur le monde. Elle renvoie à toutes les cosmogonies grecques qui, avant Socrate, tenaient lieu de philosophie de la nature. Or, nous dit Platon, l’historia n’est pas de la philosophie. Celle-ci se veut rationnelle, intelligible. La philosophie est un savoir qui se justifie de luimême à partir d’un certain nombre de critères qui sont ceux de la logique et de la cohérence. Platon remet donc en question la philosophie de l’époque présocratique, du moins ce qui en tenait lieu, car elle se révèle être une connaissance qui engendre l’ignorance. On peut ici faire le parallélisme entre cette démarche de Platon, et celle plustard de Descartes dans le discours de la Méthode. C’est bien cette beauté de l’univers qui est à l’origine de l’étonnement de l’homme, étonnement qui change radicalement le rapport de l’homme au monde, mais aussi qui l’incite à devenir comme « maître et possesseur de la nature ». L’homme qui prend en considération l’existence du monde indépendamment de sa conscience, ne serait-il pas capable de s’interroger sur les relations qui s’expriment diversement dans les phénomènes qui se produisent dans l’univers ? Ainsi l’homme a toujours cherché à apaiser son inquiétude existentielle. Cette recherche le conduit par exemple à essayer de trouver la réponse à la question « De quoi se compose l’univers ? », celle-ci va avoir des réponses diverses. Pour l’antique civilisation de Babylone la terre est un disque posé sur une nappe d’eau douce. Et tout autour du disque, il y a de l’eau salée. Mais les babyloniens ne considéraient pas l’eau 17 comme de l’eau, mais comme un ensemble d’êtres surnaturels. Ces derniers étaient considérés comme des divinités qui en fonction de leur état d’âme, pouvaient intervenir positivement ou négativement dans l’activité quotidienne des hommes. Le premier philosophe à se départir de l’attitude cosmogonique, fut Thalès de Milet. Il aborda cette question sous un angle autrement différent. En effet, il avait de l’univers une conception différente parce qu’elle se passait des dieux et déesses ainsi que des grandes batailles d’êtres surnaturels. Il répondait simplement : « Tout est formé d’eau ». Cette conception, qui consistait à chercher l’archê des choses dans un élément de la nature – l’eau pour ce qui concerne Thalès-, inaugurait de profondes transformations de la pensée antique quant à l’interprétation et l’explications des phénomènes naturels. Ainsi, selon Thalès et ses élèves, aucune divinité n’intervient dans le fonctionnement de l’univers. Celui-ci ne se conforme qu’à sa propre nature. Pour eux, les calamités ne se déchaînent et les nuages n’apparaissent qu’en vertu de certaines causes naturelles. Ils ne se manifestent que lorsque leurs causes matérielles existent. Thalès et ses disciples arrivent à la conclusion selon laquelle : l’univers se comporte selon certaines « lois de la nature » qu’on ne peut ni supprimer, ni changer. Un tel univers est-il meilleur que s’il obéissait aux caprices des dieux ? Si ces divinités agissaient selon leur bon plaisir, qui pourrait prédire ce qui surviendrait le lendemain ? Se pourrait-il même que le soleil ne se levât le lendemain si, malencontreusement quelque chose venait à contrarier le « dieu soleil ». Alors, si la proposition fondamentale de Thalès et ses disciples est vraie, c’est-àdire que l’univers obéit à des lois de la nature, qui ne changent pas, il faut chercher les mécanismes qui les régissent. On pourrait de ce fait observer la façon dont les étoiles se déplacent, les nuages flottent, les pluies tombent et les plantes poussent. Dès lors, on peut être certain que ces observations conservent leur constance sans changer soudain par l’intervention d’une divinité quelconque. Cette démarche aboutit à dégager des lois simples pour décrire et interpréter la nature générale des phénomènes. Il sera alors possible à la raison humaine d’explorer la nature des lois gouvernant l’univers. 18 L’hypothèse posée par Thalès selon laquelle l’homme peut explorer à l’aide de la raison les lois de la nature, jette les bases fondamentales de l’idée de la science. Nous disons bien hypothèse c’est-à-dire supposition et rien de plus. Mais le constat est là : depuis Thalès, il y a toujours eu des hommes qui se sont acharnés à y croire obstinément. Il est certes vrai que l’univers est bien plus complexe que Thalès n’a jamais pu l’imaginer. Cependant certaines lois de la nature s’expriment simplement. L’une d’entre elles, la loi de la conservation de l’énergie s’énonce ainsi « l’énergie totale de l’univers est constante ». mais qu’est-ce qui peut expliquer cette emprise de la raison sur le réel ? Les raisons de cette emprise sont à rechercher dans le postulat suivant : il y a une homologie entre la structure de l’esprit ou de l’entendement et la structure du réel. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre ces propos de J. Ullmo : « Depuis ses premiers pas, la science, toujours, a été imputé à la puissance propre de la raison, et les différentes réponses qui ont été apportées à cette question ont constitué les formes diverses du rationalisme, la doctrine qui affirme et veut expliquer le pouvoir de l’esprit sur les choses1 ». Cette démarche, propre à l’activité intellectuelle qui permet à la raison de se déployer pour rendre compte des phénomènes de la nature, a été très tôt perçue par « les opinions qui avant nous se sont engagées dans l’étude de l’être, et qui ont philosophé sur la vérité ». Dans le prolongement de cette rupture, Pythagore va faire consister l’archê dans le nombre. Il est le premier homme connu, ayant médité non pas sur la musique, mais sur les rapports entre longueurs des cordes qui la produisaient. Il en déduisait que les nombres gouvernaient la musique et peut-être l’univers tout entier. Le développement de l’étude des nombres, va conduire Pythagore à la découverte du théorème qui porte aujourd’hui son nom. Les enseignements de Pythagore et surtout le succès qu’il a eu en démontrant par la déduction la validité de son théorème, ont fait école et se sont imposés, comme moyen, aux Grecs pour découvrir la vérité. Cette démarche pythagoricienne repose sur deux principes : l’étude des propriétés des nombres et l’emploi du raisonnement par déduction. Ainsi, ce n’est pas seulement des notes de musiques que Pythagore a tirées de ses cordes mais, tout le fondement de ce qui va constituer ultérieurement la mathématique.
LA VERITE RESSEMBLANCE
E. Kant distingue le réel en soi des phénomènes. Nous parlerons ici de la ressemblance au sens large du terme. Et nous sommes tout de suite confrontés à un problème. Est-ce possible, que la connaissance rationnelle du réel ne soit pas affectée par la subjectivité du sujet connaissant ? C’est-à-dire sommes–nous en mesure de connaître la réalité telle qu’elle est ? Pour Kant cette tentative est vaine. La réalité en soi est, selon lui, inconnaissable. Contrairement à lui, Schelling note : « Qu’en se plaçant ainsi au point de vue de la manière de voir ordinaire, on trouve, profondément gravée dans l’entendement humain, la conviction non seulement qu’il existe un monde de choses extérieures à nous, mais aussi que nos représentations s’accordent avec ces choses d’une façon tellement parfaite que nous nous croyons en droit d’affirmer qu’il n’y a dans les choses rien d’autre que ce que nous nous représentons [] la conviction que les choses sont exactement telles que nous nous les représentons, que nous connaissons par conséquent les choses telles qu’elles sont en soi » 2 . Pour Schelling, on ne peut connaître que le vrai, et que cette vérité est l’accord de nos représentations et des objets. C’est accord qui explique selon lui la notion d’harmonie préétablie entre le monde objectif et le monde de la représentation. Mais cette harmonie n’est pas identité. S’il n’y a pas identité entre le monde subjectif et le monde objectif, en tout état de cause, la conception de Schelling de la vérité se ramène à celle de ce que luimême appelle « l’entendement ordinaire », c’est-à-dire la vérité ressemblance. Par conséquent cette position de Schelling, en dernière analyse n’est pas totalement éloignée de celle de Kant qui affirme admettre « la définition nominale de la vérité qui en fait l’accord avec son objet1 » ou encore précise-t-il « l’adéquation de nos concepts avec l’objet ». On voit bien ici que les termes accord ou adéquation impliquent la ressemblance. C’est dans ce sens qu’il faut saisir la fameuses formule de Saint-Thomas, formule d’ailleurs courante au Moyen Age ; « la vérité consiste dans l’adéquation de l’esprit et de la chose », ou encore cette réflexion de St-Augustin, « Le vrai est ce qui est tel qu’il paraît au sujet connaissant » . Nous savons que Platon bien qu’ayant critiqué ce concept de vérité ressemblance, ne le rejette pas totalement. En effet, il affirme que : « le semblable est connu par le semblable »5 . Or, nous savons que cette ressemblance chez Kant ne concerne nullement le noumène, puisque ce dernier n’est pas accessible au sujet connaissant. Ainsi, selon Kant l’objet est l’objet pour nous, c’est-à-dire le phénomène. A la différence de Kant, l’auteur de la Science de la logique, Hegel, rejette cette conception du sens commun. Il estime qu’un concept qui n’est pas adéquat à une réalité, et qu’une réalité qui ne peut se mouler au principe rationnel ne sont que « des représentations vides de vérité ». Car selon lui, et contrairement à Kant , nous pouvons effectivement connaître le réel en soi. Ainsi pour lui la connaissance rationnelle n’est pas seulement ressemblance, c’est-à-dire identité simplement qualitative, elle est plus. Elle est en outre identité numérique. La vérité est à partir de ce moment « l’unité, dit-il, du concept et de la réalité » 6 . En outre le concept de vérité comme ressemblance pose un problème lorsque nous sommes dans l’abstrait. En mathématique ou en logique par exemple, la notion de ressemblance n’a pas de sens puisque la réalité à laquelle l’on se réfère n’existe pas. Le mathématicien ne raisonne pas sur le particulier mais sur l’universel. Et cette universalité nous interdit de parler de ressemblance, car la ressemblance renvoie toujours à un objet particulier. Il demeure donc constant que la vérité ne peut être définie comme ressemblance. Pour la simple et bonne raison que l’erreur ressemble aussi à la réalité, puisqu’elle n’est possible qu’à sa ressemblance à la vérité. Par exemple on peut avoir des difficultés à distinguer des boules non discernables quant à leur forme et leur couleur, mais distinctes par leur densité. De même deux jumeaux homozygotes peuvent se ressembler adéquatement par leur morphologie, mais totalement différents par leur caractère. On peut donc opposer à la notion de vérité ressemblance, l’objection suivante : si la vérité est ressemblance alors « pour connaître si le tableau est vrai ou faux, nous devons le comparer à la réalité » 1 . Or, il n’est pas possible de faire une telle comparaison, car ou je peux directement connaître la réalité sans user de subterfuge, la vérité n’est pas alors ressemblance, ou je ne peux atteindre la réalité, dans ce cas je ne dispose d’aucun moyen pour faire la comparaison. Car pour comparer il faut avoir au moins les termes de la comparaison. En science par exemple, notamment dans le domaine de la mécanique quantique, nous savons qu’il est impossible de séparer, dans le processus de connaissance, la part de l’observateur et celle de l’observé, ainsi nous ne pouvons connaître la réalité telle qu’elle est indépendamment du sujet connaissant. C’est le sens de propos de L. Rosenfeld : « En physique classique, on peut établir une distinction nette entre le système étudié et les moyens d’observation et par conséquent faire abstraction de ces derniers dans la conception du phénomène. L’existence du quantum d’action rend cette distinction impossible, parce qu’elle impose une limite à l’analyse de l’interaction entre le système et l’appareillage qui fixe les circonstances dans lesquelles nous l’observons. C’est donc maintenant le tout indivisible formé par le système et les instruments d’observation qui définit le phénomène1 ». Ainsi le but de la science contemporaine n’est plus l’image qu’elle se fait de la nature, mais « l’image de nos rapports avec la nature ». Cette réfutation du concept de vérité ressemblance va nous permettre d’examiner les autres notions de vérité.
LOGIQUE ET VERITE FORMELLE
La connaissance rationnelle est la connaissance qui s’acquiert uniquement par l’exercice de la raison et, qui ne s’accompagne pas de l’observation de l’état réel des choses. Les principes de la logique formelle et des mathématiques pures constituent le paradigme de la connaissance rationnelle. La vérité de celle-ci ne se démontre que par la démarche déductive. La connaissance hypothético-déductive se distingue alors de la connaissance intuitive et de la connaissance empirique par l’absence totale de la subjectivité et par sa validité universelle. Fondamentalement abstraite et formelle, elle traite des relations logiques et des significations impersonnelles, elle ne tient compte ni des besoins affectifs ni de l’état réel des choses. On comprend ainsi aisément que pour le rationaliste, la vérité d’une proposition est déterminée par la cohérence de la chaîne de déductions postérieures. Les mathématiques recourent à bien des égards à cette démarche. Elles constituent un modèle de rigueur et de certitude. A cet idéal de certitude, le XVIIe siècle, avec surtout R. Descartes, s’est particulièrement distingué pour délester la pensée des pesanteurs de l’irrationnel. Ainsi un énoncé mathématique semble être une vérité éternelle, en ce qu’il apparaît démontré une fois pour toutes. L’essor de la physique mathématique, à partir de Galilée, puis plus tard des autres sciences, y compris des sciences humaines, a progressivement montré qu’une science n’était science que lorsqu’elle est mathématisée. Le développement ultérieur du rapport que les mathématiques entretiennent avec la logique constitue l’épine dorsale de ce nouveau paradigme. Cette situation appelle un questionnement philosophique dont l’horizon est toujours la détermination de ce qui constitue cette certitude et cette rigueur exceptionnelles, et la raison de cette extension quasi universelle. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre que la formalisation des théories mathématiques fondamentales, suscitée à l’origine par les problèmes de « fondement » des mathématiques ait conduit à la fin du XIXe siècle et au début du siècle dernier, au développement autonome d’une logique mathématique qui crée ses propres problèmes et concepts. 31 Il faut aussi signaler les travaux de Descartes, car ils sont contemporains à la mathématisation de la physique. Le fondement de la mathématique cartésienne tient en trois points. 1. La vérité dépend de l’évidence des idées claires et distinctes : une idée n’est vraie que si son contenu épuise entièrement l’essence dont elle est la représentation. Ainsi chez lui, le critère de la vérité c’est l’évidence. 2. C’est le propre des essences mathématiques de pouvoir ainsi être livrées sans résidu, d’être des « natures simples » objet d’intuition rationnelle. 3. L’espace réel est l’étendue géométrique Les mathématiques se caractérisent par la constitution du langage qui les exprime, elles tiennent alors leur rigueur et leur certitude de leur forme discursive ou logique. Ce formalisme dont l’un des principaux représentants est Leibniz, cherche à exprimer le raisonnement mathématique dans un calcul logique, et en conçoit l’extension à tout le réel comme l’universalité d’une forme. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et au début du Xxe siècle les mathématiques prennent un aspect nouveau. On assiste à la naissance de la théorie des groupes, théorie qui porte moins sur des êtres ontologiquement ou mathématiquement déterminés (figures, nombres) que sur le réseau des opérations qui réglemente leur maniement sur des structures. On va élaborer ainsi progressivement le concept d’ensemble, de cela découle la possibilité d’enchaîner déductivement toutes les mathématiques à partir d’un nombre restreint de concepts primitifs. On croit alors possible de construire toutes les mathématiques à partir d’un langage logique élémentaire. A la suite de la découverte des paradoxes de la théorie des ensembles1 , l’axiomatisation devient une des activités essentielles du mathématicien. En outre la certitude et la rigueur des mathématiques n’apparaissent plus comme un fait, leur fondement devient un problème, dont la formulation va constituer une tâche pour le 1 Le paradoxe B. Russel sur les ensembles : soit l’ensemble de tous les ensembles qui ne se contiennent pas euxmêmes ; supposons qu’il se contienne lui-même, alors il ne doit pas se contenir lui-même, supposons qu’il ne se contienne pas lui-même, alors il doit se contenir lui-même 32 mathématicien. Il s’agit de construire un système formel dans lequel, il serait possible de déduire toutes les mathématiques connues à partir d’un nombre minimum d’axiomes, et de règles de déduction parfaitement définies, ou tout recours à l’intuition serait banni ; de démontrer la non-contradiction de ce système. Par l’adoption du formalisme, va-t-on vers la libération de la géométrie de tout son contenu intuitif ? Car les intuitionnistes soutiennent que pour qu’on accorde l’existence à un être mathématique, il faut être capable de le construire effectivement. Ils sont alors conduits à rejeter des mathématiques les êtres dont on démontrerait simplement l’existence par l’absurde1 . Le formalisme est une conception qui fait de l’ensemble des mathématique un système déductif tenant sa valeur de sa seule forme. Cette conception est celle de N. Bourbaki, pseudonyme d’un groupe de mathématiciens français qui ont entrepris la publication, à partir de 1940, d’éléments de mathématiques ayant pour ambition de reprendre toutes les mathématiques axiomatiquement. En vérité, l’idée d’une connaissance formelle est en sens aussi ancienne que la réflexion sur la science, c’est-à-dire que la philosophie, elle remonte des présocratiques. En effet différentes sources indiquaient que les Eléates la pratiquaient comme un moyen d’analyse et de connaissance. L’idée qui apparaissait en filigrane dans leur pensée était la suivante : dans le domaine du raisonnement pur, il faut privilégier le concept sur la percept. Les arguments des Eléates ont cette particularité, ils disqualifient l’expérience sensible. Par conséquent, il semble intéressant d’examiner les principes qui déterminent leur méthode et de faire la description de leurs traits généraux. Le premier d’entre eux repose sur la distinction faite entre le domaine de la vérité et celui de l’opinion. La vérité est ce qui est affirmé de l’être et qui lui appartient en propre. C’est dans ce que Parménide écrit : « l’être est, et le non être n’est pas ». A 1 Refus de l’existence des ensembles infinis. Par exemple l’axiome du choix : étant donné une famille d’ensembles donnés disjoints et non vides, il est possible de former un ensemble constitué prélevant un élément de chacun d’eux. 33 l’opposé l’opinion est du domaine de l’apparence, des illusions et donc du non être. L’opinion selon G.Bachelard » ne pense pas ». Le second est la distinction entre le percept et le concept. Leur enseignement se particularise par leur prise de position purement intellectuelle et sans équivoque contre le sensible et pour l’intelligible. Ainsi en choisissant délibérément de ne s’intéresser qu’à la réalité abstraite au-delà du concret, ils fondaient leur confiance dans la solidité et la validité des concepts. Cette attitude n’indique pas seulement une exigence de séparation des deux domaines, mais également de façon implicite leur croyance à la supériorité du concept sur le percept dans le domaine de la connaissance. Cette distinction entre la vérité et l’opinion, est pour eux, la preuve que seul ce que l’esprit contrôle et construit rigoureusement est apte d’être validé sans conteste. Par ailleurs nous savons que l’un des principes de l’école des Eléates est la réfutation par l’absurde. Mais comment se présente cette réfutation ? Qu’est-ce que l’absurde ? L’absurde est définie comme étant une contradiction saisissable sous la forme de deux termes dont l’un est la négation de l’autre sous le même rapport. La particularité de la réfutation par l’absurde est l’observance implicite dans ce type de raisonnement de deux principes propres à toute méthode soucieuse de cohérence. Cela signifie d’abord qu’à chaque moment du raisonnement, la contradiction dans le processus de la pensée est identifiée, dénoncée comme insoutenable et inadmissible. Ensuite que la conclusion rejette la possibilité de la contradiction. Par ailleurs cette démarche de réduction par l’absurde, si souvent utilisée dans le raisonnement mathématique et en logique est un procédé d’administration de la preuve. C’est-à-dire c’est un raisonnement qui consiste à démontrer que toutes les solutions envisageables sont fausses à l’exception d’une seule. Comme on le voit du point de vue logique, ce raisonnement n’est possible que si l’on ne fait pas intervenir l’expérience concrète dans la démarche pour établir la preuve.
Introduction |