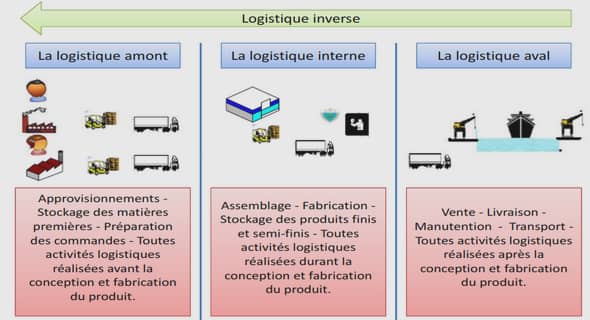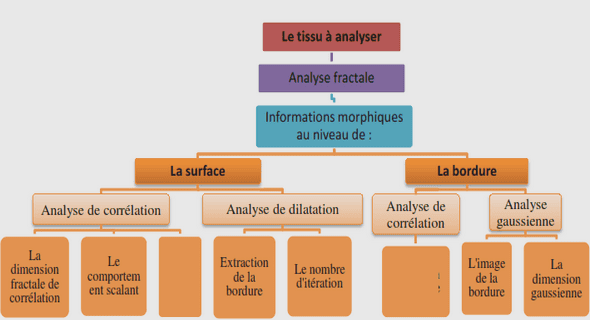Méthode et plan
Afin de comprendre le combat chevaleresque et ses évolutions, notamment avec la transformation de l’armure, j’ai choisi de me concentrer sur les représentations iconographiques des combats, et particulièrement sur deux types de sources : une iconographie « narrative », mais réaliste (la Bible de Maciejowski) et les livres de combat (Liber de arte dimicatoria, Fior di Battaglia, Florius de Arte Luctandi). Ce type d’analyse s’inscrit dans la continuité des recherches sur les AMHE, et je tente de mettre en regard la technique avec la question de la protection et de la représentation. Mon mémoire s’organise en trois grandes parties, qui constituent les trois grands « pôles » du combat chevaleresque : la protection, la technique en elle-même et la question de la représentation. Chaque partie correspond à une manière différente d’aborder les sources. Dans la première partie, « L’armure : réelle protection ou contrainte ? », je m’attache démontrer l’aspect essentiel de l’armure, tout en pointant ses imperfections et les contraintes réelles qu’elle impose, notamment dans la psychologie du combat et la tactique. Pour cela, j’utilise les sources de manière à analyser les blessures et points faibles de l’armure, et à comprendre la structure d’une armure et la contrainte que cela entraîne (ou non) sur le corps d’un individu, sur son état d’esprit, et sur les implications « logistiques ».
Dans la deuxième partie, « L’art du combat chevaleresque », je me concentre sur les techniques de combat en elles-mêmes, principalement à travers les livres de combat, qui sont la source la plus directe sur la question. Pour ce qui est de la Bible de Maciejowski, dont l’iconographie est réaliste, mais qui n’est pas une source technique, je tente de comprendre les techniques à travers la récurrence des coups et par comparaison aux sources postérieures. Je commence donc par appréhender les corpus techniques et théories de l’escrime de chaque maître étudié, avant de me concentrer sur le maniement de chaque arme, et les intentions guerrières qui y sont liées.
Enfin, dans la troisième partie, « Les représentations du chevalier : un combat normé et esthétique ? », j’aborde l’iconographie de mes sources de manière à saisir la représentation du combat en lui-même et la représentation du chevalier dans le combat, à travers la présence d’éléments « esthétiques » comme les armoiries, mais aussi l’esthétique du geste. L’objectif de cette partie est de comprendre l’influence de la nature des combats et de l’apprentissage sur les constructions techniques et mentales qui donnent ce mélange entre efficacité et représentation que sont les combats chevaleresques.
Historiographie.
Mon mémoire s’inscrit dans la continuité des recherches sur les Arts Martiaux Historiques Européens (AMHE). Comme l’indique Bertrand Schnerb1, les AMHE sont un courant historiographique nouveau. De jeunes chercheurs recréent des conditions pratiques, des reconstitutions du geste et s’appuient sur des manuels didactiques (les livres de combat). Ce courant historique n’est pas le produit d’une idée fondatrice d’un grand maître ou du travail d’une école historique. C’est le résultat de confluences quasi-spontanées de questionnements scientifiques nés d’un intérêt commun pour l’histoire de la guerre médiévale et par un goût de la reconstitution. C’est « le mariage inattendu d’une démarche historienne scientifique et d’une vision moins conformiste de l’Histoire ».
Même si les AMHE sont un domaine historiographique récent, l’intérêt pour les armes et armures est ancien. Toutefois, la plupart du temps, les historiens du XIXe siècle ont tendance à faire des catalogues de chefs-d’œuvre. Parfois ce sont des objets plus ordinaires, mais il s’agit de description de l’objet en lui-même. C’est une approche archéologique traditionnelle. Les chronologies établies au XIXe siècle sont de qualité, et l’œuvre de Viollet-le-Duc fait encore référence en termes de datation des styles et objets pour ce qui est de l’armement médiéval. Encore au XXe siècle, Claude Blair2 pratique ce genre d’approche, avec une chronologie et une description structurelle très détaillée des armures médiévales. L’historien belge Claude Gaier3 a largement participé au renouvellement de l’étude de l’armement médiéval dans son aspect sociologique. L’arme permet de comprendre le guerrier qui la manie et son époque. Même s’il n’appartient pas au courant des AMHE, il est une véritable référence dans ce domaine.
Les AMHE concernent essentiellement la compréhension des techniques de combat et leur reconstitution. Ils se fondent sur les livres de combat ainsi que, parfois, sur une iconographie moins technique, mais représentative des combats, ce qui a largement orienté le choix de mes sources. Même si mon mémoire s’inscrit dans la lignée des AMHE, j’essaie de combiner cette approche nouvelle à celle développée par Claude Gaier. J’étudie le combat et ce qui l’entoure comme vecteur d’une mentalité. Là où les premiers travaux d’AMHE étudient le combat et le comprennent par le contexte, j’ai pour but de comprendre le chevalier comme individu à travers le combat.
C’est pourquoi des travaux comme ceux de Christiane Raynaud sur la hache sont particulièrement utiles dans le cadre de ma recherche. Là où il s’agit de comprendre un contexte et des sociétés à travers un objet, je cherche à comprendre un individu à travers la manière dont il manie les objets qui lui sont liés. De plus, j’utilise les travaux de Michel Pastoureau dans le tout dernier chapitre afin de comprendre le rapport des chevaliers au symbolique dans leur autoreprésentation constante.
Les sources.
J’utilise principalement quatre sources iconographiques, mises en regard avec une source littéraire et les planches d’Eugène Viollet-le-Duc concernant l’armement:
– La Bible de Maciejowski, Latin, c.1250, Pierpont Morgan Library, New York. Un Ancien Testament enluminé appelé « Bible de Maciejowski », « Morgan Picture Bible » ou encore « Crusader Bible » parmi les principaux noms qu’on lui attribue. Cet ouvrage a été réalisé entre 1244 et 1254, probablement à Paris ou dans ses alentours.
Consultable sur le site internet de la Pierpont Morgan Library, New York : http://www.themorgan.org/collection/Crusader-Bible/thumbs
Les principales batailles sont présentes en Annexe I.
La Bible de Maciejowski est une œuvre originale au parcours assez chaotique. Selon Daniel Weiss, dans The Book of Kings, le commanditaire de cette Bible est probablement saint Louis, peu avant son départ en croisade, dans la même optique que la Sainte-Chapelle, le programme iconographique et le style de l’ouvrage comme du monument étant très proches. Cet Ancien Testament a donc été réalisé très probablement entre 1244 et 1254. Il s’agit au départ uniquement d’un livre d’images, les commentaires en latin ayant été ajoutés plus tardivement, probablement au début du XIVe siècle, d’après leur style bolognais de cette époque. On suppose que la Bible de Maciejowski était alors passée entre les mains de Charles d’Anjou (1226 – 1285), alors roi de Sicile. Elle reste en Italie jusqu’à revenir au cardinal de Cracovie, Bernard Maciejowski, au début du XVIIe siècle. En 1604, le cardinal remet cette Bible à la mission diplomatique envoyée par le pape à Ispahan, comme cadeau pour le Shah Abbas le Grand, qui fait rajouter une traduction en persan. Après le sac de la ville en 1722 par les Afghans, la Bible de Maciejowski arrive entre les mains d’un propriétaire juif, d’où les commentaires en judéo-persan. Cette œuvre est plus tard retrouvée par John d’Athanasi, puis passe entre les mains de divers propriétaires anglais avant d’être vendue à John Pierpont Morgan Jr., d’où sa conservation actuelle à New York.
Cette œuvre offre une représentation iconographique assez complète de la société du XIIIe siècle vue par les aristocrates. En effet, les enlumineurs représentent avec force de détails leur propre époque et non l’époque biblique. Les batailles sont nombreuses, particulièrement détaillées et crues, avec un caractère épique, mais surtout un réalisme marqué par rapport à d’autres sources iconographiques. Les principaux protagonistes des combats sont bien entendu représentés en chevaliers, et ce de manière très détaillée. Cela permet d’apprécier les situations de combat en armure, et d’observer différentes techniques ainsi que des éléments concernant l’armure elle-même : outre sa forme, on peut saisir son degré de protection et les points particulièrement sensibles. Faute de traités de combat ou de représentations « techniques » des combats chevaleresques en général, la Bible de Maciejowski permet d’appréhender le combat chevaleresque en armure, et le rapport des chevaliers au combat. En outre, les scènes plus « pacifiques » et d’autres éléments dans les batailles permettent de saisir l’importance du côté « esthétique » de l’armement. Enfin, on peut observer la panoplie d’armes contre lesquelles les armures sont censées protéger, et le rapport entre l’utilisation des dites armes et les points sensibles y correspondant.
– CINATO, Franck, SURPRENANT, André, Le Livre de l’Art du combat : Liber de arte dimicatoria, Paris, CNRS éditions, 2015 (2009). Édition critique du Royal Armouries
MS. I.33, Leeds. (Début XIVe siècle)
Les principales gardes sont présentes en Annexe II.
L’usage de cette source est très différent des précédentes. En effet, il s’agit ici de ce que l’on considère comme le premier traité d’escrime, retraçant les diverses techniques de combat à l’épée et bocle (sorte de petit bouclier rond à manipule central). L’origine exacte de ce manuscrit est inconnue (même si on sait qu’il s’agit d’une région germanophone), mais les spécialistes ont identifié une écriture qui serait celle du secrétaire du duc-évêque de Würzburg, ce qui permet l’hypothèse d’une origine bavaroise. L’auteur est probablement un moine, il pourrait s’agir d’un certain Liutger (Lutegerus), le moine enseignant l’escrime à l’écolier dans la représentation iconographique. L’iconographie (des duels successifs entre clerc et écolier) est de première importance puisqu’elle n’est pas une simple illustration du texte : le texte est lui-même un commentaire de l’image, comme l’ont montré Franck Cinato et André Surprenant.
Dans le cadre de mon mémoire, cette source est utilisée d’une manière à la fois globale et indirecte. Travail de synthèse entre l’escrime pratiquée par les clercs et celles des « combattants généraux » (entendus comme les chevaliers et autres professionnels de la guerre), cet ouvrage sait distinguer les deux traditions. On peut donc approcher les techniques des combattants « généraux » à travers leurs évocations et principes mis en avant par le livre de Liutger. Cette source comporte plusieurs limites, les principales étant que le combat est uniquement à pied, que les protagonistes ne portent pas d’armures, et que les armes se limitent à l’épée et la bocle (on n’a donc ni la lance ni l’écu). En effet, l’objectif originel de ce manuscrit semble être d’enseigner les techniques d’autodéfense. Pourtant, le réalisme recherché et l’analyse technique des « combattants généraux » permettent une réelle approche de l’attitude des chevaliers au combat et d’évoquer des formes de combat en dehors du champ de bataille, avec l’armure endossée. Pour pallier les manques de cette source, plusieurs solutions s’offrent à nous. On ne peut certes pas analyser le combat à cheval, mais les sources antérieures et postérieures révèlent de faibles transformations, donc on peut se concentrer sur l’escrime à pied, peu évoquée dans l’iconographie de la Bible de Maciejowski.
On doit donc procéder de la manière suivante :
• On sélectionne les techniques de combat explicitement désignées comme « généralistes » sans exclure totalement les méthodes « cléricales », qui ont pu partiellement influencer l’autre tradition.
• On vérifie leur applicabilité en armure en se posant les questions suivantes : la technique est-elle réalisable avec une armure, considérant les contraintes que cela occasionne ? La technique est-elle utile ou intéressante pour passer les défenses d’une armure ? Si non, est-elle au moins intéressante dans les conditions d’un tournoi ? Les techniques de bocle sont-elles aussi réalisables avec un écu à énarmes ?
• On analyse les conditions dans lesquelles un chevalier sans armure peut se retrouver à combattre armé seulement de son épée (et éventuellement de la bocle) : embuscade, attaque-surprise…
Une fois toutes ces caractéristiques définies, on peut envisager l’importance de l’armure chevaleresque et les transformations qu’elle occasionne dans la manière de combattre, au sens technique et psychologique.
Ce manuscrit est considéré comme l’un des premiers traités de combat italiens, et compte parmi les premiers ouvrages de l’auteur, le maître d’armes Fiore Furlano de Cividale d’Austria, delli Liberi da Permariacco (c.1350 – c.14204). Né dans la région du Frioul, dans l’État patriarcal d’Aquilée, Fiore dei Liberi doit son surnom de « Liberi » à un privilège d’immédiateté que possède sa famille, ce qui le rattache au groupe des chevaliers libres de du Saint Empire. Il affirme avoir commencé à étudier très tôt les armes, et avoir remporté plusieurs duels dans des conditions dangereuses (épées affûtées et absences de protections) et gagné à chaque fois, car il ne voulait pas transmettre sa science du combat à d’autres maîtres. Il a enseigné à de célèbres condottieri dans tout le nord de l’Italie, ayant spécialement entraîné Galeazzo Gonzaga de Mantoue en 1395 pour son duel contre Jean II le Meingre, dit « Boucicaut ». Il écrit deux versions du Fior di Battaglia entre 1400 et 1409, l’une étant conservée à la Pierpont Morgan Library de New York et l’autre au J. Paul Getty Museum de Los Angeles.
Ce traité de combat illustre différentes techniques de combat avec ou sans armure, avec ou sans armes, à pied ou à cheval. Les illustrations ne sont pas peintes, mais sont très réalistes, et décrivent bien les techniques de combat potentiellement utilisées dans une bataille ou un duel plutôt que dans un tournoi. Les illustrations du combat en armures de plates permettent tout particulièrement d’apprécier les changements apportés dans le combat par la transformation de l’armure, voire même des attitudes psychologiques semblant privilégier nouvellement la lutte (même dans l’usage de l’épée) et l’estocade. En observant les techniques du XIIIe siècle, où l’armure de mailles est amenée à son maximum protecteur, et la transition du Liber de arte dimicatoria, on se rend compte d’un bouleversement à l’ère de l’armure complète de plates dans la manière d’appréhender le combat.