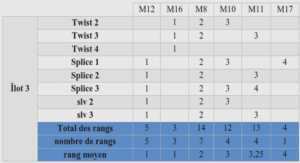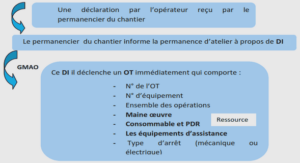La motivation
Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu quand il s’agit d’apprendre une langue étrangère, mais on est généralement d’accord sur le fait que la motivation est l’un des plus importants pour y réussir. Le modèle de Spolsky (1989) montre les facteurs qu’il estime être les plus essentiels pour le résultat de l’apprentissage, et comme on peut le voir, la motivation a un rôle central dans ce processus, où elle est liée aux attitudes de l’apprenant mais aussi à son âge, à sa personnalité, à sa capacité et à ses connaissances antérieures.
Par contre, il y a plus de désaccord sur ce qui constitue la motivation (Ellis, 1994). Selon Gardner et MacIntyre (1993 : 2), la motivation est une structure complexe avec trois composants : « desire to achieve a goal, effort extended in this direction, and satisfaction with the task ».
La motivation peut avoir un effet sur l’apprentissage, être causative. Et elle peut aussi être influencée par l’apprentissage, être résultative. On fait aussi souvent une distinction entre la motivation intrinsèque, où il s’agit des intérêts et des besoins personnels de l’apprenant, et la motivation extrinsèque, qui concerne les facteurs extérieurs comme par exemple les récompenses (Ellis, 1994). Gardner and Lambert (1972) ont proposé les termes ‘motivation intégrée’ et ‘motivation instrumentale’ pour parler d’une distinction qui ressemble à celle qui existe entre la motivation intrinsèque et la motivation extérieure. Ces motivations différentes peuvent exister chez la même personne en même temps (Ellis, 1994). Ce sont les termes de Gardner et Lambert que j’ai choisi d’utiliser dans ce mémoire.
La motivation intégrée
La motivation intégrée se réfère donc à l’apprentissage des langues pour le développement personnel et l’enrichissement culturel (Lightbown et Spada, 1999). L’apprenant a comme but d’être accepté par les gens de la culture de la langue cible, une sorte d’identification (Malmberg, 2000). Keller (1983) – qui utilise le terme ‘intrinsèque’ au lieu d’’intégrée’-explique que ce type de motivation est créé chez l’apprenant quand sa curiosité de la langue étrangère est éveillée et gardée. Il existe différents facteurs qui influencent la motivation intégrée, entre autres l’attitude, l’intérêt et le désir de l’apprenant d’apprendre la langue étrangère. Ces facteurs sont souvent liés à des voyages, à des amitiés, etc. (Ellis, 1994). L’étude de Gliksman, Gardner et Smythe (1982), montre qu’un élève ayant une motivation intégrée forte est plus actif dans la salle de classe. Il poursuit l’apprentissage de la langue étrangère et il est moins probable qu’il laisse tomber ses études. Une façon, pour le professeur, de créer une motivation intégrée chez les élèves dans un contexte scolaire est de leur donner la possibilité de communiquer ; selon Rossier, (cité par Ellis, 1994) le désir de communiquer chez l’apprenant est très important. Il est aussi important de créer des défis d’un niveau adéquat, pas trop difficiles et pas trop faciles.
La motivation instrumentale
Il arrive que l’apprenant apprenne la langue pour des raisons telles que la future carrière, le statut social ou pour atteindre un niveau d’éducation exigé (Gardner and Lambert, 1972). Dans une étude ancienne de Dunkel (1948), l’auteur a offert à certains des élèves dans une classe des récompenses pour leurs résultats, tandis que d’autres élèves étaient simplement exhortés à faire de leur mieux. Ceux qui ont reçu des récompenses ont obtenu des résultats beaucoup meilleurs. Gardner et MacIntyre (cités par Ellis, 1994) ont remarqué que lorsque les récompenses ont été annulées, les effets de cette motivation instrumentale ont disparu (Ellis, 1994).
La motivation comme cause ou comme résultat
Il est difficile de dire si la motivation est la cause ou le résultat, ou tous les deux, de la réussite dans l’apprentissage d’une langue étrangère. Gardner (1985) affirme qu’elle est causative, mais il accepte aussi que parfois on observe une modification de l’attitude de l’apprenant à cause d’une expérience positive de l’apprentissage (Ellis, 1994). Par contre, Strong (1984) indique que le désir chez l’apprenant d’apprendre une langue étrangère est fortement influencé par le rendement.
Il est possible que la relation entre la motivation et le rendement soit interactive. Un niveau élevé de motivation stimule l’apprentissage, mais la réussite dans l’apprentissage de la langue étrangère aide l’apprenant à maintenir une motivation déjà existante. Au contraire, si la motivation est basse, les résultats deviennent mauvais et la motivation sera encore plus basse (Ellis, 1994). Ceberio (2004) voit la motivation comme un processus dynamique et est d’avis que la motivation ‘intérieure’ et la motivation ‘extérieure’ dépendent l’une de l’autre.
Motivation dans la salle de classe
Dans le livre de Lightbown et Spada (1999), on constate que les élèves motivés sont souvent, selon les professeurs, ceux qui participent activement dans l’enseignement, qui expriment leur intérêt à la matière, et qui travaillent beaucoup (font leurs devoirs avec soin). Si le professeur est capable d’éveiller l’intérêt d’apprendre la langue étrangère, en créant un enseignement stimulant avec des buts clairs et réalisables, il peut contribuer beaucoup à la motivation d’élève. Les chercheurs dans le domaine de la psychologie de l’enseignement, Crookes and Schmidt (1991), ont remarqué différents facteurs dans une situation scolaire, qui rendent les élèves plus motivés à apprendre : il s’agit de faire participer les élèves, d’une façon active, dans la leçon, et aussi de varier les activités, les exercices et les matériaux. Il faut que le professeur pense à l’âge de ses élèves, à leur niveau de langue et à leurs intérêts. Mais Cicurel (2002 : 54) souligne aussi le rôle de l’élève : « L’apprenant reste d’une certaine manière le maître de la façon d’apprendre et d’intégrer. Inattention, ou attention à des événements fortuits, refus de participation ou retour à l’activité de classe sont des comportements qui font partie du quotidien d’un apprentissage en classe. »
Le contact avec la langue cible en dehors de la situation scolaire, par exemple à travers un voyage, donne souvent à l’élève un feed-back positif. Parfois il est difficile de varier l’enseignement à cause du niveau faible de la langue de l’élève. Il faut alors plutôt se concentrer sur les connaissances de base de la langue. Beaucoup d’élèves trouvent aussi qu’il demande beaucoup de travail d’apprendre une langue étrangère, et ils ne trouvent pas l’énergie de le faire à cause de la concurrence de toutes les autres matières à étudier à l’école. Il faut noter si un élève ne suit pas, cela risque de faire que l’élève abonde ses études de la langue. Un élève de l’étude d’Oscarsson (1999) dit : « Quand on ne comprend rien…le professeur continue…Alors, on disait qu’on avait bien compris et alors, il continuait et on ne comprenait pas ça non plus et on ne le savait pas avant, voilà ça continuait comme ça…C’était ennuyant”.1 En étant conscients des buts, les élèves prennent plus de responsabilités pour leurs propres études et pour leurs progrès. Ils seront plus sûrs d’eux-mêmes et cela a un effet positif sur l’ambiance du groupe. Une ambiance positive dans la salle de classe est très importante pour inspirer les élèves, sinon il y aura des élèves qui n’oseront pas agir et parler pendant la leçon et cela peut empêcher la motivation de l’élève (Oscarsson, 1999).
Approches différentes dans l’enseignement des langues étrangères
On a souvent essayé de trouver la méthode qui donne le meilleur résultat dans l’apprentissage d’une langue étrangère, mais il a été difficile de prouver qu’une méthode est meilleure qu’une autre (Cicurel, 2002). Les élèves ont des aptitudes différentes et le professeur doit fournir un enseignement différencié et individualisé pour le rendre motivant pour tous les élèves et ne pas faire marcher tout le monde du même pas (Cuq et Gruca, 2003). Si le professeur fait participer les élèves dans la planification de l’enseignement, et leur fait exprimer leurs idées et leurs propositions, les élèves deviendront souvent plus motivés à continuer leurs études (Oscarsson, 1999).
Selon l’étude d’Oscarsson, les professeurs, en général, ne mettent plus au premier plan l’enseignement de la grammaire et du lexique, mais travaillent beaucoup plus avec la compétence communicative des élèves. L’étude faite par Ceberio (2004) analyse les composantes de la motivation d’apprenants en situation plurilingue. Les résultats montrent l’importance de la communication et de l’échange entre cultures pour motiver les élèves. Elle parle de l’importance de l’intercompréhension, de la capacité de comprendre la langue et de se faire comprendre et de faire de l’élève « le sujet qui communique ». D’après Pekarek-Doehler (2000: 4 – 5, cité par Cebrio 2004) « la conception de l’apprenant comme individu intériorisant un système linguistique est abandonné en faveur de l’idée d’un acteur social qui développe des compétences langagières variables à travers son interaction avec d’autres acteurs sociaux » Dans la situation scolaire, la communication avec des natifs de langue cible est rare et il faut créer des situations substitut, avec le groupe/classe et le professeur (Ceberio, 2004).
Une autre approche motivante pour l’apprentissage de l’élève est aussi une approche communicative mais avec une perspective actionnelle. On voit les apprenants comme des acteurs sociaux qui accomplissent des tâches. L’apprenant réalise une action sociale dans des circonstances et des environnements donnés, à l’intérieur d’un domaine d’action particulier.
Cette perspective actionnelle correspond à la prise en compte d’un nouvel objectif social lié aux progrès de l’intégration européenne, celui de préparer les apprenants non seulement à vivre mais aussi à travailler, dans leur propre pays ou dans un pays étranger, avec des natifs de différentes langues-cultures étrangères. Il ne s’agit plus seulement de communiquer avec l’autre, mais d’agir avec lui en langue étrangère » (Puren, 2006). Le point central est de faire de manière que les élèves comprennent et connaissent les règles socioculturelles et soient au courant de l’intention de la communication (Cuq et Gruca 2003 : 245).
Comme Ceberio, Byram (1992) parle de l’importance de la connaissance d’une autre culture et d’une autre civilisation. Cela contribue à réduire les préjugés et à promouvoir la tolérance et crée souvent des attitudes positives chez l’élève envers d’autres peuples de d’autres cultures, en même temps qu’on arrive à une compréhension approfondie d’un peuple et d’une culture particulière, dans le cas actuel, la culture française. Avec une attitude positive envers la culture cible, il est évidemment plus simple à motiver un élève à apprendre la langue.
Résultats
Les réponses des professeurs dans l’interview
Les différentes facteurs influençant la motivation
Comme réponse à ma question sur ce qui motive les élèves, les professeurs soulignent des facteurs de motivations différents qui sont en jeu quand il s’agit d’apprendre une langue étrangère. La professeur A affirme qu’il est important que les élèves s’amusent en apprenant la langue cible. Elle trouve aussi qu’ils se sentent motivés quand ils ont le sentiment de réussir, par exemple en étant capables de donner les bonnes réponses à un examen. Selon la professeur A, les examens sont vraiment importants pour les élèves, plus importants pour les élèves que pour elle comme professeur, car elle sait souvent déjà leur niveau de toute façon. Pour les élèves, l’examen fonctionne comme leur « carotte ». La professeur A dit que les élèves ont besoin de montrer et de savoir leur niveau, et au lycée, les élèves sont souvent très foculisés sur les résultats. Elle utilise une image pour clarifier son argument : « C’est comme un professeur m’a dit une fois: ”Je joue dans un orchestre, et ça me fait vraiment plaisir de jouer, mais on veut aussi se montrer à un public”. On veut montrer, « voilà ce que je sais ».Ça fait partie du jeu, de recevoir une note, bien sûr on doit avoir une note pour savoir « voilà mon niveau », aussi pour pouvoir avancer. »2 Elle dit aussi que la relation entre la motivation et le résultat chez l’élève est souvent évidente, il est très rare qu’un élève qui a de mauvais résultats, se sente très motivé. Si on n’est pas fort en français, on ne trouve pas que c’est amusant. Les élèves ne réussissent pas à accepter leur propre niveau, ils comparent tout le temps avec les autres. La professeur A souligne aussi que si elle donne des tâches trop difficiles, trop au-dessus du niveau de l’élève, celui-ci laisse très facilement tomber son travail. La professeur B affirme aussi que les résultats aux examens et les notes sont très importants pour les élèves. Il faut qu’ils voient clairement leur progrès pour devenir plus motivés de continuer. La professeur B parle de l’importance pour l’élève de sentir qu’il peut se servir de la langue, d’avoir un but, par exemple en vue d’un futur séjour à Paris. Elle dit aussi que si l’élève manque la volonté d’apprendre la langue, la réussite sera presque impossible, et à la place, les élèves concentrent leur énergie sur d’autres matières. La professeur A pense que les élèves au lycée ont aujourd’hui beaucoup d’activités à côté de l’école, et il est difficile pour certains élèves d’avoir suffisamment d’énergie pour tout. La professeur B dit que plusieurs élèves trouvent que le français demande beaucoup de travail et souvent ça aide si l’élève a un appui chez lui, de la part des parents ou des frères et sœurs. Il n’est pas rare que l’élève voyage avec la famille en France pendant l’été, et parmi ces élèves-là on voit une grande différence, ils ont confiance en eux-mêmes, et leurs notes sont souvent très bonnes. Ils veulent améliorer leurs français pour une raison spécifique, et peut-être aussi ne pas se sentir gênés devant la famille en parlant. Peut-être qu’il y a des attentes de la part des parents, ou bien le frère ou la sœur parle français, et l’élève devient inspiré. C’est la même chose avec les élèves qui ont fait un échange ou ont suivi un cours de langue en France. En retournant ils sont beaucoup plus motivés et ont souvent gardé de bons souvenir de la culture française. Les deux professeurs pensent aussi que le seul fait de connaître la culture, la beauté du pays, la nourriture, etc. donne envie de continuer à apprendre la langue, une fois rentré en Suède. La professeur A donne l’exemple d’une classe qui a fait un échange avec une école en France. Au retour, elle a trouvé que plusieurs élèves étaient plus motivés qu’avant, elle a remarqué que leur attitude avait changé vis-à-vis de la langue française. La professeur A dit qu’on trouve souvent que le français est une belle langue et il semble que ce ne soit pas souvent une langue à laquelle on est indifférent, comparé avec l’allemand par exemple, qui est plus proche du suédois ; elle ne croit pas que l’allemand est aussi séduisant que le français, l’espagnol ou l’italien, par exemple.
La motivation dans la salle de classe
La professeur B parle de l’importance d’une bonne ambiance dans la classe pour créer un enseignement motivant. Elle dit que normalement il y a un respect parmi les élèves quand il s’agit de la communication en français. Tout le monde fait des erreurs, c’est tout à fait normal. Mais en dépit d’une bonne ambiance dans le groupe, les élèves ont souvent peur de parler, surtout les élèves qui ne sont pas aussi forts que les autres. La professeur A est de l’avis de la professeur B, et elle dit que même si elle souligne qu’il est tout à fait naturel de faire des erreurs en parlant, les élèves se sentent souvent inhibés dans des situations de communication. Elle pense donc que la raison en est qu’ils ne se sentent pas à l’aise en parlant devant leurs camarades de classe, plus que la peur pour elle comme professeur, car quand elle parle français avec un élève en tête-à-tête, l’élève ose parler davantage. La professeur A pense que pendant ces moments d’enseignement individuel, il est beaucoup plus simple de trouver les problèmes linguistiques de l’élève, et on peut atteindre de meilleurs résultats. Quelques élèves lui demandent parfois de donner des leçons en plus, en dehors de l’enseignement obligatoire, quand elle et l’élève ont une heure libre en même temps. Elle pense aussi que s’il y a une bonne ambiance dans le groupe, les élèves s’inspirent l’un l’autre. Parfois elle pense qu’il est difficile de vraiment savoir ce que les élèves pensent de l’ambiance dans la classe. Les élèves peuvent être des experts quand il s’agit de prétendre que tout est bien, même s’ils ne sont pas contents, et puis, à la place, ils se plaignent dans les couloirs. Mais si les élèves ne disent rien, il est impossible pour elle de savoir ce qu’il faut faire pour changer la situation dans la salle de classe.
Les deux professeurs pensent que si elles font participer les élèves à la planification de l’enseignement, ceux-ci seront beaucoup plus motivés d’atteindre leurs buts. La professeur B dit que leur engagement et leur motivation se basent, en partie, sur leur droit de participer aux décisions qui concernent l’enseignement. Mais elle dit qu’il ne serait pas possible de laisser les élèves trop décider, elle donne aux élèves la structure et les cadres généraux. Elle explique qu’au début du semestre, elle propose aux élèves un plan et elle conclue un accord avec les élèves. Et avant qu’elle fasse la version définitive du plan, elle demande aux élèves de faire des suggestions. Si, par exemple, les élèves lui disent qu’ils veulent faire du théâtre, elle essaye d’en tenir compte. La professeur A souligne l’importance de l’influence de l’élève pour obtenir de bons résultats et aussi pour rendre l’élève motivé. Mais son expérience lui dit que les élèves doivent apprendre à connaître quels sont les points de départ pour planification de l’enseignement. Pendant beaucoup d’années, elle a travaillé avec un programme qui s’appelle « apprentissage autonome ». Souvent, au début, ça fait peur à l’élève, car il peut avoir le sentiment de ne pas connaître les attentes du professeur ; elle a remarqué que cela est plus fréquent chez les élèves qui ont de bonnes notes. Elle affirme aussi que si elle fait participer les élèves dans la planification de l’enseignement, cela demande plus de travail de la part des élèves, ils doivent s’engager plus et proposer des idées. C’est quelque chose qu’ils doivent apprendre, et elle donne au groupe de plus en plus de responsabilité au fur et à mesure. Elle dit qu’il faut du temps pour établir un « apprentissage autonome », c’est un processus de presque un semestre, après un an ils peuvent commencer à travailler plus indépendamment et après deux ans, c’est quelque chose qui va de soi. Il faut que les élèves s’habituent à penser autrement quand il s’agit de la manière d’utiliser les nouveaux outils : comment on planifie, comment il faut travailler avec les devoirs et comment on évalue. Mais la professeur A souligne que cette méthode de travail demande beaucoup de la part du professeur, il faut organiser la situation d’apprentissage et être là pour motiver les élèves et leur monter le moral. Quand cette méthode de travailler marche bien, elle voit une augmentation de la motivation chez les élèves, car, entre autres choses, ils ont la possibilité de travailler avec ceux qu’ils veulent et selon leur propre choix.
Le rôle de l’élève
La professeur B décrit un élève motivé comme quelqu’un qui est actif pendant les leçons, lève souvent la main, exprime ses idées et ses propositions. Cet élève veut vraiment améliorer son français, il confirme toujours s’il a bien compris et lui demande, par exemple, la meilleure façon d’exprimer une phrase. Parfois, un élève qui n’est pas très fort en français, ne pose jamais de questions. La professeur B trouve que c’est un grand risque, cet élève va avoir du mal à améliorer son niveau de langue, il risque d’être bloqué. Le fait d’être sûr de soi aide, selon la professeur A, beaucoup l’acquisition d’une langue étrangère, car il faut essayer de parler, de « s’y jeter ». La professeur A a remarqué que ce sont souvent les filles qui atteignent de bons résultats. Elle pense que la cause en est que les filles répondent souvent à des attentes d’être de bons élèves. C’est comme si tout le monde pensait qu’une fille doit être bonne. Mais elle pense que pour un garçon c’est différent, même si les garçons ne sont pas toujours bons, ils sont contents tout de même. Apprendre une langue demande beaucoup de travail, et normalement les garçons ne veulent pas y sacrifier tout le temps qu’il faut, ils veulent faire vite. Elle ajoute qu’un garçon a la capacité de devenir vraiment fort en français ou dans une autre langue étrangère, car il ose parler et essayer plus, généralement il a moins peur de faire des fautes qu’une fille. La professeur B a aussi remarqué cette différence entre filles et garçons, et elle préfère avoir des classes avec un mélange des sexes, car les garçons osent plus, ils l’interrompent plus pour poser des questions s’ils n’ont pas bien compris.
La professeur A raconte que la seule fois qu’elle pense que c’est ennuyeux d’être professeur, c’est quand les élèves ne prennent pas leur part de la responsabilité. Mais, normalement, il y a toujours quelques-uns qui sont intéressés et qui ont une bonne attitude, ce qui lui donne beaucoup d’énergie et lui fait garder sa passion pour le métier de professeur. Si un élève montre vraiment qu’il n’est pas intéressé et a une attitude négative, elle trouve qu’il est difficile d’atteindre cet élève, car celui-ci part déjà de la pensée que tout ce qu’elle dit est fastidieux et n’a d’autres buts que de se plaindre du comportement de l’élève.