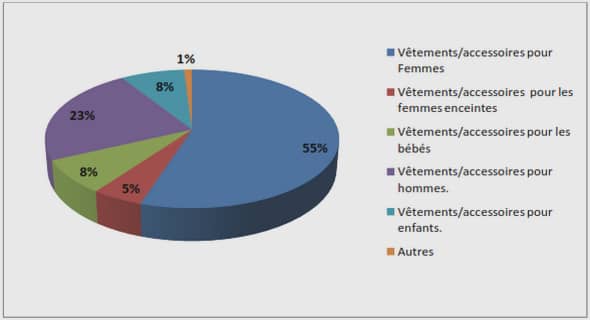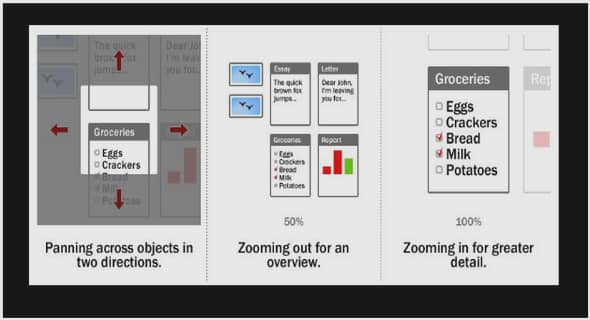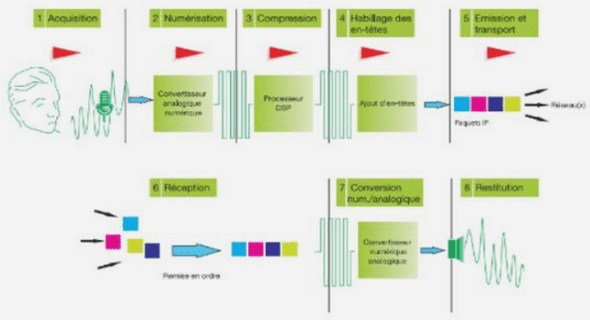LA TRANSPARENCE : UN ENJEU DE SOUVERAINETE NUMERIQUE
Lawrence Lessig nous a offert une grille de lecture inédite du cyberespace1153. Le jeu de puissance auquel fait face cette sphère, qui se détache du terrain classique1154 à bien des égards a une incidence sur notre ordre juridique, dans la mesure où il est concurrencé par des architectures techniques1155, souvent opaques, et dont les choix sont opérés par les programmeurs informatiques, aboutissant à un choc des légitimités démocratiques (Paragraphe 1). Dans un tel contexte de rapports de force, il est impératif d’assurer l’autonomie des citoyens en démocratie, plus haut degré de la légitimité politique, en recourant à la technique juridique de la souveraineté politique, et ce dans le but de faire primer sur ces acteurs la transparence des architectures techniques, pour le cas échéant, permettre ensuite leur régulation (Paragraphe 2).
L’opacité des architectures techniques
Le « code » ayant la capacité de concurrencer le droit étatique traditionnel (A), il a ouvert la voie à un choc des légitimités au sein du cyberespace (B). La mission principale de la transparence est alors de pouvoir observer le positionnement de ces puissances, et le cas échéant, si elles devaient aller à l’encontre de l’intérêt général, de les contraindre.
« Code is Law »
Dès 1999, Lawrence Lessig constate que le cyberespace est un nouveau régulateur susceptible de menacer nos libertés1156. L’auteur s’intéresse à la nature de ce cyberespace, et en déduit que c’est le code logiciel, ainsi que les infrastructures physiques permettant son exécution, qui le structurent. En d’autres termes, il entend par « code », ce que nous pouvons également assimiler aux traitements algorithmiques1157. Le recours à ces outils numériques permet alors la mise en place d’architectures informatiques, incarnant une intention politique, économique ou encore d’intérêts divers, qui vont à leur tour conditionner l’exercice des droits et libertés. En effet, ces architectures techniques ne sont pas neutres et sont l’émanation d’un contexte, mais aussi de l’intention des concepteurs1158. Selon nous, cette crainte est renforcée dès lors que le positionnement des opérateurs économiques et de la puissance publique qui s’y affrontent n’est pas nécessairement visible, et ne peut qu’être difficilement démontré. La difficulté réside également dans le fait que nous utilisons des architectures techniques sans nous soucier de leur philosophie et des incidences qu’elles ont sur les droits et libertés.
Mais qui est donc le véritable régulateur de ce « code » ? Lawrence Lessig précise que certaines architectures informatiques sont par exemple plus protectrices de la vie privée que d’autres, mais le choix d’une architecture par rapport à une autre repose finalement sur les programmeurs qui incarnent le positionnement des puissances du terrain classique qu’ils dupliquent sur le terrain en ligne. Chaque architecture dispose de ses avantages et inconvénients au regard de l’objectif poursuivi. Le choix des développeurs est cependant tributaire de certaines incitations1159. C’est le « code » qui fait la loi au sein du cyberespace, ce qui aboutira l’adage « Code is law ».
La loi n’est donc plus suffisante. Pour qu’un Etat réglemente au sein de cette sphère, il faudra aussi le faire par l’intermédiaire du « code ». L’analyse de cet auteur est à notre sens primordiale dans la compréhension des enjeux relatifs au numérique, et constitue une grille de lecture du cyberespace. Toutefois, cet adage, « Code is law » est imparfait, et Lawrence Lessig en convient, le « code » n’est pas pour autant du véritable droit, en tout cas pas dans l’acception du code qu’il présente puisqu’il n’a pas d’effet normatif selon ses dires du début des années un régulateur. Ce régulateur, aussi, menace la liberté ». Il est à noter que ce célèbre article est la retranscription des grandes idées développées par Lawrence Lessig dans le cadre de l’ouvrage Code and Other Law of Cyberspace publié en 1999, et dont la réédition et l’actualisation a été effectuée en 2006. Voir en sens, LESSIG L., Code version 2.0, Basic Books, 2006.
Est entendu par algorithme : « L’objet de l’algorithmique est la conception, l’évaluation et l’optimisation des méthodes de calcul en mathématiques et en informatique. Un algorithme consiste en la spécification d’un schéma de calcul, sous forme d’une suite d’opérations élémentaires obéissant à un enchaînement déterminé. », FLAJOLET P., COLLARD P., 20001160, bien que pour certains auteurs il puisse désormais en s’agir1161. En revanche, la certitude repose dans le fait que ce code va en réalité concurrencer le droit traditionnel. A notre sens, un exemple contemporain illustre parfaitement cette lecture du cyberspace : les cryptomonnaies. En effet, en reposant sur la « blockchain », c’est-à-dire une architecture technique décentralisée, la philosophie de ce système n’a pas initialement d’autre but que de proposer un modèle alternatif à l’émission de monnaie classique, afin de s’émanciper des banques centrales, et donc des Etats1162. Nous pouvons aisément comprendre qu’une telle technologie s’attaque à l’organisation étatique de la société. Son déploiement technologique demeure toutefois intéressant pour certains usages, mais elle concurrence par nature d’autres principes de notre droit si elle est utilisée dans le cadre du vote électronique par exemple. En effet, elle se heurte à des violations des principes du droit électoral, dans la mesure où, dans les faits, sous couvert d’une meilleure fiabilité du vote par correspondance, elle négligerait le rôle d’une autorité électorale en tant que tiers de confiance et ne pourrait garantir techniquement le secret du vote1163. Il conviendrait donc davantage de faire appel à des architectures techniques en fonction des objectifs souhaités, ce qui ne peut être poursuivi dès lors que l’on connait et prend en compte les tenants et aboutissants de l’architecture en question1164, ce que permet la transparence.
Pierre Musso illustre par ailleurs très bien les manœuvres s’exerçant au sein de ce cyberespace :
• (…) dans le cyberespace, s’échangent des représentations sociales, se confrontent des « cartes mentales » d’acteurs, s’instituent des hiérarchies et des conflits d’image et de réputation. Dans ce second monde s’ordonnent des points de vue d’acteurs, des projets d’action, des conceptions du monde, des imaginaires et des valeurs ; ils s’y rencontrent, collaborent ou s’affrontent »1165.
L’enjeu de la transparence est alors significatif pour observer ces positionnements, et le cas échéant les réglementer.
Lawrence Lessig rappelle que certains penseurs croient en la vertu d’un « code » qui se régulerait de lui-même, et qu’aucun autre acteur, ni même la puissance publique ne serait à même de contrôler1166. Il évoque cependant que le code est par nature trop mouvant. Et si les architectures techniques devenaient compatibles avec une régulation d’ordre étatique, alors le code ne poserait pas autant de difficultés. Toutefois, force est de constater qu’en vertu de l’absence d’un universalisme des droits humains concernant les libertés économiques, il parait utopique d’aboutir par exemple, à une structuration d’internet qui satisfasse tous les Etats du monde. Nous comprenons d’ailleurs la volonté d’exiger des architectures conformes à nos valeurs démocratiques dès lors que cela a été discuté et bénéficie de la légitimité politique. Pour retranscrire cette volonté politique, et en contrôler la mise en œuvre, nous considérons que des institutions devront être dédiées à cette tâche1167.
L’auteur de « Code is law » s’interroge : faut-il qu’une entité joue un rôle dans le choix de ce code, dans la mesure où les architectures conditionnent les valeurs ? Il évoque donc le rôle que pourrait jouer l’Etat dans ces choix. Il s’insurge particulièrement à l’encontre des partisans d’une non-intervention étatique1168. Pour lui, mettre à l’écart l’Etat reviendrait à laisser les choix de l’architecture d’internet aux développeurs, ce qui, convenons-en, n’est pas démocratiquement acceptable du point de vue de la légitimité politique1169. C’est sur une note relativement pessimiste que l’auteur termine ce célèbre article en craignant que le code ne mette mal l’ordre juridique tout entier en affirmant que
◦ Nous devrions interroger l’architecture du cyberespace comme nous interrogeons le code du Congrès. Si nous ne le faisons pas, ou si nous n’apprenons pas à le faire, la pertinence de notre tradition constitutionnelle s’estompera. L’importance de notre engagement envers les valeurs fondamentales, par le biais d’une constitution adoptée de manière consciente, s’estompera. La menace que cette époque représente pour les libertés et les valeurs dont nous avons hérité nous échappera. La loi du cyberespace sera celle que le cyberespace codera, mais nous aurons perdu notre rôle dans l’établissement de cette loi »1170.
L’étude de ces acteurs œuvrant au sein du cyberespace démontre qu’ils ne bénéficient évidemment pas de la même légitimité, ce qui aboutit naturellement à un choc des légitimités.
Le choc des légitimités
La réglementation du cyberespace passe également par le contrôle des concepteurs des architectures techniques, ce qui pose naturellement la question de la légitimité au regard des choix opérés par ces derniers et du contrôle plus ou moins fort qu’il est nécessaire d’exercer sur eux. Convient-il de laisser les programmeurs décider de tous les choix techniques opérés au sein du cyberespace ? Il n’est pas possible de répondre par l’affirmative, ne serait-ce que pour des raisons de légitimité démocratique, et qui plus est parce que les technologies ne sont pas neutres1171.
Afin de différencier l’intérêt général prétendument poursuivi par l’Etat, des intérêts économiques particuliers recherchés par les acteurs privés du numérique, il convient de revenir sur la notion d’intérêt général puisqu’elle est au cœur de la distinction entre ces deux puissances concurrentes. La notion d’intérêt général est au fondement de l’Etat moderne, et particulièrement au cœur de notre système juridique, comme le rappelait l’étude annuelle du Conseil d’Etat de 19991172. Même si ce concept est difficile à définir juridiquement, il convient tout de même d’admettre que l’Etat se justifie par la poursuite d’un intérêt général, ce qui n’est pas, par principe, l’objectif poursuivi par les entreprises privées. Ces sociétés privées peuvent bien entendu poursuivre des objectifs d’intérêt général à travers leurs prestations, mais cela n’est pas leur finalité première, qui demeure la réalisation d’activités lucratives. L’intérêt général a fait l’objet de nombreuses critiques1173, y compris de la part des marxistes et des libéraux. Les premiers voyaient dans l’Etat non pas la poursuite de l’intérêt général, mais d’intérêts particuliers de la classe sociale dirigeante. Quant aux seconds, l’intérêt général est perçu comme la transcendance d’intérêts particuliers, et constituerait un risque potentiel de violation des libertés individuelles.
La naissance de la notion d’intérêt général apparaît au moment de la Révolution française à une période où la souveraineté, incarnée par la personne sacrée du roi qui était censé poursuivre le bien commun pour ses sujets prend fin, et est transférée au Peuple1174. Ce transfert de souveraineté du pouvoir royal vers un pouvoir laïcisé plus légitime, car ne reposant plus que sur le plan temporel, et entre les mains d’une seule entité appelée Peuple, est un tournant puisque la loi apparaît alors comme étant l’expression de la volonté générale1175.
La vision utilitariste1176, libérale, de l’intérêt général, qui consiste à cantonner l’organisation de la vie en société à l’activité économique, implique que le pouvoir politique soit amené à réguler le moins possible les relations entre les individus. Le régulateur principal ne peut être dans ce cas l’Etat, mais le marché. Le présupposé est ici que l’intérêt général ne peut émaner que des vices de l’humanité, constitués d’une propension à satisfaire, avant toute autre chose, l’intérêt purement personnel. Cet intérêt individuel est donc le socle naturel sur lequel devra reposer cet intérêt général, qui n’est autre que la somme d’intérêts privés. Dans ce cas de figure, les institutions publiques ne sont alors limitées qu’à des missions de nature régaliennes, qui n’ont pas d’autre utilité sociale que d’assurer la sécurité intérieure et extérieure, dans le but d’assurer la prospérité du marché, et donc des intérêts individuels1177.
La vision volontariste de l’intérêt général poursuit quant à elle des objectifs de nature différente. Dans cette acception Rousseauiste1178, « l’intérêt général ne saurait se substituer sans que les individus n’acceptent, par un contrat social, de faire abstraction de leurs intérêts particuliers »1179. L’objectif est de s’assurer que la somme d’intérêts privés, le plus souvent de nature économique, ne prennent l’ascendant sur l’intérêt commun. Ce nouvel ordre allie ainsi l’utilité du rassemblement des humains, qui peut parfois être aussi de nature économique, mais tout en y associant l’idée de justice. Pour cela, le contrat social va permettre à l’individu d’être source du droit dans le cadre d’un débat démocratique, ce qui légitime de plus une telle société. C’est par l’intermédiaire de la raison que le Peuple, devenu le souverain, réduira les risques de poursuite d’un intérêt contraire à l’intérêt général. La volonté générale ne peut pas faire l’objet d’une représentation dans cette vision rousseauiste, dans la mesure où le pouvoir législatif ne peut être exercé directement que par le Peuple. En ce sens, l’Etat jouit d’un haut degré de légitimité par rapport aux puissances concurrentes.
La démocratie libérale, telle que nous la connaissons actuellement en France, opère une synthèse de ces deux acceptions. Cela est tout d’abord justifié par le fait que la doctrine s’est accordée sur l’impossibilité matérielle d’organiser un exercice direct du pouvoir législatif par le Peuple, nécessitant un exercice du pouvoir par la voie de représentants. Ensuite, parce que le libéralisme économique l’a emporté, et qu’il convenait d’œuvrer au sein de ce paradigme, mais il a nécessité des régulations de marché en réponse aux dérives de ce qui était présenté comme un régulateur. Cette hybridation des théories est présente dans les démocraties libérales, mais la prééminence de la théorie volontariste est par exemple surtout établie en France. Ceci explique notamment le succès du droit public et la création de nombreux services publics dans notre Etat1180. A l’inverse, la théorie utilitariste l’emporte dans les Etats de culture anglophone expliquant que le secret l’emporte davantage sur la transparence des acteurs privés recourant à des outils numériques attentatoires aux libertés1181, puisque l’Etat y est davantage appréhendé comme une menace.
Ces conceptions sont fondamentales tant elles influencent la manière dont le droit étatique se retrouve aujourd’hui concurrencé par des puissances privées à la légitimité tout autre que politique. Force est de constater qu’une Constitution est également la retranscription juridique de ces valeurs, et que certaines approches de l’intérêt général impactent nécessairement la manière d’appréhender la transparence juridique.
Même si l’Etat s’est engagé très fortement au sein du cyberespace du fait de la menace terroriste, cela n’a souvent été qu’une réaction à de tels événements, ou de gouvernance par les nombres1182, et non dans une approche de maintien de droits et libertés face à l’émergence de géants privés du numérique par exemple. Ce choc des légitimités a été rendu possible par un désengagement de l’Etat dans le cyberespace sur la question du maintien ou de l’amélioration de la condition des libertés au sein de l’environnement numérique.
Dans le cadre de la gouvernance, la tentation est de mettre sur le même plan des légitimités de natures différentes, alors que rien ne devrait supplanter la légitimité politique.