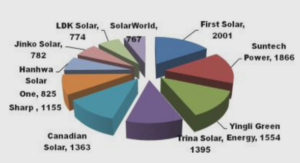Cours licence de sciences économiques histoire de la pensée économique, tutoriel & guide de travaux pratiques en pdf.
Du principe qui donne lieu à la division du travail
Cette division du travail, de laquelle découlent tant d’avantages, ne doit pas être regardée dans son origine comme l’effet d’une sagesse humaine qui ait prévu et qui ait eu pour but cette opulence générale qui en est le résultat ; elle est la conséquence nécessaire, quoique lente et graduelle, d’un certain penchant naturel à tous les hommes qui ne se proposent pas des vues d’utilité aussi étendues : c’est le penchant qui les porte à trafiquer, à faire des trocs et des échanges d’une chose pour une autre.
Il n’est pas de notre sujet d’examiner si ce penchant est un de ces premiers principes de, la nature humaine dont on ne peut pas rendre compte, ou bien, comme cela paraît plus probable, s’il est une conséquence nécessaire de l’usage de la raison et de la parole. Il est commun à tous les hommes, et on ne l’aperçoit dans aucune autre espèce d’animaux, pour lesquels ce genre de contrat est aussi inconnu que tous les autres. Deux lévriers qui courent le même lièvre ont quelquefois l’air d’agir de concert. Chacun d’eux renvoie le gibier vers son compagnon ou bien tâche de le saisir au passage quand il le lui renvoie. Ce n’est toutefois l’effet d’aucune convention entre ces animaux, mais seulement celui du concours accidentel de leurs passions vers un même objet. On n’a jamais vu de chien faire de propos délibéré l’échange d’un os avec un autre chien. On n’a jamais vu d’animal chercher à faire entendre à un autre par sa voix ou ses gestes : Ceci est à moi, cela est à toi; je te donnerai l’un pour l’autre. Quand un animal veut obtenir quelque chose d’un autre animal ou d’un homme, il n’a pas d’autre moyen que de chercher à gagner la faveur de celui dont il a besoin. Le petit caresse sa mère, et le chien qui assiste au dîner de son maître s’efforce par mille manières d’attirer son attention pour en obtenir à manger. L’homme en agit quelquefois de même avec ses semblables, et quand il n’a pas d’autre voie pour les engager à faire ce qu’il souhaite, il tâche de gagner leurs bonnes grâces par des flatteries et des attentions serviles. Il n’a cependant pas toujours le temps de mettre ce moyen en œuvre. Dans une société civilisée, il a besoin à tout moment de l’assistance et du concours d’une multitude d’hommes, tandis que toute sa vie suffirait à peine pour lui gagner l’amitié de quelques personnes. Dans presque toutes les espèces d’animaux, chaque individu, quand il est parvenu à sa pleine croissance, est tout à fait indépendant et, tant qu’il reste dans son état naturel, il peut se passer de l’aide de toute autre créature vivante. Mais l’homme a presque continuellement besoin du secours de ses semblables, et c’est en vain qu’il l’attendrait de leur seule bienveillance. Il sera bien plus sûr de réussir, s’il s’adresse à leur intérêt personnel et s’il leur persuade que leur propre avantage leur commande de faire ce qu’il souhaite d’eux. C’est ce que fait celui qui propose à un autre un marché quelconque; le sens de sa proposition est ceci : Donnez-moi ce dont j’ai besoin, et vous aurez de moi ce dont vous avez besoin vous-mêmes; et la plus grande partie de ces bons offices qui nous sont nécessaires s’obtiennent de cette façon. Ce n’est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière et du boulanger, que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu’ils apportent à leurs intérêts. Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme1; et ce n’est jamais de nos besoins que nous leur parlons, c’est toujours de leur avantage. Il n’y a qu’un mendiant qui puisse se résoudre à dépendre de la bienveillance d’autrui; encore ce mendiant n’en dépend-il pas en tout; c’est bien la bonne volonté des personnes charitables qui lui fournit le fonds entier de sa subsistance; mais quoique ce soit là en dernière analyse le principe d’où il tire de quoi satisfaire aux besoins de sa vie, cependant ce n’est pas celui-là qui peut y pourvoir a mesure qu’ils se font sentir. La plus grande partie de ces besoins du moment se trouvent satisfaits, comme ceux des autres hommes, par traité, par échange et par achat. Avec l’argent que l’un lui donne, il achète du pain. Les vieux habits qu’il reçoit d’un autre, il les troque contre d’autres vieux habits qui l’accommodent mieux, ou bien contre un logement, contre des aliments, ou enfin contre de l’argent qui lui servira à se procurer un logement, des aliments ou des habits quand il en aura besoin.
Comme c’est ainsi par traité, par troc et par achat que nous obtenons des autres la plupart de ces bons offices qui nous sont mutuellement nécessaires, c’est cette même disposition à trafiquer qui a dans l’origine donné lieu à la division du travail. Par exemple, dans une tribu de chasseurs ou de bergers, un individu fait des arcs et des flèches avec plus de célérité et d’adresse qu’un autre. Il troquera fréquemment ces objets avec ses compagnons contre du bétail ou du gibier, et il ne tarde pas à s’apercevoir que, par ce moyen, il pourra se procurer plus de bétail et de gibier que s’il allait lui-même à la chasse. Par calcul d’intérêt donc, il fait sa principale occupation des arcs et des flèches, et le voilà devenu une espèce d’armurier. Un autre excelle à bâtir et à couvrir les petites huttes ou cabanes mobiles ; ses voisins prennent l’habitude de l’employer à cette besogne, et de lui donner en récompense du bétail ou du gibier, de sorte qu’à la fin il trouve qu’il est de son intérêt de s’adonner exclusivement à cette besogne et de se faire en quelque sorte charpentier et constructeur. Un troisième devient de la même manière forgeron ou chaudronnier; un quatrième est le tanneur ou le corroyeur des peaux ou cuirs qui forment le principal revêtement des sauvages. Ainsi, la certitude de pouvoir troquer tout le produit de son travail qui excède sa propre consommation, contre un pareil surplus du produit du travail des autres qui peut lui être nécessaire, encourage chaque homme à s’adonner à une occupation particulière, et à cultiver et perfectionner tout ce qu’il peut avoir de talent et d’intelligence pour cette espèce de travail.
Dans la réalité, la différence des talents naturels entre les individus est bien moindre que nous ne le croyons, et les aptitudes si différentes qui semblent distinguer les hommes de diverses professions quand ils sont parvenus à la maturité de l’âge, n’est pas tant la cause que l’effet de la division du travail, en beaucoup de circonstances. La différence entre les hommes adonnés aux professions les plus opposées, entre un philosophe, par exemple, et un portefaix, semble provenir beaucoup moins de la nature que de l’habitude et de l’éducation. Quand ils étaient l’un et l’autre au commencement de leur carrière, dans les six ou huit premières années de leur vie, il y avait peut- être entre eux une telle ressemblance que leurs parents ou camarades n’y auraient pas remarqué de différence sensible. Vers cet âge ou bientôt après, ils ont commencé à être employés à des occupations fort différentes. Dès lors a commencé entre eux cette disparité qui s’est augmentée insensiblement, au point qu’aujourd’hui la vanité du philosophe consentirait à peine à reconnaître un seul point de ressemblance. Mais, sans la disposition des hommes à trafiquer et à échanger, chacun aurait été obligé de se procurer lui-même toutes les nécessités et commodités de la vie. Chacun aurait eu la même tâche à remplir et le même ouvrage à faire, et il n’y aurait pas eu lieu à cette grande différence d’occupations, qui seule peut donner naissance à une grande différence de talents.
Que la division du travail est limitée par l’étendue du marché
Puisque c’est la faculté d’échanger qui donne lieu à la division du travail, l’accroissement de cette division doit, par conséquent, toujours être limité par l’étendue de la faculté d’échanger, ou, en d’autres termes, par l’étendue du marché. Si le marché est très petit, personne ne sera encouragé à s’adonner entièrement à une seule occupation, faute de pouvoir trouver à échanger tout le surplus du produit de son travail qui excédera sa propre consommation, contre un pareil surplus du produit du travail d’autrui qu’il voudrait se procurer.
Il y a certains genres d’industrie, même de l’espèce la plus basse, qui ne peuvent s’établir ailleurs que dans une grande ville. Un portefaix, par exemple, ne pourrait pas trouver ailleurs d’emploi ni de subsistance. Un village est une sphère trop étroite pour lui; même une ville ordinaire est à peine assez vaste pour lui fournir constamment de l’occupation. Dans ces maisons isolées et ces petits hameaux qui se trouvent épars dans un pays très peu habité, comme les montagnes d’Écosse, il faut que chaque fermier soit le boucher, le boulanger et le brasseur de son ménage. Dans ces contrées, il ne faut pas s’attendre à trouver deux forgerons, deux charpentiers, ou deux maçons qui ne soient pas au moins à vingt milles l’un de l’autre. Les familles éparses qui se trouvent à huit ou dix milles du plus proche de ces ouvriers sont obligées d’apprendre à faire elles-mêmes une quantité de menus ouvrages pour lesquels on aurait recours à l’ouvrier dans des pays plus peuplés. Les ouvriers de la campagne sont presque partout dans la nécessité de s’adonner à toutes les différentes branches d’industrie qui ont quelque rapport entre elles par l’emploi des mêmes matériaux. Un charpentier de village confectionne tous les ouvrages en bois, et un serrurier de village tous les ouvrages en fer. Le premier n’est pas seulement charpentier, il est encore menuisier, ébéniste; il est sculpteur en bois, en même temps qu’il fait des charrues et des voitures. Les métiers du second sont encore bien plus variés. Il n’y a pas de place pour un cloutier dans ces endroits reculés de l’intérieur des montagnes d’Écosse. A raison d’un millier de clous par jour, et en comptant trois cents jours de travail par année, cet ouvrier pourrait en fournir par an trois cents milliers. Or, dans une pareille localité, il lui serait impossible de trouver le débit d’un seul millier, c’est-à-dire du travail d’une seule journée, dans le cours d’un an.
De l’origine et de l’usage de la monnaie
C’est de cette manière que la monnaie est devenue chez tous les peuples civilisés l’instrument universel du commerce, et que les marchandises de toute espèce se vendent et s’achètent, ou bien s’échangent l’une contre l’autre, par son intervention.
Il s’agit maintenant d’examiner quelles sont les règles que les hommes observent naturellement, en échangeant les marchandises l’une contre l’autre, ou contre de l’argent. Ces règles déterminent ce qu’on peut appeler la Valeur relative ou échangeable des marchandises.
Il faut observer que le mot valeur a deux significations différentes; quelquefois il signifie l’utilité d’un objet particulier, et quelquefois il signifie la faculté que donne la possession de cet objet d’en acheter d’autres marchandises. On peut appeler l’une, Valeur en usage, et l’autre, Valeur en échange. – Des choses qui ont la plus grande valeur en usage n’ont souvent que peu ou point de valeur en échange; et au contraire, celles qui ont la plus grande valeur en échange n’ont souvent que peu ou point de valeur en usage. Il n’y a rien de plus utile que l’eau, mais elle ne peut presque rien acheter; à peine y a-t-il moyen de rien avoir en échange. Un diamant, au contraire, n’a presque aucune valeur quant à l’usage, mais on trouvera fréquemment à l’échanger contre une très grande quantité d’autres marchandises.
Pour éclaircir les principes qui déterminent la valeur échangeable des marchandises, je tâcherai d’établir :
Premièrement, quelle est la véritable mesure de cette valeur échangeable, ou en quoi consiste le prix réel des marchandises;
Secondement, quelles sont les différentes parties intégrantes qui composent ce prix réel ;
Troisièmement enfin, quelles sont les différentes circonstances qui tantôt élèvent quelqu’une ou la totalité de ces différentes parties du prix au -dessus de leur taux naturel ou ordinaire, et tantôt les abaissent au-dessous de ce taux, ou bien quelles sont les causes qui empêchent que le prix de marché, c’est-à-dire le prix actuel des marchandises, ne coïncide exactement avec ce qu’on peut appeler leur prix naturel.
Je tâcherai de traiter ces trois points avec toute l’étendue et la clarté possibles dans les trois chapitres suivants, pour lesquels je demande bien instamment la patience et l’attention du lecteur : sa patience pour me suivre dans des détails qui, en quelques endroits, lui paraîtront peut-être ennuyeux; et son attention, pour comprendre ce qui semblera peut-être encore quelque peu obscur, malgré tous les efforts que je ferai pour être intelligible. Je courrai volontiers le risque d’être trop long, pour chercher à me rendre clair; et après que j’aurai pris toute la peine dont je suis capable pour répandre de la clarté sur un sujet qui, par sa nature, est aussi abstrait, je ne serai pas encore sûr qu’il n’y reste quelque obscurité.
Du prix réel et du prix nominal des marchandises, ou de leur prix en travail et de leur prix en argent
Un homme est riche ou pauvre, suivant les moyens qu’il a de se procurer les choses nécessaires, commodes ou agréables de la vie. Mais la division une fois établie dans toutes les branches du travail, il n’y a qu’une partie extrêmement petite de toutes ces choses qu’un homme puisse obtenir directement par son travail; c’est du travail d’autrui qu’il lui faut attendre la plus grande partie de toutes ces jouissances; ainsi, il sera riche ou pauvre, selon la quantité de travail qu’il pourra commander ou qu’il sera en état d’acheter.
Ainsi, la valeur d’une denrée quelconque pour celui qui la possède et qui n’entend pas en user ou la consommer lui-même, mais qui a intention de l’échanger pour autre chose, est égale à la quantité de travail que cette denrée le met en état d’acheter ou de commander.
Le travail est donc la mesure réelle de la valeur échangeable de toute marchandise. Le prix réel de chaque chose, ce que chaque chose coûte réellement à celui qui veut se la procurer, c’est le travail et la peine qu’il doit s’imposer pour l’obtenir. Ce que chaque chose vaut réellement pour celui qui l’a acquise et qui cherche à en disposer ou à l’échanger pour quelque autre objet, c’est la peine et l’embarras que la possession de cette chose peut lui épargner et qu’elle lui permet d’imposer à d’autres personnes. Ce qu’on achète avec de l’argent ou des marchandises est acheté par du travail, aussi bien que ce que nous acquérons à la sueur de notre front. Cet argent et ces marchandises nous épargnent, dans le fait, cette fatigue. Elles contiennent la valeur d’une certaine quantité de travail, que nous échangeons pour ce qui est supposé alors contenir la valeur d’une quantité égale de travail. Le travail a été le premier prix, la monnaie payée pour l’achat primitif de toutes choses. Ce n’est point avec de l’or ou de l’argent, c’est avec du travail que toutes les richesses du monde ont été achetées originairement; et leur valeur pour ceux qui les possèdent et qui cherchent à les échanger contre de nouvelles productions, est précisément égale à la quantité de travail qu’elles les mettent en état d’acheter ou de commander.
Richesse, c’est pouvoir, a dit Hobbes; mais celui qui acquiert une grande fortune ou qui l’a reçue par héritage, n’acquiert par là nécessairement aucun pouvoir politique, soit civil, soit militaire. Peut-être sa fortune pourra-t-elle lui fournir les moyens d’acquérir l’un ou l’autre de ces pouvoirs, mais la simple possession de cette fortune ne les lui transmet pas nécessairement. Le genre de pouvoir que cette possession lui transmet immédiatement et directement, c’est le pouvoir d’acheter; c’est un droit de commandement sur tout le travail d’autrui, ou sur tout le produit de ce travail existant alors au marché. Sa fortune est plus ou moins grande exactement en proportion de l’étendue de ce pouvoir, en proportion de la quantité du travail d’autrui qu’elle le met en état de commander, ou, ce qui est la même chose, du produit du travail d’autrui qu’elle le met en état d’acheter. La valeur échangeable d’une chose quelconque doit nécessairement toujours être précisément égale à la quantité de cette sorte de pouvoir qu’elle transmet à celui qui la possède.
Mais, quoique le travail soit la mesure réelle de la valeur échangeable de toutes les marchandises, ce n’est pourtant pas celle qui sert communément à apprécier cette valeur. Il est souvent difficile de fixer la proportion entre deux différentes quantités de travail. Cette proportion ne se détermine pas toujours seulement par le temps qu’on a mis à deux différentes sortes d’ouvrages. Il faut aussi tenir compte des différents degrés de fatigue qu’on a endurés et de l’habileté qu’il a fallu déployer. Il peut y avoir plus de travail dans une heure d’ouvrage pénible que dans deux heures de besogne aisée, ou dans une heure d’application à un métier qui a coûté dix années de travail à apprendre, que dans un mois d’application d’un genre ordinaire et à laquelle tout le monde est propre. Or, il n’est pas aisé de trouver une mesure exacte applicable au travail ou au talent. Dans le fait, on tient pourtant compte de l’une et de l’autre quand on échange ensemble les productions de deux différents genres de travail. Toutefois, ce compte-là n’est réglé sur aucune balance exacte; c’est en marchandant et en débattant les prix de marché qu’il s’établit, d’après cette grosse équité qui, sans être fort exacte, l’est bien assez pour le train des affaires communes de la vie.
D’ailleurs, chaque marchandise est plus fréquemment échangée et, par conséquent, comparée, avec d’autres marchandises qu’avec du travail. Il est donc plus naturel d’estimer sa valeur échangeable par la quantité de quelque autre denrée que par celle du travail qu’elle peut acheter. Aussi, la majeure partie du peuple entend bien mieux ce qu’on veut dire par telle quantité d’une certaine denrée, que par telle quantité de travail. La première est un objet simple et palpable; l’autre est une notion abstraite, qu’on peut bien rendre assez intelligible, mais qui n’est d’ailleurs ni aussi commune ni aussi évidente.
Mais quand les échanges ne se font plus immédiatement, et que l’argent est devenu l’instrument général du commerce, chaque marchandise particulière est plus souvent échangée contre de l’argent que contre toute autre marchandise. Le boucher ne porte guère son bœuf ou son mouton au boulanger ou au marchand de bière pour l’échanger contre du pain ou de la bière; mais il le porte au marché, où il l’échange contre de l’argent, et ensuite il échange cet argent contre du pain et de la bière. La quantité d’argent que sa viande lui rapporte détermine aussi la quantité de pain et de bière qu’il pourra ensuite acheter avec cet argent. Il est donc plus clair et plus simple pour lui d’estimer la valeur de sa viande par la quantité d’argent, qui est la marchandise contre laquelle il l’échange immédiatement, que par la quantité de pain et de bière, qui sont des marchandises contre lesquelles il ne peut l’échanger que par L’intermédiaire d’une autre marchandise; il est plus naturel pour lui de dire que sa viande vaut trois ou quatre pence la livre, que de dire qu’elle vaut trois ou quatre livres de pain, ou trois ou quatre pots de petite bière. – De là vient qu’on estime plus souvent la valeur échangeable de chaque marchandise par la quantité d’Argent, que par la quantité de Travail ou de toute autre Marchandise qu’on pourrait avoir en échange.
Cependant l’Or et l’Argent, comme toute autre marchandise, varient dans leur valeur ; ils sont tantôt plus chers et tantôt à meilleur marché; ils sont quelquefois plus faciles à acheter, quelquefois plus difficiles. La quantité de travail que peut acheter ou commander une certaine quantité de ces métaux, ou bien la quantité d’autres marchandises qu’elle peut obtenir en échange, dépend toujours de la fécondité ou de la stérilité des mines exploitées dans le temps où se font ces échanges. Dans le seizième siècle, la découverte des mines fécondes de l’Amérique réduisit la valeur de l’or et de l’argent, en Europe, à un tiers environ de ce qu’elle avait été auparavant. Ces métaux, coûtant alors moins de travail pour être apportés de la mine au marché, ne purent plus acheter ou commander, quand ils y furent venus, qu’une moindre quantité de travail, et cette révolution dans leur valeur, quoique peut- être la plus forte, n’est pourtant pas la seule dont l’histoire nous ait laissé des témoignages. Or, de même qu’une mesure de quantité, telle que le pied naturel, la coudée ou la poignée, qui varie elle-même de grandeur dans chaque individu, ne saurait jamais être une mesure exacte de la quantité des autres choses, de même une marchandise qui varie elle-même à tout moment dans sa propre valeur, ne saurait être non plus une mesure exacte de la valeur des autres marchandises.
Des quantités égales de travail doivent être, dans tous les temps et dans tous les lieux, d’une valeur égale pour le travailleur. Dans son état habituel de santé, de force et d’activité, et d’après le degré ordinaire d’habileté ou de dextérité qu’il peut avoir, il faut toujours qu’il sacrifie la même portion de son repos, de sa liberté, de son bonheur. Quelle que soit la quantité de denrées qu’il reçoive en récompense de son travail, le prix qu’il paye est toujours le même. Ce prix, à la vérité, peut acheter tantôt une plus grande, tantôt une moindre quantité de ces denrées; mais c’est la valeur de celles-ci qui varie, et non celle du travail qui les achète. En tous temps et en tous lieux, ce qui est difficile à obtenir ou ce qui coûte beaucoup de travail à acquérir est cher, et ce qu’on peut se procurer aisément ou avec peu de travail est à bon marché.
Ainsi, le travail, ne variant jamais dans sa valeur propre, est la seule mesure réelle et définitive qui puisse servir, dans tous les temps et dans tous les lieux, à apprécier et à comparer la valeur de toutes les marchandises. Il est leur prix réel; l’argent n’est que leur prix nominal.
Mais, quoique les quantités égales de travail soient toujours d’une valeur égale pour celui qui travaille, cependant, pour celui qui emploie l’ouvrier, elles paraissent tantôt d’une plus grande, tantôt d’une moindre valeur. Le dernier achète ces quantités de travail, tantôt avec une plus grande, tantôt avec une plus petite quantité de marchandises; et pour lui le prix du travail paraît varier comme celui de toute autre chose. Il lui semble cher dans un cas, et à bon marché dans l’autre. Dans la réalité pourtant, ce sont les marchandises qui sont à bon marché dans un cas, et chères dans l’autre.
Ainsi, dans cette acception vulgaire, on peut dire du travail, comme des marchandises, qu’il a un prix réel et un prix nominal. On peut dire que son prix réel consiste dans la quantité de choses nécessaires et commodes qu’on donne pour le payer, et son prix nominal dans la quantité d’argent. L’ouvrier est riche ou pauvre, il est bien ou mal récompensé, en proportion du prix réel, et non du prix nominal, de son travail.
La distinction entre le prix réel et le prix nominal des marchandises et du travail n’est pas une affaire de pure spéculation, mais elle peut être quelquefois d’un usage important dans la pratique. Le même prix réel est toujours de même valeur; mais au moyen des variations dans la valeur de l’or et de l’argent, le même prix nominal exprime souvent des valeurs fort différentes. Ainsi, quand une propriété foncière est aliénée sous la réserve d’une rente perpétuelle, si l’on veut que cette rente conserve toujours la même valeur, il est important, pour la famille au profit de laquelle la rente est réservée, que cette rente ne soit pas stipulée en une somme d’argent fixe. Sa valeur, dans ce cas, serait sujette à éprouver deux espèces de variations : premièrement, celles qui proviennent des différentes quantités d’or et d’argent qui sont contenues, en différents temps, dans les monnaies de même dénomination; secondement, celles qui proviennent des différences dans la valeur des quantités égales d’or et d’argent à différentes époques.
Les princes et les gouvernements se sont souvent imaginé qu’il était de leur intérêt du moment de diminuer la quantité de métal pur contenu dans leurs monnaies; mais on ne voit guère qu’ils se soient jamais imaginé avoir quelque intérêt à l’augmenter. En conséquence, je crois que, chez toutes les nations, la quantité de métal pur contenue dans les monnaies a été à peu près continuellement en diminuant, et presque jamais en augmentant. Ainsi, les variations de cette espèce tendent presque toujours à diminuer la valeur d’une rente en argent.
La découverte des mines de l’Amérique a diminué la valeur de l’or et de l’argent en Europe. On suppose communément, je crois, sans preuve bien certaine, que cette diminution continue toujours graduellement et qu’elle doit durer encore pendant long-temps. D’après cette supposition donc, les variations de ce genre sont plus propres à diminuer qu’à augmenter la valeur d’une rente en argent, quand même on la stipulerait payable, non en une quantité de pièces de monnaie de telle dénomination, comme en tant de livres sterling, par exemple, mais en une certaine quantité d’onces d’argent pur ou à un titre déterminé.
Les rentes qu’on s’est réservées en blé ont conservé leur valeur beaucoup mieux que celles stipulées payables en argent, même dans le cas où la dénomination de la monnaie n’a pas souffert d’altération. Par le statut de la dix-huitième année d’Élisabeth, il a été réglé qu’un tiers des rentes de tous les baux des collèges serait réservé en blé, payable soit en nature, soit au prix courant du marché public le plus voisin. Suivant le docteur Blackstone, l’argent qui provient de la portion payable en blé, quoique dans l’origine il n’ait été qu’un tiers du total de la rente, est ordinairement à peu près le double de ce que rapportent les deux autres tiers. A ce compte, il faut donc que les anciennes rentes des collèges, stipulées en argent, soient descendues environ au quart de leur ancienne valeur, ou ne vaillent guère plus d’un quart du blé qu’elles valaient originairement. Or, depuis le règne de Philippe et Marie, la dénomination de la monnaie anglaise n’a subi que peu ou point d’altération, et le même nombre de livres, schellings et pence a toujours contenu à peu près la même quantité d’argent fin. Cette diminution dans la valeur des rentes des collèges, stipulées en argent, provient donc en totalité de la diminution dans la valeur de l’argent.
Quand l’abaissement de la valeur de l’argent coïncide avec la diminution de la quantité contenue dans des monnaies de même dénomination, la perte est alors beaucoup plus grande. En Écosse, où la monnaie a subi bien plus de changements qu’en Angleterre, et en France où elle en a subi beaucoup plus qu’en Écosse, il y a d’anciennes rentes qui ont été dans l’origine d’une valeur considérable, et qui se sont trouvées réduites presque à rien.
Dans des temps très éloignés l’un de l’autre, on trouvera que des quantités égales de travail se rapportent de bien plus près dans leur valeur à des quantités égales de blé, qui est la subsistance de l’ouvrier, qu’elles ne le font à des quantités égales d’or et d’argent, ou peut-être de toute autre marchandise. Ainsi, des quantités égales de blé, à des époques très distantes l’une de l’autre, approcheront beaucoup plus entre elles de la même valeur réelle, ou bien elles mettront beaucoup plus celui qui les possédera en état d’acheter ou de commander une même quantité de travail, que ne le feraient des quantités égales de presque toute autre marchandise que ce puisse être. Je dis qu’elles le feront beaucoup plus que des quantités égales de toute autre marchandise; car même des quantités égales de blé ne le feront pas exactement. La subsistance de l’ouvrier, ou le prix réel du travail, diffère beaucoup en diverses circonstances, comme je tâcherai de le faire voir par la suite. Il est plus libéralement payé dans une société qui marche vers l’opulence, que dans une société qui reste stationnaire; il est plus libéralement payé dans une société stationnaire, que dans une société rétrograde. Une denrée quelconque, en quelque temps que ce soit, achètera une plus grande ou une moindre quantité de travail, en proportion de la quantité de subsistances qu’elle pourra acheter à cette époque. Par conséquent, une rente réservée en blé ne sera sujette qu’aux variations dans la quantité de travail que telle quantité de blé peut acheter ; mais une rente stipulée en toute autre denrée sera sujette non seulement aux variations dans la quantité de travail que telle quantité de blé peut acheter, mais encore aux variations qui surviendront dans la quantité de blé que telle quantité de cette denrée stipulée pourra acheter.
Il est bon d’observer que, quoique la valeur réelle d’une rente en blé varie beaucoup moins que celle d’une rente en argent, d’un siècle à un autre, elle varie pourtant beaucoup plus d’une année à l’autre. Le prix du travail en argent, comme je tâcherai de le faire voir plus loin, ne suit pas, d’une année à l’autre, toutes les fluctuations du prix du blé en argent, mais il paraît se régler partout sur le prix moyen ou ordinaire de ce premier besoin de la vie, et non pas sur son prix temporaire ou accidentel. Le prix moyen ou ordinaire du blé se règle, comme je tâcherai pareillement de le démontrer plus loin, sur la valeur de l’argent, sur la richesse ou la stérilité des mines qui fournissent le marché de ce métal, ou bien sur la quantité de travail qu’il faut employer et, par conséquent, de blé qu’il faut consommer pour qu’une certaine quantité d’argent soit transportée de la mine jusqu’au marché. Mais la valeur de l’argent, quoiqu’elle varie quelquefois extrêmement d’un siècle à un autre, ne varie cependant guère d’une année à l’autre, et même continue très souvent à rester la même ou à peu près la même pendant un demi-siècle ou un siècle entier. Ainsi, le prix moyen ou ordinaire du blé en argent peut continuer aussi, pendant toute cette longue période, à rester le même ou à peu près le même, et avec lui pareillement le prix du travail, pourvu toutefois que la société, à d’autres égards, continue à rester dans la même situation ou à peu près. Pendant le même temps, le prix temporaire ou accidentel du blé pourra souvent doubler d’une année à l’autre : par exemple, de vingt-cinq schellings le quarter, s’élever à cinquante. Mais lorsque le blé est à ce dernier prix, non seulement la valeur nominale, mais aussi la valeur réelle d’une rente en blé est au premier prix, ou bien elle pourra acheter une quantité double, soit de travail, soit de toute autre marchandise, le prix du travail en argent, et avec lui le prix de la plupart des choses, demeurant toujours le même au milieu de toutes ces fluctuations.
Il paraît donc évident que le travail est la seule mesure universelle, aussi bien que la seule exacte, des valeurs, le seul étalon qui puisse nous servir à comparer les valeurs de différentes marchandises à toutes les époques et dans tous les lieux.
On sait que nous ne pouvons pas apprécier les valeurs réelles de différentes marchandises, d’un siècle à un autre, d’après les quantités d’argent qu’on a données pour elles. Nous ne pouvons pas les apprécier non plus d’une année à l’autre, d’après les quantités de blé qu’elles ont coûté. Mais, d’après les quantités de travail, nous pouvons apprécier ces valeurs avec la plus grande exactitude, soit d’un siècle à un autre, soit d’une année à l’autre. D’un siècle à l’autre, le blé est une meilleure mesure que l’argent, parce que, d’un siècle à l’autre, des quantités égales de blé seront bien plus près de commander la même quantité de travail, que ne le seraient des quantités égales d’argent. D’une année à l’autre, au contraire, l’argent est une meilleure mesure que le blé, parce que des quantités égales d’argent seront bien plus près de commander la même quantité de travail.
Mais, quoique la distinction entre le prix réel et le prix nominal puisse être utile dans des constitutions de rentes perpétuelles, ou même dans des baux à très longs termes, elle ne l’est nullement pour les achats et les ventes, qui sont les contrats les plus communs et les plus ordinaires de la vie.
Au même temps et au même lieu, le prix réel et le prix nominal d’une marchandise quelconque sont dans une exacte proportion l’un avec l’autre. Selon qu’une denrée quelconque vous rapportera plus ou moins d’argent au marché de Londres, par exemple, elle vous mettra aussi en état d’acheter ou de commander plus ou moins de travail au même temps et au même lieu.
Ainsi, quand il y a identité de temps et de lieu, l’argent est la mesure exacte de la valeur échangeable de toutes les marchandises; mais il ne l’est que dans ce cas seulement.
Quoique, à des endroits éloignés l’un de l’autre, il n’y ait pas de proportion régulière entre le prix réel des marchandises et leur prix en argent, cependant, le marchand qui les transporte de l’un de ces endroits à l’autre n’a pas autre chose à considérer que leur prix en argent, ou bien la différence entre la quantité d’argent pur qu’il donne pour les acheter, et celle qu’il pourra retirer en les vendant. Il se peut qu’une demionce d’argent à Canton, en Chine, achète une plus grande quantité, soit de travail, soit de choses utiles ou commodes, que ne le ferait une once à Londres. Toutefois, une marchandise qui se vend une demionce d’argent à Canton peut y être réellement plus chère, être d’une importance plus réelle pour la personne qui la possède en ce lieu, qu’une marchandise qui se vend à Londres une once ne l’est pour la personne qui la possède à Londres. Néanmoins, si un commerçant de Londres peut acheter à Canton, pour une demi- once d’argent, une marchandise qu’il revendra ensuite une once à Londres, il gagne à ce marché cent pour cent, tout comme si l’once d’argent avait exactement la même valeur à Londres et à Canton. Il ne s’embarrasse pas de savoir si une demionce d’argent à Canton aurait mis à sa disposition plus de travail et une plus grande quantité de choses propres aux besoins et aux commodités de la vie, qu’une once ne pourrait le faire à Londres. A Londres, pour une once d’argent, il aura à sa disposition une quantité de toutes ces choses double de celle qu’il pourrait y avoir pour une demionce, et c’est là précisément ce qui lui importe.
Comme c’est le prix nominal, ou le prix en argent des marchandises, qui détermine finalement, pour tous les acheteurs et les vendeurs, s’ils font une bonne ou mauvaise affaire, et qui règle par là presque tout le train des choses ordinaires de la vie dans lesquelles il est question de prix, il n’est pas étonnant qu’on ait fait beaucoup plus d’attention à ce prix qu’au prix réel.
Mais, dans un ouvrage de la nature de celui-ci, il peut quelquefois être utile de comparer les différentes valeurs réelles d’une marchandise particulière, à différentes époques et en différents lieux, ou d’évaluer les différents degrés de puissance sur le travail d’autrui qu’elle a pu donner en différentes circonstances à celui qui la possédait. Dans ce cas, ce n’est pas tant les différentes quantités d’argent pour lesquelles elle a été communément vendue qu’il s’agit de comparer, que les différentes quantités de travail qu’auraient achetées ces différentes quantités d’argent; mais il est bien difficile de pouvoir jamais connaître avec quelque degré d’exactitude les prix courants du travail dans des temps et des lieux éloignés. Ceux du blé, quoiqu’ils n’aient été régulièrement enregistrés que dans peu d’endroits, sont en général beaucoup plus connus, et on en trouve fréquemment des indications dans les historiens et dans les autres écrivains. Il faut donc, en général, nous contenter de ces prix, non pas comme étant toujours exactement dans les mêmes proportions que les prix courants du travail, mais comme étant l’approximation la meilleure que l’on puisse obtenir communément pour trouver à peu près ces proportions. J’aurai occasion par la suite de faire quelques comparaisons et rapprochements de ce genre.
Présentation et plan du cours
Adam Smith (1723-1790) Richesse des nations (1776)
Livre I, chapitres 1, 2, 3, 4, 5, 6 (extraits)
Livre II, chapitres 3 (extrait)
Livre IV, chapitres 2, 9 (extraits)
Livre V, chapitres 2, section iii (extrait)
David Ricardo (1772-1823) Principes de l’économie politique et de l’impôt (1817)
Chapitre I (La valeur), sections 1, 2, 3, 4
Chapitre II (La rente)
Chapitre IV (Prix naturel & prix courant)
Chapitre V (Les salaires, extraits)
Chapitre VI (Les profits, extraits)
Chapitre XXI (Des effets de l’accumulation sur les profits, extraits)..
Karl Marx (1818-1883) Le capital, livre 1 (1867)
Chapitre I (« La marchandise »)
Chapitre IV (« La formule générale du capital »)
Chapitre V (« Contradictions de la formule générale du capital », extrait)
Chapitre VI (« L’achat et la vente de la force de travail »)
Chapitre XIX (Transformation de la valeur de la force de travail en salaire)
Léon Walras (1834-1910) Études d’économie sociale (1896)
Théorie générale de la société (6e leçon : « De l’individu et de l’État »)
Théorie de la propriété
Éléments d’économie politique pure (1874)
Préface de la 4e édition (extrait)
2e leçon : Distinction entre la science, l’art et la morale (extrait)…
3e leçon : De la richesse sociale ; triple conséquence de la rareté
5e leçon : Du marché et de la concurrence
18e leçon : Eléments et mécanismes de la production (extrait)
John Maynard Keynes (1883-1946) Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie (1936)
Chapitre 2 : Les postulats de l’économie classique
Chapitre 3 : Le principe de la demande effective
Chapitre 24 : Notes finales sur la philosophie sociale etc.
« La théorie générale de l’emploi », in Quaterly Journal of Economics (1937)