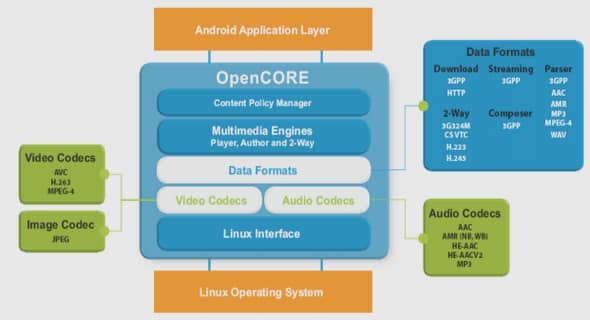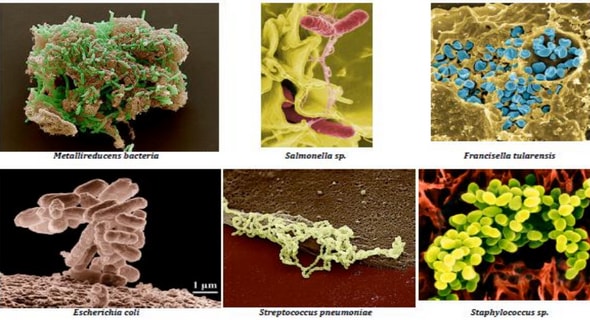PHYLOGEOGRAPHIE DU RICE YELLOW MOTTLE VIRUS
Variabilité et diversité du RYMV en Afrique
Diversité sérologique
La diversité sérologique d’une collection d’isolats de RYMV prélevés dans plusieurs pays africains a été étudiée à l’aide d’une série d’anticorps monoclonaux discriminants. Cinq sérotypes (Ser) ont été ainsi définis. Ces sérotypes ont une distribution géographique propre. Ainsi, les sérotypes Ser2 et Ser3 sont présents en Afrique de l’ouest exclusivement, le sérotype Ser1 se retrouve à la fois en Afrique de l’ouest et centrale. Les sérotypes Ser4 et Ser5 sont présents exclusivement en Afrique de l’est. Quelques isolats malgaches venant de la région du nord-ouest, de Ranohira et de la collection d’Ambatobe en 1990 ont été étudiés avant cette étude. Ils appartiennent au sérotype Ser4 (N’-Guessan et al., 2001).
Diversité moléculaire
L’ORF1 et l’ORF sont les parties les plus variables du génome du RYMV, alors que l’ORF2 est la partie la plus conservée. L’ORF code pour la protéine de capside du virus. Il est transcrit à des concentrations élevées via un ARN subgénomique. Les phylogénies reconstruites l’ORF sont très largement compatibles avec celles reconstruites à partir du génome entier càd leurs arbres ont la même forme. L’ensemble de ces raisons (forte concentration de l’ARN subgénomique porteur de l’ORF, variabilité élevée et congruence phylogénétique) fait de l’ORF la portion du génome la plus appropriée pour l’étude de la diversité du RYMV. L’étude de la variabilité moléculaire basée sur le séquençage de l’ORF a révélé une diversité élevée. Six souches ont été définies. Elles recoupent largement les sérotypes établis à l’aide d’anticorps monoclonaux. Leur répartition géographique est caractéristique : les souches S2 et S3 (correspondant à Ser2 et Ser3, respectivement) se trouvent en Afrique de l’ouest exclusivement. La souche S1 (correspondant à Ser1) se subdivise en deux lignées, l’une présente en Afrique de l’ouest, l’autre en Afrique ouest/centrale (coupure le long d’un axe nordsud Togo, Bénin, Niger). Les souches S4 (correspondant à Ser4) et S5 et S6 (correspondant à Ser5) sont présentes en Afrique de l’Est exclusivement (Pinel et al, 2000 ; Abubakar et al., 2003 ; Fargette et al., 2004 ; Traoré et al., 2005 ; Fargette et al., 2006). Les divergences de séquence de l’ORF4 atteignent 16% en nucléotides et 12% en acides aminés. La variabilité des souches d’Afrique de l’est est plus de deux fois plus élevée que celle des souches d’Afrique de l’ouest.
ARN satellite
Un virus de plantes est quelques fois parasité par un satellite pathogène qui peut être soit un virus très petit soit un ARN (Astier et al, 2001). Ces satellites présentent des formes linéaires ou circulaires. Ils dépendent du virus dit assistant pour leur réplication mais ils ne sont pas nécessaires au virus assistant pour son cycle. Toutefois, les symptômes provoqués par le virus assistant sur la plante hôte sont accentués en présence des satellites. Le RYMV possède le plus petit satellite circulaire connu avec 220 nucléotides. Il est classé parmi les ARN satellites circulaires sans fonction messagère, comme d’autres virus du genre des sobemovirus (Hull et Fargette, 2005). Près de 75% des isolats collectés des champs sur du riz cultivé ou sur des graminées sauvages dans les régions représentatives de la distribution géographique du virus possèdent un ARN satellite. La prévalence peut atteindre 100% en Afrique centrale et en Afrique de l’ouest. Elle est plus faible en Afrique de l’est. Deux formes très voisines du satellite ont été mises en évidence. L’étude de deux isolats malgaches a révélé la présence d’une des deux formes du satellite. L’ARN satellite ne jouait pas de rôle ni dans la phylogénie ni dans la pathogénie du RYMV (Pinel et al., 2003).
Phylogénie et Phylogéographie
Phylogénie
La phylogénie est l’étude des relations historiques et évolutives entre organismes ou microorganismes d’un taxon donné. Elle révèle les parentés entre genres, espèces, sousespèces, souches ou variants. Elle aboutit à la reconstruction d’un arbre phylogénétique au sein duquel les apparentements du taxon sont visualisés. L’arbre phylogénétique est basé sur l’analyse soit de caractères morphologiques, soit de caractères moléculaires. La phylogénie moléculaire se base sur la comparaison des séquences d’ADN ou d’ARN d’un gène, d’une région, d’un fragment ou du génome entier, comme dans le cas où la taille du génome est limitée. Il y a plusieurs méthodes de reconstruction phylogénétique (Darlu et Tassy, 1993) : La méthode cladistique consiste à étudier les branchements phylogéniques, en mettant en évidence les séries de transformations des caractères de l’état plésiomorphe ou primitif à l’état apomorphe ou dérivé. L’arbre appelé alors cladogramme est un diagramme représentant les relations hiérarchiques entre les groupements de taxa ou de séquences et il construit par la méthode de la parcimonie (MP : « maximum parcimony »). Le principe de la 17 parcimonie est de choisir l’arbre au plus court chemin, c’est à dire minimisant les transformations ou les substitutions de l’ancêtre aux descendants, donc l’arbre le plus parcimonieux.
INTRODUCTION GENERALE |