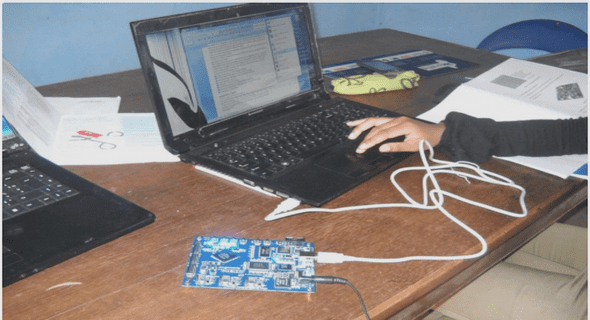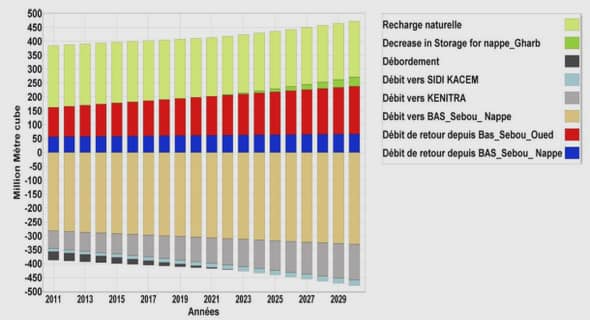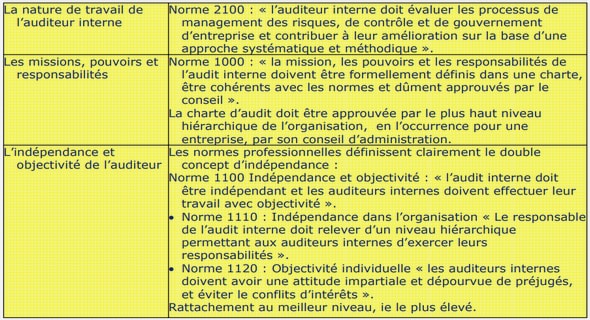Un paradigme à refonder : pour un réalisme élargi
Le but de cette thèse est de proposer une théorie dela dynamique institutionnelle de l’Europe depuis la seconde guerre mondiale jusqu’au traité de Lisbonne. Il s’agit essentiellement d’expliquer comment le continent européen a pu passer du stade de système international en proie à une guerre généralisée et totale à celui desystème intégré au plan gouvernemental, parlementaire et juridictionnel.
Dans ce cadre, l’enjeu théorique central est bien entendu l’explication du changement, à travers la connexion de la théorie des relations internationales aux théories de l’intégration et des institutions européennes. En effet, la théoriedes relations internationales a souvent butté sur la construction européenne, et les théories del’intégration européenne ont souvent éludé la question du lien avec les relations internationales classiques en prenant la coopération entre Etats européens comme un postulat de départ. De cetévitement mutuel découle un certain dialogue de sourds entre paradigmes. Il s’agira donc ici de proposer un paradigme théorique capable aussi bien de rendre compte du fonctionnement d’un système international classique (relations entre Etats indépendants) que d’un système interne (relations entre institutions intégrées) ainsi que de toutes les transformationsqui peuvent conduire de l’un à l’autre, c’est-à-dire du phénomène d’intégration. Pour cela nous partirons des théories des relationsinternationales puisqu’elles représentent en quelque sorte le point de départ de notre questionnement. Partir des théories des institutions internes serait prendre le risque de postuler une grande partie du problème résolu au lieu de l’affronter. Nous chercherons à montrer que la théorie réaliste, qui a historiquement été échafaudée pour rendre compte des relations internationales dans ce qu’elles ont de plus conflictuel, de moins coopératif et donc de moins intégré, constitue un bon point de départ. Mais il s’agira de proposer une version élargie du réalisme, c’est-à-dire applicable au-delà de l’étroite sphère des relations interétatiques et des questions de sécurité à laquelle il est le plus souvent confiné.
Le débat le plus ancien en théorie des relations internationales est celui qui oppose le libéralisme au réalisme. Ces deux écoles ont étéjointesre plus récemment par le courant constructiviste, qui entretient néanmoins, nous le verrons, des liens de parentés importants avec la tradition libérale. Puisque la question qui nous intéresse est en définitive celle de l’intégration, il s’agira d’interroger ces différents courants non seulement au regard de leur explication des relations internationales mais surtout de leur façon d’appréhender les possibles transformations du système international. Le libéralisme dont sont issues les théories intergouvernementalistes et néofonctionnalistes est d’abord une tradition économique dont les explications sont fondées sur l’idée que les individus cherchent essentiellement à maximiser leu rs profits, ce qui les incite notamment à échanger. Ainsi, la coopération par la division dutravail est le point de départ de la théorie libérale : « C’est ce que fait celui qui propose à un autre un marché quelconque ; le sens de sa proposition est ceci : Donnez-moi ce dont j’ai besoin, et vous aurez de moi ce dont vous avez besoin vous-mêmes; et la plus grande partie de ces bons offices qui nous sont nécessaires s’obtiennent de cette façon. Ce n’est pas de la bie nveillance du boucher, du marchand de bière et du boulanger, que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu’ils apportent à leurs intérêts » (Smith, 1991, t1, p. 82). Et plus « la acultéf d’échanger », autrement dit plus le marché s’étend dans l’espace, plus l’intégration par la division du travail s’étend (p. 85). Notons que ce libéralisme économique est au départtrès matérialiste : ce sont les intérêts matériels qui font l’échange, pas les bons sentiments. Ainsi, pour le paradigme libéral, l’intégration économique est simplement fonction de l’évolution des moyens de communication qui étendent le marché et les échanges. Montesquieu, libéral politique, expose un raisonnement similaire appliqué aux relations internationales : « L’effet naturel du commerce est de porter la paix. Deux nations qui négocient ensemble se rendent réciproquement dépendantes : si l’une a intérêt cheter,àa l’autre a intérêt à vendre ; et toutes les unions sont fondées sur des besoins mutuels » (1995, p. 610). Ici, le lien est établi entre intégration économique et intégration politique ausens large. Et en affirmant que le développement des échanges transnationaux est à l’origine de l’intégration européenne, néofonctionnalistes et intergouvernementalistes ne font que prolonger cette thèse du « doux commerce » de Montesquieu. Le libéralisme est en efet un paradigme qui tend à prédire le triomphe de la paix voire de l’union entre les Etats, tout simplement parce que la paix, l’échange et la division du travail sont profitables à l’économie. C’est la raison pour laquelle, l’école libérale a été, au moins jusqu’à la secondeguerre mondiale, associée à un certain optimisme progressiste. Un exemple typique de ce libéralisme classique est ainsi The Great Illusion de Norman Angell (1911), fondé sur cette idée quela guerre entre Européens ne peut être une solution attractive puisqu’elle est économiquement désastreuse. Cette thèse valut d’ailleurs à Angell le prix Nobel de la paix en 193 3. Le problème est que cette approche économiste des relations internationales s’est rapidement heurtée à la réalité de la persistance et même de l’intensification des guerres, illustréeau XXème siècle par les deux conflits mondiaux. Mais le libéralisme ne s’avoua pas vaincu et pour expliquer l’échec de ses prédictions pacifiques il mobilisa, à côté de l’explication par la recherche de l’intérêt matériel, une explication par les idées, formant ainsi le consensus économico-idéaliste dont nous avons identifié l’héritage chez Haas et Moravcsik. En somme, si les Etats continuaient à se faire la guerre, c’était parce qu’ils n’avaient pas encore « conscience » de leurs intérêts communs à échanger pacifiquement. L’idéalisme, issu lui aussi des Lumières, succédait ainsi à l’économisme classique. Le principe de base est que la diffusion des idées, de la culture a pour effet de créer de nouvelles normes sociales qui font avancer l’histoire. C’est la raison pour laquelle les pères idéologiques de la « construction européenne » sont largement associés au paradigme libéral à travers l’idée que l’apprentissage, l’héritage des philosophes, les contacts interculturels, sont susceptibles de faire émerger avec le temps, une prise de conscience nouvelle qu’il est préférable de s’unirque de se faire la guerre. Ainsi Bull (1977), principal représentant de l’école anglaise, décritla société internationale comme un système dans lequel l’intensité des interactions fait progressivement émerger une culture partagée qui permet de fonder des institutions coopératives et d’établir des normes pour réguler la compétition. En se fondant sur une méthodologie plus empirique, le libéralisme sociologique de Deutsch (1988) peut être rapproché de l’école néofonctionnaliste dans la mesure où il fait découler l’intégration de l’intensification des flux de communication transnationaux, qui selon lui génèrent dans les populations un sentiment de ommunautéc à un niveau international et des attentes qui excluent la guerre. Une autre variante du libéralisme insiste sur le rôle décisif des institutions. Pour Keohane (1984), les institutions économiques internationales ont initialement été mises en place grâce à l’hégémonieaméricaine, mais elles perdurent car elles ont créé un régime coopératif qui réduit l’incertitude et facilite les accords entre Etats. Enfin, une dernière variante du libéralisme, issue directement du Projet de paix perpétuellede Kant, est représentée par la théorie de la « paix démocratique », (Russett, 1994) qui prédit que la culture du compromis et du règlement pacifique des conflits qui caractérise les démocraties apaise les relations entre les Etats de régime démocratique et les détourne de la guerre. La diffusion de la démocratie doit donc pacifier les relations internationales. Dans le libéralisme, idées et intérêts sont ainsi utilisés comme deuxcteursfa autonomes et complémentaires. En particulier les idées se voient accorder le rôle central dans la dynamique de l’Histoire qui peut être définie comme une « prise de conscience » progressive des intérêts communs, que ce soit par la coopération, la communication, les institutions internationales ou la diffusion de la démocratie. Ce rapide panorama du paradigme libéralen relations internationales met en lumière sa difficulté à penser le changement en général et la question de l’intégration en particulier. En effet, du fait de son origine économique, le libéralisme n’est pas particulièrement bien placé pour expliquer la coopération : il la présuppose dans la mesure où il présuppose la division du travail et l’échange ua sein d’un marché pacifié. D’autre part, en palliant les insuffisances de ses explications économiques par le recours aux explications idéalistes, il propose un modèle peu parcimonieux voire ad hoc. Enfin et surtout, la thèse libérale d’une évolution progressive des représentionsa due à la diffusion des échanges, des flux de communication ou des normes coopératives n’a que peu d’intérêt pour expliquer la transformation du système européen qui en cinq ans,de 1945 à 1950, passa de la guerre la plus meurtrière de son histoire à la première tentative d’intégration pacifique aboutie de son histoire. Cette évolution ne peut être lue simplement comme l’effet d’un progrès linéaire.
Le réalisme s’est justement affirmé en réaction à’optimismel libéral, décrédibilisé par l’échec de la SDN et la seconde guerre mondiale. Par rapport à notre question de départ sur le passage de l’Europe de Munich à l’Europe de Lisbonne, le réalisme a l’avantage de prendre Munich au sérieux. Ainsi, le réalisme « classique » (Carr,2001 ; Morgenthau, 1993 ; Aron, 1962) souligne essentiellement la tendance des Etats à re chercher leurs intérêts propres plutôt que l’intérêt commun des libéraux, et à viser la puissance, la domination et la gloire, plutôt que le simple profit économique (Aron, 1962, p. 83). Les premiers réalistes ne font ainsi que substituer à l’économisme optimiste des libéraux un naturalisme pessimiste. Ainsi, pour Morgenthau, le premier principe du réalisme est que les « lois » de la politique ont leur origine dans la « nature humaine » (1993, p. 4) ; et cette nature les pousse à rechercher la domination (p. 37). Ce constat s’inscrit dans la tradition de Thucydide (2000, V-105), qui fait dire aux Athéniens que les hommes « obéissent nécessairement à une loi de nature qui les pousse à dominer les autres à chaque fois qu’ils so nt les plus forts ». De même Machiavel écrit dans son Discours sur la première décade de Tite-Live: « Tous les écrivains qui se sont occupés de politique (et l’histoire est remplie d’exemples qui les appuient) s’accordent à dire que quiconque veut fonder un Eta t et lui donner des lois doit supposer d’avance les hommes méchants, et toujours prêts à montrer leur méchanceté toutes les fois qu’ils en trouveront l’occasion » (1980, p. 161). C’est la nature humaine et son « animus dominandi » qui structurent les relations internationales. Plus intéressant est le néoréalisme de Waltz (2001, 1979) qui va vers une plus grande parcimonie. Pour Waltz, la culture, les idées ou même la nature humaine ne jouent qu’un rôle secondaire pour expliquer le comportement des Etats. Ce qui compte c’est la structure du système qui contraint l’action des Etats « qui cherchent à assurer leur survie » (1979, p. 91) 1. Cette structure est premièrement caractérisée par l’état d’anarchie du système international (1979, p. 89), c’est-à-dire l’absence de gouvernement mondial capable de faire appliquer des lois, qui interdit aux Etats de se faire pleinement confiance et les pousse à ne compter que sur eux-mêmes self( help) (1979, p. 105) et à préparer la guerre. Deuxièmement, l’anarchie est caractérisée par l’indifférenciation fonctionnelle des Etats qui, parce qu’ils cherchent à préserver leur indépendance, évitent de dépendre les uns des autres par la division du travail, contrairement à ce qu’affirme la thèse centrale des libéraux (1979, p. 93). Troisièmement,la structure du système international est caractérisée par la répartition des capacités matérielles entre Etats et le nombre de grandes puissances (1979, p. 97). Waltz est donc structuraliste contre les réductionnistes qui partent des caractéristiques particulières des Etats ou desindividus ; et il est matérialiste contre les idéalistes qui accordent le premier rôle aux intentions ou aux représentations. Le néoréalisme produit ainsi une sorte de révolution coperniciennepar rapport aux écoles précédentes. Dans la lignée du Durkheim (1988, p. 194) et de son refus du psychologisme, Waltz (2001, p. 28) place le moteur de l’histoire non pas dans la nature ou la conscience de l’homme, dans ses idées, ses croyances, sa volonté ou le fonctionnement de son cerveau, bref son intériorité, mais bien dans des contraintes structurelles et matérielles qui existent en dehors de la conscience des individus et qui dessinent des intérêts objectifs auxquels les acteurs se plient par une sorte de socialisation stratégique au système (1979, p. 127-128). Les intérêts ainsi définis acquièrent une nette prééminence théoriqueContrairement. aux libéraux qui s’appuient d’une part sur les intérêts économiqueset d’autre part sur le progrès des idées, le néoréalisme ne s’attache qu’à une seule source fondamentale d’explication, les contraintes structurelles, qui déterminent les intérêts et lesidées. Les idées ne sont donc plus des facteurs autonomes mais secondaires. Mais c’est aussi pour cette raison que le néoréalisme est souvent considéré comme statique et incapable de penser lechangement. En effet, alors que les libéraux pensent que le changement vient notamment de l’évolution des idées, qui permettent de passer de la confrontation d’intérêts égoïstes laà coopération, les néoréalistes pensent que les idées ne changent rien à l’affaire et que les Etats instrumentalisent les idéologies au service de leurs intérêts propres et immuables (Waltz, 1979, p. 173). L’intégration, largement postulée par les libéraux, est ainsi à l’inverse difficile à penser dans le cadre du modèle néoréaliste puisqu’il part du principe que les Etats cherchent essentiellement à préserver leur indépendance et leur indifférenciation fonctionnell. Plus généralement, ce n’est pas tant le changement qui intéresse les néoréalistes que « l’uniformité saisissante dans la nature de la vie internationale à travers les millénaires » (1979, p. 66).
L’originalité de l’école constructiviste en relations internationales, qui s’est notamment affirmée à travers les travaux de Wendt (1992 ; 1999), est d’avoir justement tenté d’affronter directement le problème du changement. Wendt remet ainsi en question l’objectivité des effets de l’anarchie imputés par Waltz (1999, p. 105). Pour lui les caractéristiques de l’anarchie sont avant tout déterminées par la culture dominante des acteurs et il en distingue trois types : l’anarchie hobbesienne où les Etats ne se font pas confiance et se voient comme des ennemis (p. 260) ; l’anarchie lockéenne, où les Etats se reconnaissent mutuellement comme souverains mais aussi rivaux (p. 279) ; et enfin l’anarchie kantienne où les Etats forment une communauté d’amis (p. 298) . De façon générale, le constructivisme opère un renversement de perspective par rapport au néoréalisme. Les intérêts ne sont pas le moteur de l’histoire puisque leur perception et leur définition par les acteurs varient en fonction du paradigme culturel dominant. En revanche, les idéessont prééminentes car elles déterminent la culture à partir de laquelle sont définis les identités, les intérêts, les normes, les comportements et finalement les relations sociales. Contrairement aux libéraux qui considèrent idées et intérêts comme des facteurs tonomes,au le constructivisme de Wendt postule que même les intérêts et la force, généralement considérés comme des facteurs matériels, sont des construits culturels (1999, p. 94). Les intérêts sont des idées (p. 114). L’explication des phénomènes sociaux renvoie donc in fine à la diffusion des idées qui déterminent les cultures structurantes. Et ces idées sont le résultat d’un processus d’apprentissage mutuel, les acteurs construisant des définitions partagées au cours de leurs interactions (p. 331). En traitant l’autre de façon égoïste, je le pousse à se comporter en ennemi ; en le traitant de façon bienveillante, je le pousse à se comporter en ami (p. 341). Or, Wendt admet lui-même le caractère « circulaire » dece type d’explication, les pratiques des acteurs sociaux étant déterminées par leur culturet leur culture étant le produit de leurs pratiques (p. 342). Pour expliquer le changement de culture (par exemple le passage d’une culture égoïste et conflictuelle à une culture coopérative), Wendt (p. 343) en revient finalement à des variables largement matérielles, typiques des théories libérales, comme l’interdépendance, le destin commun ou l’homogénéit. Mais il admet également que le fait de dépendre de l’autre (p. 348), de partager son destin (p. 352) ou de lui ressembler (p. 356) ne débouche pas nécessairement sur la coopération t epeut tout aussi bien être source de conflits. Le facteur clef qui complète les trois premiers est finalement pour lui l’auto-contrainte (self-restraint) qui, dans un processus d’apprentissage mutuel, permet de fonder l’identification et la confiance entre acteurs (p. 359-360). Le changement est donc le résultat d’un mélange d’incitations et d’apprentissage, qui ressemble assez au mécanisme de prise de conscience des intérêts communs, classiquement mobilisé par les libéraux. Comme pour les libéraux, c’est en fin de compte l’alliance entre des facteurs matériels et objectifs d’une part (comme l’interdépendance) et des facteurs subjectifs et idéels d’autre part (comme l’identification), qui constitue le moteur du changement social. Le constructivisme général et holiste de Wendt (1999) ne semble donc pas être unesolution plus satisfaisante que le libéralisme car expliquer l’intégration européennen disant que les Européens sont passés d’une culture hobbesienne violente à une culture ka ntienne pacifique relèverait de la pure tautologie. Wendt invoque bien un processus d’apprentissage social mais ce faisant, il caractérise plus qu’il n’explique le changement, puisque cet apprentissage peut s’appuyer sur des incitations comme l’interdépendance, le destin commun ou l’homogénéité mais peut aussi ne pas se produire du tout si les acteurs ne se font pas confiance (1999, p. 357). Or, accorder le rôle décisif à la confiance et à l’auto-contrain te laisse en réalité le problème ouvert car rien ne permet de savoir pourquoi cette confiance et cette auto-contrainte s’établissent à un moment donné plutôt qu’à un autre. Wendt (p. 362) v a même jusqu’à décrire l’engagement de l’Allemagne en faveur de l’unité européenne comme un « sacrifice », ce qui pourrait laisser penser que l’intégration s’appuie sur une action altruiste inexplicable. En définitive, le constructivisme de Wendt, s’il a l’avantage de pose r clairement la question des transformations du système international, ne permet pas d’isoler un mécanisme explicatif ni encore moins de faire des prédictions, si ce n’est par le retour à une téléologie progressiste (Wendt, 2003).
Face au libéralisme qui met en lumière le fonctionnement de l’intégration mais ne peut en expliquer l’origine, face au réalisme classique et au néoréalisme qui, à l’inverse, met en lumière les facteurs qui s’opposent à l’intégration et rendent les relations internationales conflictuelles, et enfin face au constructivisme qui fait le constat que les relations internationales peuvent fonctionner suivant des logiques très différentes, sans parvenir à expliquer le changement, l’enjeu de cette thèse sera de proposer une théorie de l’intégration capable d’expliquer de façon simple et parcimonieus e la transformation du système européen de Munich à Lisbonne. Pour cela, nous nous appuiero ns sur la seule tradition théorique en relations internationales à être largement absente dans le débat en politique européenne, la tradition réaliste. Ce choix peut sembler paradoxalmais il peut s’expliquer pour deux raisons.
D’une part, précisément parce que la théorie réaliste n’a pas été forgéea priori pour rendre compte du phénomène d’intégration mais plutôt pourrendre compte de la permanence de la conflictualité en anarchie et de la difficulté de oopérer,c elle est un bon point de départ pour qui veut attaquer de front le problème de l’intégration, sans l’éluder en postulant un monde déjà pacifié comme les libéraux. Autrement dit, s’il n’est pas difficile pour une théorie de bien rendre compte de l’Europe de Munich (comme le font les réalistes) ou de bien rendre compte de l’Europe de Lisbonne (comme le font les libéraux), il est difficile de tenir les deux bouts de la chaîne à la fois avec un seul et unique modèle. Ainsi, si une théorie réaliste parvient à rendre compte de l’intégration européenne, alors ilsera raisonnable de penser que cette théorie est capable de rendre compte de la totalitédu spectre des systèmes politiques possibles, du plus conflictuel au plus intégré (lestrois anarchies de Wendt). La deuxième raison est que le réalisme demeure à ce jour le paradigme le plus parcimonieux en relations internationales, se fondant uniquement sur les rapports de force matériels au lieu de passer opportunément de la primauté des intérêts économiques à la primauté des idées au gré des difficultés empiriques, comme les libéraux. Or, lafécondité d’une théorie, si elle se mesure à l’ampleur des réalités empiriques dont elle est capable de rendre compte, se mesure également son économie de moyen. Chercher à réduire la dualité entre relations internationales et politique interne à l’aide d’une théorie unique n’a urait aucun intérêt si cette théorie ne faisait elle-même que reproduire en son sein une nouvelle dualité en mobilisant des explications différentes selon les cas. De façon générale nous hercherons donc à développer une théorie qui prenne au sérieux la question du changement ensciences sociales.