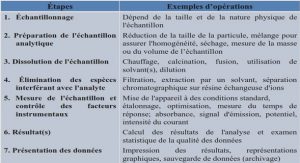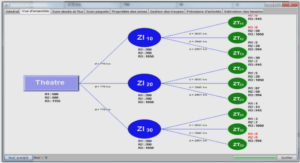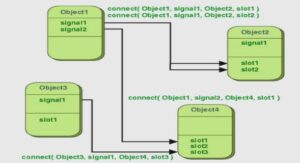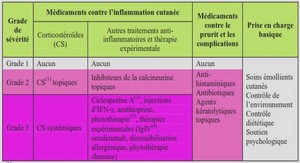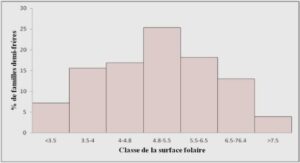QUEL MODÈLE THÉORIQUE POUR LA MÉTAPHORE
Nous avons pu nous en rendre compte à travers les parties qui précèdent : les tensions sont nombreuses entre les différentes théories qui ont cours concernant la métaphore ou le métaphorique, qu’elles prennent pour objet la seule métaphore in absentia ou qu’elles élargissent le champ à toutes les figures d’analogie, voire à tous les tropes, qu’elles définissent notre figure comme substitution ou comme prédication, voire comme rapprochement conflictuel, qu’elles plongent la métaphore dans l’inconscient ou qu’elles se contentent de perpétuer une approche rhétorique classique, ou encore selon les façons dont elles appréhendent son fonctionnement analogique, comme simple jeu de ressemblance ou comme proportionnalité par exemple. Cette nouvelle et dernière partie se propose donc, maintenant qu’un certain nombre d’obstacles théoriques ont été mis en évidence, après avoir en quelque sorte dessiné « en creux » les contours d’une approche différente de la métaphore, de la faire émerger positivement, d’en tirer une épreuve. Ce faisant, il s’agit de réduire la diversité des modèles théoriques rencontrés à travers deux mouvements complémentaires : en écartant les modèles qui apparaissent mal fondés, bien entendu, mais aussi en essayant de dégager l’unité des approches plus pertinentes, de les concilier autant que possible. Il s’agit donc de proposer un modèle qui puisse rendre compte à la fois de la diversité des usages de la notion et de l’unité du phénomène, sans céder le moins du monde aux travers que nous avons pu relever. 4.1. Par delà le verbal et le non verbal À la liste des différents modèles théoriques qu’il importe d’articuler, il convient évidemment d’ajouter ceux de la métaphore linguistique et iconique ou, plus précisément, pour ce qui nous concerne, cinématographique. D’un côté, le sentiment s’impose assez largement en effet qu’il est légitime de parler de métaphore au cinéma mais, de l’autre, sans même parler du soupçon récurrent sur la possibilité d’une métaphore visuelle, le problème demeure de savoir s’il s’agit exactement de la même figure. Dans quelle mesure pouvons-nous employer le même terme pour désigner l’ensemble de ces phénomènes, aussi voisins qu’ils paraissent de prime abord ? Malgré les éléments de réponse déjà esquissés, cela mérite de retenir encore notre attention. Sur la question d’une métaphore étroitement soumise au linguistique
Problème du décalque et pertinence du rapprochement avec la métaphore au cinéma
Le problème se pose de façon récurrente. Guillaume Soulez, dans Quand le film nous parle, indique par exemple l’accord très large, de Christian Metz à J. Aumont et J. Gerstenkorn, pour à la fois étendre l’interrogation rhétorique au cinéma et y refuser le « décalque » terme à terme des traditionnelles figures de rhétorique. Il semble bien alors que « l’objet d’étude devient le passage d’une forme à l’autre, la migration des formes ».3 Les scrupules sont de mise en effet. Par souci de rigueur, lorsque ces auteurs se penchent sur la question de la figure en général et, pour Christian Metz et Jacques Gerstenkorn, sur la métaphore en particulier, aucun ne prétend vraiment fondre dans un tout unique leur forme littéraire et cinématographique. Dans La Métaphore au cinéma, comme le relève Guillaume Soulez, l’auteur « abandonne immédiatement la métaphore comme figure au profit de “la dynamique visuelle de la ʿressemblanceʾ ” ». Il en va de même pour Christian Metz, qui signale que la définition traditionnelle de la métaphore ou de la comparaison ne peut convenir pour appréhender les ouvriers-moutons des Temps modernes, qu’il faut élargir le cadre, se défaire du « privilège du mot » et préférer « les grands types de trajets symboliques ».4 Pour autant, il me frappe que les exemples de Metz et plus encore de Gerstenkorn ressemblent de très près, la plupart du temps, au champ couvert par la rhétorique classique. L’idée n’est pas morte de trouver des « équivalents » même s’il ne s’agit pas, chez l’un comme chez l’autre, de reconduire la taxinomie précédemment adoptée pour la rhétorique verbale mais plutôt de l’adapter. Les élargissement notionnels proposés, s’ils sont suivis d’effets, expliquent imparfaitement le choix des exemples notamment et ceux-ci à l’inverse ne recouvrent pas complètement le champ ouvert par les auteurs, à savoir les « poussées » signifiantes, « métaphoriques » ou « métonymiques », d’inspiration lacano-jakobsoniano-freudienne chez Metz et le « travail de la ressemblance » chez Gerstenkorn. Dans La Métaphore au cinéma par exemple, même si un certain nombre de cas étudiés me semblent à la frontière de ce que j’appellerais le métaphorique, comme certaines « syllepses » chapliniennes où la ressemblance ne fait pas forcément sens – du moins à la façon d’une métaphore, où il y a une intention, une volonté d’asserter particulière – la majorité reste dans l’aire de la figure d’analogie : les cas d’analogies purement formelles étudiées par le groupe µ dans le Traité du signe visuel ne ressortissent pas vraiment à l’étude de Gerstenkorn.5 Du sens entre en jeu, même si c’est parfois d’une façon plus large, qui correspond à la notion d’analogie adoptée. En fait, les exemples restent marqués par une compréhension intuitive des figures de rhétorique, celle-là même qui a pu leur donner une relative consistance et stabilité depuis l’Antiquité, malgré la grande approximation de leurs définitions. C’est même là, à mon sens, le grand mérite de l’ouvrage : malgré le choix inaugural de conserver une part de la tradition rhétorique sans en faire le fastidieux inventaire, choix qui fait peser le risque d’en reproduire les errements, ce que l’auteur perçoit bien et souligne plaisamment, au tout début de la première partie, avec la métaphore de l’ornithorynque, la logique profonde de son travail n’est pas là. Il s’agit de souligner l’importance écrasante du fait métaphorique au cinéma, ses formes nombreuses et multiples – qu’elles recoupent ou non celles de la tradition rhétorique – et de convaincre de sa richesse, en l’occurrence au cinéma, par de nombreux exemples. Aussi les « grandes classes d’analogies » relevées dans la première partie, où l’on peut reconnaître une inspiration rhétorique « classique » par moments, par exemple avec les métaphores du premier chapitre, in absentia d’abord puis mixtes, partiellement in praesentia, ou avec les syllepses du second chapitre, puis avec les jeux d’échos, clairement in praesentia, ces grandes classes ne doivent-elles plus grand chose, finalement, aux divisions traditionnelles. Elles s’articulent assez difficilement avec elles parce que leur but est ailleurs : il s’agit avant tout d’élargir le champ de perception du phénomène métaphorique, comme chez Metz, mais sur la base cette fois d’une grande attention aux moyens d’expression cinématographiques – l’auteur du Signifiant imaginaire cite très peu d’exemples dans son ouvrage. Dans cette perspective, où la diversité des formes métaphoriques au cinéma est pleinement mise en valeur, seul le vocabulaire gêne parfois, l’idée de « greffe » métaphorique par exemple là où, à mon sens, rien n’est ajouté, où le comparant est certes fondu dans le comparé mais où l’un ne préexiste pas forcément à l’autre, où les deux sont souvent saisis dans le même mouvement, vocabulaire qui reconduit par moments la conception substitutive alors qu’elle n’irrigue pas les analyses en profondeur. Le projet très concret de Gerstenkorn est donc bien de révéler une correspondance profonde entre la métaphore linguistique et cinématographique. Et cette dimension-là aussi apparaît nettement, dès le début de La Métaphore au cinéma, à côté du danger d’un possible décalque : « les métaphores filmiques méritent bien d’être reconnues comme telles », pouvons-nous lire en effet, « malgré [les] amorces plus ou moins développées de mises en syntagme », c’est-à-dire leur caractère paradigmatique moindre, leur faible dimension in absentia, « et en dépit de tout ce qui les distingue de leurs homologues linguistiques ». Dès les premières occurrences étudiées, l’auteur propose ainsi le pari d’un phénomène unique malgré des réalisations différentes, en indiquant en l’occurrence que « le moment métaphorique ne peut être dissocié du contexte et la mise en paradigme [au cinéma] n’est jamais aussi “pure” que pour une métaphore verbale. » 6 De même, dans la seconde partie de l’ouvrage, Jacques Gerstenkorn souligne-t-il « l’importance des relations analogiques » dans les films, c’est-à-dire du métaphorique, et il dénonce ce qui a pu l’occulter, à savoir « l’idée reçue d’une impossibilité de signifier l’analogie autrement qu’à l’aide d’outils verbaux. » 7 Il y a donc bien des métaphores au cinéma, et l’on peut dire, d’une certaine façon, qu’elles ne passent pas par les mots.
La structure métaphorique « profonde »
Quoi qu’il en soit de ce dernier point, qui nous éloigne un peu de mon propos principal, il convient de souligner cette interaction, qui se produit dans la métaphore comme dans l’image, entre du verbal et du non verbal, même s’il ne s’agit plus ici du linguistique et de l’iconique mais du langage et d’une structure qu’on pourrait dire sémiotique et qui se révèle en large partie indépendante de la substance d’expression. C’est évidemment ce niveau « profond » de la métaphore, qui affleure dans le verbal comme dans l’iconique, qui s’inscrit dans le roman comme dans le film, qui invite à utiliser les catégories freudiennes pour appréhender la métaphore. Seulement, si cette approche a sa pertinence, si Christian Metz a raison de souligner qu’on peut appréhender la figure d’analogie comme témoignant de processus primaires, elle change de nature lorsqu’elle est ressaisie par une conscience, à la façon, comme on l’a vu, du mot d’esprit. C’est pourquoi il faut distinguer fermement la structure « profonde » de la métaphore, qui n’est autre que la saisie réfléchie d’une ressemblance, que son élaboration au sein d’un système qui reste en partie implicite, de la simple ressemblance « formelle » proposée par l’inconscient : elle est beaucoup moins profonde que ces jeux « paronymiques » sur la plasticité du langage et des images où l’on voit souvent une trace du travail « primaire ». Comme première approximation, pour donner une idée de cette analogie impliquée dans le texte ou dans le film, on peut se souvenir de l’analogie au sens proportionnel d’Aristote. Qu’il reste quelque chose du lapsus dans la métaphore, comme le signale joliment Metz, que « quelque chose de plus fort » fasse irruption à travers le mot « gerbe » dans « Booz endormi » et fasse comme « un trou » dans l’« étoffe » de la phrase initialement visée, cela n’empêche pas que le « trou » est resté, que Hugo a accepté « la structure [du] lapsus », que le poème réconcilie la « poussée » inconsciente avec des impératifs non seulement syntaxiques (le fameux « sa » devant « gerbe ») mais aussi logiques et poétiques – qu’il récupère cette poussée et qu’il la transfigure.23 Dans les vers, l’analogie change donc de nature : le parallélisme se construit, jusque dans son paradoxe. Ce simple fait du parallélisme suffit à indiquer la nouveauté radicale de la métaphore par rapport à la « poussée » initiale : si l’on veut se représenter la figure d’analogie, c’est en quelque sorte sur une double portée qu’il faut l’inscrire. Elle est constituée par une double ligne dont les différents termes sont liés un à un, au prix parfois d’un fort paradoxe, certes, mais dans une structure qui, si elle se donne comme une « représentation de choses », si elle associe des objets de pensée entre eux, n’en est pas moins sous-tendue par une « représentation de mots ». Il suffit de penser, pour visualiser cette structure, au schéma déjà employé à propos de « la coupe d’Arès » : il peut s’appliquer à toutes les sortes de métaphores. Pour la commodité, prenons un exemple dont les termes, nombreux, sont explicites. Soit le paragraphe suivant, avant le passage le plus fameux de René de Chateaubriand : Comment exprimer cette foule de sensations fugitives que j’éprouvais dans mes promenades ? Les sons que rendent les passions dans le vide d’un cœur solitaire ressemblent au murmure que les vents et les eaux font entendre dans le silence d’un désert ; on en jouit, mais on ne peut les peindre.24 On pourrait représenter l’analogie ainsi : les sons [faibles] les passions le vide un cœur solitaire sont comme : le murmure les vents et les eaux le silence un désert Il serait possible de commenter longtemps toutes les significations qui se déploient à partir d’une telle image. Il est rare qu’en si peu de mots nous soient donnés tant d’éléments clefs d’une analogie. Pour ne relever qu’un trait, je me suis permis de restituer la signification « sons faibles » à partir de « murmure », parce qu’il me semble que c’est le seul élément resté un peu implicite dans « l’équation » posée par Chateaubriand, mais on peut noter que cette omission même est significative. D’abord, c’est peut-être la signification principale, de premier plan, proposée par la métaphore, la plus explicite lorsque le narrateur qualifie de « murmure » les sons en question – la perception du sens des autres rapprochements est laissée à la libre appréciation des lecteurs, qui peuvent ne pas faire retour sur la phrase et se contenter de cette première attribution sommaire, ne pas s’interroger par exemple sur la ressemblance entre les passions et l’élément liquide ou aérien. D’ailleurs, c’est ce trait-là qui permet de comprendre rapidement les deux phrases qui encadrent cette métaphore : on ne peut « exprimer » ou « peindre » le vague des passions parce que l’impact de celles-ci est apparemment faible, il est quasiment imperceptible (doublement, d’ailleurs : il est non seulement très léger mais aussi, comme son, invisible, impossible à figurer). Il est alors possible d’aller plus loin, de s’interroger sur cet étrange son qu’on ne peut « peindre », et c’est tout un paysage désolé qui apparaît, même sans penser à la suite trop connue du texte : le son est faible mais il n’est pas inexistant puisque « le silence » du « désert » n’est lui-même pas complet, entrecoupé qu’il apparaît du « murmure » de l’eau qui ne peut chuter comme dans une cascade et du vent qui ne peut hurler dans les branches des arbres ou dans les toits, qui ne rencontre pas d’obstacles. C’est donc pourquoi on ne peut brosser le tableau des passions de René : on ne peut les visualiser comme le permettrait un paysage de montagne ou ne serait-ce qu’un bocage, avec des arbres soumis aux éléments. Les landes sont vides à l’intérieur plus encore qu’à l’extérieur : rien n’arrête le vent, l’eau, de même que ces passions qui tournent en rond, sans rencontrer d’obstacle dans le cœur solitaire. Je n’insiste pas davantage : nous constatons une fois de plus que la prolifération « syntagmatique » favorisée par la métaphore est considérable. Nous voyons par ailleurs que l’analogie posée plus haut est encore incomplète puisqu’on pourrait y ajouter la métaphore du tableau impossible (« exprimer » d’un côté, « peindre » de l’autre), sans compter ces passions sans objet qui font du cœur d’un homme ainsi dépossédé le simple réceptacle de feuilles mortes soumises aux caprices du vent, que rien n’arrête… Nous pouvons observer, quoi qu’il en soit, que la métaphore est bien constituée de ces couples d’idées qui tissent un réseau plus ou moins dense de significations selon les cas.