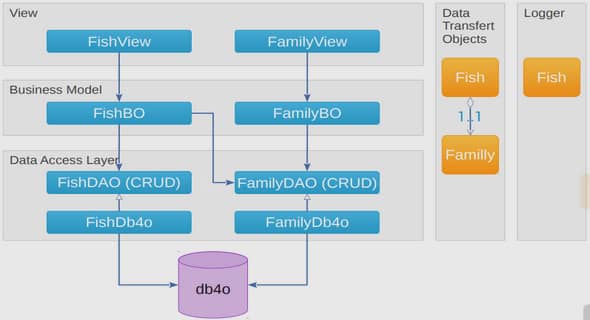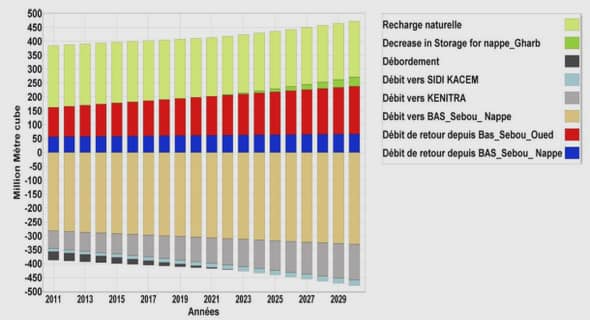Recension des écrits sur l’efficacité thérapeutique
Bien que les processus de changement en thérapie aient constitué un sujet d’intérêt menant les cliniciens et chercheurs à se questionner, les recherches sur l’efficacité des thérapies n’ont réellement commencé qu’à partir des années trente et celles concernant l’évaluation des changements produits en cours de thérapie ont débuté en 1970 (Lambert & Ogles, 2004).
Certains auteurs, notamment Eysenck (1952), Prioleau, Murdock et Brody (1983), avaient présenté des résultats qui mettaient en doute l’efficacité des psychothérapies. C’est en se penchant à nouveau sur la question que d’autres chercheurs ont décelé des erreurs méthodologiques et que les faits ont pu être rétablis (Lambert & Ogles, 2004; Lambert, 2013; Lipsey & Wilson, 1993 ; McNeilly & Howard, 1991). À l’heure actuelle, beaucoup de données de recherche se sont accumulées et ont démontré de façon formelle que les effets de la thérapie s’avèrent supérieurs à l’effet placebo (Barker, Funk, & Houston, 1988 ; Lambert, 2010, 2013; Lambert & Ogles; Wampold, 2001) et que l’effet placebo se montre supérieur à l’absence de traitement (Barker & al., 1988 ; Lambert, Shapiro, & Bergin, 1978; Lipsey & Wilson; Shapiro & Shapiro, 1982, 1983 ; Smith & Glass, 1977; Smith, Glass, & Miller, 1980; Wilson & Rachman, 1983). Ainsi, grâce à l’abondance des études et méta-analyses portant sur le sujet et à l’amélioration des méthodes de recherche, il est maintenant établi, et cela, sans équivoque, que la thérapie est avantageuse pour nombre de patients (Lambert; Lambert & Ogles; Lipsey & Wilson).
Les écrits scientifiques démontrent aussi que non seulement les traitements offrent des bénéfices rapidement (Gullo, Lo Coco, & Gelso, 2012; Howard, Kopta, Krause, Merton, & Orlinsky, 1986; Kadera, Lambert, & Andrew, 1996; Lambert, 2013), mais que ceux-ci tendent à se maintenir à long terme (Emmelkamp & Powers, 2010; Lambert & Ogles; Lambert, 2013; Shedler, 2010) chez les participants qui ont collaboré aux collectes de données posttraitement, et ce, pour tous les types de traitement (Marchand, Roberge, Primiano, & Germain, 2009; Sherman, 1998; Taylor 1996).
Lambert et Ogles (2004) mentionnent que 40 % à 70 % des patients tirent bénéfice de la thérapie. Ces mêmes auteurs avancent que 50 % des individus évalués dysfonctionnels au départ retrouvent un niveau de détresse moindre et des changements significatifs à l’intérieur de 21 sessions de psychothérapie (Lambert & Ogles,; Lambert 2013). Dès lors, ces résultats démontrent que la thérapie est efficace pour nombre de personnes. Il reste maintenant à mieux connaître les facteurs associés à cette efficacité et à identifier les variables clés.
Variables associées à l’efficacité. L’efficacité thérapeutique a donc fait l’objet de nombreuses recherches dont la majorité convergeait vers un constat en faveur de l’efficacité. Plusieurs chercheurs se sont demandé à quoi associer ces résultats et ont tenté de mettre en lumière les variables associées à l’efficacité des thérapies (Greenberg & Pinsof, 1986; Horvath & Greenberg, 1989; Lambert, 1992; Lambert & Asay (1999); Shapiro & Shapiro, 1982, 1983; Wampold, 2001). Ces recherches ont permis d’identifier de nombreuses variables reliées à l’efficacité thérapeutique. Lambert et Asay estiment que 40 % de l’efficacité thérapeutique est attribuable à des facteurs associés au patient. La relation thérapeutique offre une contribution évaluée à 30 % alors que les attentes du patient et l’approche utilisée contribuent pour 15 % chacune à l’efficacité thérapeutique (Lambert; Lambert & Asay).
Lambert et Bergin (1994), pour leur part, classifient les variables en trois grandes catégories : les variables du patient, les variables issues de l’approche utilisée par le thérapeute et les variables du thérapeute. Parmi les variables du patient, la motivation apparaît être un facteur important, de même que l’implication du patient dans la thérapie, sa contribution à l’alliance thérapeutique ainsi que le motif de consultation. Les variables reliées aux approches comprennent la durée de la thérapie, le contrat concernant les buts à atteindre, les protocoles de traitement et la technique utilisée en fonction de la problématique du patient. Parmi les variables du thérapeute, il y a, par exemple, la capacité du thérapeute à utiliser les habiletés propres à la psychothérapie, ses aptitudes à entrer en relation, etc.
Introduction |